L’Embarras des langues
Jean-Claude Corbeil
Je dédie ce livre aux enfants de la loi 101 qui n’ont pas connu l’époque où la langue française était, au Québec, une langue de seconde zone dominée par la langue anglaise, dans l’espoir qu’ils reprennent à leur compte l’avenir d’un Québec de langue et de culture françaises.
Et à la mémoire d’Ariane Archambault qui a accompagné la conception de ce livre pendant des années et qui aurait été si heureuse de le voir paraître.
Préface
J’ai rencontré Jean-Claude Corbeil pour la première fois en 1996. Je savais cependant déjà qu’il avait été l’un des acteurs importants de la grande aventure linguistique des années 1960 et 1970 auxquels nous devions les premières réflexions et les premiers rapports à l’origine du mouvement qui a conduit à l’adoption, en 1977 par l’Assemblée nationale du Québec, de la Charte de la langue française. Je connaissais sa participation très active aux travaux de la commission Gendron (1968-1973). Je savais aussi qu’en tant que directeur linguistique de l’Office de la langue française, il avait exploré les principaux thèmes d’une politique linguistique qui pourrait avantageusement succéder à la loi 63, notamment la langue de travail, l’affichage public, les raisons sociales, l’emploi du français dans le commerce et les affaires. Ces travaux exploratoires avaient servi de base à la rédaction de la Loi sur la langue officielle (1974). Par la suite, à l’instigation de Camille Laurin et sous la responsabilité des sociologues Guy Rocher et Fernand Dumont, il avait collaboré à la préparation du livre blanc sur La politique québécoise de la langue française et à la rédaction du projet de loi 1, devenu par la suite la loi 101.
Jean-Claude Corbeil avait quitté la fonction publique depuis 1991 et il était alors intensément engagé dans le monde de l’édition quand, en 1996, à titre de ministre responsable de l’application de la Charte de la langue française, je lui ai demandé d’accepter de préparer une nouvelle Proposition de politique linguistique que le gouvernement du temps souhaitait soumettre à la consultation publique. C’est ainsi qu’a commencé une étroite collaboration qui a duré quatre ans. Dans cette proposition intitulée « Promouvoir l’usage et la qualité du français, langue officielle et langue commune du Québec », on trouve clairement exposés les principes au cœur de la pensée de Jean-Claude Corbeil, principes que, d’entrée de jeu, j’ai fait miens : la langue française est au centre de l’identité québécoise, la langue française est le fondement de la cohésion de la société québécoise, les apports de toutes les minorités à la société québécoise sont une richesse et un avantage, la connaissance d’autres langues est un enrichissement personnel et, enfin, l’approche législative doit être complétée par une approche sociale et une approche de concertation internationale. Cette idée de concertation internationale pour mieux maîtriser les nouvelles technologies en français et pour permettre l’élaboration d’une stratégie en faveur du plurilinguisme était alors relativement neuve. Elle portera des fruits et suscitera des développements extrêmement porteurs en faveur de la diversité culturelle et linguistique.
En 1997, je propose à Jean-Claude le poste de sous-ministre associé à l’application de la politique linguistique. Les trois années qui ont suivi ont été intenses, agitées même, sur le front linguistique. Il y eut plusieurs crises très médiatisées : attaques de Howard Galganov et d’Alliance-Québec[1] contre l’existence même de la loi 101, tentatives de rebilinguiser l’affichage interne dans les grands magasins du centre-ville de Montréal, multiplication des causes portées devant les tribunaux, résistance dans le quartier chinois à la nécessaire prédominance du français, échange de correspondance aigre-douce avec Maurice Druon, secrétaire perpétuel de l’Académie française, au sujet de la féminisation chère aux Québécoises, etc. Dans tous ces dossiers, pour gérer toutes ces situations délicates, la présence de Jean-Claude à mes côtés s’est révélée inestimable. Non seulement a-t-il toujours été de bon conseil, mais il s’est personnellement investi en acceptant, par exemple, de jouer les médiateurs dans le quartier chinois.
Outre la proposition de politique linguistique, Jean-Claude Corbeil a participé à la rédaction de deux autres documents importants : le rapport du Groupe de travail interministériel chargé de situer le dossier linguistique dans la perspective des années 2000 et celui de la Commission des États généraux sur la situation et l’avenir de la langue française au Québec rendu public en 2001. Sans oublier la conception des amendements apportés à la Charte de la langue française pour la moderniser dans un secteur qui lui tenait à cœur, celui des nouvelles technologies.
Comme l’auteur l’explique dans son introduction, l’idée de ce livre lui est venue à la suite d’une conférence prononcée devant les étudiants du Département de linguistique et de traduction de l’Université de Montréal en mai 2004. Cette idée s’est renforcée dans son esprit tout au long des années suivantes. En 2006, il faisait l’essai du contenu d’un éventuel ouvrage lors d’un séminaire sur la politique linguistique québécoise au programme de la session d’hiver du même département.
Non seulement les nouvelles générations, celles des enfants de la loi 101, lui seront reconnaissantes de combler un grand vide en retraçant l’histoire et l’évolution de la politique linguistique québécoise, mais aussi – et ils sont nombreux – le remercieront tous ceux qui se préoccupent de l’avenir de notre nation majoritairement francophone en Amérique du Nord. Personne n’était mieux placé que lui pour nous faire comprendre les origines, les hauts et les bas, les grandeurs et les misères, les enjeux passés et actuels de la politique linguistique en la situant d’emblée, comme elle doit l’être, dans un contexte qui dépasse largement la question de la langue elle-même, voire la portée d’une loi, si structurante soit-elle.
L’intérêt principal de ce livre réside ainsi, de mon point de vue, dans l’ampleur du propos de Jean-Claude Corbeil. Il décrit minutieusement la fascinante histoire de la politique linguistique du Québec en prenant en compte toutes les dimensions qu’elle doit englober pour être efficace. Il nous raconte, bien sûr, l’évolution des lois, mais il s’interroge aussi des effets, sur les immigrants, des deux modèles concurrents d’intégration, le canadien et le québécois. Il examine les conséquences de la mondialisation et se demande si la volonté des citoyens de se mobiliser pour maintenir le français bien vivant au Québec est toujours présente. Il aborde, enfin, de front, la question de la qualité de la langue, parlée et écrite. Tous ces éléments sont importants et en interrelation : il en fait une analyse remarquable.
L’on comprend mieux en fermant ce livre pourquoi le gouvernement du Québec a dû intervenir dans le dossier linguistique, comment il l’a fait et en quoi la politique linguistique est toujours d’actualité. À la toute fin, Jean-Claude Corbeil affirme, avec raison, que « la source de la pression sur la langue française s’est déplacée ». Il précise : « Ce n’est plus comme à l’époque de l’adoption de la Charte de la langue française, la force économique de la minorité anglophone, mais celle de la langue anglaise comme langue internationale. » Voilà abordé un dernier point fondamental : celui de l’avenir de la langue française comme grande langue de communication dans le monde. Comment faire en sorte que le français figure encore parmi les dix premières langues internationales alors que son statut est déjà affaibli et que le nombre de ses locuteurs est en croissance moindre que celle des locuteurs d’autres langues? En effet, si aujourd’hui on ne peut parler de débandade dans les grandes organisations internationales, on constate tout au moins un recul du français, une situation qui se dégrade. C’est moins le statut officiel du français qui est mis en cause que les pratiques linguistiques au sein de ces organisations, qui évoluent sensiblement vers un unilinguisme de fait, motivé souvent par des considérations budgétaires ou par un prétendu souci d’efficacité. Que ce soit aux Nations Unies, à New York ou à Genève, ou encore à Bruxelles, siège des institutions européennes, la tendance au « tout à l’anglais » est identique. Mais pourquoi tenter de renverser cette tendance, pourquoi résister à une hiérarchisation des langues, l’anglais comme langue des affaires, de la modernité et même de la diplomatie, le français et les autres langues comme langues de rayonnement culturel et de la vie quotidienne? Parce que, notamment, aucune langue ne peut prétendre exprimer à elle seule la complexité de la réalité, fût-elle celle d’une nation hyperpuissante, et surtout, parce qu’il y a des coûts bien réels à la suppression du plurilinguisme. S’il y a une leçon que nous pouvons tirer de l’expérience québécoise, c’est celle de la nécessaire utilité, de la nécessaire rentabilité économique d’une langue, de son nécessaire prestige auprès de ses locuteurs pour qu’elle demeure une langue d’avenir. La colonisation linguistique n’est pas plus acceptable que tout autre type de colonisation et mène d’ailleurs au même résultat : langue dévaluée, chute de l’estime de soi, atrophie de la vitalité d’expression dans les domaines de la science et de la technologie, vitalité compromise en informatique qui entraîne un déficit de logiciels courants en de multiples langues, vitalité de création amoindrie dans le secteur culturel, notamment en cinéma et en télévision. Là aussi, le Québec peut servir d’exemple : l’adoption de la Charte de la langue française en 1977 nous a donné confiance en nous-mêmes et a contribué à changer notre psychologie de perdants, qui nous collait à la peau depuis deux siècles.
Comment dès lors sauvegarder la vocation internationale du français? Le Québec peut agir et prendre des initiatives, mais seulement, comme le souligne Jean-Claude Corbeil, en coulisse, puisqu’il n’est pas présent lui-même dans les instances internationales, en convainquant des États souverains du bien-fondé de ses arguments en faveur du plurilinguisme. C’est de cette manière qu’il a agi lors du débat sur la diversité culturelle tenu à l’UNESCO, d’où a émané une Convention internationale qui sera mise en œuvre cette année. Par contre, le Québec est membre de l’Organisation internationale de la Francophonie et il entretient avec la France des relations intenses, directes et privilégiées. Cet atout, il doit s’en servir pour que la Francophonie, dont c’est une priorité affirmée, joue son rôle avec encore plus de détermination et pour que la France comprenne qu’il y va de son intérêt. Déjà, sous l’impulsion en partie du Québec, la Francophonie a mis sur pied un programme massif d’apprentissage du français pour des milliers de fonctionnaires de l’Union européenne et a fait adopter, après d’âpres discussions, lors de son dernier sommet tenu à Bucarest en Roumanie, en septembre dernier, un vade-mecum énumérant de façon précise les obligations de chaque pays membre quant à l’usage du français dans les enceintes internationales.
La diversité linguistique, rappelons-le en terminant, constitue un enjeu stratégique aussi important que ceux de la biodiversité, des changements climatiques ou de la sécurité. C’est en l’affirmant et en l’affermissant que les institutions internationales refléteront vraiment leur caractère multilatéral. La situation de la langue française au Québec, paradoxalement forte et fragile à la fois, comme le démontre Jean-Claude Corbeil tout au long de cet ouvrage, est le microcosme de la langue française dans un monde où défendre le français équivaut à défendre toutes les autres langues.
Louise Beaudoin
Ancienne ministre responsable de l’application de la Charte de la langue française (1995-2001), aujourd’hui professeure associée au Département de science politique de l’Université du Québec à Montréal (UQAM)
Introduction
À l’origine de ce livre, il y a le reproche scandalisé d’une étudiante de traduction du Département de linguistique et de traduction de l’Université de Montréal. Une collègue, Monique Cormier, m’avait invité à expliquer à ses étudiants, surtout des étudiantes d’ailleurs, l’origine de la politique linguistique québécoise. C’était en mai 2004. J’avais esquissé les grandes lignes de la situation de la langue française d’avant les lois linguistiques[2] et évoqué les événements qui avaient poussé les gouvernements à les concevoir et à les faire adopter. Les questions des étudiants, d’abord rares puis de plus en plus nombreuses, révélaient chez eux une ignorance complète de ces choses, qui me surprenait beaucoup, tant, au contraire, elles étaient demeurées présentes à mon esprit et à l’esprit des gens de ma génération, du moins avais-je cette illusion. Je suppose qu’en mauvais joueur de poker, je n’avais pas caché ma surprise. À la sortie du cours, une étudiante me dit, sur un ton sans réplique : « C’est de votre faute si on ne sait rien! Personne ne nous en a jamais parlé et vous n’avez rien écrit sur le sujet! » Je n’ai pas protesté, elle avait parfaitement raison. Les collègues et moi, et tous les autres spécialistes, nous avions publié des articles et des livres savants sur tous les aspects de l’évolution de la situation de la langue française à la suite de l’application de la Charte de la langue française, mais rien pour vulgariser l’origine, les principes et les objectifs de cette loi et de la politique linguistique dont elle n’est que l’élément principal. Nous ne nous étions pas préoccupés de transmettre à ceux qui nous suivaient les raisons de veiller au grain. La protestation de cette étudiante m’est restée en tête. L’année universitaire suivante, toujours à l’instigation de la même collègue, le Département de linguistique et de traduction m’invitait à présenter un séminaire sur le sujet. J’en ai profité pour cesser d’être un linguiste savant (!) pour plutôt revenir au point de départ, à l’origine de la politique linguistique québécoise, et à l’essentiel, ses raisons d’être, qui demeurent, à mon avis, toujours d’actualité.
Ce fut le banc d’essai du contenu de ce livre, qui paraît 30 ans après la promulgation de la Charte de la langue française. Je le destine au grand public, tout particulièrement à ceux et à celles que l’on appelle les enfants de la loi 101. Sont inclus dans ce groupe tous les adultes qui ont aujourd’hui entre 30 et 50 ans, tous leurs enfants et tous les immigrants récents. Les Québécois, francophones, anglophones et allophones de ces tranches d’âge n’étaient pas nés ou étaient très jeunes ou n’étaient pas au pays au moment de la Révolution tranquille (1960), et ils n’ont pas vécu les débats autour de l’adoption des premières lois linguistiques, la Loi pour promouvoir la langue française (loi 63, 1969), la Loi sur la langue officielle (loi 22, 1974) et la Charte de la langue française (loi 101, 1977).
Mes intentions sont ambitieuses, mais sans prétention.
En premier lieu, raconter comment et grâce à qui les Canadiens français[3], à partir surtout des années 1950, ont pris collectivement conscience de leur situation, et de celle de leur langue, face à l’oligarchie anglophone et à la prédominance de leur langue dans la vie économique et politique du Québec et du Canada.
En deuxième lieu, suivre à la trace la formation, chez les francophones, d’une opinion publique qui acceptait de moins en moins cet état des choses, qui a réclamé ensuite que leur situation et celle de leur langue s’améliorent et qui a fini par comprendre que rien ne changerait à moins que le gouvernement n’intervienne. La question de la langue a ainsi cessé d’être strictement linguistique pour devenir politique. À partir de ce moment et jusqu’à nos jours, le débat sur la langue a eu deux visages, l’un, législatif et politique, l’autre linguistique, la qualité de la langue parlée et écrite au Québec.
En dernier lieu, faire le point sur l’actualité du dossier linguistique, dire où le Québec en est et évaluer ce qui m’apparaît être déficient dans la politique actuelle, en ce qui a trait à l’efficacité relative de la législation linguistique et de la politique d’immigration et à la qualité de la langue sous ses deux aspects les plus stratégiques, l’enseignement de la langue française et la description de l’usage québécois de cette langue.
Par-dessus tout, je suis convaincu que le plus nécessaire aujourd’hui, ce n’est pas de faire constamment le bilan de la loi 101. Le plus urgent, c’est que les citoyens québécois reprennent à nouveau l’initiative et la responsabilité du dossier linguistique, qu’une opinion publique vigilante se manifeste, qu’on reprenne tous en main le projet d’une société québécoise de langue et de culture françaises, capable d’intégrer de nouveaux membres, mais sans se trahir, dans le respect d’elle-même et des autres.
La plupart des thèmes abordés ici sont litigieux. Chaque fois que le sujet s’y prêtait, j’ai pris soin de décrire en premier lieu l’événement ou le contenu d’une loi ou d’une politique et ensuite seulement d’en faire le commentaire, dans une tentative de distinguer ce qui est objectif de ce qui est commentaire subjectif de ma part. Il y aura certainement des personnes qui ne seront pas d’accord avec ces commentaires ou cette manière de relater les événements. Tant mieux si ce livre fait renaître le débat sur l’un des aspects du dossier de la langue, ce qui contribuerait à le sortir des limbes médiatiques où il est maintenant et à réveiller une opinion publique plutôt apathique.
D’une époque à l’autre, l’expression politique linguistique n’a pas désigné la même idée.
Avant la crise de Saint-Léonard (1968), les Canadiens français en étaient arrivés à exiger des gouvernements du Canada et du Québec qu’ils interviennent, l’un et l’autre, dans le dossier linguistique, soit pour préciser le statut du français au Canada et dans l’administration publique fédérale, soit, au Québec, pour modifier la dynamique de la concurrence entre la langue anglaise de la minorité et la langue française de la majorité. On demandait aux gouvernements d’adopter des politiques linguistiques, entendant par là qu’ils prennent l’un et l’autre, dans leurs sphères de compétence, des mesures pour modifier le statu quo linguistique, des mesures que l’on souhaitait significatives, efficaces, au besoin coercitives, mais sans les décrire ni entrer dans le détail.
Avec la Loi sur les langues officielles du Canada et la loi 63 au Québec, ces mesures ont pris la forme d’une législation linguistique. La loi 63 s’est mué en loi 22 et en loi 101. L’attention s’est alors concentrée uniquement sur le texte de loi, sa conception, son adoption, son efficacité, sa contestation devant les tribunaux, son évolution. À partir de ce moment et jusqu’à maintenant, on a confondu la législation et la politique linguistiques, sans s’aviser que le concept de politique linguistique est plus vaste puisqu’il englobe tous les autres modes d’intervention d’un gouvernement ou d’une institution dans les questions de langue, que ce soit par loi, par règlement ou par simple pratique administrative. Le volet législatif a ainsi relégué au second plan l’immigration et l’enseignement de la langue, qui sont des aspects tout aussi stratégiques de la politique linguistique. La question de la qualité de la langue paraît même toujours sans grande importance sociale, puisqu’elle échappe à tout contrôle institutionnel et qu’elle prend sa source dans le comportement linguistique des locuteurs de la langue, comme individus et comme membres de la communauté. Elle met pourtant en cause l’enseignement de la langue française sous l’autorité du ministère de l’Éducation et la conception que la société se fait de la norme linguistique. La relation entre ces deux points est très étroite, puisque le rôle du Ministère est, en principe, de transmettre aux enfants la connaissance de la langue standard dont ils devront faire usage par la suite dans leur vie adulte.
Le titre de ce livre exige un commentaire.
À dessein, j’ai utilisé le mot embarras, malgré la mauvaise réputation que lui vaut son sens concret d’obstacle qui entrave la circulation, les embarras de la route, par exemple. Ce mot suggère aussi, au figuré, à la fois l’idée d’un choix entre les langues parlées et utilisées au Québec, qui toutes ont leur raison d’être et leurs avantages et qui sont toutes des sources potentielles d’enrichissement, mais un choix difficile à faire selon les circonstances, d’où l’idée d’un malaise causé par la relation délicate, parfois même épineuse, entre les langues en présence au Québec. La consultation des dictionnaires confirme l’ambivalence du mot embarras. Le Dictionnaire historique de la langue française d’Alain Rey conclut qu’au figuré, ce mot désigne une incertitude de l’esprit devant une décision à prendre, comme dans l’expression avoir l’embarras du choix, ou une situation difficile, qui cause un désagrément. Le Grand Dictionnaire encyclopédique Larousse note la même ambiguïté du mot en lui attribuant le sens d’incertitude de l’esprit, de perplexité d’une personne qui ne sait quelle voie prendre. Je crois que telle est la situation des locuteurs du Québec dans la vie quotidienne, des francophones devant l’anglais et les langues des immigrants, des anglophones et des allophones face à la langue française, langue de la majorité et langue officielle commune. C’est d’ailleurs là la source et la raison d’être de la politique linguistique. Le prologue en tête du livre répond d’ailleurs à la question : de quels embarras s’agit-il?
L’organisation du contenu de l’ouvrage est chronologique.
La première partie retrace les événements à l’origine de la situation des langues au Québec et au Canada, soit l’introduction de la langue française dans la vallée du Saint-Laurent, en contact immédiat avec les langues des Amérindiens, puis l’irruption soudaine de la langue anglaise à la suite de la défaite des plaines d’Abraham et la réaction des Canadiens de l’époque à l’égard de la langue du conquérant. Le décor linguistique est ainsi posé pour longtemps, puisque les conséquences de ce passé perdurent jusqu’à maintenant. Est évoquée ensuite la manière dont les Canadiens français – ils ne se disent pas encore Québécois – ont pris conscience de la situation de leur langue face à la langue anglaise, situation qui leur est apparue de moins en moins acceptable, d’autant que la langue anglaise de la minorité attirait vers elle la plupart des immigrants. La crise de Saint-Léonard a cristallisé ce ras-le-bol et a provoqué la ronde des lois linguistiques qui se succédèrent en quelques années. On peut considérer que la Charte de la langue française clôt cette période.
Le dernier chapitre de cette première partie traite de la genèse et de la conception de la politique d’immigration, le second aspect en importance de la politique linguistique québécoise.
La deuxième partie de l’ouvrage est consacrée à l’actualité de la politique linguistique. Le premier chapitre décrit les contestations successives de la loi 101 devant les tribunaux et les modifications du texte original de la Charte de la langue française qui s’en sont suivies. Ensuite, sont abordées les questions relatives à la qualité de la langue, la notion de norme linguistique sociale et la fonction qu’elle joue au sein de la société, les éléments d’une description de cette norme, phonétique, grammaticale et lexicale, enfin l’immense problème de l’enseignement du français au Québec. Cette question aurait dû être traitée dans la première partie de l’ouvrage, après la législation linguistique et la politique d’immigration, étant donné que cet enseignement relève de la responsabilité du ministère de l’Éducation, donc, de l’initiative du gouvernement. Mais, à cause de l’étroite relation de l’enseignement du français avec la notion de norme et avec l’état actuel de la langue dans son usage québécois, il était préférable d’en traiter à la suite de ces deux sujets. Tenter d’évaluer l’importance que les Québécois accordent de nos jours à la question de la langue, si on en juge par leurs comportements et par la place qu’y accordent les médias, clôt cette partie.
La conclusion résume les défis linguistiques qui se posent encore aujourd’hui, en faisant la synthèse des déficiences signalées tout au long du texte. Car il ne faut pas penser qu’il n’y a plus rien à faire, que tout est réglé, que tout est parfait dans le meilleur des mondes, qu’il n’y a plus à se préoccuper du dossier de la langue, qu’on peut passer à autre chose, à l’environnement, à la délocalisation de l’économie, à nos affaires personnelles, au besoin en délaissant la langue française au profit de la langue anglaise, plus utile et plus répandue dans le monde des affaires. Comme le font pourtant les locuteurs des autres pays, les Québécois n’arrivent pas à privilégier chez eux leur propre langue, sans se priver d’utiliser à l’occasion la langue anglaise comme langue d’appoint. Il est très difficile de leur enlever du subconscient la conviction que la langue française est une langue de seconde zone, que la langue la plus importante, c’est l’anglais, conviction bien enracinée dans les esprits depuis au-delà de deux siècles.
Dans la troisième et dernière partie de l’ouvrage sont reproduits quelques-uns de mes textes, plus théoriques cependant, mais en relation avec certains sujets des chapitres précédents auxquels ils apportent un complément d’information. Ce sont des articles anciens, qui ont été des jalons de l’histoire récente du discours sur la langue. D’une part, j’ai ainsi évité des développements trop spécialisés dans le texte destiné au grand public, d’autre part ce sont des textes difficiles à retrouver et qui, pour cette raison, me sont souvent demandés par des collègues ou des étudiants d’un peu partout. Chaque texte est situé en peu de mots dans le contexte de l’époque. Ils sont cités tels qu’ils ont été publiés, sans modification.
En annexes figurent un résumé des principales dispositions de la Loi sur la langue officielle de 1974 et de celles de la Charte de la langue française, dans sa version originale de 1977. Suit une brève comparaison de ces deux textes, disponibles aujourd’hui que dans le répertoire historique des lois du Québec, donc difficiles d’accès pour qui n’est pas de formation juridique.
Il me reste l’agréable devoir de remercier les personnes qui ont accompagné la rédaction de ce livre.
En tout premier lieu, Louise Beaudoin, qui a accepté d’en rédiger la préface. Les Québécois gardent tous d’elle le souvenir d’une ministre entièrement dédiée à faire respecter la loi 101 et à promouvoir la langue française, ici et dans le monde.
Je ne saurais trop remercier Monique Cormier, du Département de linguistique et de traduction de l’Université de Montréal, et Anne-Marie Villeneuve, éditrice chez Québec Amérique, d’avoir accepté de lire le brouillon de chaque chapitre sitôt qu’il était terminé. Chacune le lisait de son point de vue, Monique Cormier comme lectrice connaissant bien le domaine, Anne-Marie Villeneuve comme lectrice type du public cible, la génération des enfants de la loi 101 dont elle fait partie. Leurs commentaires ont permis de beaucoup améliorer le texte initial. Mes remerciements vont également à Marie-Éva de Villers qui a relu le manuscrit complet une dernière fois avec amitié et avec la compétence et la rigueur qu’on lui connaît.
Je remercie également Chantal Robinson, l’excellente directrice de la bibliothèque de l’Office québécois de la langue française, ainsi que le personnel du ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles, notamment du Centre de documentation de la Direction des affaires publiques et des communications. Grâce à leur aide si précieuse, j’ai eu accès à tous les documents dont j’ai eu besoin pour remonter le cours de l’histoire de la politique linguistique.
Je remercie enfin tous les collègues qui ont participé avec moi à l’aventure du dossier de la langue française au Québec depuis 1970, ceux de l’Office québécois de la langue française, du Conseil supérieur de la langue française et du Secrétariat à la politique linguistique ainsi que mes collègues linguistes du Québec, de France et de Belgique. Nous en avons discuté tous les aspects, nous en avons vécu ensemble les péripéties jusqu’à aujourd’hui. Je suis conscient de tout ce que je leur dois.
Par-dessus tout, je rends hommage à la lucidité et au courage des deux ministres qui sont à l’origine des lois linguistiques du Québec. D’abord, François Cloutier, en qualité de ministre du gouvernement libéral de Robert Bourassa, qui a piloté la première version d’une intervention législative globale, la Loi sur la langue officielle : on lui doit d’avoir fait de la langue française la seule langue officielle du Québec à une époque où tout tendait vers le bilinguisme français-anglais à la manière de la politique fédérale. Ensuite, Camille Laurin, ministre du premier gouvernement péquiste de René Lévesque, qui lui a succédé et qui a resserré la loi pour accorder à la langue française une plus grande prédominance. Il a donné à la loi linguistique son caractère définitif de Charte de la langue française pour en souligner l’importance décisive pour toute la société québécoise, y compris pour tous les ministères et actes du gouvernement du Québec. L’un et l’autre avaient en commun d’être psychiatres. Il me plaît de penser que cette profession leur avait permis de comprendre l’importance cruciale de la langue pour les personnes, pour les institutions et pour la vie collective d’une nation.
Prologue – De quels embarras s’agit-il?
Autant la langue est, pour le locuteur, une chose familière, quotidienne, allant de soi, autant elle peut être à la source ou agir comme révélateur de tensions au sein de la société.
Ces tensions sont de nature et d’intensité fort variables. Elles sont parfois relativement anodines, par exemple le simple malaise d’un locuteur malhabile à s’exprimer face à un interlocuteur plus performant, la gêne d’un locuteur incapable de maîtriser la norme linguistique de son groupe et qui s’en sent dévalorisé, ce qui l’incitera peut-être à contester la validité de cette norme plutôt que de chercher à l’acquérir. Elles peuvent être potentiellement dangereuses ainsi qu’en témoignent les accrochages entre groupes linguistiques différents selon les rapports qui s’établissent entre eux à travers la pratique du bilinguisme, accrochages qui peuvent fort bien dégénérer en conflits plus ou moins graves, comme la lecture des journaux nous en donne des exemples fréquents.
Si tout va bien, le locuteur ordinaire ne ressent pas ces tensions, qui ne dépassent pas le niveau de l’expérience immédiate et n’atteignent pas le niveau de conscience et de réflexion nécessaire à la cristallisation d’un phénomène ressenti comme un problème, pour lui et pour les autres. Par contre, plus la tension monte, plus les attitudes se figent et plus la recherche d’une solution devient délicate et difficile. Dans l’un et l’autre cas, on observe que les connaissances requises pour discuter avec un minimum de réalisme des questions de langue sont fort peu répandues, en dehors du cercle restreint des linguistes, et encore ceux-ci risquent-ils d’être limités par leurs propres champs de spécialité. Et ainsi, tout le monde en parle à sa manière, avec d’autant plus d’autorité que chacun se sent compétent pour discuter des problèmes qui touchent sa propre langue ou qui découlent de la relation qu’elle entretient avec les autres langues.
Au départ, avant même d’évoquer l’histoire de la politique linguistique québécoise et de faire le point sur la situation actuelle, il est utile de présenter tous les aspects de la langue susceptibles d’être à la source d’un embarras, pour le locuteur individuel ou pour le groupe, au moins pour avoir une vue d’ensemble de ce qui se cache derrière le comportement linguistique. Au terme de ce prologue, le lecteur devrait avoir une bonne idée des problèmes fondamentaux que peut poser la langue et mieux comprendre que leur analyse et la recherche de solutions aient pu provoquer des tensions linguistiques au Québec.
Nous nous proposons d’examiner ici les embarras qui peuvent provenir du rapport du locuteur individuel à sa langue maternelle, du rôle que joue la langue dans la société, du fait que les groupes de locuteurs ne font pas le même usage de la langue, enfin de la coexistence de langues différentes sur le même territoire. Toutes les communautés linguistiques vivent plus ou moins intensément ces embarras, mais chacune à sa manière, selon sa situation sociolinguistique. Le cas du Québec nous servira ici de toile de fond pour les décrire.
Première source d’embarras : les rapports du locuteur individuel à sa langue maternelle
Ils sont complexes. D’une part, il en fait un usage personnel pour exprimer sa pensée et ses sentiments avec la plus grande efficacité possible. D’autre part, il cherche en même temps à communiquer avec les autres, au besoin en adaptant son propos à ses interlocuteurs. D’où une tension constante entre liberté et contrainte sociale.
Le locuteur individuel naît, pour ainsi dire, dans la langue. Dès sa naissance, elle s’impose à lui comme code privilégié de communication avec son entourage. Elle conservera cette fonction tout au long de son existence, dans tous les actes de sa vie personnelle et sociale, du moins si rien ne vient l’obliger à la délaisser en faveur d’une autre langue.
L’usage que le locuteur individuel fait de la langue est, en général, spontané, tout entier orienté vers la pensée à transmettre, vers ce qu’il veut exprimer et communiquer à autrui. En langue parlée, la part de réflexion sur le code, sur la langue en tant que système, est très minime, pour ne pas dire inexistante chez la plupart des locuteurs. En langue écrite, de par les conditions particulières où se trouve alors l’utilisateur, devant sa page blanche ou son écran d’ordinateur, seul avec lui-même à la recherche de la formulation la plus heureuse de sa pensée, souvent entouré de livres de référence, disposant de temps pour hésiter, chercher, vérifier, se relire, corriger, la part de réflexion est plus grande, quoiqu’elle porte plutôt sur la stylistique et la correction linguistique que sur le système lui-même. En fait, à part les linguistes, peu d’utilisateurs de la langue se préoccupent de comprendre comment fonctionne la langue en tant que code et système, sauf cette curiosité constante pour les dictionnaires, c’est-à-dire pour le lexique de la langue.
Chaque locuteur marque de sa personnalité l’usage qu’il fait de la langue. Dans la richesse du système global, chacun puise et utilise une partie des ressources de la langue, mélange relativement homogène composé de choses apprises, de choix personnels et d’emprunts à autrui. Chacun, en somme, a son style, du plus humble des locuteurs à l’écrivain de renom. Ce style résulte de la synthèse de l’histoire de chaque personne : lieu et milieu d’origine, scolarisation, étapes de la carrière, fréquence et intensité des contacts avec d’autres locuteurs, habitude de lecture. Il est également le résultat des attitudes de l’individu à l’égard de la langue, la sienne et celle des autres locuteurs de sa langue, selon qu’il est attentif, observateur, préoccupé d’améliorer la qualité de sa propre performance, ou qu’il est, au contraire, peu désireux de changer ou même hostile à tout autre usage que le sien et celui de ses proches.
Il y a donc une part de liberté dans l’usage de la langue. Mais il s’agit d’une liberté surveillée, soumise à la pression du groupe. Car la langue est fondamentalement une convention sociale et l’efficacité de la communication exige de la part du locuteur individuel le respect minimal des éléments du code partagés avec ses interlocuteurs, s’il veut être compris et accepté. Le style de chacun doit, de ce fait, demeurer dans des limites très précises et toute innovation qui s’en éloigne trop risque au mieux de surprendre, au pire, d’être incomprise. Paradoxe de la liberté de l’usage individuel et de la contrainte sociale de la langue.
À travers la langue, le locuteur individuel ressent et manifeste un profond sentiment d’appartenance à son milieu immédiat d’abord, à sa communauté linguistique globale ensuite. Ce sentiment se manifeste de deux façons : par une certaine manière d’utiliser la langue dans le respect de la norme de son milieu et par le choix de la langue de sa propre communauté comme langue d’usage. À plus forte raison, si une personne abandonne sa langue maternelle au profit d’une autre, phénomène de transfert linguistique qu’on observe dans les milieux bilingues ou multilingues, elle manifeste ouvertement qu’elle rejette sa communauté d’origine et qu’elle préfère s’intégrer à une autre communauté linguistique et culturelle. Entre l’appartenance normale à sa langue maternelle et le transfert linguistique définitif vers une autre, il y a des étapes intermédiaires, nombreuses et subtiles, qui font souvent que le passage d’une langue à l’autre se fait en douceur.
On comprend alors que, généralement, le locuteur individuel soit très attaché à sa langue. Elle lui sert de lien avec tous les membres de son groupe. En même temps que la sécurité, il y trouve la liberté et la spontanéité d’expression, en pleine maîtrise des moyens les plus efficaces pour transmettre sa pensée dans toutes ses nuances.
Enfin, le sentiment d’appartenance et d’attachement à sa propre langue amène le locuteur individuel à se situer à l’égard des autres langues. Ses attitudes dépendront du statut de sa langue par rapport aux autres, selon qu’elle est majoritaire ou minoritaire, de sa perception des locuteurs des autres langues et des attitudes de ceux-ci à l’égard de lui-même, de sa langue et de sa communauté.
En fait, chaque locuteur décide de sa conduite personnelle en matière de langue et, en même temps, participe à la définition de la politique de son groupe par rapport aux autres langues, soit implicitement, par son comportement et ses attitudes, soit explicitement, par l’acceptation ou le rejet d’un projet d’organisation linguistique de la société.
Deuxième source d’embarras : le rôle de la langue dans la société
Dans toute société, la langue est à la fois une institution par rapport à laquelle le locuteur individuel doit se situer et un élément symbolique de cohésion sociale, donc de solidarité et d’identité collective. De ce fait, la langue peut être également une source de tension lorsque plusieurs communautés linguistiques se partagent le même espace social.
La langue est un fait social. On en a toujours convenu. Plus précisément, la langue est une convention sociale, un contrat passé entre tous les locuteurs d’une génération à l’autre, un héritage que reçoit l’individu à la naissance et qu’il transmettra à son tour à ses enfants, avec les modifications que le temps y aura apportées. À lui seul, aucun locuteur individuel ne peut modifier la langue.
Dans cette optique, la langue est, dans la pratique quotidienne, un comportement de l’être humain, analogue aux autres comportements sociaux comme se vêtir (la mode), se nourrir (la cuisine), se constituer en groupe familial (la parenté), se conduire par rapport aux autres (la morale), concevoir l’existence d’un domaine sacré distinct du profane (la religion). De ce point de vue, il n’y a pas de différence de nature entre la langue, la cuisine ou la mode. Dans l’un et l’autre cas, il y a un individu qui fait quelque chose – qui parle, qui mange, qui s’habille –, qui le fait d’une certaine manière qui lui est personnelle tout en se conformant à une manière de faire propre au groupe auquel il appartient. Dans l’un et l’autre cas également, le comportement de l’individu n’est pas parfaitement spontané, ni totalement libre. Il se situe à l’intérieur d’un cadre de référence, d’une norme sociale, qui à la fois facilite la conduite, puisqu’elle est ainsi guidée, et sécurise l’individu, parce qu’alors il ne provoque aucune hostilité de la part des autres membres du groupe, mais qu’au contraire il est accepté, intégré, estimé par eux.
C’est cependant une institution sociale qui a un statut très particulier par rapport aux autres, remarque de Saussure :
La langue – et cette considération prime toutes les autres – est à chaque moment l’affaire de tout le monde; répandue dans une masse et maniée par elle, elle est une chose dont tous les individus se servent toute la journée. Sur ce point, on ne peut établir aucune comparaison entre elle et les autres institutions. Les prescriptions d’un code, les rites d’une religion, les signaux maritimes, etc., n’occupent jamais qu’un certain nombre d’individus à la fois et pendant un temps limité; la langue, au contraire, chacun y participe à chaque instant, et c’est pourquoi elle subit sans cesse l’influence de tous. Ce fait capital suffit à montrer l’impossibilité d’une révolution. La langue est de toutes les institutions sociales celle qui offre le moins de prise aux initiatives. Elle fait corps avec la vie de la masse sociale, et celle-ci, étant naturellement inerte, apparaît avant tout comme un facteur de conservation[4].
On peut considérer également la langue comme un élément de la culture d’une société. Mais là aussi, c’est un élément d’un statut très particulier puisqu’il sert à exprimer tous les autres et puisque c’est par la langue qu’est exposée la production intellectuelle de ses membres dans tous les domaines, poésie, littérature, théâtre, sciences, journaux, revues, télévision, essais, textes scientifiques et commerciaux, etc.
La langue joue, enfin, un important rôle de cohésion sociale. Elle crée entre les individus une solidarité et une connivence de tous les instants. Elle symbolise et manifeste l’appartenance à une société et à une culture originales, différentes des autres, tout aussi riches et dignes de respect.
C’est en ayant en tête ces phénomènes complexes que nous utilisons le terme de communauté linguistique pour désigner les locuteurs qui partagent la même langue sur le même territoire.
Lorsque plusieurs communautés linguistiques se trouvent réunies dans un même pays, la langue remplit pour les locuteurs de chacune d’entre elles la même fonction de cohésion sociale, ils y trouvent le même réconfort, la même solidarité, la même sécurité. Si ces sentiments sont mis en danger, surtout si la libre concurrence entre les langues les compromet, il faut s’attendre à ce que les locuteurs réagissent et qu’il survienne entre les communautés linguistiques des affrontements qui peuvent dégénérer en conflits. Les exemples sont nombreux qui démontrent la justesse de cette observation, par exemple en Belgique, entre Wallons et Flamands, aux États-Unis entre la langue anglaise et la langue espagnole, pour ne citer que ces deux exemples connus. La société doit alors trouver en elle-même les moyens de faire vivre en harmonie toutes les communautés linguistiques. C’est l’objet de toute politique linguistique, comme on le constate en Suisse, en Belgique, au Luxembourg, en Catalogne, en Lettonie, au Québec et au Canada, bien évidemment.
Troisième source d’embarras : la variation sociale
Chaque locuteur emploie la langue à sa manière en se pliant plus ou moins à la norme linguistique de son groupe et à celle de sa communauté linguistique. S’ajoute au Québec l’embarras du rapport entre l’usage du français propre au Québec et celui de la France.
Toutes les langues varient, dans toutes leurs composantes, avec une intensité différente d’une composante à l’autre. Le phénomène est universel. La prononciation et le système phonologique sous-jacent ne sont pas identiques d’une variante à l’autre de la même langue et d’une époque à l’autre. La morphologie et la syntaxe changent également, quoique ces parties de la langue soient celles dont l’inertie est la plus grande. Le changement le plus fréquent est celui du lexique, qui se modifie constamment, soit par l’évolution des sens accordés aux mots, soit sous l’influence des nouveautés introduites dans la culture et qu’il faut nommer, soit à la suite des contacts avec d’autres cultures et d’autres langues.
Cette variation de la langue est due à des causes diverses, qui servent habituellement à différencier et à classer les différentes formes de la variation linguistique. Le passage du temps provoque la variation temporelle. L’hétérogénéité de la société entraîne la variation sociale. Les différences d’activités professionnelles donnent lieu à la variation occupationnelle. La dispersion des locuteurs d’une langue dans l’espace se marque par la variation géographique. Enfin, les circonstances où se trouve le locuteur au moment d’utiliser la langue déterminent le registre de son usage, s’il a la compétence d’en changer.
Les attitudes à l’égard de la variation linguistique sont très diverses. En général, la variation temporelle ne gêne personne, surtout lorsqu’il s’agit de constater des usages très anciens, périmés pour ainsi dire. On y trouve même du charme lorsqu’on est suffisamment sensible à cette manifestation du passé, le charme des textes classiques aimés ou celui de la langue de nos grands-parents, langue de nos souvenirs d’enfance souvent. La variation occupationnelle est fort bien acceptée, tout au plus note-t-on une certaine animosité à l’égard des terminologies trop hermétiques et à l’égard des textes rendus incompréhensibles par la trop forte spécialisation du rédacteur, surtout lorsqu’ils sont destinés au grand public comme le sont les textes administratifs, les textes juridiques, les clauses d’un contrat ou les modes d’emploi d’un objet. Par contre, la variation sociale et la variation géographique sont loin de faire l’unanimité. L’une et l’autre sont à la source de vives discussions entre les locuteurs d’une même langue et une source de difficultés pour les locuteurs étrangers qui en connaissent une autre variante.
La variation sociale provient du fait qu’aucune communauté linguistique n’est homogène. Toute communauté se subdivise en sous-groupes plus ou moins nombreux, constitués par les locuteurs qui font un même usage de la langue, usage que l’on met généralement en corrélation avec une ou plusieurs caractéristiques, le niveau socioéconomique, le niveau de scolarité, la distinction ville/ campagne, la région de résidence ou de provenance, l’âge, l’activité professionnelle. Enfin, dans les pays d’immigration comme le Québec, l’usage national de la langue cohabite avec d’autres variétés de français que parlent les locuteurs qui viennent d’autres pays de la francophonie, de France ou des pays du Maghreb ou d’Afrique subsaharienne, ou des Antilles.
Il en découle divers problèmes sociaux et linguistiques.
On constate que chaque groupe distinct de locuteurs partage, dans les faits, un usage identique de la langue, que ses membres sont d’accord entre eux sur la manière dont il convient de parler, c’est-à-dire qu’ils partagent une même norme linguistique caractéristique de leur groupe. C’est ainsi que peuvent s’opposer la langue populaire et la langue bourgeoise, la langue du milieu (l’argot des malfaiteurs) et la langue des honnêtes gens, la langue des branchés et celle des ringards, etc.
Par contre et en même temps, tous les membres de la communauté linguistique ont une idée précise de la meilleure manière de parler la langue, c’est-à-dire que tous partagent une même norme de référence, dont ils exigent même le respect de la part de ceux des locuteurs qui sont instruits, qui ont des professions de communication ou qui se trouvent dans des circonstances très officielles, le personnel politique par exemple. Dans la vie quotidienne, ces différentes normes cohabitent en général sans problème, chacun connaissant les règles du jeu linguistique. D’un autre point de vue, les différences de normes deviennent l’occasion d’un débat public au moment où elles se manifestent en dehors de leur lieu d’origine, par exemple en littérature, lorsque des auteurs osent écrire en langue populaire, ou encore à la radio, à la télévision, au moindre relâchement de langue. Le débat de la norme peut parfois devenir orageux lorsqu’il est question de la langue de l’école ou lors de la publication de dictionnaires, surtout si les lexicographes introduisent dans le dictionnaire des usages relevant de la langue populaire ou familière.
L’existence de normes différentes oblige le locuteur individuel à se situer par rapport à chacune d’elles et à choisir celle qu’il fera sienne pour son usage personnel, qui peut fort bien ne pas être la norme de son enfance.
La variation géographique provient du fait que chaque région de la francophonie utilise la langue française d’une manière qui lui est propre, facilement perceptible au premier abord par la prononciation et par des particularités lexicales. Si, dans les dictionnaires publiés à Paris, on inclut l’une de ces particularités, elles sont identifiées comme des régionalismes. Cette étiquette peut tout aussi bien renvoyer à un mot ou un sens d’une région de France qu’à un mot d’un autre pays où la langue française est parlée, soit comme langue maternelle (Suisse, Belgique, Québec, Acadie), soit comme langue d’importation (Maghreb, pays africains). Ainsi, la marque région. dans le Nouveau Petit Robert (2004) est définie comme mot ou emploi particulier au français parlé dans une ou plusieurs régions [France, pays francophones], mais qui n’est pas d’usage général ou qui est senti comme propre à une région. Dans le monde hispanique, on emploie le terme de provincialismes (provincialismos)[5] pour désigner les écarts de l’espagnol des pays d’Amérique par rapport à l’espagnol castillan d’Espagne.
Pourtant, à l’évidence, le Québec, s’il est bien une région de la francophonie, n’est pas dans une même relation linguistique par rapport à la langue française qu’une région de France. Il en est de même des pays hispano-américains par rapport à l’espagnol d’Espagne ou des États-Unis par rapport à l’anglais d’Angleterre. À partir du moment où une langue européenne s’est implantée dans différents pays et sur plusieurs continents, elle n’appartient plus en propre au pays d’origine et ne peut plus être sous le contrôle exclusif des institutions de l’ancienne métropole. Elle est devenue une langue internationale, partagée par plusieurs communautés linguistiques qui se l’ont appropriée à part entière.
Cette expansion des langues européennes a eu deux conséquences principales. D’une part, différents pays partagent maintenant la même langue et forment ainsi une grande communauté internationale sur la base de traits culturels et linguistiques communs. Mais en même temps, et malgré eux pour ainsi dire, ils en font un usage différent qui est l’expression de traits culturels qui leur sont particuliers et qui sont les conséquences de leur insertion dans un autre environnement, d’une évolution historique distincte, d’un lent éloignement de la culture de la métropole.
Le locuteur prend ainsi conscience de son appartenance à une communauté plus grande que la sienne, en même temps qu’il réalise qu’il y a des différences entre sa manière de parler et celle des autres.
Le problème devient alors évident et préoccupant : comment concilier l’unité de la langue commune, instrument de communication avec tous les autres pays de la même langue, et l’existence des particularités linguistiques symboliques de son identité et qui désignent les réalités de sa culture et de son environnement?
Quatrième source d’embarras : la concurrence entre les langues
De tout temps, les langues sont en contact et, de nos jours, de plus en plus en concurrence les unes avec les autres, surtout à cause de l’immigration.
Il est très rare qu’un pays soit rigoureusement homogène du point de vue linguistique. En général, plusieurs communautés linguistiques cohabitent sur le même territoire où elles entretiennent des rapports qui peuvent varier à l’infini, entre les deux pôles extrêmes de l’indifférence et de l’hostilité.
Il y a autant de sources à la concurrence entre langues qu’il y a de pays et de situations historiques.
Lors de la découverte et de la colonisation de l’Amérique, les pays européens, la France, l’Angleterre, l’Espagne et le Portugal, ont superposé leurs langues aux langues des populations autochtones, le plus souvent sans s’en préoccuper, les considérant au contraire comme primitives et tout au plus utiles à l’exploration des nouveaux territoires.
Au début de l’implantation de la langue européenne dans son nouvel environnement, l’usage de la langue dans la colonie demeure identique à celui de la métropole. Ce n’est que progressivement qu’il diverge et s’éloigne peu à peu du modèle européen, quand les descendants des premiers « colons » s’approprient la langue en même temps que le pays. L’usage américain n’est pas identique à l’usage britannique, la langue espagnole varie d’un pays à l’autre de l’Amérique centrale et de l’Amérique du Sud. Par contre, au Québec, cette question est toujours l’objet d’un éternel litige.
Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la diminution du taux de naissance dans les pays industrialisés, jointe à la reprise de l’immigration massive, a modifié en profondeur la structure de la population des pays d’accueil. De nouvelles langues et, donc, de nouvelles cultures s’ajoutent au fond culturel ancien. Plus les membres de ces communautés sont nombreux, plus elles s’affirment, réclament le droit à la différence, cherchent une manière de participer à la vie nationale sans nécessairement vouloir s’y fondre totalement, en abandonnant toutes leurs caractéristiques culturelles, comme la langue ou la religion. La France, par exemple, a accueilli beaucoup de nouveaux citoyens en provenance d’Afrique du Nord ou d’Afrique subsaharienne, qui s’intègrent difficilement, moins sur le plan linguistique, puisque le français s’impose comme langue de survie, que dans le domaine religieux et dans les modes de vie. Les États-Unis, autre exemple, voient les populations de langue espagnole croître rapidement, en provenance des pays d’Amérique latine. L’usage de l’espagnol augmente constamment et une forme spontanée de bilinguisme se pratique au sein de la population de bien des États, avec, en réaction, l’augmentation d’un courant d’opinion au sein de la majorité anglophone en faveur d’une politique déclarant l’anglais seule langue officielle de la Confédération. Plusieurs États, dont la Californie, ont déjà opté pour une telle politique, dont on peut penser qu’elle est difficilement applicable dans les faits.
Et pendant que les pays et les régions se diversifient et se fragmentent, la tendance inverse s’accélère, vers l’uniformisation linguistique et culturelle du monde. L’usage de la langue anglaise se répand dans tous les pays au détriment des langues nationales par la mondialisation de l’économie, la concentration de l’information scientifique et technique, l’introduction des moyens électroniques de communication, d’échange et de conversation, comme Internet. Tous ces phénomènes ont partout les mêmes conséquences sociolinguistiques : briser les contraintes linguistiques nationales qui encerclent chaque personne dans sa langue maternelle, modifier les besoins et aspirations de chacun, individualiser les comportements en fonction d’intérêts personnels immédiats. Les consensus nationaux en matière d’usage des langues s’effritent encore davantage.
Les situations de concurrence linguistique sont, on le voit, très variées, plus ou moins complexes, plus ou moins conflictuelles.
Un ultime embarras : la fragilité de la terminologie
Les termes utilisés pour décrire une situation sociolinguistique complexe, majorité, minorité, langue principale, langue dominante, immigrant, intégration, sont eux-mêmes piégés, en ce sens qu’ils sont susceptibles d’être interprétés hors de leur sens premier et réel, par l’adjonction de connotations péjoratives ou dépréciatives qu’ils n’ont pas en réalité ou qu’ils n’avaient pas à l’origine. Quand un terme devient suspect, il est difficile de l’utiliser et quasi impossible de lui redonner son innocence. Pas surprenant alors que l’euphémisme prolifère, vidant les notions de leur substance et nuisant fortement à la précision des mots et, conséquemment, à l’efficacité de l’analyse et de la discussion sociale pourtant nécessaire. La rectitude politique fait ici des ravages considérables en noyant tout dans une sorte de politesse apparente où l’intention de ne pas blesser l’interlocuteur compromet la qualité et l’efficacité de la communication. C’est que, dans les situations de concurrence linguistique, la sensibilité des individus et des groupes mis en cause est très vive, beaucoup plus vive que lorsqu’il s’agit de variation linguistique. Chaque locuteur individuel est touché. La relation d’identité à la langue joue à fond, l’avenir de la communauté linguistique est en jeu, une certaine conception des rapports entre les langues et entre ceux qui les parlent est menacée ou tout au moins contestée, certainement soumise à examen. Les réactions sont donc immédiates et explicites. Il n’est pas toujours facile de conduire un débat serein, avec un minimum d’objectivité.
Le Québec est un bon exemple d’un pays qui a cherché et qui cherche toujours une réponse à tous ces embarras dans le cadre d’une société juste et démocratique. Ce n’est jamais facile au jour le jour, comme en témoigne l’aventure de la politique linguistique.
Première partie – L’invention de la politique linguistique québécoise
À l’origine de la politique linguistique telle que nous la connaissons maintenant, il nous faut évoquer en tout premier lieu les circonstances qui ont amené deux grandes langues européennes, le français et l’anglais, à se retrouver face à face dans la vallée du Saint-Laurent et la manière dont ont réagi les Français de la Nouvelle-France, les ancêtres des Québécois francophones d’aujourd’hui. Il nous faut décrire, en deuxième lieu, le long processus de réflexion et de discussions dont est sortie peu à peu l’intention de prendre les moyens d’assurer un avenir à la langue et à la culture françaises au Québec. Nous rappellerons ainsi les principaux événements qui ont permis aux Québécois de prendre conscience de la situation de la langue française au Québec et de discerner de mieux en mieux les moyens à employer pour pallier les dangers qu’elle court en terre d’Amérique. Ce sera là l’objet du premier chapitre de la première partie de l’ouvrage, en deux sections, l’arrière-plan historique de la politique linguistique et l’approfondissement de la situation du français face à l’anglais.
Le deuxième chapitre de la première partie s’ouvre sur l’événement qui a déclenché une crise linguistique sans précédent au Québec, l’affaire de Saint-Léonard. Elle forcera le gouvernement de l’Union nationale à improviser de toute urgence la première loi linguistique, le bill 63 (1969), dont l’échec entraînera la promulgation, par le gouvernement libéral de Robert Bourassa, d’une loi plus précise, plus globale, plus coercitive, la loi 22 (1974), loi qui accorda, pour la première fois, au français le statut de seule langue officielle du Québec. Le gouvernement du Parti québécois, porté au pouvoir en 1976, jugea que cette loi autorisait trop facilement l’emploi de la langue anglaise en lieu et place de la langue française et qu’elle favorisait trop systématiquement le recours au bilinguisme, qui a toujours joué au détriment de la langue française. Il lui substitua en 1977 la Charte de la langue française, dite loi 101.
Mais, avant même de passer aux textes de la première partie de ce livre, une remarque préliminaire s’impose : la manière de nommer les descendants des habitants de la Nouvelle-France a beaucoup varié au fil des années, en même temps que la population du nouveau pays devenait de plus en plus composite.
De canadiens à québécois
Ces diverses dénominations subsistent dans les textes de chaque époque. Certaines sont toujours en usage dans le vocabulaire politique d’aujourd’hui, dotées de connotations idéologiques particulières.
À l’époque de la Nouvelle-France, on appelait Canadiens ceux qui y résidaient de manière permanente, et leurs descendants, par opposition à ceux qui y étaient de passage, militaires et administrateurs en mission au nom du Roy. En effet, depuis les voyages de Jacques Cartier, au début du XVIe siècle, le mot Canada servait à désigner une partie ou le tout de la vallée du Saint-Laurent, comme le montrent les cartes géographiques anciennes. Ce vocable prendra une grande extension par la suite jusqu’à devenir le nom officiel de tout le pays au nord des États-Unis.
Au lendemain de la Défaite/Conquête de 1760, les habitants de l’ex-Nouvelle-France continuent de se dire Canadiens par opposition aux Anglais qui immigreront dans la nouvelle colonie britannique. Ceux-ci prendront l’habitude de les appeler les Français pour bien souligner leur ancienne appartenance à une autre nation et à une autre culture. Ainsi, l’opposition entre les Français et les Anglais deviendra symbolique des allégeances et des cultures des deux groupes réunis sur le même territoire par les hasards des guerres européennes de l’époque. Ainsi, Alexis de Tocqueville écrit, en 1831 : « Les Anglais et les Français se fondent si peu que les seconds gardent exclusivement le nom de Canadiens, les autres continuent de s’appeler Anglais [6]. »
Dans son rapport de 1839, Lord Durham fonde toute son analyse de la situation de la colonie britannique sur l’observation des antipathies viscérales entre les Anglais et les Français, qu’il nomme aussi parfois les Canadiens ou les Canadiens français.
À partir de la Confédération de 1867, les deux peuples fondateurs deviennent les Canadiens français et les Canadiens anglais. Les Canadiens du temps de la Nouvelle-France se transforment alors en Canadiens français, puisque le mot Canada servira dorénavant à désigner l’ensemble du nouveau pays et qu’en conséquence, le terme Canadiens sera utilisé comme générique pour désigner tous les habitants du pays indépendamment de leur origine, de leur langue et du lieu de résidence dans le pays.
Lors des États généraux du Canada français (novembre 1967), une scission se produit entre les Canadiens français. Les Canadiens français du Québec choisissent de se nommer Québécois, les Canadiens français des autres provinces deviennent les francophones hors Québec, qui se désignent aujourd’hui soit comme Acadiens, soit comme francophones du Canada, les uns et les autres réunis dans une même Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada. La situation sociopolitique de chaque groupe est si différente que la notion de Canada français a éclaté. Tous en ont pris conscience :
Après la disparition avouée du Canada français en tant que symbole national, on a pu observer une certaine forme de morcellement de l’identité francophone au Canada. La manifestation de luttes régionales a aussi contribué à ce nouveau phénomène. Depuis, force est de constater que malgré l’usage commun de la langue, les communautés francophones et acadienne et le Québec francophone ont emprunté des avenues de développement différentes[7] .
De nos jours, la manière de nommer les habitants de la « province » de Québec (selon la terminologie officielle de la Constitution canadienne) est devenue confuse, à tout le moins changeante selon le point de vue.
Selon la langue, on partage la population entre francophone, anglophone et allophone, sans qu’on sache trop si les Amérindiens et les Inuits sont inclus dans cette dernière catégorie. Du strict point de vue linguistique, on a plutôt tendance à les considérer dans une classe à part, comme locuteurs des langues autochtones, subdivisées en grandes familles linguistiques dont les dialectes sont plus ou moins éloignés les uns des autres. Au Québec, on distingue neuf familles de langues autochtones[8] : l’algonquin, l’attikamek, le cri, le micmac, le mohawk, le montagnais, le naskapi et la grande famille de l’inuktitut.
Selon la « province » où les personnes de langue française résident, on parle aujourd’hui de Québécois, de francophones hors Québec, d’Acadiens, tout en les considérant tous comme des Canadiens, au sens qu’a ce mot aujourd’hui dans la Confédération canadienne. De temps à autre, on voit ressurgir l’appellation quelque peu vieillie de Canadiens français, qui a pris, de ce fait, un petit air archaïque.
Au Québec, le terme Québécois lui-même est devenu ambigu. Tantôt, on désigne sous ce nom les Québécois de langue française, les Québécois de souche (comme on commence à dire en France les Français de souche), pour les différencier des Anglais et des immigrants, anciens ou récents, plus ou moins profondément intégrés. Tantôt, on désigne sous ce terme, dans la foulée d’une nouvelle conception du NOUS inclusif, tous les citoyens du Québec, indépendamment de leurs langues d’origine ou de leurs langues maternelles, y compris les Anglo-Québécois et les Autochtones.
Enfin, l’adjectif français tend à être remplacé par francophone dans des contextes de plus en plus différents, par exemple la chanson francophone, la librairie francophone, en rupture avec le sens étymologique du terme, qui parle (-phone) français (franco). L’adjectif francophone prend ainsi, de plus en plus souvent, le sens de langue française, sans doute pour éviter la double interprétation possible de l’adjectif français, selon qu’il se réfère à la langue ou à la France.
Pour la rédaction de ce livre, nous utilisons les dénominations de chaque époque, pour éviter les anachronismes. Ainsi, les citoyens du Québec de langue française sont successivement nommés Canadiens, Canadiens français, Québécois, ou même aujourd’hui Québécois de langue française. Bien évidemment, nous citons les textes sans y rien changer, même s’ils comportent des mots aujourd’hui devenus tabous, notamment le mot race, neutre jusqu’aux années 1940, qui a acquis depuis lors une forte valeur dépréciative qui en interdit l’emploi de nos jours.
Chapitre I – La genèse du projet de politique linguistique au Québec
L’arrière-plan historique
Il faut remonter aux XVIIe et XVIIIe siècles pour retracer les événements à l’origine de la politique linguistique du Québec et de celles du Canada, car il y en a plusieurs[9].
Nous les évoquerons succinctement dans ce premier chapitre. Le fait essentiel est la concurrence entre la langue française introduite en Amérique par la colonisation française (1608-1760) et la langue anglaise imposée à la population à la suite de la défaite des troupes françaises de Montcalm aux mains des troupes anglaises de Wolfe sur les plaines d’Abraham, en septembre 1759. Le traité de Paris de 1763 devait consacrer la cession de la Nouvelle-France à l’Angleterre.
1. L’introduction de la langue française dans la vallée du Saint-Laurent : diversité linguistique de la population
La langue française est introduite sur les rives du Saint-Laurent par la colonisation française, surtout à partir de la fondation de Québec en 1608.
À cette époque, le français du Roy, c’est-à-dire celui de l’Île-de-France autour de la capitale Paris, coexistait en France avec un grand nombre de dialectes du français, appelés péjorativement patois, qui correspondaient plus au moins aux anciennes provinces de France, comme le montre la carte suivante[10].

Le français du Roy était la langue de l’administration (depuis l’ordonnance de Villers-Cotterêts, 1539), la langue du commerce, la langue de l’enseignement avec le latin, la langue des grands écrivains, en somme celle de la noblesse, du haut clergé, de la bourgeoisie. C’était également la langue d’intercommunication entre gens de dialectes (de patois) différents.
La France de l’époque se caractérisait par la prédominance du français du Roy et une pratique du bilinguisme français/dialectes dont l’intensité variait beaucoup chez les Français d’alors selon la région, le statut social et le niveau d’instruction du locuteur, selon aussi qu’il habitait la ville ou la campagne. L’intercompréhension entre le français du Roy et les variantes dialectales diminuait selon qu’on s’éloignait de l’Île-de-France, c’est-à-dire de la région de Paris où résidait le Roy, soit vers le sud, domaine des langues d’oc, soit vers le sud-est, domaine du franco-provençal. Notons qu’à la périphérie de la France, les langues de trois régions n’étaient pas d’origine latine, la Bretagne où on parlait le breton, langue d’origine celtique, l’Alsace où on parlait l’alsacien ou le lorrain d’origine germanique, enfin le pays basque et sa langue, langue non-indo-européenne dont l’origine est un mystère encore aujourd’hui.
Alain Rey est d’avis que le français du Roy et les dialectes constituaient un continuum linguistique et non une mosaïque de langues :
À l’intérieur même de l’ancien français, les territoires dialectaux se perçoivent avec des variantes phonétiques et morphologiques, et des originalités dans le lexique, mais sans que se dégagent de véritables langues différentes. Un groupe à l’Est (lorrain, bourguignon), un groupe au Nord-Est (picard et wallon), un groupe à l’Ouest (normand, angevin, poitevin) entourent un groupe central parfois appelé francien. Mais, à part quelques traits indiscutables, les différences dialectales de l’ancien français (y compris ce francien) relèvent d’une illusion historique. Ce qui est devenu le français, ce n’est pas un dialecte, celui de l’Île-de-France, parmi d’autres dialectes, mais déjà une langue largement partagée, diffusée par le pouvoir royal[11].
Ceux et celles qui sont venus en Nouvelle-France étaient ou des représentants de l’autorité royale, ou des militaires (officiers et hommes de troupe), ou des membres du haut et du bas clergé, ou des personnes recrutées pour émigrer dans la colonie (artisans, paysans, commerçants, etc.). Autour des ports d’embarquement, surtout La Rochelle, Dieppe, Honfleur, Saint-Malo, la nouvelle d’une colonie au-delà de la mer était certainement plus connue qu’ailleurs, ce qui a favorisé le recrutement de gens des régions avoisinantes.
Quelles étaient les régions de France d’où ces personnes sont venues? Deux chercheurs ont tenté de répondre à la question.
La première et la plus importante enquête est celle de Stanislas Lortie, historien, démographe et surtout généalogiste québécois. Lortie a patiemment parcouru les archives, surtout les actes des notaires et les registres de paroisse, pour y retrouver les noms et les provinces d’origine des habitants de la Nouvelle-France venus entre 1608 et 1700 et qui y sont mentionnés lors de mariages, de ventes, de baptêmes, de testaments. Il a ainsi retrouvé la trace de 4 894 personnes qu’il a réparties en quatre tranches de 20 ans chacune. Il a publié le résultat de ses recherches dans un article intitulé De l’origine des Canadiens français, publié en 1903[12]. Lortie a classé et compté les habitants de la Nouvelle-France selon la province d’origine, ce qui donne la répartition suivante, selon le tableau cité par Barbaud :
| Provinces où étaient nés les émigrants | Nombre des émigrants | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Époque où ils apparaissent dans les registres | Totaux de 1608 à 1700 | ||||
| 1608 à 1640 | 1640 à 1660 | 1660 à 1680 | 1680 à 1700 | ||
| Augoumois | — | 13 | 54 | 26 | 93 |
| Anjou | 2 | 56 | 60 | 21 | 139 |
| Artois | — | 2 | 9 | 3 | 14 |
| Aunis, Île de Rhé, Île d’Oléron | 23 | 115 | 293 | 93 | 524 |
| Auvergne | — | 3 | 18 | 14 | 35 |
| Béarn | — | 1 | 1 | 8 | 10 |
| Beauce | 14 | 22 | 46 | 23 | 105 |
| Berry | 1 | 5 | 32 | 11 | 49 |
| Bourgogne | 1 | 6 | 36 | 21 | 64 |
| Bourbonnais | — | 1 | 2 | 5 | 8 |
| Bretagne | 4 | 9 | 108 | 54 | 175 |
| Brie | 2 | 7 | 25 | 2 | 36 |
| Champagne | 7 | 23 | 76 | 23 | 129 |
| Comté de Foix | — | 1 | 1 | — | 2 |
| Dauphiné | — | 4 | 14 | 6 | 24 |
| Flandre, Hainaut | — | 1 | 11 | 3 | 15 |
| Franche-Comté | — | — | 1 | 5 | 6 |
| Gascogne | — | 5 | 22 | 24 | 51 |
| Guyenne | — | 8 | 61 | 55 | 124 |
| Île-de-France | 36 | 76 | 378 | 131 | 621 |
| Languedoc | — | 1 | 26 | 23 | 50 |
| Limousin | — | 5 | 26 | 44 | 75 |
| Lorraine | 1 | 6 | 7 | 2 | 16 |
| Lyonnais | 1 | 3 | 13 | 16 | 33 |
| Maine | 1 | 66 | 31 | 15 | 113 |
| Marche | — | 1 | 1 | 4 | 6 |
| Nivernais | — | 2 | 4 | 1 | 7 |
| Normandie | 89 | 270 | 481 | 118 | 958 |
| Orléanais | 4 | 7 | 33 | 19 | 63 |
| Perche | 89 | 122 | 24 | 3 | 238 |
| Périgord | — | 1 | 28 | 16 | 45 |
| Picardie | 11 | 7 | 60 | 18 | 96 |
| Poitou | — | 54 | 357 | 158 | 569 |
| Provence | — | 3 | 13 | 6 | 22 |
| Roussillon | — | — | 2 | — | 2 |
| Saintonge | 10 | 37 | 140 | 87 | 274 |
| Savoie | — | — | 6 | 6 | 12 |
| Touraine | — | 21 | 42 | 28 | 91 |
| Totaux | 296 | 964 | 2542 | 1092 | 4894 |
D’après ces statistiques, les provinces d’origine les plus souvent citées dans les archives sont la Normandie, l’Aunis-Saintonge, l’Île-de-France, la Bretagne non bretonnante, la Perche, le Poitou et la Champagne.
Ernest Martin, linguiste français et professeur à l’Université de Bordeaux, a repris les chiffres de Lortie, mais en répartissant les immigrants selon les zones sociolinguistiques de la France de l’époque. Un autre linguiste français, Bernard Pottier, avait décrit la situation du français en France au milieu du XXe siècle par rapport à la pratique des dialectes ou des langues non romanes (alsacien, basque, breton). Il constatait une pratique d’un bilinguisme plus ou moins intense entre le français, langue commune que l’augmentation de la scolarité avait favorisé, et les autres idiomes, surtout parlés dans les campagnes, par les personnes âgées et dans les activités quotidiennes, le travail des champs, le marché, la pêche, la chasse. L’intensité de ce bilinguisme français-dialectes variait selon les régions de France, ce que montre la carte suivante de Bernard Pottier[13] :
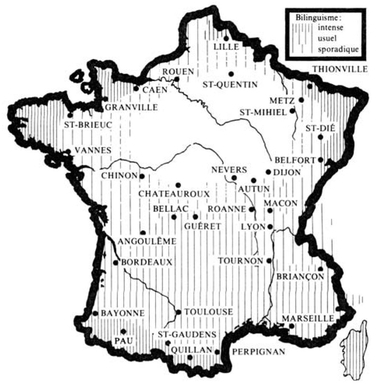
La persistance de l’usage des dialectes en France, de même que leur distribution autour de la zone du français, incitait à penser que telle était la situation au XVIIe siècle, quoique le bilinguisme y fût sans doute plus répandu. Philippe Barbaud a donc, à bon droit, eu l’idée de reporter les origines provinciales de la population de la Nouvelle-France sur la carte du bilinguisme français-dialectes de Bernard Pottier. Il peut ainsi mieux cerner la langue, de même que le degré de bilinguisme, c’est-à-dire du niveau de familiarité avec le français du Roy, que chacun apportait avec lui en Nouvelle-France. Selon soit Lortie, soit Martin, soit Pottier, on distingue ainsi les trois grandes régions d’origine de la population, que nous encerclons sur la carte suivante :
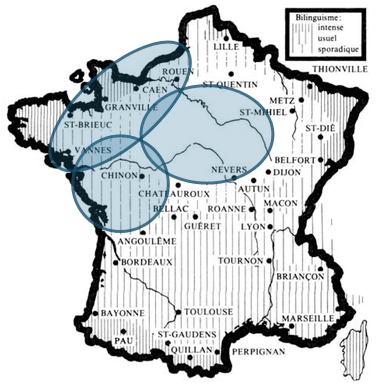
Selon la compétence linguistique, les premiers arrivants en Nouvelle-France en provenance de France, les ancêtres des Québécois de souche, se répartissaient en trois groupes :
- les uns parlaient français, soit environ 25 % de la population immigrante. Ils étaient originaires pour la plupart de l’Île-de-France et des régions avoisinantes. Nous les nommerons « les francisants » pour les distinguer des deux autres groupes;
- les autres (environ 30 % de la population) parlaient le dialecte de leur région, mais connaissaient le français et étaient capables d’en faire usage. Nous les dirons « dialectisants », pour les distinguer du groupe suivant;
- d’autres enfin, soit environ 45 % de la population, parlaient surtout leurs dialectes, mais avaient tout de même une certaine connaissance du français du Roy. Par rapport au groupe précédent, nous les dirons « patoisants ».
Malgré ces différences, l’unité linguistique de la colonie autour du français du Roy se réalise rapidement à la fin du XVIIe ou au tout début du XVIIIe siècle. Elle se produit en Nouvelle-France plus tôt qu’en France où elle ne s’amorcera qu’à partir de la Révolution, moment où prend naissance l’idéologie de l’unité linguistique de la France sous le slogan Une nation, une langue[14] et où l’emploi des dialectes sera proscrit de l’usage public et combattu par les institutions de l’État, notamment le service militaire et l’Éducation nationale. À ce moment-là, les relations avec la France seront rompues, conséquence de la cession de l’ex-colonie à l’Angleterre. La langue française en terre d’Amérique évoluera en marge de ce qui se passera en France.
Deux raisons principales expliquent cette unité linguistique rapide.
D’une part, le français du Roy est la langue des autorités politiques, donc de l’Administration de la colonie, la langue des autorités religieuses, donc de la pratique de la religion catholique avec le latin du cérémonial, des services de santé et des premières écoles, la langue des seigneurs et de la gestion des seigneuries.
D’autre part, la cohabitation forcée des émigrants sur un étroit territoire mélange la population sans tenir compte des lieux d’origine ni de la compétence linguistique des personnes. Le contact entre les différents dialectes est constant et tous les dialectisants ou patoisants sont en contact quotidien avec le français du Roy. Tous ont besoin d’une langue commune pour vivre ensemble. La situation sociolinguistique de la Nouvelle-France, sur ce point, est très différente de celle de la France de la même époque où les distances et la difficulté des communications ne favorisaient guère les contacts entre locuteurs de compétence linguistique différente.
On peut ajouter une troisième raison, dont on peut penser qu’elle a sûrement contribué à la diffusion du français du Roy, l’arrivée des Filles du Roy, épisode qui a profondément marqué le folklore des origines de la population de la Nouvelle-France. De 1663 à 1673, donc au tout début de la colonie, environ 770 jeunes femmes, célibataires ou veuves, sont recrutées en France, souvent dotées par le Roy et amenées en Nouvelle-France pour corriger le déséquilibre démographique de la colonie où il n’y avait qu’une femme pour sept hommes. Une majorité de ces femmes (58 %) provenaient de la région parisienne, parlaient français et étaient souvent instruites. Elles ont influencé la langue de leur mari et celle de leurs enfants et ainsi contribué à la diffusion du français dans la colonie naissante.
Des traces de la langue de cette époque subsistent dans le français du Québec d’aujourd’hui, par exemple la prononciation en wé du groupe wa, comme dans toi, moi, qui était la prononciation correcte à cette époque. Des mots de cette langue subsistent dans le lexique habituel des locuteurs québécois, alors qu’ils ne sont plus en usage en France ou y sont considérés comme des archaïsmes, par exemple abrier, s’abrier, achalandage, attisée, batture, bordages, brunante, bûcher (du bois), calé (chauve), creux (profond), garrocher, poudrerie, ripe (copeaux), tuque. C’est la première et la plus ancienne source de ce qu’on appelle les québécismes.
À leur arrivée, les Français entrent en contact avec les différentes tribus amérindiennes. Les relations sont amicales et plus soutenues qu’aujourd’hui. Les missionnaires, les coureurs des bois, plus tard les explorateurs apprennent leurs langues, les uns pour les évangéliser, les autres pour les besoins du commerce des fourrures ou à l’occasion de l’exploration du territoire. De nombreux mots amérindiens ou inuits, plus ou moins transformés, entrent alors dans la langue française des colons pour désigner des peuples, des lieux ou des réalités et coutumes des cultures amérindiennes et inuites.
Par exemple, des mots de ces langues sont devenus aujourd’hui des toponymes officiels : Canada, Québec, Hochelaga, Tadoussac, Rimouski, Abitibi, Témiscamingue, Chicoutimi, Gaspé, Natashquan, Anticosti[15]. D’autres mots sont entrés dans le lexique québécois pour désigner des réalités de ces cultures, par exemple achigan (variété de poisson), anorak (vêtement d’hiver), atoca (petit fruit rouge), babiche (lanière de peau), carcajou (mammifère carnivore), igloo (abri de neige), kayak (embarcation légère pontée), maskinongé (variété de poisson), mocassin (chaussure de peau), ouaouaron (grosse grenouille), pimbina (arbre à fruits rouges), squaw (femme indienne), wigwam (habitation amérindienne). Ces emprunts constituent la seconde source de québécismes, plutôt tarie aujourd’hui, sauf pour les noms propres, notamment les noms de lieux dans le Nouveau-Québec, parfois des noms de peuples qui décident de se nommer dans leurs propres langues. Ainsi, les Esquimaux ont décidé de se nommer Inuits et d’appeler leur langue inuktitut; de la même manière, les Montagnais portent depuis peu le nom d’Innus.
À la veille de la Conquête, l’identité culturelle de la Nouvelle-France est originale et distincte de celle de la métropole. La population est composée en majorité de ceux qui y sont nés, qu’on appelait les Canadiens, et de ceux qui y étaient de passage, des administrateurs, des membres du haut clergé et des officiers de la garnison. La langue commune est le français du Roy enrichi d’emprunts aux dialectes d’origine, aux langues amérindiennes et à l’inuktitut. Enfin, le territoire s’étend du golfe du Saint-Laurent aux Rocheuses vers l’ouest et jusqu’au golfe du Mexique au sud en contournant les colonies anglaises de la côte est. Mais les Français ne colonisent pas ces vastes étendues, surtout peuplées d’Amérindiens. Cependant, des toponymes d’origine française subsistent aux États-Unis et dans l’ouest du Canada et témoignent de l’époque de la Nouvelle-France, par exemple Baton Rouge, en Louisiane, ou Sault-Sainte-Marie, en Ontario.
On ne peut savoir ce que serait devenue la colonie française n’eût été la défaite des plaines d’Abraham.
2. L’irruption de la langue anglaise dans la vallée du Saint-Laurent et la réaction des Canadiens
La langue anglaise est brutalement introduite dans ce qui était jusqu’alors la Nouvelle-France à la suite de la défaite des troupes françaises sur les plaines d’Abraham en 1760.
Les Anglais découvrent que le pays est très peuplé, qu’il est bien administré et organisé, qu’ils se trouvent face à une société cimentée par la langue et la culture françaises et par la pratique de la religion catholique. Ils comprennent rapidement qu’il sera difficile, sinon impossible, de l’assimiler rapidement, à moins de la noyer dans une population de langue anglaise. Ce fut pour eux une grande surprise.
Dès la reddition de Québec en 1759 et la capitulation de Montréal en septembre 1760, les administrateurs, les officiers et les militaires français sont rapatriés en France. Environ 300 familles se joignent à eux. Restent environ 10 000 familles, quelques seigneurs devenus canadiens, une partie du clergé, les artisans et les paysans, soit plus de 65 000 personnes dont 50 000 vivent de l’agriculture. Toutes ces personnes étaient trop liées au pays pour accepter de partir.
L’embryon de système scolaire s’effondre. La grande majorité de la population devient sous-scolarisée, pour ne pas dire illettrée ou analphabète fonctionnelle[16]. Le lien entre langue écrite et langue parlée est rompu. Le français devient de plus en plus une langue de transmission orale, coupée, sauf pour une mince élite, du prestige et de l’influence normalisatrice de la langue transmise par l’école, à travers la connaissance de la grammaire, l’habitude de la lecture et la fréquentation de la littérature.
Les Anglais sont trop peu nombreux pour imposer l’usage exclusif de la langue anglaise. Les Canadiens continueront à faire usage de la langue française. Le gouvernement de Londres s’en accommodera tout en poursuivant une politique d’immigration pour augmenter la population de langue anglaise et en espérant que les Canadiens finiront par comprendre qu’ils ont tout intérêt à abandonner leur langue.
Le conquérant interdit les relations avec la France. Les conséquences en seront à la fois linguistiques et commerciales.
Le français d’ici évoluera en marge de celui de France, du moins jusqu’à ce que les relations avec la France soient officiellement renouées en 1855 avec l’arrivée de la goélette La Capricieuse dans le port de Québec. L’écart augmentera entre les deux usages, celui qui s’instaurera en France à partir de la Révolution et celui qui s’était établi en Nouvelle-France et qui sera conservé par esprit de résistance. La langue des Canadiens, surtout le lexique, s’anglicisera de plus en plus au contact des institutions britanniques, de l’imposition du code criminel anglais, de la cohabitation continuelle avec la langue anglaise de la minorité.
Les relations commerciales avec la France sont interdites. Les habitants de l’ex-colonie, les seigneurs, les marchands, les artisans, les paysans mêmes dont les fermes ont été brûlées et le bétail réquisitionné par l’armée ennemie, sont ruinés. L’argent de papier, lettres de créance et billets divers, perd la plus grande partie de sa valeur puisque la France cesse de l’honorer. Il est racheté à vil prix par les Anglais. Les marchands français se trouvent coupés de leurs fournisseurs et de leurs créanciers, en même temps que les marchands anglais de la côte est se précipitent dans la nouvelle colonie britannique pour occuper le terrain. L’anglais s’impose comme langue du commerce et des affaires et, par la suite, à même les profits réalisés, comme langue de l’industrialisation au milieu du XIXe siècle. La langue anglaise devient la langue dominante, la langue de prestige, la langue du succès économique, avec, comme conséquence sociale, la concurrence entre le français de la majorité et l’anglais de la minorité, comme conséquence linguistique, la pratique d’un bilinguisme sauvage et la lente anglicisation de la langue française. Une foule de mots anglais pénètrent dans la langue française de l’ex-Nouvelle-France, parmi lesquels il sera toujours difficile de distinguer les mots indispensables, les emprunts, des mots inutiles, les anglicismes. C’est la troisième source de québécismes.
Les Anglais deviennent maîtres du destin des Français de la Nouvelle-France. Le Parlement de Londres décidera dorénavant du sort de la nouvelle colonie britannique, et ce, jusqu’au rapatriement de la Constitution du Canada en 1982, qui n’a pu se produire, d’ailleurs, qu’avec l’assentiment du Parlement de Londres. De nos jours, l’existence d’un « gouverneur général » et de « lieutenants-gouverneurs » est la dernière trace de ce statut de colonie, symbolique sans doute, mais révélatrice de l’attachement des Canadiens anglais à leur passé, à l’Institution royale et à ce qui fut naguère l’Empire britannique.
L’administration de la nouvelle colonie se fait selon la volonté du Parlement de Londres et selon le modèle et les institutions de la démocratie anglaise.
La réaction des Canadiens à leur nouvelle situation est à la fois politique et linguistique.
Leurs premières requêtes vont à ce qui était, à leurs yeux, le plus important. Les Canadiens réclament la liberté de pratiquer la religion catholique, de parler français et de conserver la coutume de Paris comme Code civil.
Le traité de Paris de 1763 met fin officiellement à la Nouvelle-France. Le Parlement de Londres confie l’administration de la nouvelle colonie britannique, dénommée maintenant province de Québec, à un gouverneur aux pouvoirs discrétionnaires, assisté d’un conseil, mais sans chambre d’assemblée.
En ce qui concerne la religion, le traité précise que « Sa Majesté Britannique convient d’accorder aux Habitants du Canada la liberté de la religion catholique […] selon le rite de l’Église romaine en autant que le permettent les lois de la Grande-Bretagne ». Cette liberté de religion ne sera jamais remise en cause par la suite.
Dans ce traité, il n’est ni question des droits de la langue française, ni de la langue de l’administration et des lois, civiles et criminelles, de la nouvelle colonie. Les Canadiens s’engagent dans un long combat pour rester de langue et de culture françaises. Le statut de la langue française sera au cœur de ce long cheminement, dont nous évoquerons plus en détail les étapes au point suivant.
L’Acte de Québec de 1774 vient préciser le traité de Paris. Les frontières de la province de Québec sont précisées : du Labrador jusqu’aux Grands Lacs, tout au long de la vallée du Saint-Laurent, mais en excluant les territoires au sud des Grands Lacs.
Les lois civiles françaises sont rétablies, mais les lois criminelles anglaises, plus libérales, sont imposées.
Ce traité confirme également les rouages administratifs de la province : un gouverneur aux pouvoirs discrétionnaires, assisté d’un conseil législatif composé de 17 à 23 membres, dont un certain nombre de Canadiens.
La question des langues n’y est pas abordée. Dans les circonstances, un lien étroit s’établit dans l’esprit des Canadiens entre la langue française et la religion catholique par opposition à la langue anglaise liée au protestantisme. Le thème « La langue gardienne de la foi » traversera toute l’histoire du Québec jusqu’à la Révolution tranquille de 1960.
Le témoignage d’Alexis de Tocqueville est très éloquent. Lors de son voyage au Bas-Canada en 1831, il observe les difficiles relations entre les Canadiens et les Anglais. Surtout, il constate la domination complète de la minorité anglaise sur la majorité française dans tous les domaines. Il écrit :
Mais il est facile de voir que les Français sont le peuple vaincu. Les classes riches appartiennent pour la plupart à la race anglaise. Bien que le français soit la langue presque universellement parlée, la plupart des journaux, les affiches, et jusqu’aux enseignes des marchands français sont en anglais. Les entreprises commerciales sont presque toutes en leurs mains.
Les Anglais et les Français se fondent si peu que les seconds gardent exclusivement le nom de Canadiens, les autres continuent à s’appeler Anglais[17].
La réaction linguistique est plus discrète, moins affirmée, plus portée à dénoncer l’anglicisation de la langue française qu’à réclamer l’usage du français dans les secteurs clés de la vie collective, du commerce et des affaires.
La bourgeoisie instruite s’accommode, s’entiche même de la langue anglaise des nouveaux arrivants, puisqu’ils détiennent le pouvoir politique et économique. Mais elle se scandalise de l’anglicisation de plus en plus marquée de la langue française. Elle dénonce la dégradation de la langue et fait appel à la fierté et à la responsabilité des locuteurs individuels à qui elle demande de défendre la langue française contre l’envahissement de la langue anglaise et de veiller à la qualité de leur usage personnel de la langue. De nombreux recueils d’anglicismes sont alors publiés, sur le modèle Dites… ne dites pas durant le XIXe siècle jusqu’aux années 1950-1960.
Mais, en même temps, cette même bourgeoisie laisse aux anglophones toute latitude d’imposer la langue anglaise comme langue du commerce, de l’affichage et de l’industrialisation, sans songer à y opposer la moindre restriction. Jusqu’à la Révolution tranquille, ce sera la loi de la libre concurrence entre les langues qui prévaudra dans ces domaines.
Et elle laisse le gros de la population francophone, plus ou moins instruite, se débrouiller comme elle le peut face à la langue anglaise, au moment où se constitue la classe ouvrière du Québec à même la migration vers les villes de la population des campagnes.
La contradiction entre ces deux attitudes est totale et dramatique pour la langue française. Nous en subissons encore aujourd’hui les conséquences.
Les lignes de force de l’avenir de l’ex-colonie se mettent en place dès ces premières années.
La dualité entre la langue française et la langue anglaise façonnera peu à peu ce qui deviendra par la suite le Canada et le Québec, selon une dichotomie de plus en plus accentuée entre deux allégeances culturelles, l’une, anglo-saxonne, l’autre française; la première, majoritaire au Canada, la seconde, majoritaire uniquement au Québec. La question du caractère distinct du Québec, héritier de la Nouvelle-France, deviendra de plus en plus cruciale. Elle n’a reçu aucune réponse satisfaisante jusqu’à aujourd’hui.
En effet, pendant une très longue période, soit du traité de Paris en 1763 jusqu’au milieu du XXe siècle, plus précisément jusqu’à la Loi sur les langues officielles de 1969 pour leur statut au Canada et jusqu’à la Loi sur la langue officielle de 1974 pour le statut du français au Québec, la langue française et la langue anglaise sont demeurées sans statut bien défini.
Nous n’évoquerons pas ici les nombreux événements politiques qui se sont produits pendant ces deux siècles et qui ont eu des incidences linguistiques[18]. Le faire nous éloignerait trop de notre propre objectif, l’histoire de la renaissance sociopolitique de la langue française au Québec à partir de 1950.
Par contre, il est pertinent de relater les péripéties politiques du long entêtement des Canadiens français à réclamer inlassablement que soit précisé le statut de leur langue dans la nouvelle colonie britannique.
3. La langue française à la recherche d’un statut
Une langue maternelle et la culture qu’elle véhicule ne se quittent pas facilement. Les Français de la Nouvelle-France, devenus britanniques malgré eux, ont tout naturellement persisté à parler français, en demandant avec insistance et constance au nouveau pouvoir politique de leur en garantir le droit. Cette volonté et cette exigence se sont transmises d’une génération à l’autre jusqu’à nos jours, malgré les incitations ou la tentation, elles aussi toujours renouvelées, de céder à l’attrait de la langue anglaise.
Il faudra de longues années, et de dures luttes politiques, pour que la langue française obtienne un statut précis.
Le traité de Paris de 1763, qui confirmait la cession de la Nouvelle-France à l’Angleterre, ne fait aucune mention de la ou des langues de l’administration et des lois, ni des droits accordés à la langue française.
En l’absence de toute précision s’amorce alors la libre concurrence entre la langue française de la majorité et la langue anglaise de la minorité. La pratique du bilinguisme se met en place, les deux groupes linguistiques utilisant, imposant ou défendant leur propre langue selon les circonstances.
En 1774, au moment des discussions qui mèneront à l’adoption de l’Acte de Québec, les demandes des Canadiens sont plus précises. Ils réclament qu’une assemblée législative soit créée pour diriger le pays conformément aux institutions de la démocratie britannique, que le français en soit la langue, de même que la langue de la justice et de l’administration.
La réponse de Londres est tout aussi précise : il est prématuré d’accorder une Chambre d’assemblée à la colonie; le nombre de membres du conseil auprès du gouverneur est augmenté pour y inclure plus de Canadiens (8 membres sur 27). Les lois civiles françaises sont rétablies. Il n’est question ni du statut de la langue française, ni de celui de la langue anglaise. La concurrence entre le français et l’anglais se poursuit, de même que le bilinguisme.
En 1783, à la suite de la guerre d’Indépendance des États-Unis, près de 6 000 Loyalistes préfèrent immigrer dans la colonie restée britannique plutôt que de devenir Américains.
La majorité d’entre eux s’installe au nord du lac Ontario à la demande du gouverneur Haldimand. Ces Loyalistes seront le noyau de la population de la future province d’Ontario.
Une minorité d’entre eux s’établit au sud de la vallée du Saint-Laurent, près de la nouvelle frontière, dans cette région qui deviendra plus tard les Cantons-de-l’Est.
À leur arrivée, les Loyalistes sont surpris de se trouver dans un pays de langue française, sans institution parlementaire. Ceux du nord du lac Ontario demandent d’être séparés du reste de la colonie.
La concurrence entre le français et l’anglais s’intensifie.
En 1791, le Parlement britannique prend la décision de diviser la province de Québec en deux unités administratives distinctes, le Haut et le Bas-Canada. Le Haut-Canada (l’Ontario d’aujourd’hui) pour les colons anglais ou les Loyalistes au nombre d’environ 15 000, le Bas-Canada (le Québec) pour les Canadiens, au nombre d’environ 140 000 sur une population totale d’environ 150 000 personnes.
L’administration de la colonie est confiée à un gouverneur général, avec droit de veto, assisté d’un conseil exécutif.
Dans chaque nouvelle province, un lieutenant-gouverneur est nommé, assisté d’un conseil législatif dont les membres sont nommés à vie par le Roy. Le Conseil législatif du Bas-Canada est composé majoritairement d’Anglais, quoiqu’ils ne représentent qu’à peine 7 % de la population, qui défendent les intérêts britanniques. Chaque province est dotée d’une Chambre d’assemblée (Parlement) élue par le peuple. Ces dispositions comportent cependant un vice fondamental : le Conseil exécutif et le Conseil législatif peuvent faire échec indéfiniment à la Chambre d’assemblée.
Aucune mention du statut des langues, du français ou de l’anglais, n’est faite dans le texte de la loi du Parlement britannique de 1791 instituant les deux provinces et créant une administration centrale qui les coiffe.
Le premier Parlement du Bas-Canada est composé de 60 Français et 20 Anglais. Lors de la première session de la Chambre d’assemblée (du Parlement) en janvier 1793, le débat porte uniquement sur la langue des lois. Décision de Londres : elles seront édictées en langue anglaise avec traduction en langue française, ce qui accélérera l’anglicisation de la langue française juridique. Dans tous les autres domaines, la libre concurrence des langues se poursuit.
Une suite d‘événements surviennent alors, dans le Bas-Canada, entre 1834 et 1837, qui conduiront les Canadiens à s’opposer de plus en plus aux conséquences de la loi de 1791. Les motifs de mécontentement sont nombreux.
Le régime administratif de 1791 favorise dans le Bas-Canada la prépondérance des deux conseils sur la Chambre d’assemblée. Les Canadiens protestent contre le peu d’autonomie du Parlement élu et demandent que le Conseil législatif soit lui aussi élu. Ils demandent ni plus ni moins la souveraineté politique.
Ils formulent leurs griefs sous la forme de 92 Résolutions. Une seule (n° 52) traite indirectement de la langue en affirmant le caractère français du Bas-Canada et en constatant que la langue française est devenue prétexte d’exclusion, d’infériorité politique et de discrimination des droits des citoyens français à l’avantage des citoyens anglais.
Les hommes politiques de Grande-Bretagne sont d’accord pour donner satisfaction aux Canadiens tout en voulant demeurer maîtres de la vallée du Saint-Laurent. Ils nomment un nouveau gouverneur général, Archibald Gosford. Celui-ci propose à Londres une nouvelle composition du Conseil exécutif à majorité canadienne (5 Canadiens pour 3 Britanniques) et un Conseil législatif lui aussi à majorité canadienne (10 membres dont seulement 3 Britanniques).
Les Anglais sont furieux de ces concessions. Ils comprennent que les Canadiens visent et pourraient obtenir le vrai pouvoir. Ils organisent la résistance, au besoin par les armes. Ils forment un organisme paramilitaire, le Doric Club. Ils proposent l’union des deux Canadas pour obtenir la majorité.
La discussion s’éternise. Les Canadiens restent fermes sur leur position. Ils organisent des assemblées populaires pour augmenter l’appui du peuple à leurs députés. Le nouveau gouverneur général Gosford intervient et interdit ces assemblées. Mgr Lartigue le soutient en rappelant aux Canadiens qu’il n’est « jamais permis de transgresser des lois ou de se révolter contre l’autorité légitime sous laquelle on a le bonheur de vivre ». En réaction au Doric Club, les Canadiens fondent les Fils de la Liberté. Le 6 novembre 1837, des membres du Doric Club attaquent les Fils de la Liberté. Gosford émet des mandats d’arrêt contre les principaux chefs des Patriotes accusés de trahison.
La situation dégénère. En 1837, la Rébellion des Patriotes éclate. Elle est violemment réprimée par les troupes britanniques à la demande du gouverneur général, Lord Archibald Gosford.
À la suite de cette rébellion, Gosford démissionne. Londres nomme Lord Durham gouverneur général du Canada et lui confie le soin de faire enquête et de prendre les mesures pour apaiser l’éternel conflit entre les Canadiens et les Anglais.
Durham recommande l’union des deux Canadas, qui donnerait la majorité aux Anglais (400 000 Anglais dans le Haut-Canada, 150 000 dans le Bas-Canada contre 450 000 Canadiens au total). Il préconise également une politique d’immigration de citoyens britanniques pour augmenter davantage cette mince majorité, pour accélérer la subordination politique des Canadiens et accroître ainsi leur infériorité économique et leur médiocrité culturelle.
L’Acte d’Union des deux Canadas est décrété en 1841. La nouvelle entité politique est dénommée Province du Canada ou Canada-Uni.
La loi maintient un régime administratif analogue au précédent : un Gouverneur, chef véritable du gouvernement, un Conseil exécutif non responsable devant la Chambre, un Conseil législatif nommé par le Roy et une Chambre d’assemblée composée d’un nombre égal de députés, soit 42, élus dans les anciens Haut et Bas-Canadas, bien que le Bas-Canada soit plus peuplé. Le Parlement du Canada-Uni est établi à Montréal en 1843. L’article 41 de la nouvelle Constitution fait de l’anglais la seule langue officielle du Canada-Uni.
Cependant, dès l’ouverture du Parlement, La Fontaine défend les droits du français comme langue parlementaire. En 1848, l’article 41 est abrogé. On revient au bilinguisme de facto, sans préciser le statut des langues.
Les réformistes du Haut et du Bas-Canada, menés respectivement par Robert Baldwin et Louis-Hippolyte La Fontaine, réclament toujours que le Conseil exécutif soit redevable devant la Chambre, ce qui est la caractéristique essentielle d’un gouvernement vraiment responsable. Les élections de 1847 donnent une nette majorité aux réformistes. Le gouverneur, Lord Elgin, suivant les instructions de Londres, accepte le principe de la responsabilité ministérielle qui réduit considérablement les pouvoirs du Gouverneur. Il invite Baldwin et La Fontaine à former un nouveau cabinet. En 1849, à l’ouverture de la session du gouvernement, le gouverneur Elgin lit le discours du trône en anglais et en français. Le ministère Baldwin-La Fontaine propose et fait voter une indemnité aux habitants du Bas-Canada qui ont subi des dommages lors des événements de la Rébellion de 1837, tout comme les habitants du Haut-Canada en avaient profité quelques années auparavant.
Tous ces événements, la révocation de l’article 41, l’affaiblissement de l’autorité du Gouverneur, garant de la suprématie britannique, l’indemnisation des Canadiens, véritable prime à la révolte, c’en est trop pour les marchands tories et orangistes britanniques de Montréal qui organisent un grand rassemblement de leurs partisans devant le parlement. La réunion tourne à l’émeute : l’immeuble du parlement est envahi par la foule, saccagé et incendié.
L’Union des deux Canadas deviendra rapidement une impasse politique.
Les quatre régions de l’époque, qui correspondent en gros au Québec, à l’Ontario, à la Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick, voient la nécessité d’unir leurs intérêts tout en assurant à chacune une certaine autonomie. Le gouvernement britannique ne s’y oppose pas et laisse aux Canadiens le soin d’élaborer eux-mêmes une nouvelle constitution. Elle sera votée comme un simple bill privé par le Parlement de Londres, sous le titre de Acte de l’Amérique du Nord britannique, et officialisée par une proclamation royale le 24 mai 1867, avec entrée en vigueur le 1er juillet suivant.
La Constitution prévoit un régime administratif à deux paliers, provincial et fédéral, chacun doté de ses propres organes de gouvernement. Elle partage les pouvoirs et les domaines de compétence entre les deux niveaux de gouvernement, selon les intérêts et contraintes budgétaires de l’époque. Un seul article, l’article 133, traite de l’usage des langues, française et anglaise, mais uniquement dans les Chambres du Parlement du Canada et de la Législature du Québec : dans ces deux instances, les lois et les procès-verbaux doivent être rédigés dans les deux langues et l’usage de l’une ou de l’autre dans les débats est, en principe, libre et facultatif. Les autres provinces n’ont pas cette obligation. Pour tout le reste, la libre concurrence des langues est maintenue comme règle. Le sort des Canadiens français hors Québec n’est pas évoqué.
Les Canadiens de naguère deviennent les Canadiens français, les Anglais, les Canadiens anglais, même si la dénomination contrastée, les Français et les Anglais, est demeurée vivante jusqu’à nos jours.
La Confédération donnera encore plus de poids à la langue anglaise au Canada et au Québec. L’anglicisation de la langue française se poursuit et le caractère dominant de la langue anglaise s’accentue. La langue française devient de plus en plus minoritaire dans l’ensemble du Canada du fait de l’immigration et de l’augmentation de l’emploi de la langue anglaise comme langue commune. Le français est de peu de poids dans l’ensemble du continent nord-américain. La situation de la langue française continue de se détériorer lentement.
Au Québec, la population demeure majoritairement de langue française malgré le fait que les nouveaux arrivants aient tendance à choisir la langue anglaise et à s’intégrer à la communauté de langue anglaise à l’exemple de tous les autres immigrants du reste du Canada. Les Anglais sont minoritaires, il est vrai, mais ils détiennent cependant le pouvoir économique, ce qui incite les Canadiens français à sous-estimer le fait qu’ils sont majoritaires. La concurrence entre le français et l’anglais s’amplifie. L’anglais acquiert rapidement le statut de langue dominante, à cause de sa prépondérance dans les activités économiques au Québec, dans la vie politique canadienne et dans l’administration fédérale.
À partir de 1940, la politique du gouvernement du Canada est de plus en plus centralisatrice. La tendance au Parlement d’Ottawa est de s’ingérer dans les champs de compétence exclusive des provinces, selon la Constitution de 1867, grâce à son pouvoir de dépenser. En effet, les revenus du gouvernement fédéral ont augmenté et dépassé largement ses dépenses, alors que ceux des provinces n’étaient plus adaptés à l’augmentation de leurs dépenses dans les domaines de leur compétence, l’éducation, la santé, l’administration des villes et villages, la culture
L’approfondissement de la situation du français face à l’anglais
Entre 1950 et 1970, les intellectuels de langue française commencent à regarder d’un autre œil la situation des Canadiens français au Canada et au Québec par rapport à celle des Canadiens anglais. Tout est remis en cause.
Le conservatisme de l’époque, appuyé par l’Église, incarné sur le plan politique par l’Union nationale de Maurice Duplessis, inspiré d’un nationalisme rétrograde, leur apparaît comme une démission, comme l’acceptation du statu quo découlant du rapport de force issu des conséquences de la Conquête. Tant que ce conservatisme sévira, l’avenir du Québec sera bloqué, sans issue.
Dans ce contexte, la langue française est vouée à une lente dégradation et à n’être plus d’aucune utilité tant économique que politique, sauf en ce qui touche à la gestion des affaires de la « province » et encore, pas dans le domaine financier puisque le ministère des Finances est le plus souvent confié à un ministre de langue anglaise pour mieux faire le pont avec le capitalisme anglo-saxon ambiant. Ainsi, la sujétion des Canadiens français est décrite et contestée par des intellectuels dans le même esprit qui inspirait à cette époque le grand mouvement des Indépendances[19] dans les pays colonisés par la France. Leur critique est féroce. La situation de la langue française au Canada et au Québec leur semble symbolique du peu de prestige des Canadiens français, langue d’un peuple ignorant et sans culture, langue d’ouvriers soumis à la langue anglaise des usines, langue de paysans sous la tutelle du clergé, langue transmise par la tradition orale et en voie de créolisation.
Les contestataires fondent des revues où ils pourront s’exprimer, Cité libre (1950), Liberté (1959), Parti pris (1963). Ils publient des essais, souvent polémiques, pour étoffer leur analyse et leur critique de la situation. Les journalistes relaient ces mouvements d’idées vers le grand public, qui commence, lui aussi, à se convaincre que le statu quo n’est plus acceptable, qu’un autre avenir est possible pour le peuple québécois, que les vieux partis politiques sont dépassés, qu’ils doivent se transformer et renouveler leurs objectifs pour concrétiser les nouvelles aspirations des Canadiens français, leur façonner un nouvel avenir et leur ouvrir de nouvelles ambitions, personnelles et collectives.
Une nouvelle génération de politiciens surgit du même mouvement de contestation, dont ils prennent en charge les consensus qui en émergent pour les transformer en éléments de programme politique, à la condition cependant que ces consensus soient partagés par une large frange de la population.
Pour sonder l’opinion publique, les gouvernements, du Québec et du Canada, créent, durant cette période, trois importantes commissions d’enquête : en 1961, la Commission royale d’enquête sur l’enseignement dans la province de Québec, en 1963, la Commission d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme au Canada et, en 1968, la Commission d’enquête sur la situation de la langue française et sur les droits linguistiques au Québec. Ces commissions donnent aux intellectuels de nouvelles occasions et les moyens financiers de poursuivre plus en profondeur l’analyse de la situation de la langue française au Québec et au Canada. Il deviendra alors de plus en plus évident que la question de la langue est à la fois d’ordre linguistique (la « qualité de la langue »), mais aussi, et davantage, une question de statut du français par rapport à l’anglais.
Ainsi, la question essentielle est posée, celle de l’avenir du Québec et, par ricochet, du Canada français. Quel est le plus important pour la langue française et pour le Québec : faire du Canada un pays véritablement bilingue, from coast to coast, ou faire du Québec un pays de langue française? La réponse met en cause deux approches antagonistes, une approche fédéraliste selon la tradition des deux peuples fondateurs dans l’esprit de la Confédération de 1867 et une approche du nationalisme en voie de renouvellement, qui affirme le caractère français du Québec.
Les débats modifieront peu à peu la perception qu’ont les Québécois et les Québécoises d’eux-mêmes, de leur langue, de leur situation et de leur avenir au Québec, au Canada et dans le monde.
Nous nous proposons ici d’évoquer les points forts de cette prise de conscience.
1. Nouveaux regards sur la langue française et son avenir durant les années 1950 et 1960
La critique de la langue parlée et écrite par les Canadiens français s’accentue durant cette période et débouche sur une critique de l’enseignement du français, langue maternelle, dans les écoles de l’époque, qui relevaient alors du Département de l’Instruction publique.
Le 21 octobre 1959, André Laurendeau[20], sous le pseudonyme de Candide, publie un billet dans la chronique L’actualité intitulé « La langue que nous parlons ». Il reprend à son compte le terme joual pour stigmatiser la langue parlée des élèves de l’école publique, un terme méprisant dont Pierre Elliott Trudeau[21] inventera plus tard l’équivalent en langue anglaise : lousy french (lousy = pouilleux, moche, dégueulasse). Laurendeau écrivait :
Faut-il expliquer ce que c’est que parler joual, [...] Tout y passe : les syllabes mangées, le vocabulaire tronqué ou élargi toujours dans le même sens, les phrases qui boitent, la vulgarité virile, la voix qui fait de son mieux pour être canaille. [...] Une conversation de jeunes adolescents ressemble à des jappements gutturaux. De près, cela s’harmonise mais s’empêtre : leur langue est sans consonnes, sauf les privilégiées qu’ils font claquer. Et parfois à la fin de l’année ils vous rapportent un prix de bon langage. Ça vous fait froid dans le dos. [...] D’ici là on nous permettra de nous effrayer de l’effondrement que subit la langue parlée au Canada français. Certains individus progressent, mais la moyenne ne cesse de baisser[22].
L’étiquette joual a connu un succès durable puisqu’elle est toujours utilisée de nos jours, le plus souvent avec une connotation péjorative.
Ce billet à l’emporte-pièce stimula un frère enseignant qui écrivit une longue lettre à André Laurendeau. Celui-ci y trouva une si évidente confirmation de son opinion qu’il décida de la publier. Pour ne pas compromettre l’auteur, il lui attribua le pseudonyme de Frère Untel[23]. Cette première lettre parut dans Le Devoir le 3 novembre 1959. Elle « créa un joli tumulte. Pendant des mois, tout le monde lisait et discutait les réponses outragées ou enthousiastes qui paraissaient dans Le Devoir. Et tout le monde attendait la prochaine lettre du Frère Untel. Il en parut une douzaine entre novembre 1959 et juin 1960. Autant de coups de tonnerre dans le ciel lourd d’un Québec au bord du grand orage[24]. »
Jacques Hébert, alors directeur des Éditions de l’Homme, décide de publier en un volume les lettres du Frère Untel sous le titre Les Insolences du Frère Untel. Le livre parut le 6 novembre 1960 et connut sur-le-champ un succès fulgurant, vingt-huit mille exemplaires vendus en trois semaines, cent mille après quatre mois, du jamais-vu dans l’édition québécoise. Un vrai phénomène social sur un sujet au premier abord peu populaire, la langue que nous parlons.
Pour le comprendre, il faut relire la première lettre, en découvrir le ton, net et sans détour, découvrir surtout la grande liberté de parole et de style que se permet le Frère Untel, la colère sourde de cet enseignant point trop grincheux, qui « aime l’enseignement, [mais qui] trouve désespérant d’enseigner le français parce que nos élèves parlent joual, écrivent joual et ne veulent pas parler ni écrire autrement. Les choses se sont détériorées à tel point qu’ils ne savent même plus déceler une faute. » Le Frère Untel continuait : « J’ai lu dans ma classe, au moment où elle a paru, L’actualité de Laurendeau. Les élèves ont reconnu qu’ils parlaient joual. L’un deux, presque fier, m’a même dit : “On est fondateur d’une nouvelle langue!” Ils ne voient donc pas la nécessité d’en changer. “Tout le monde parle comme ça” me répondaient-ils. Ou encore : “On fait rire de nous autres si on parle autrement que les autres”, ou encore, et c’est diabolique comme objection : “Pourquoi se forcer pour parler autrement, on se comprend” ». Surtout, le Frère Untel attribue sans détour l’existence du joual à la décadence de la culture : « Cette absence de langue qu’est le joual est un cas de notre inexistence, à nous, les Canadiens français. […] On est ainsi au cœur du problème, qui est un problème de civilisation. Nos élèves parlent joual parce qu’ils pensent joual, et ils pensent joual parce qu’ils vivent joual, comme tout le monde par ici. [...] C’est toute notre civilisation qui est jouale, on ne réglera rien en agissant au niveau du langage lui-même (concours, campagne de bon parler français, congrès, etc.). » Le Frère Untel conclut que « pour nous guérir, il nous faudrait des mesures énergiques. La hache!, la hache!, c’est à la hache qu’il faut travailler [25]. »
La publication de ces Insolences provoqua un grand choc dans l’opinion publique du Québec, tant au sujet de la langue qu’à celui de l’enseignement du français. En réponse à cette double inquiétude, le gouvernement libéral de Jean Lesage adopte deux mesures : en mars 1961, il crée un Office de la langue française et il lance une commission d’enquête sur l’enseignement en avril de la même année, dont nous traiterons en détail au point suivant.
Le mandat de l’Office de la langue française est alors strictement d’ordre linguistique : « veiller, sous la direction du ministre, à la correction et à l’enrichissement de la langue parlée et écrite[26] ».
Les premiers travaux de l’organisme sont symboliques de ce mandat : début des travaux de lexicologie et de terminologie pour lutter contre les anglicismes et pour améliorer et enrichir le vocabulaire des Canadiens français; mise en place d’un service de consultation téléphonique gratuit pour répondre aux questions tant du grand public que des traducteurs, des journalistes, des publicitaires; amorce d’une collaboration avec le ministère de l’Éducation dès sa création en 1964, surtout pour veiller à la qualité de la langue des manuels; collaboration également avec les agents d’information de tous les autres ministères. L’Office prend officiellement position, en 1965, sur La norme du français écrit et parlé au Québec : respect intégral de la morphologie et de la syntaxe de la langue française, mais, dans le lexique, les mots et expressions propres et nécessaires au Québec sont admis. En 1969, pour illustrer ce dernier principe, l’Office publie les Canadianismes de bon aloi, timide début du nécessaire travail de tri des éléments du lexique en usage au Québec, mélange de vieux mots, d’anglicismes, d’emprunts à la langue anglaise, aux langues amérindiennes et à l’inuktitut. En 1970 paraît une plaquette intitulée Quel français devons-nous enseigner?, première et seule prise de position officielle de l’Office sur ce sujet toujours et sans cesse débattue depuis lors dans une grande confusion d’opinions et de points de vue.
La création de l’Office a suscité à la fois enthousiasme et méfiance, pour la même raison d’ailleurs, la crainte du dirigisme linguistique. Nous écrivions à ce sujet en 1965 :
Le dirigisme linguistique a mauvaise presse aujourd’hui, alors qu’il a toujours existé et qu’il existera toujours. On ne peut évidemment régler l’évolution linguistique d’une communauté à coups de décrets. En ce sens, le dirigisme linguistique est stérile. Mais on peut orienter cette évolution, d’où un dirigisme dans le sens propre du terme. L’Office de la langue française du Québec tente l’aventure d’une forme souple et intelligente de dirigisme normatif : être la conscience vigilante de l’évolution linguistique qui, dans son essence même, est un phénomène inconscient, souterrain, puisqu’il se déroule au plus profond de la masse des usagers de la langue. Dans toute société, l’autorité linguistique existe, mais c’est un fait mal connu et mal défini[27].
En réaction au joual-mépris de Laurendeau et du Frère Untel, qui marque le sommet du dénigrement du français au Québec, des écrivains, plus ou moins regroupés autour de la revue Parti pris[28] choisissaient de faire du joual leur langue d’écriture, en tout ou en partie, aussi bien dans le récit que dans les dialogues. Au joual-mépris, ils opposaient le joual-fierté. Ces écrivains étaient nombreux et ont créé un véritable courant littéraire : Jacques Renaud, André Major, Gérald Godin, Claude Jasmin, Michel Tremblay, pour ne nommer que les plus connus, empruntaient largement à la langue populaire. Leur intention n’était pas de consacrer le joual en en faisant une langue littéraire. Ils voulaient plutôt provoquer un scandale et une prise de conscience collective de l’état de dégradation dans lequel l’ignorance et la négligence plongeaient la langue française au Québec. Ils voulaient surtout montrer à quel point la langue française avait dégénéré depuis que la langue anglaise lui faisait concurrence. En donnant un visage littéraire au joual, ils espéraient déclencher un sursaut de fierté blessée, susciter un mouvement de revalorisation du français, d’amélioration du français que nous parlons. Depuis lors, l’emploi du joual comme langue d’écriture s’est poursuivi, quoique les motifs n’en soient plus ni aussi nobles ni aussi militants qu’à l’époque de Parti pris.
D’autres intellectuels entreprenaient, durant ces mêmes années, de démontrer que la question de la langue au Québec n’est pas uniquement ni surtout une question d’ordre linguistique, mais d’abord et avant tout un problème d’ordre économique et politique. La qualité de la langue au Québec, soutenaient-ils globalement, dépend de son statut. « En fait, écrivait Fernand Ouellette[29] en 1964, ce sont des facteurs extralinguistiques qui déterminent la force ou la faiblesse des langues en lutte et leur situation respective[30]. » Si la langue française est, de l’avis le plus répandu, en un si piètre état, ce n’est donc pas uniquement à cause de la négligence de ses locuteurs, mais bien parce que des conditions politiques et économiques défavorables en restreignent l’emploi généralisé, en provoquent la contamination par la langue anglaise, en somme, parce qu’elle n’a plus l’espace de s’épanouir. Le regard sur la situation de la langue française change de direction et la question devient : quels sont ces facteurs extralinguistiques qui entraînent la dégénérescence de la langue française au Québec et dans le reste du Canada?
La réponse la plus évidente est la prépondérance de la langue anglaise sur la langue française qui s’est intensifiée de décennie en décennie depuis la Défaite/Conquête de 1760. Tous en sont conscients. La pratique du bilinguisme qui en découle est inégalitaire et injuste : les anglophones peuvent demeurer unilingues, même au Québec où la majorité de la population est pourtant de langue française. Ils n’ont pas besoin d’apprendre le français puisque les Québécois sont bilingues ou s’arrangent pour baragouiner l’anglais quand c’est nécessaire, par exemple pour être servis dans les magasins ou pour travailler dans des entreprises ou des bureaux dirigés et gérés en langue anglaise par des patrons anglophones, le plus souvent unilingues. Cette situation ressemble beaucoup à celle des pays colonisés qui, à la même époque, luttaient pour échapper à la domination des puissances européennes, ou, à tout le moins, pour récupérer les moyens de maîtriser eux-mêmes leur propre destin en modifiant leur statut face aux pays colonisateurs. Le grand mouvement des Indépendances occupait alors toute l’actualité des médias. Un livre paraît en 1957 qui sera beaucoup lu par les intellectuels canadiens-français et qui les inspirera, celui d’Albert Memmi, Portrait du colonisé, précédé du Portrait du colonisateur[31]. Ce livre fut si populaire qu’il en parut une édition canadienne en 1972 suivi du compte rendu d’une discussion de l’auteur avec des étudiants de l’École des HEC de Montréal sous le titre révélateur de la lecture que faisaient les francophones de son ouvrage Les Canadiens français sont-ils colonisés?[32] Pierre Vallières[33] l’avait certainement lu et s’en souvenait quand il décrivit, en 1968, la manière dont il percevait la situation des Canadiens français dans un ouvrage intitulé Nègres blancs d’Amérique[34].
Le regard sur la langue française se radicalise. L’idée d’un Québec uniquement de langue française est mise de l’avant. En 1963, Jean-Marc Léger[35] écrit : « L’unilinguisme français au Québec est une question de vie ou de mort pour le Canada français[36]. » Cet objectif d’unilinguisme français découle, pour tous les intellectuels de l’époque, d’un objectif plus global : créer au Québec une société où il ne serait plus indispensable d’être bilingue pour vivre et pour réussir, une société où la langue française, poursuit Léger, serait « la langue de l’activité quotidienne, du travail, du progrès économique et technique, de l’avancement, l’instrument normal d’expression, de communication et d’échanges dans tous les secteurs et à tous les niveaux ». L’opposition au bilinguisme généralisé devient de plus en plus forte, surtout à partir de la création de la Commission sur le bilinguisme et le biculturalisme en 1963, dite commission Laurendeau-Dunton. Serait-il suffisant de modifier la pratique du bilinguisme pour améliorer la situation de la langue française, au Québec surtout, ou pour freiner l’anglicisation croissante de la syntaxe et du lexique du français du Québec? Rien n’est moins certain. D’un autre point de vue, cette idée d’unilinguisme du Québec exclurait-elle tout emploi de la langue anglaise?, solution qui serait totalement impossible, voire utopique, puisqu’il faudra bien, de toute manière, communiquer avec le reste du Canada et avec les États-Unis, ne serait-ce que pour les besoins des relations commerciales. Le rôle et le statut de la langue anglaise par rapport à la langue française sont remis en cause, même dans l’hypothèse, que plusieurs avancent, où le français serait déclaré langue prépondérante. Ce courant d’idées met en lumière la question essentielle : comment concilier l’unilinguisme éventuel du Québec avec la nécessité d’une certaine forme de bilinguisme?
Ces questions d’intérêt général ne peuvent être réglées par les seuls citoyens ou par les groupes de pression en présence. L’État doit s’en mêler. En matière de langues, il ne peut s’en tenir à la langue française elle-même, qualité et enseignement. Il est urgent que le gouvernement du Québec élargisse son engagement à l’égard de la langue française en adoptant une politique de la langue même si cette « idée [est] relativement jeune [et] étonne nombre de citoyens et en fait bondir d’autres », écrivait Jean-Marc Léger en 1964[37]. Chacun y va de sa proposition quant au contenu d’une semblable politique. Peu à peu, l’unanimité se crée sur les points essentiels qu’elle devrait aborder : la langue de travail, l’affichage public et la publicité, la langue du commerce et des affaires, la langue des relations de l’État avec les citoyens. Mais les avis demeurent très partagés sur le statut à accorder au français et à l’anglais. Les uns proposent que le français et l’anglais soient l’un et l’autre reconnus comme langues officielles, notamment au Canada. Les deux langues pourraient être également officielles au Québec, mais à la condition que le français, langue de la majorité des citoyens, y soit déclaré langue prédominante ou langue prioritaire, l’adjectif varie d’un auteur à l’autre. D’autres proposent que le français soit la seule langue officielle du Québec (l’idée de J.-M. Léger était devenue plus acceptable, moins révolutionnaire qu’elle n’avait semblé sur le coup), tout en admettant que les anglophones demeurent de langue anglaise, à condition cependant qu’ils apprennent le français comme langue seconde, tout comme les francophones apprennent l’anglais. On se prononce peu sur la place et l’importance qu’il faudrait accorder à la langue anglaise dans les entreprises ou dans le domaine de commerce et des affaires.
Enfin, on commence à prendre conscience que les immigrants choisissent de plus en plus de s’intégrer à la communauté de langue anglaise, conséquence du peu de prestige et d’utilité de la langue française. À long terme, et si rien n’est fait, les Canadiens français risquent de devenir de moins en moins majoritaires, surtout à Montréal où se concentrent les immigrants. L’inquiétude est d’autant plus vive que le nombre d’enfants par famille de langue française avait commencé à diminuer. Le gouvernement du Québec n’avait, à cette époque, aucune influence sur la politique d’immigration ou sur la sélection des immigrants, l’une et l’autre sous le contrôle du seul gouvernement fédéral. Le gouvernement du Québec mettra beaucoup de temps à s’intéresser à cet aspect de la question linguistique. L’affaire de Saint-Léonard, dont nous traiterons par la suite, le forcera à s’y intéresser sérieusement.
En somme, durant ces années de la Révolution tranquille où tout est remis en cause après la longue période d’immobilisme des années Duplessis, les idées fusent, la discussion est vive, l’audace et l’imagination sont au pouvoir, mais les propositions demeurent floues, trop abstraites pour qu’une politique linguistique réaliste et applicable puisse être conçue. Aucun gouvernement ne songe alors à s’engager dans cette voie socialement et politiquement périlleuse. Il faudra attendre quelques années encore.
2. La commission Parent (1961) ou comment mettre fin à la sous-scolarisation des Québécois de langue française
Le très faible niveau de scolarisation des francophones du Québec est l’un des facteurs, mais pas le seul, qui a contribué à détériorer la situation de la langue française au Québec face à la langue anglaise.
La majorité de la population francophone était si peu instruite que les Canadiens français ne pouvaient participer à l’industrialisation du Québec que comme main-d’œuvre, au mieux à des postes de contremaîtres. Nous étions nés, disait l’adage, pour un petit pain. Les anglophones, et surtout la direction des entreprises, partageaient amplement la même conviction.
Quelques statistiques empruntées aux documents anciens montrent l’ampleur et la persistance, d’une décennie à l’autre, du faible taux de scolarisation des Canadiens français jusqu’en 1960[38].
Indice du faible taux de scolarisation de la population entre 1827 et 1960
En 1827, sur 87 000 signataires d’une pétition au gouverneur Dalhousie, 78 000 ne signent que d’une croix, soit 89,6 %.
En 1842, le taux de la fréquentation scolaire au Québec est de 4,4 %, soit 4 935 enfants sur une population d’âge scolaire de 111 544 enfants.
En 1855, les collèges classiques[39], seules voies d’accès à l’université, reçoivent moins de 1 % (0,79 %) d’une population d’environ 300 000 jeunes.
En 1871, la population francophone dispose de huit établissements d’enseignement supérieur, fréquentés par 751 élèves.
En 1891, 29,6 % de la population du Québec est analphabète, contre 15 % au Nouveau-Brunswick, 13,8 % en Nouvelle-Écosse et 7 % en Ontario.
Entre 1910 et 1915, nous savons que le taux de persévérance scolaire diminue rapidement au cours du primaire : le gros des élèves se retrouvent dans les trois premières années et décroît rapidement ensuite pour atteindre environ 1 % en 7e année.
En 1927, une commission d’enquête estime qu’à Montréal, 94 % des élèves quittent l’école avant ou après la 6e année et ne vont pas au-delà..
Enfin, en 1959, la majorité des enfants ne dépassaient pas l’école élémentaire. Le pourcentage de ceux qui entreprenaient des études secondaires n’atteignait pas 35 %.Au plus 4 % des jeunes parvenaient aux écoles professionnelles supérieures ou à l’université.
La majorité de la population n’avait qu’une connaissance très superficielle de la langue écrite (savoir lire et écrire suffisait!) et faisait surtout un usage oral de la langue, favorable à la dialectisation et sans défense devant l’anglicisation, faute du contrepoids de la langue écrite standard.
Durant toutes ces années, l’instruction publique était sous l’autorité de deux comités confessionnels, l’un de religion catholique, l’autre de religion protestante. Le comité catholique était composé de tous les évêques du Québec et d’un nombre égal de laïcs. Jusqu’en 1960, l’éducation et l’enseignement étaient, au Québec, sous le contrôle des Églises. Le système scolaire du Québec comportait, en conséquence, deux réseaux d’écoles, l’un catholique, de langue française, l’autre protestant, de langue anglaise. Même après cette date, la division du système scolaire selon la religion s’est maintenue jusqu’à ce qu’un amendement à la Constitution canadienne en 1998 y substitue une division selon la langue, à la demande du gouvernement québécois.
Les écoles catholiques avaient comme politique de n’accepter que des élèves de religion catholique, alors que les écoles protestantes accueillaient tous les enfants qui s’y présentaient, sans tenir compte ni de leur religion ni même de leur langue. C’est ainsi que les enfants des immigrants protestants de langue française n’ont pas été acceptés dans les écoles de langue française à cause de la religion de leurs parents, de même que les enfants de parents juifs originaires d’Afrique du Nord et de langue française, encore moins les enfants des autres immigrants dont les parents n’étaient ni de religion catholique, ni de langue française. Par contre, les écoles catholiques de langue française acceptaient les enfants des immigrants catholiques, par exemple italiens ou polonais, sans tenir compte de la langue maternelle des enfants. Le critère de la religion primait celui de la langue. Les Canadiens français ne se rendaient pas compte que cette sélection scolaire des enfants favorisait l’intégration des immigrants à la communauté de langue anglaise et qu’à la longue, cette pratique modifierait la démographie linguistique du Québec en faveur du groupe de langue anglaise. Le réveil fut tardif et brutal, la tendance des immigrants, très difficile à modifier, d’autant que la langue française n’était alors que de peu d’utilité pour bien gagner sa vie, même pour les francophones qui devaient très souvent passer à la langue anglaise pour y arriver. Ce sera le point central de la crise de Saint-Léonard, que nous décrirons en détail au chapitre suivant.
Les structures scolaires étaient, dans les années 1950, éclatées entre des institutions sans relation les unes avec les autres, plutôt en concurrence quant au prestige.
Les écoles de langue française se partageaient en deux réseaux distincts d’établissements, l’un pour les garçons, l’autre pour les filles.
Pour tous les enfants, garçons et filles, l’école primaire comportait sept années de scolarité. Elle donnait ensuite accès à différentes institutions.
Les garçons avaient le choix entre l’école supérieure de cinq ans, gratuite mais nettement moins prestigieuse que le collège classique ou les écoles d’arts et métiers[40]. Ceux qui avaient choisi l’école supérieure se trouvaient, à la fin de leurs études secondaires, devant un choix restreint. Ou ils passaient directement au monde du travail, ou ils poursuivaient des études dans les écoles de commerce, dans les écoles techniques supérieures, ou encore dans les diverses institutions spécialisées, école d’agriculture, école normale d’instituteurs, etc.
À la fin des études primaires, les jeunes filles pouvaient soit passer à l’école supérieure publique, identique à celle des garçons, soit s’inscrire, si leurs parents pouvaient payer les droits de scolarité, à l’un ou à l’autre des établissements privés, instituts de pédagogie familiale ou cours lettres-sciences de quatre ans qui leur permettait de rejoindre, plus ou moins facilement, les études classiques. Les études secondaires terminées, le plus grand nombre d’entre elles se préparaient au monde du travail, soit dans des écoles de secrétariat, soit dans les écoles d’infirmières ou les écoles normales d’institutrices.
Les plus doués des garçons et des filles, les plus motivés ou les mieux encadrés par leurs parents, avaient accès aux collèges classiques, tous privés, tous sous la direction de prêtres diocésains ou de communautés religieuses, donc coûteux. C’était la seule voie d’accès à l’université. Le programme d’études favorisait les humanités (langue latine et grecque, langue et littérature françaises, histoire, philosophie) au détriment des mathématiques, des sciences et des techniques. Les diplômés des collèges classiques se dirigeaient majoritairement vers les professions libérales (médecine et droit, surtout) ou vers la prêtrise.
Il n’existait que peu de collèges classiques ouverts aux filles, tous privés et tous dirigés par des communautés religieuses.
Augmenter le taux de scolarisation des Canadiens français, qu’ils soient adultes ou enfants, garçons ou filles, fut l’un des tout premiers objectifs de la Révolution tranquille des années 1960. Tous considéraient que c’était la première chose à faire pour modifier le rapport de force entre langue française et langue anglaise, pour donner à tous les mêmes chances de s’épanouir, d’entreprendre et de mener une vie conforme à leurs aspirations et à leurs talents.
Une réforme en profondeur du système scolaire était devenue nécessaire. Pour assurer son succès, le gouvernement libéral de Jean Lesage crée, en avril 1961, la Commission royale d’enquête sur l’enseignement , mieux connue sous le nom de commission Parent, dont les travaux se poursuivront de 1961 à 1966.
Mandat et membres de la Commission royale d’enquête sur l’enseignement
Le mandat de la commission était très large : « Étudier l’organisation et le financement de l’enseignement dans la province de Québec, faire rapport de ses constatations et opinions et soumettre ses recommandations quant aux mesures à prendre pour assurer le progrès de l’enseignement dans la province. »
Le gouvernement en a confié la responsabilité à neuf personnes, d’horizons professionnels diversifiés, mais qui reflétaient l’organisation de l’enseignement au moment de la création de la commission, avec une nette surreprésentation des universités et des collèges classiques, donc des établissements privés d’enseignement. Une seule personne provenait des écoles publiques.
Ces personnes étaient :
- Mgr Alphonse-Marie Parent, vice-recteur de l’Université Laval, président,
- Sœur Marie-Laurent de Rome, professeur de philosophie au collège Basile-Moreau,
- Jeanne Lapointe, professeur à la Faculté des lettres de l’Université Laval,
- Gérard Filion, directeur du journal Le Devoir,
- Paul Larocque, secrétaire de la compagnie Alcan,
- David Munroe, directeur de l’Institut d’Éducation de l’Université McGill,
- John McIlhone, directeur adjoint des études à la Commission des écoles catholiques de Montréal,
- Guy Rocher, directeur du Département de sociologie de l’Université de Montréal,
- Arthur Tremblay, directeur adjoint de l’école de pédagogie de l’Université Laval.
Les commissaires ont mené eux-mêmes les diverses activités de la Commission et rédigé ensemble le rapport final.
La Commission a invité tous ceux que le sujet intéressait, notamment les éducateurs, à lui présenter leurs vues et suggestions en vue d’améliorer l’enseignement et de garantir le libre accès de l’école à tous les jeunes, filles et garçons, en âge de la fréquenter.
La Commission a tenu des audiences publiques dans huit villes du Québec et elle a reçu et étudié plus de 300 mémoires.
Les commissaires ont visité une cinquantaine d’établissements d’enseignement de tous les niveaux à travers le Québec.
Les commissaires ont également visité des maisons d’enseignement européennes pour examiner l’organisation des études et y puiser des idées utiles à la réforme québécoise.
Le rapport de la Commission, connu par la suite sous le titre de rapport Parent, du nom de son président, sera publié à partir de 1963, en trois tomes successifs. Le premier tome, en avril 1963, a pour sujet Les structures supérieures du système scolaire. Le deuxième, de novembre 1964, traite de La réforme de l’enseignement, Les niveaux d’enseignement, Les programmes d’études, Les services éducatifs. Le troisième et dernier tome, de mars 1966, aborde des aspects plus administratifs de la réforme L’administration de l’enseignement, Le financement de l’éducation, Les agents de l’Éducation. Le rapport couvre donc la presque totalité de la décennie 1960. Par ses travaux et par les discussions qu’elle a provoquées, la Commission participe au bouillonnement des idées que nous avons évoqué précédemment au sujet de la langue française et des moyens à prendre pour en améliorer la qualité et le prestige de manière à permettre à ses locuteurs de participer pleinement à l’essor économique et culturel d’un Québec en pleine mutation.
Les recommandations du rapport Parent ont façonné le système d’enseignement tel qu’il est maintenant :
- Création, en 1964, du ministère de l’Éducation et du Conseil supérieur de l’éducation.
- Généralisation et démocratisation de l’accès à l’éducation :
- Préscolaire facultatif, mais d’accès universel;
- Scolarité obligatoire de 11 ans, en deux étapes : école primaire de six ans et école secondaire de cinq ans.
- Création, en 1967, des collèges d’enseignement général et professionnel (cégep), d’une durée de deux ans, pour le programme général, ou de trois ans pour le programme technique. Le diplôme d’études collégiales (D.E.C.) de deux ans est maintenant la condition d’accès à l’université, alors que le programme technique débouche directement sur le monde du travail et peut, pour certaines techniques et à certaines conditions, donner accès à l’université.
- Abolition des collèges classiques, mais maintien de l’enseignement privé subventionné. Les collèges classiques d’autrefois se transformeront soit en écoles secondaires privées soit en cégeps, soit les deux à la fois.
- Création des facultés des sciences de l’éducation et fermeture conséquente des écoles normales.
- Création, en 1968, du réseau de l’Université du Québec pour augmenter l’accessibilité aux études supérieures dans les régions tout en favorisant le développement scientifique du Québec. Le réseau est constitué de dix établissements universitaires : six à vocation générale, à Montréal (UQAM), à Trois-Rivières (UQTR), à Chicoutimi (UQAC), à Rimouski (UQAR), en Outaouais (UQO) et en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) et quatre établissements spécialisés, l’Institut national de la recherche scientifique (INRS), l’École nationale d’administration publique (ÉNAP), l’École de technologie supérieure (ÉTS) et la Télé-Université (TELUQ).
La commission Parent, en provoquant la réforme en profondeur du système d’enseignement au Québec, a atteint son objectif principal : le niveau de scolarité de la population de langue française a connu une augmentation rapide et spectaculaire, qui se maintient depuis lors.
La Commission n’a pas traité explicitement de la relation entre enseignement du français et opportunité d’une politique linguistique globale. De l’avis de Guy Rocher[41], les commissaires n’étaient pas d’accord entre eux à ce sujet. Ceux qui s’y opposaient estimaient qu’en discuter outrepassait le mandat de la Commission. D’autres commissaires, au contraire, soutenaient qu’il était impossible de discuter de l’enseignement du français sans en décrire la situation et sans évoquer l’omniprésence de la langue anglaise dans l’industrie, le commerce et les affaires. Le rapport Parent a donc clairement établi le lien entre efficacité de l’enseignement du français et motivation socioéconomique de cette langue.
Les extraits du rapport qui suivent sont très significatifs de ce compromis et ont dû apporter de l’eau au moulin des tenants d’une politique linguistique comme moyen de rehausser l’importance sociale et économique de la langue de la majorité française.
Qu’on en juge.
La Commission évoque la situation de la langue française très minoritaire au milieu d’une Amérique du Nord anglophone et pose au départ de son analyse que :
d’énormes forces économiques, sociales, politiques et linguistiques font pression, depuis près de deux cents ans, sur le groupe canadien-français et sur sa langue. C’est pourquoi l’enseignement du français, comme langue maternelle de la majorité québécoise, doit s’adapter à certaines nécessités particulières . (Rapport Parent, tome II, paragraphe 610.)
La Commission en tire comme conséquence qu’on :
[…] devra étudier les effets de cette situation linguistique sur le comportement collectif, au niveau adulte, et sur l’apprentissage du français, à l’âge scolaire. L’avenir culturel du Québec repose en partie sur la manière d’envisager le problème linguistique qui lui est particulier, avec toutes ses composantes historiques, nationales et économiques. Les répercussions psychologiques de la dichotomie linguistique imposée à un Canadien français dont la langue de travail est l’anglais comporte sans doute un danger pour l’équilibre de sa personnalité. (Rapport Parent, tome II, paragraphe 620.)
Et elle insiste sur ce point capital :
L’école aura beau faire, le français sera sans cesse menacé d’effritement et de disparition au Québec si l’enseignement qu’on en donne ne s’appuie pas sur de solides motivations socio-économiques. […] Le ministère de l’Éducation n’est pas le seul en cause ici. Le gouvernement du Québec tout entier doit, tout en veillant à ne pas isoler le Québec en un ghetto, adopter des mesures très fermes pour protéger le français non seulement dans les écoles et dans les universités, mais dans toute la vie publique. C’est particulièrement urgent à Montréal. L’administration provinciale et les services publics, la vie économique et commerciale, l’affichage doivent témoigner de ce respect de la langue de la majorité québécoise; il y a là une question de justice et d’honneur. Aucun écolier ne prendra le français au sérieux à l’école si, à Montréal particulièrement, les ouvriers, administrateurs et hommes d’affaires sont obligés de parler anglais dans leur travail quotidien ou pour obtenir une promotion. Dans le Québec, une excellente connaissance du français devrait être tout aussi nécessaire pour réussir en affaires. Cette motivation socioéconomique doit être le point d’appui de la réforme que nous proposons pour l’enseignement de la langue maternelle. (Rapport Parent, tome II, paragraphe 621.)
C’est probablement à cause de la situation socio-économique dont nous parlons, poursuit plus loin la Commission, que bon nombre de Néo-Canadiens s’installant au Québec choisissent, dans une proportion de 5/7, de faire de leurs enfants des anglophones. […] Il faudrait étudier les motivations des immigrants qui arrivent au Québec pour savoir pourquoi ils choisissent l’anglais pour eux et pour leurs enfants. (Rapport Parent, tome II, paragraphe 622.)
Enfin, la Commission met de l’avant l’importance de la maîtrise de la langue française comme langue d’enseignement.
L’importance qu’on accorde à l’enseignement de la langue maternelle devra se refléter non seulement dans les cours centrés sur cet enseignement proprement dit, mais dans l’enseignement de toutes les matières; aucun candidat à l’enseignement ne devra recevoir son diplôme s’il ne possède une connaissance très sûre de sa langue maternelle; chacun des professeurs, à tous les degrés, dans toutes les matières, est aussi un professeur de langue maternelle et doit avoir atteint à une certaine connaissance spécialisée dans ce domaine : sa phonétique doit être impeccable, son vocabulaire précis et abondant, sa phrase correcte, il doit s’exprimer avec aisance et naturel, aussi bien oralement que par écrit. On ne doit pas oublier que, durant des heures et des heures, la langue que parle un enseignant imprègne la conscience linguistique de tous les enfants, à la manière d’un modèle. La première étape, dans la réforme de l’enseignement du français, c’est donc la formation à donner à tous les maîtres à cet égard et l’exigence des examens qu’ils auront à subir dans cette matière. (Rapport Parent, tome II, paragraphe 614.)
La Commission consacre un chapitre particulier, le chapitre IV du tome III, aux groupes ethniques minoritaires dans le système scolaire :
Ces divers groupes de nouveaux citoyens, écrit la Commission, dont la très grande majorité se fixe dans la région de Montréal, s’orientent, en général, vers la culture canadienne d’expression anglaise, plutôt que vers la culture canadienne d’expression française; cette préférence apparaît en particulier sur le plan scolaire. Il y a là une situation qui doit porter la majorité canadienne-française du Québec à s’interroger sur ce choix, sur ses propres attitudes et sur le rôle de l’école à l’égard de ce problème. (Rapport Parent, tome III, paragraphe 184.)
La Commission attribue « à a longue habitude d’isolement des Canadiens français, aux réflexes de défense que leur a donnés leur situation minoritaire dans l’ensemble du Canada et à leur infériorité économique au Québec le fait qu’ils étaient sans doute mal préparés psychologiquement à accueillir largement parmi eux de nouveaux citoyens dont les habitudes de vie, la mentalité étaient différentes des leurs ». (Rapport Parent, tome III, paragraphe 189.)
La Commission hésite à traiter tous les aspects de l’intégration des immigrants à la communauté de langue française. « Une bonne partie des questions qui s’y rattachent dépassent le mandat explicite de notre commission; mais les aspects proprement scolaires du problème ne peuvent être passés sous silence. » (Rapport Parent, tome III, paragraphe 192.)
Les écoles de langue anglaise, à l’époque des travaux de la commission Parent, recevaient à bras ouverts les immigrants sans aucune réserve, ni de religion, ni de langue, nous l’avons déjà noté plus haut. De la même manière, affirme la Commission :
[…] doit-on ouvrir toutes grandes aux immigrants de toutes origines les portes des écoles publiques de langue française. Il faudra, pour cela, que bien des Canadiens français fassent un certain effort pour rompre une habitude de repliement sur soi, de méfiance à l’égard des nouveaux venus. Dans un pays qui doit, comme le Canada, compter sur l’immigration pour croître et se développer pleinement, il faudra désormais accepter de bon gré et avec empressement l’apport que représentent ces nouveaux citoyens pour le Québec. (Rapport Parent, tome III, paragraphe 194.)
Ces passages du rapport Parent sont encore d’actualité. On aurait intérêt à en relire les chapitres consacrés à l’enseignement du français et à l’accueil des immigrants.
Chose certaine, la contribution du rapport Parent à l’aménagement linguistique du Québec a été considérable, d’abord parce qu’elle a provoqué une réforme complète du système d’enseignement, mais aussi parce qu’elle a amené, par son autorité morale, les Canadiens français à prendre conscience du piètre statut du français au Québec, que bien d’autres intellectuels dénonçaient également à la même époque. Elle a aussi évoqué pour la première fois, quoique discrètement, l’idée que le Québec devait participer à la sélection des immigrants plutôt que d’en laisser l’entière responsabilité au gouvernement fédéral, comme c’était alors le cas.
Le rapport Parent a-t-il provoqué une augmentation aussi considérable qu’il le souhaitait du taux de scolarisation globale des jeunes Québécois, et surtout du taux de persévérance scolaire au-delà du secondaire?
En juger dépend de l’angle sous lequel on considère la question.
Si on compare le Québec aux autres pays, la situation s’est nettement améliorée, comme l’indique une publication récente de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)[42]. L’espérance de scolarisation, c’est-à-dire le nombre d’années pendant lesquelles un enfant de 5 ans sera scolarisé à temps plein, est de 16,7 ans au Québec, en comparaison de 17,2 ans au Danemark, 16,6 ans en Belgique, 16,5 en France et 14,8 aux États-Unis, pour une moyenne de 15,4 ans dans les pays de l’OCDE. Pour la période de la scolarité obligatoire, le taux de scolarisation au Québec est de 96 %, la moyenne des pays de l’OCDE étant de 97,6 %. En ce qui a trait à l’enseignement postsecondaire chez les adultes de 17 à 34 ans, le Québec occupe le premier rang avec un taux de scolarisation de 20,3 %, comparativement à 16,2 % aux États-Unis et 13,9 % en France, alors que la moyenne des pays est de 11,2 %.
D’un autre point de vue, on constate que la courbe de la scolarisation des jeunes Québécois est rapidement et dramatiquement décroissante de la fin du secondaire au doctorat, bien qu’objectivement le nombre des diplômés ait augmenté. En effet, toujours d’après les statistiques compilées par le ministère de l’Éducation et diffusées dans l’édition 2006 des indicateurs de l’éducation[43], le cheminement scolaire d’une cohorte de jeunes accédant aux études en 2004-2005 montre que, sur 100 personnes qui entrent à l’école primaire, 99 poursuivront leurs études au secondaire, 85 obtiendront le diplôme d’études secondaires, ce qui signifie que 15 d’entre elles décrocheront des études et arriveront sur le marché du travail sans diplôme, 39 recevront le diplôme d’études collégiales, en enseignement général ou technique, 29 obtiendront par la suite un premier titre universitaire (le baccalauréat), 9 poursuivront jusqu’à la maîtrise et une seule personne, jusqu’au doctorat.
Or, le monde a beaucoup changé depuis les années 1960, années de publication du rapport Parent. Surtout, les exigences du monde du travail ont considérablement augmenté. Un simple diplôme d’études générales de niveau secondaire est loin de suffire et mène tout droit au chômage ou au sous-emploi. Le minimum d’aujourd’hui est, ou une solide formation professionnelle au secondaire pour l’exercice d’un métier selon les normes de chaque corporation, ou une formation de niveau cégep et, mieux, une formation de niveau universitaire, ce qui devient de plus en plus une condition d’embauche. La performance du système d’enseignement québécois n’est pas plus adaptée à notre époque qu’elle l’était au moment du rapport Parent. Elle s’est améliorée, il est vrai, mais le monde a changé plus rapidement autour de nous que l’ambition et la volonté de s’instruire chez les jeunes, et plus radicalement dans les connaissances et les compétences qu’exige notre civilisation postindustrielle que ce qu’offre maintenant le contenu de l’École québécoise.
Qui s’instruit s’enrichit, proclamait un slogan qui a poussé les jeunes et les adultes vers les études prolongées à l’époque de la commission Parent. Il faudrait en inventer une version moderne pour contrebalancer les attraits d’une société de consommation qui poussent jeunes et moins jeunes vers la satisfaction immédiate du moindre désir, et donc vers le moyen le plus rapide et le plus immédiat de gagner des sous. S’instruire n’est plus à la mode, il faut y sacrifier trop de temps et trop de plaisirs.
3. La commission Laurendeau-Dunton (1963) : mandat et contribution à la perception de la situation de la langue française au Canada
La Commission royale d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme a été créée le 19 juillet 1963 par le gouvernement fédéral à l’instigation du premier ministre libéral de l’époque, Lester B. Pearson. La présidence en est confiée à André Laurendeau, journaliste au quotidien Le Devoir, et à Arnold Davidson Dunton, journaliste de formation, directeur de la Société Radio-Canada de 1945 à 1958, qui se consacrera entièrement à la commission, de sa création jusqu’en 1970. La Commission est, le plus souvent, nommée plus familièrement commission Laurendeau-Dunton, des noms des deux premiers présidents, ou commission BB, pour bilinguisme et biculturalisme. Au décès d’André Laurendeau, c’est le commissaire Jean-Louis Gagnon qui assuma la coprésidence.
La commission a été instituée pour :
[…] faire enquête et rapport sur l’état présent du bilinguisme et du biculturalisme au Canada et [pour] recommander les mesures à prendre pour que la Confédération canadienne se développe d’après le principe de l’égalité entre les deux peuples qui l’ont fondée, compte tenu de l’apport des autres groupes ethniques à l’enrichissement culturel du Canada, ainsi que les mesures à prendre pour sauvegarder cet apport, en particulier :
- faire rapport sur l’état et la pratique du bilinguisme dans tous les services et institutions de l’administration fédérale – y compris les sociétés de la Couronne – ainsi que dans leurs contacts avec le public, et présenter des recommandations de nature à assurer le caractère bilingue et fondamentalement biculturel de l’administration fédérale;
- faire rapport sur le rôle dévolu aux institutions, tant publiques que privées, y compris les grands organes de communication, en vue de favoriser le bilinguisme, de meilleures relations culturelles ainsi qu’une compréhension plus répandue du caractère fondamentalement biculturel de notre pays et de l’apport subséquent des autres cultures; présenter des recommandations en vue d’intensifier ce rôle; et
- discuter avec les gouvernements provinciaux, compte tenu de ce que la compétence constitutionnelle en matière d’éducation est conférée aux provinces, des occasions qui sont données aux Canadiens d’apprendre le français et l’anglais et présenter des recommandations sur les moyens à prendre pour permettre aux Canadiens de devenir bilingues.
Dans son rapport préliminaire, première publication de la Commission à la suite des rencontres régionales, la Commission précise sa perception des motifs qui rendaient nécessaire l’examen des relations entre les cultures et les langues des deux peuples fondateurs. Elle écrit : « La Commission a été formée […] pour examiner les griefs formulés de plus en plus vigoureusement par les Canadiens français et en particulier par le Québec. C’est le Canada français qui, par ses porte-parole, se déclare insatisfait de l’état des choses actuel et assure qu’il est victime d’inégalités inacceptables[44] ».
Le rapport de la Commission s’échelonne au fil des années en plusieurs tranches, entre 1965 et 1970, apportant, du fait même de la qualité de ses travaux, une contribution de toute première importance à l’approfondissement de la situation de la langue française face à la langue anglaise, cette fois dans l’ensemble du Canada. Le rapport comporte cinq tranches : le Rapport préliminaire de la Commission royale d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme en 1965; le rapport sur Les langues officielles en 1967; le rapport sur L’éducation en 1968; le rapport sur Le monde du travail; L’apport culturel des autres groupes ethniques en 1969; finalement, en 1970, le rapport sur La capitale fédérale; Les associations volontaires.
À la différence de la commission Parent, la commission Laurendeau-Dunton se dote d’un groupe de recherche multidisciplinaire pour creuser tous les aspects de son mandat, culturel et linguistique, historique, démographique, économique, psychologique et, bien évidemment, politique.
Pendant que le groupe de recherche s’organise et entreprend ses travaux, la Commission organise vingt-trois rencontres régionales, dans toutes les provinces du Canada, au Québec (Québec, Sherbrooke, Trois-Rivières, Rimouski, Chicoutimi), en Ontario (London, Sudbury, Windsor, Kingston, Port Arthur (aujourd’hui Thunder Bay); au Manitoba (Winnipeg), en Saskatchewan (Regina et Saskatoon), en Alberta (Edmonton et Calgary), en Colombie-Britannique (Vancouver et Victoria); au Nouveau-Brunswick (Moncton et Fredericton), en Nouvelle-Écosse (Yarmouth et Halifax), à Terre-Neuve (Saint-Jean), enfin au Cap-Breton (Sydney). L’objectif de ces rencontres, en plus de recevoir et d’entendre des rapports de tous ceux et celles que le mandat de la commission intéressait, est de susciter à l’endroit du principe de l’égalité des peuples fondateurs « l’adhésion libre d’un peuple libre, un vouloir-vivre collectif », surtout de la part des jeunes, qui sont l’avenir du pays[45].
Elle tient également des rencontres privées avec divers groupes de pression, avec des associations et avec les représentants des institutions ou avec des personnes œuvrant dans l’un ou l’autre champ en relation avec le mandat de la commission.
Enfin, elle rencontre les premiers ministres de toutes les provinces du Canada.
Les premiers travaux de la Commission, et notamment la publication du rapport préliminaire, auront l’effet d’un électrochoc, au Québec surtout, mais aussi ailleurs au Canada.
À la suite de tous les témoignages entendus durant les rencontres régionales et des échanges avec le public qu’ils ont suscités, la Commission lance un avertissement : « le Canada traverse la période la plus critique de son histoire, depuis la Confédération. […] C’est l’heure des décisions et des vrais changements; il en résultera soit la rupture, soit un nouvel agencement des conditions d’existence [du Canada]. Nous ignorons si cette crise sera longue ou brève. Mais nous sommes, toutefois, convaincus qu’elle existe[46]. »
Au fur et à mesure de l’avancement et de la publication de ses travaux, la Commission brosse un portrait sombre de la situation du français et des francophones au Canada.
La Commission démontre le déséquilibre de la rémunération selon la langue et le peu de prestige des francophones et de la langue française dans l’économie du Canada et du Québec qui en découle.
Pour l’ensemble du Canada, les bilingues, quelle que soit leur origine, touchent des revenus plus élevés que les unilingues de toutes origines, anglophone ou francophone. L’écart entre Canadiens d’origine française ou d’origine britannique subsiste car ces derniers, qu’ils soient unilingues anglophones ou bilingues, jouissent du revenu moyen le plus élevé; les anglophones unilingues d’origine britannique gagnent plus que les bilingues d’origine française. Il semble donc que l’origine ethnique ait sur les revenus une répercussion plus grande que la connaissance des langues. (Tome III du rapport de la commission Laurendeau-Dunton, paragraphes 50 et 51.)
Même au Québec, le bilinguisme n’est pas payant. « Les bilingues, d’origine française ou britannique, gagnent moins que les Britanniques anglophones unilingues. Pour l’ensemble de la province, les anglophones unilingues ont un revenu moyen de 5 502 $ (les études à la base de cette évaluation datent du milieu des années 1960), les bilingues, de 4 772 $, les francophones unilingues, de 3 099 $. » (Tome III du rapport de la commission Laurendeau-Dunton, paragraphe 52.)
Selon les résultats d’une enquête de la Commission auprès d’un échantillon de grandes entreprises manufacturières du Québec, « à mesure qu’on s’élève dans l’échelle de rémunération, la proportion des francophones décline. Elle constitue invariablement une infime minorité au sommet. » (Tome III du rapport de la commission Laurendeau-Dunton, paragraphe 1022.)
Enfin, si on répartit la moyenne du revenu de la population active masculine du Québec en 14 classes selon l’origine ethnique, les salariés d’origine française arrive au 12e rang, tout juste devant les Italiens et les Amérindiens. Le classement est le suivant : Britanniques, Scandinaves, Hollandais, Juifs, Russes, Allemands, Polonais, Asiatiques, Ukrainiens, autres Européens, Hongrois, Français, Italiens, Amérindiens. (Tome III du rapport de la commission Laurendeau-Dunton, paragraphe 56).
Ce classement fut une véritable gifle pour les Canadiens français du Canada, mais surtout pour les francophones du Québec.
À Montréal, la proportion des francophones à haut revenu est de 17 %, celle des travailleurs à faible revenu d’un peu moins que 50 %. (Tome III du rapport de la commission Laurendeau-Dunton, paragraphe 1047.)
La conclusion s’impose d’elle-même à la Commission :
Dans tous les domaines du monde du travail que nous avons passés en revue, les francophones sont désavantagés par rapport aux anglophones. […] Dans le monde du travail au Canada, que l’on considère l’entreprise privée, la fonction publique fédérale ou les forces armées, les francophones ont beaucoup moins de chance d’occuper les postes supérieurs. En outre, ceux d’entre eux qui occupent des postes élevés doivent, très souvent, utiliser l’anglais au travail. (Tome III du rapport de la commission Laurendeau-Dunton, paragraphe 1363.)
L’intuition qu’avait eue la commission Parent qui constatait la faible motivation socioéconomique de la langue française et qui y attribuait le peu d’attraction qu’elle exerçait sur les immigrants a trouvé dans les constatations de la commission Laurendeau-Dunton une brutale confirmation. Le dossier de la langue de travail au Québec devient la priorité des priorités dans une éventuelle politique linguistique.
La Commission démontre le peu de prestige dont jouissent les francophones et la langue française auprès des anglophones du reste du Canada (ROC, rest of Canada) et même du Québec.
À partir des opinions entendues lors des audiences à travers le Canada, la Commission résume ainsi les attitudes des anglophones à l’égard du Canada français[47].
Certains réclamaient que l’anglais soit la seule langue du Canada et s’opposaient à l’idée de déclarer le français, langue officielle. Ils soutenaient que la Conquête avait réglé de façon définitive les relations entre anglophones et francophones.
D’autres étaient d’avis que, de toute manière, le français était appelé à disparaître à la longue comme langue de communication. Les îlots français ne sauraient éviter d’être assimilés graduellement par la culture et la langue de l’Amérique du Nord, « le cimetière de tant de langues et de cultures ».
Il est tragique de constater, conclut la Commission, combien peu les Canadiens de langue anglaise sont conscients des sentiments et des aspirations des Canadiens français. Elle poursuit : de manière générale, les anglophones « ne semblent pas, jusqu’ici, avoir compris ou être prêts à accepter les conséquences de l’égalité des deux peuples ». Le Canada leur apparaît comme un pays de langue anglaise, avec une minorité francophone à laquelle on a accordé des droits restreints. Les anglophones ne semblaient pas, à cette époque, connaître les dispositions de la Constitution du Canada de 1867 selon lesquelles le bilinguisme des textes des lois et les procès-verbaux du gouvernement du Canada et de celui du Québec était obligatoire et l’emploi de la langue française ou de la langue anglaise, facultatif dans les débats en chambre.
La Commission fait apparaître clairement la difficulté et l’ambiguïté du bilinguisme au Canada.
En raison du statut de l’anglais, il apparaît clairement que pour les anglophones, le bilinguisme constitue un choix, alors que pour les francophones, il devient une contrainte, étant donné que les anglophones, même au Québec, ne sont pas obligés de connaître le français, alors que les francophones doivent savoir l’anglais au point même, dans certains cas, d’en faire leur principale langue de travail. La Commission confirme ainsi l’analyse des intellectuels québécois.
Dans le reste du Canada, les anglophones ne sont nullement intéressés à apprendre le français, dont ils ne ressentent aucun besoin, ni économique ni culturel.
La Commission souligne que « le jeu des nombres » fait constamment varier les notions de majorité et de minorité.
Lors des rencontres fédérales-provinciales, le Québec est toujours très largement minoritaire, à 1 contre 9 autres provinces, 1 contre 10 gouvernements si on inclut le gouvernement fédéral, 1 contre 12 si on ajoute les territoires.
Les francophones sont une minorité au Canada, dans toutes les provinces, sauf au Québec. Dans certaines provinces, ils sont même moins nombreux que d’autres groupes ethniques.
Les anglophones sont une minorité au Québec, mais ils occupent une position nettement dominante dans le monde des affaires et de l’industrie.
Au Québec même, les francophones se considèrent tantôt comme une majorité, tantôt comme une minorité, selon qu’ils considèrent leur situation politique (ils ont leur propre gouvernement, du moins en principe) ou leur situation économique, sous contrôle des anglophones.
Les anglophones sont de moins en moins d’origine britannique, du fait que les immigrants optent pour la langue anglaise, même au Québec, et à cause des transferts linguistiques des francophones vers la langue anglaise, surtout dans les autres provinces, y compris au Nouveau-Brunswick.
Les recommandations de la Commission ont connu des sorts variables.
La Commission recommandait au gouvernement fédéral de déclarer le français et l’anglais, langues officielles du Canada : « Nous recommandons que l’anglais et le français soient formellement déclarés langues officielles du Parlement du Canada, des tribunaux fédéraux, du gouvernement fédéral et de l’administration fédérale[48]. »
En 1969, les Communes d’Ottawa donnaient suite à cette recommandation en adoptant la Loi sur les langues officielles du Canada, proposée par le gouvernement libéral de Pierre Elliott Trudeau. « L’anglais et le français sont les langues officielles du Canada pour tout ce qui relève du Parlement et du gouvernement du Canada », proclame l’article 2 de cette loi.
Cette loi permet l’usage du français et de l’anglais dans les débats parlementaires. Elle rend obligatoire la publication de tous les documents fédéraux dans les deux langues, simultanément ou dans un délai raisonnable. Elle assure à tous les citoyens canadiens l’accès aux services de la fonction publique dans la langue officielle de leur choix, selon des modalités d’application qui tiennent compte du nombre des locuteurs de la langue minoritaire selon les régions. Enfin, elle encourage l’usage du français et de l’anglais comme langues de travail de la fonction publique, ici encore selon des modalités qui tiennent compte de l’endroit où se trouve l’unité administrative sur le territoire du Canada. Il est cependant encore très difficile de travailler en français au sein de la fonction publique fédérale où l’usage de l’anglais est généralisé et où les unilingues anglophones sont en si grande majorité qu’ils freinent toute utilisation du français par des collègues francophones. La création de postes bilingues parmi les gestionnaires de haut niveau n’a modifié en rien la situation. Les deux solitudes linguistiques sont toujours face à face dans la fonction publique fédérale et l’obligation d’être bilingues s’impose toujours davantage aux francophones, puisqu’ils peuvent difficilement travailler en français. Les rapports annuels du ou de la commissaire aux langues officielles constatent année après année, inlassablement et avec une constance exemplaire les échecs de la Loi sur les langues officielles du Canada, soit dans l’offre de service en français aux citoyens de langue française, soit dans l’emploi du français comme langue de travail par les francophones. Lire un de ces rapports, c’est les lire tous.
Cette loi n’a aucun caractère contraignant dans les autres domaines de la vie publique, qui sont de compétence provinciale. Il y a donc une certaine ambiguïté dans le titre même de la loi : il ne s’agit pas d’une loi qui règle l’usage du français et de l’anglais sur l’ensemble du territoire canadien, comme on pourrait le croire, mais seulement dans les activités du gouvernement fédéral. C’est déjà beaucoup, mais ce n’est pas davantage.
Cependant, cette politique exerce une pression morale sur l’ensemble des citoyens canadiens et sur chacun des gouvernements provinciaux. D’une part, la langue française est de plus en plus souvent utilisée dans la vie politique canadienne au point qu’il est devenu impossible, du moins fort difficile ou embarrassant, d’être premier ministre du Canada ou ministre dans le cabinet fédéral sans connaître le français et sans pouvoir en faire usage couramment. D’autre part, la connaissance du français et de l’anglais est devenue un atout important pour qui veut faire carrière dans la fonction publique fédérale ou pour qui veut faire affaire avec le Québec, à cause de la loi linguistique québécoise. Les parents et les jeunes de toutes les provinces le savent et veulent se préparer en conséquence. Enfin, la politique fédérale favorise le bilinguisme français-anglais partout au Canada, notamment par le soutien financier accordé aux programmes d’enseignement des langues officielles ou aux organismes de défense des minorités de l’une ou l’autre langue officielle, y compris au Québec.
Pierre Elliott Trudeau, devenu premier ministre, a récusé le principe des « deux peuples fondateurs » et a substitué le multiculturalisme et le multilinguisme au biculturalisme et au bilinguisme dont faisait mention le mandat de la Commission. Ce changement de perspective a eu d’importantes conséquences. Le multiculturalisme a enlevé toute légitimité à la conviction historique des francophones et des anglophones d’être les fondateurs du pays. Les uns et les autres n’étaient, selon Trudeau, que des communautés linguistiques analogues à toutes les autres, sans plus. Le fait de les dire communautés linguistiques de langue officielle impressionne de moins en moins les communautés linguistiques d’immigration, les agace même, surtout quand ce statut confère des avantages particuliers aux minorités de langue française du Canada, souvent moins nombreuses qu’elles-mêmes. De plus, le multiculturalisme encourage les communautés d’immigration à affirmer et à cultiver leurs différences culturelles. Le Canada devient de plus en plus une mosaïque de cultures, d’autant que la culture canadienne-anglaise arrive mal à se distinguer de la culture américaine, largement véhiculée par les médias américains. D’autre part, si la langue anglaise arrive à s’imposer comme seule langue administrative et seule langue de la vie collective, elle subit la concurrence des langues d’origine comme langue familiale et parfois même comme langue de l’affichage public. Le Québec échappe encore à cette tendance à cause de la persistance et de prédominance de la culture et de la langue françaises, l’une et l’autre protégées par une politique linguistique explicite.
Enfin, une partie de l’opinion publique anglophone est ouvertement hostile à la politique des langues officielles du Canada, donc hostile à l’usage du français ailleurs qu’au Québec. Une assez forte minorité d’anglophones estiment qu’elle menace l’unité du Canada et qu’elle est trop coûteuse. C’est le vieux rêve d’un pays, une langue, donc l’anglais partout comme langue commune, sauf, et c’est le corollaire implicite, au Québec, à condition cependant que la langue anglaise y soit protégée comme langue de la minorité anglophone de cette province. Le sort des minorités de langue française dans les autres provinces du Canada ne semble pas être une préoccupation pour eux.
La commission Laurendeau-Dunton recommandait également aux provinces du Nouveau-Brunswick et de l’Ontario qu’elles déclarent d’elles-mêmes qu’elles reconnaissent l’anglais et le français comme langues officielles, et qu’elles acceptent le régime linguistique découlant de cette déclaration.
Seule la province du Nouveau-Brunswick l’a fait en adoptant, en 1969, la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick. Cette loi déclare le français et l’anglais langues officielles. Elle s’inspire directement de la politique de bilinguisme du gouvernement fédéral. En conséquence, la loi s’applique dans tous les organismes relevant de l’autorité du gouvernement, les ministères et les sociétés d’État, mais ne touche aucun autre secteur.
L’application de la loi s’est révélée décevante, surtout pour les francophones. Le gouvernement a donc créé un groupe d’étude sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick, dont le rapport a été déposé en 1982 sous le titre Vers l’égalité des langues officielles du Nouveau-Brunswick, dit rapport Poirier-Bastarache. Les recommandations du rapport n’ont pas eu de suite concrète et le débat sur l’application de la loi s’est poursuivi. Un nouveau Comité consultatif sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick a donc été constitué dont le rapport a paru en 1986, dit rapport Guérette-Smith.
Tous ces événements ont eu des effets, positifs et négatifs, sur l’évolution du dossier de la politique linguistique du Nouveau-Brunswick. La loi, même déficiente dans son application, a au moins contribué à faire officialiser la dualité linguistique de la province et a conféré à la langue française une légitimité et une visibilité qui la sortait de la quasi-clandestinité où elle était tenue jusqu’alors. Les deux groupes d’étude ont obligé les différents intervenants à préciser leurs opinions et a permis un début d’analyse de la situation sociolinguistique du Nouveau-Brunswick, travaux qui auraient dû précéder la formulation de la Loi sur les langues officielles. Par contre, tous ces détours ont servi de paravent derrière lequel le gouvernement a masqué son inaction et son incapacité à préciser la portée réelle de la loi, au-delà du principe des deux langues officielles.
En 1988, le gouvernement a donné une nouvelle direction à la politique linguistique en adoptant la Loi reconnaissant l’égalité des communautés linguistiques officielles. La Loi sur les langues officielles affirmait le bilinguisme de l’État et laissait à chaque citoyen le choix de la langue. La nouvelle approche introduit un relais entre l’État et le citoyen, la communauté linguistique, avec, comme effet, prévisible mais peut-être pas prévu, de pousser les individus à se solidariser pour affirmer et défendre les droits et intérêts de leur communauté. La dualité sera plus vive, parce qu’elle est maintenant juridiquement fondée.
Il semble bien, cependant, que la politique linguistique de cette province se développe maintenant à partir du principe de l’égalité des communautés linguistiques. Une série de mesures ont été adoptées, qui précisent la portée de la Loi sur les langues officielles : usage des deux langues officielles comme langues de service dans la fonction publique, les hôpitaux et les sociétés d’État et encouragement aux fonctionnaires à travailler dans la langue de leur choix; obligation pour les ministères et autres organismes de l’État de formuler leur plan d’application de cette mesure; programme de formation linguistique accélérée des fonctionnaires; création d’un Comité permanent du cabinet sur les langues officielles.
Le Nouveau-Brunswick en est là. La question linguistique n’est pas réglée pour autant. D’une part, les francophones ne sont pas entièrement satisfaits des mesures prises pour faire appliquer la politique d’égalité des langues, surtout qu’elles ne touchent que le fonctionnement de l’État et laissent de côté de larges pans de la vie quotidienne, notamment toute l’activité économique privée. D’autre part, une partie de l’opinion publique anglophone est hostile à cette politique et en demande l’abolition pure et simple. La création de zones linguistiques hante les esprits des uns et des autres et apparaît de plus en plus comme une solution réaliste, mais difficile d’application[49].
Aux autres provinces, la commission Laurendeau-Dunton recommandait de déclarer le français et l’anglais langues officielles dès que la minorité de l’une ou de l’autre langue atteindrait 10 % de la population[50]. Aucune province n’y donnera suite, surtout pas le Québec qui risquait alors de devenir officiellement bilingue.
Autre conséquence importante des travaux de la Commission : la délimitation très nette des champs de compétence juridique en matière de langue. Le gouvernement central n’a de pouvoir que sur les organismes qui relèvent de son autorité, les gouvernements des provinces ont, seuls, le pouvoir de régler par loi ou règlement l’usage des langues sur leurs territoires. Ce qui revenait à affirmer que le Québec avait le droit et le pouvoir d’adopter sa propre politique linguistique, s’il le désirait, comme plusieurs intellectuels commençaient à le proposer.
Enfin, paradoxalement, cette commission fédérale a contribué à convaincre les Québécois de la nécessité de modifier chez eux les règles du jeu en ce qui touche à l’emploi du français et de l’anglais dans le monde du travail et de l’économie en leur démontrant que c’était là l’origine de leur médiocre situation et du peu de prestige de leur langue chez leurs compatriotes et chez les immigrants.
Le gouvernement fédéral a été le premier à légiférer en matière linguistique. D’autres gouvernements ont fait de même depuis lors. Certaines politiques linguistiques sont formulées sous forme de texte législatif, d’autres sous forme de règlement spécifique ou de disposition dans des textes de loi portant sur d’autres sujets, surtout l’enseignement.
Il y a aujourd’hui cinq lois linguistiques au Canada : la Loi sur les langues officielles du Canada (1969) : français et anglais; la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick (1969), français et anglais; la Charte de la langue française (du Québec, 1977) : français seul; la Loi sur les langues officielles (des territoires du Nord-Ouest, 1984) : sept langues sont déclarées officielles : le français, l’anglais et cinq langues autochtones (le cri, le flanc-de-chien, le quiwch’in, l’inuktitut et l’esclave) et la Loi sur les langues (du Yukon, 1988) : français et anglais (aucune langue autochtone n’est mentionnée).
Dans toutes les autres provinces, la politique linguistique est ou implicite, l’anglais y étant, dans les faits, la seule langue commune à emploi officiel, ou réduite à quelques règlements administratifs facilement modifiables. Par contre, le Manitoba a été contraint par la Cour suprême à revenir au bilinguisme constitutionnel des textes de lois et règlements, conformément à ce que prévoyait la Constitution de 1867. Ce fut là l’une des conséquences inattendues de l’arrêt de la Cour suprême à la suite de la contestation du chapitre de la Charte de la langue française de 1977 qui édictait que le français serait dorénavant la seule langue de présentation et d’adoption des lois[51]. Le gouvernement du Québec prenait appui sur le précédent créé, il y avait plus de cent ans, par la province du Manitoba qui avait pu mettre fin impunément au bilinguisme français-anglais auquel elle avait pourtant été assujettie par la même Constitution. Bien logiquement, la Cour suprême, en déclarant inconstitutionnel ce chapitre de la loi 101, a dû rétablir le bilinguisme des lois au Manitoba alors que la communauté de langue française avait, entre-temps, fondue comme beurre au soleil.
4. La commission Gendron (1968) : mandat, travaux, rapport, influence sur la conception de la politique linguistique québécoise
Pour calmer l’inquiétude des Québécois au sujet de la situation de la langue française face à la langue anglaise, décrite par la commission Laurendeau-Dunton et dont on discutait presque chaque jour dans les médias, le gouvernement de l’Union nationale, dirigé par Jean-Jacques Bertrand, créa le 9 décembre 1968 une Commission d’enquête sur la situation de la langue française et sur les droits linguistiques au Québec, connue par la suite sous le nom de commission Gendron, du nom de son président. D’une part, les francophones pressaient le gouvernement de prendre des mesures énergiques pour conforter l’avenir de la langue française et assurer à ses locuteurs un sort économique plus équitable et plus conforme au fait qu’ils étaient la majorité des citoyens. D’autre part, la minorité anglophone et les minorités allophones réclamaient du gouvernement, la première, qu’il conserve à la langue anglaise son statut et ses institutions, les secondes, qu’il garantisse le libre choix de la langue d’enseignement, question litigieuse déclenchée au même moment par la crise de Saint-Léonard dont il sera question par la suite. L’aspect politique et juridique de la question linguistique passait rapidement au premier plan.
Mandat et composition de la Commission d’enquête sur la situation de la langue française et sur les droits linguistiques au Québec
Le mandat de la Commission était « de faire enquête et rapport sur la situation du français comme langue d’usage au Québec et [de] recommander les mesures propres à assurer
- les droits linguistiques de la majorité aussi bien que la protection des droits de la minorité,
- le plein épanouissement et la diffusion de la langue française au Québec dans tous les secteurs d’activité, à la fois sur les plans éducatif, culturel, social et économique. »
La commission était formée de Jean-Denis Gendron, président, linguiste et vice-doyen à la Faculté des lettres de l’Université Laval, et, comme commissaires, de Madeleine Doyon-Ferland, ethnologue et professeure à la même faculté, Edward McWhinney, constitutionnaliste et professeur à l’Université McGill, Nicolas Mateesco-Matte, avocat et professeur de droit spatial à l’Université de Montréal et Aimé Gagné, directeur des relations publiques de l’entreprise Alcan.
La Commission devait faire rapport dans les douze mois. Elle obtiendra le 15 octobre 1969 un report de cette échéance au 9 décembre 1970.
Entre-temps, la crise de Saint-Léonard et du bill 63 a eu lieu, le Parti libéral de Robert Bourassa a succédé à l’Union nationale, l’opinion publique s’est modifiée et s’est radicalisée de part et d’autre au sujet des langues. Le gouvernement Bourassa modifie en conséquence le mandat de la Commission en septembre 1970 en lui demandant de s’attaquer « d’abord et en priorité aux questions du français langue de travail, de l’intégration des nouveaux Québécois à la communauté francophone du Québec et des droits linguistiques de nos concitoyens ». Les recherches de la Commission se poursuivront durant les mêmes années où l’Office de la langue française recevra, de la part du même gouvernement, le mandat de donner suite à la loi 63, dont nous parlerons plus loin. Cet organisme devra, de son côté, mener ses propres recherches, appliquées cette fois à la possibilité de mettre en œuvre les dispositions de cette loi. Ainsi, il y aura souvent convergence entre les travaux des deux équipes. Au chapitre suivant, nous traiterons plus en détail des travaux de l’Office de la langue française et de la manière dont les recherches de la commission Gendron y ont été intégrées.
À l’instar de la commission Laurendeau-Dunton, la commission Gendron se donne un groupe de recherche multidisciplinaire et en confie la direction à Pierre-Étienne Laporte[52].
L’activité de la Commission est intense durant toutes ces années, ce qui explique le retard à en rédiger la synthèse sous forme de rapport et de recommandations. À ce sujet, on peut se faire une idée des discussions et divergences d’opinion des commissaires entre eux en lisant le témoignage du commissaire Aimé Gagné, le seul à avoir mis par écrit le récit de sa participation à la Commission[53].
La Commission tient huit audiences publiques, de trois à cinq jours, entre septembre 1969 et mai 1970, une à Québec, toutes les autres à Montréal. Elle reçoit 210 mémoires. Elle complète cette information primaire en visitant cinq entreprises industrielles ou financières.
Elle conduit un important programme de recherches : 28 études spécialisées touchant les divers aspects de son mandat, historique, économique, juridique, sociologique, social, sociolinguistique, et neuf rapports de synthèse de ces différents travaux.
Selon le mandat initial, la Commission devait faire rapport le 9 décembre 1970. Les commissaires ont demandé et obtenu que le dépôt du rapport soit reporté d’abord au 31 mars 1971, puis au 20 octobre 1971, enfin au 31 décembre 1972, date finale imposée par le gouvernement.
Le rapport final comporte trois tomes : 1. La langue de travail (379 pages et 92 recommandations); 2. Les droits linguistiques (474 pages et 6 recommandations) et 3. Les groupes ethniques (570 pages et 81 recommandations).
Qu’est-il advenu du rapport de la commission Gendron et quelle influence a-t-il exercé sur la conception de la politique linguistique québécoise? Tout dépend de ce dont on parle.
Les informations fournies par les études et par les rapports de synthèse ont été certainement les plus utiles à la compréhension de la situation et à la détermination des modes d’intervention et des moyens d’action, d’autant que les données de la commission Gendron confirmaient et complétaient celles de la commission Laurendeau-Dunton. Certaines observations étaient ainsi devenues des évidences bien documentées et incontestables aux yeux de tous les observateurs, tant francophones qu’anglophones. Le débat social en était plus objectif et moins partial.
La Commission publiait les rapports de recherche au fur et à mesure qu’ils étaient terminés. Le personnel de l’Office de la langue française pouvait donc en prendre connaissance et s’en inspirer pour ses propres réflexions et travaux. Les rapports de recherche les plus utiles aux travaux de l’Office ont été les suivants :
De Brouwer, Jean-Claude, Le français « langue de travail » : ce qu’en pensent les élites économiques du Québec.
Gagné, Soucy-D., Les mass media, l’attachement à la langue et les modèles linguistiques au Québec en 1971, et Étude concernant la langue française dans les agences de publicité au Québec.
Hamelin, Jean, La dimension historique du problème linguistique.
Inagaki, Morido et Dagenais, Marcel, Analyse économique des possibilités d’implantation du français comme langue de travail au Québec et L’utilisation du français comme langue de travail au Québec : Possibilités et contraintes économiques.
Sheppard, Claude-Armand, Inventaire commenté des droits linguistiques au Québec, Réglementation fédérale et provinciale de la langue de la publicité et Portée socio-juridique de la juridiction provinciale en matière de langue.
Vaudelle, Jean-Maurice, Les sièges sociaux et l’environnement québécois. De plus, quatre rapports de synthèse ont été également très consultés au moment de leur publication, soit par le personnel de l’Office, soit par le cabinet du ministre François Cloutier, en tant que ministre responsable du dossier linguistique :
Laporte, Pierre-É., L’usage des langues dans le monde du travail au Québec.
Boudreau, Marcel, Qualité de la langue.
Paré, Marcel, La langue de la publicité.
Sheppard, Claude-Armand, Les droits linguistiques au Québec.
D’un autre point de vue, le rapport de la Commission précède de peu le moment où le ministre Cloutier songe à régler la question linguistique au Québec au moyen d’une loi linguistique, ce qui influencera la lecture que lui-même et son équipe feront du rapport. L’accueil réservé aux recommandations de la commission Gendron est très nuancé selon le sujet.
Au sujet du statut du français et de l’anglais, la commission Gendron recommandait :
- a) que le Gouvernement du Québec se donne comme objectif général de faire du français la langue commune des Québécois, c’est-à-dire une langue qui, étant connue de tous, puisse servir d’instrument de communication dans les situations de contact entre Québécois francophones et non francophones.
Cette recommandation est toujours d’actualité et inspire encore aujourd’hui la politique linguistique québécoise. La Commission recommandait en second lieu :
- b) que le gouvernement du Québec […] proclame dans une loi-cadre le français langue officielle du Québec, ainsi que le français et l’anglais langues nationales du Québec.
Le gouvernement Bourassa retient l’idée du français seule langue officielle du Québec, dont il fera l’article 1 de la loi 22, mais rejette la distinction entre langue officielle et langue nationale, sans doute inspirée à la commission Gendron par la constitution de la Suisse ou par celles de plusieurs pays d’Afrique subsaharienne.
Au sujet de la langue de travail, les propositions de la commission Gendron étaient complexes et d’une grande prudence :
- La Commission recommandait « au Gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour faire du français la langue des communications internes dans les milieux de travail au Québec ».
- Elle recommandait de procéder par étapes, en négociant le programme avec les entreprises (recommandation n° 4) : une première étape de communication orale bilingue, français/anglais, une deuxième étape où le français devient la langue commune des communications orales, enfin une dernière étape où le français devient la langue des communications écrites (recommandation n° 5). En plus, la Commission recommandait « aux entreprises d’adopter une politique de bilinguisation strictement adaptée aux besoins de leurs cadres et de leurs autres employés » (recommandation n° 8).
- Elle recommandait « au Gouvernement de proposer aux entreprises une politique de francophonisation qui ait pour objet d’augmenter graduellement, à compétence égale, la présence des francophones aux échelons moyens et supérieurs de la hiérarchie administrative » jusqu’au taux moyen de chaque groupe linguistique dans la main-d’œuvre québécoise (recommandation n° 9), au cours des dix prochaines années, par étapes également et selon la disponibilité des francophones et la croissance économique du Québec (recommandation n° 11).
- Enfin, la Commission recommandait une politique de bilinguisation des cadres anglophones (recommandation n° 14) aux frais de l’État (recommandation n° 16).
L’idée de faire du français la langue des communications internes des entreprises sera retenue, de même que l’augmentation de la présence des francophones au niveau supérieur.
Par contre, le gouvernement ne sera pas d’accord pour procéder par étapes, encore moins pour fonder la francisation des entreprises sur le principe de la bilinguisation des cadres anglophones. Cependant, la connaissance de la langue française par les cadres sera exigée comme élément du programme de francisation des entreprises.
En matière d’affichage public, la Commission recommandait que « l’usage du français soit obligatoire et qu’aucune inscription dans une autre langue ne l’emporte sur l’inscription rédigée en français » (recommandation n° 63). Ce principe sera retenu par le gouvernement Bourassa.
Les recommandations de la Commission Gendron au sujet de la langue des affaires sont nombreuses. Elle recommande :
- que, dans un délai de cinq ans, le français soit obligatoire « dans tous les documents qui décrivent des biens ou des services et qu’aucun texte rédigé dans une ou plusieurs autres langues n’occupe une place plus importante que le texte rédigé en français » (recommandation n° 54). Le gouvernement sera d’accord sur ce principe.
- Que « tout organisme privé constitué en vertu des lois du Québec ait un nom français, sans exclure pour autant des versions de ce nom dans d’autres langues » (recommandation n° 57). Idée acceptée.
- Que « tout contrat écrit passé entre un consommateur francophone et un commerçant de biens ou de service soit rédigé en français, à moins que le consommateur n’exige qu’il soit rédigé en anglais uniquement » (recommandation n° 66). Idée retenue.
- Que « toute pièce délivrée à un client francophone pour témoigner de l’achat d’un bien ou d’un service soit rédigée en français, à moins que le consommateur n’exige qu’il soit rédigé en anglais uniquement » (recommandation n° 67). Idée retenue.
Enfin, la Commission formule de nombreuses recommandations en ce qui a trait à l’administration publique et parapublique, y compris l’administration municipale, les services de santé, les ordres professionnels (recommandations 68 à 78).
Elles serviront par la suite de sources d’inspiration pour la rédaction des lois successives. Deux principes généraux s’en dégagent toutefois, qui seront toujours respectés par la suite, l’administration publique devant montrer par son exemple que le français est la langue commune de tous les citoyens du Québec : l’usage du français doit être généralisé dans tous les services publics, d’une part, et, d’autre part, les citoyens anglophones individuels ont droit à des services dans leur langue, à leur demande.
5. Les acquis de l’approfondissement de la situation de la langue française.
Durant la période que nous venons d’évoquer, entre 1950 et 1970, l’opinion publique chez les Canadiens français se modifie totalement. De la résignation à leur sort qui était l’attitude générale au début des années 1950 sous l’emprise conjuguée du régime Duplessis et de l’Église catholique, l’inquiétude grandit chez eux à mesure qu’ils prennent conscience que les anglophones monopolisent les fonctions de direction des entreprises et la propriété ou la gestion des commerces, les réduisant aux postes subalternes et au rôle de main-d’œuvre, donc aux petits salaires. Les révélations de la commission Laurendeau-Dunton et de la commission Gendron sont si précises et si bien documentées que la situation leur devient inacceptable. Le désir de changer l’ordre des choses grandit rapidement chez les francophones dans l’indifférence des anglophones sûrs d’eux-mêmes et de leur bon droit. La pression sur les gouvernements pour qu’ils agissent devient de plus en plus forte à mesure qu’on se rapproche de la fin des années 1960. Le dossier de la langue cesse d’être uniquement linguistique pour devenir surtout politique. C’est le point d’aboutissement de ces deux décennies. Rien, sur le plan sociolinguistique, ne sera plus jamais pareil.
La situation de la langue française est maintenant décrite avec précision sous tous ses aspects. Les grands thèmes des modifications nécessaires sont connus et font consensus. Cet acquis sera précieux au moment d’élaborer un projet de politique et de loi linguistiques. Les gouvernements successifs pourront s’appuyer sur les données des trois commissions pour légitimer les dispositions qu’ils prendront.
Enfin, l’idée de la commission Gendron de faire du français la langue commune du Québec sera remise à l’honneur par le Parti québécois, notamment à partir du rapport du Comité interministériel sur la situation de la langue française en 1996, intitulé Le français, langue commune, Enjeu de la société québécoise.
Les intellectuels de langue française furent à l’origine de ce changement de mentalité. Les chercheurs y apportèrent une contribution de toute première importance par leur participation à l’une ou à l’autre commission.
C’est la fin d’une époque, la fin des illusions engendrées par la Confédération de 1867, celle des deux peuples fondateurs, celle de l’égalité des Français de naguère et des Anglais de la Conquête, l’illusion de l’égalité du français et de l’anglais, celle aussi de l’innocuité du bilinguisme.
Le pourquoi d’une politique linguistique est devenu évident. Il reste à répondre à la question du comment.
L’époque de la résignation est terminée. Commence celle de l’affirmation.
Chapitre II – L’élaboration des premières lois linguistiques
Le lecteur sait maintenant pourquoi la nécessité d’améliorer la capacité de la langue française à résister, au Québec, à la concurrence de la langue anglaise s’est lentement imposée aux Canadiens français durant les décennies 1950 et 1960. Le lecteur a vu aussi comment les Canadiens français sont arrivés à se convaincre que le seul et le meilleur moyen d’y parvenir était de faire adopter par le gouvernement une politique linguistique, dont ils avaient décelé les thèmes principaux à partir de l’observation de la situation de la langue française au Québec et au Canada, dont les commissions Laurendeau-Dunton et Gendron ont confirmé l’exactitude.
Il était plus facile de réclamer une politique linguistique que de la concevoir et, surtout, de la faire adopter par l’Assemblée nationale. Il fallait d’abord que les partis politiques en fassent un article de leurs programmes électoraux et qu’ils prennent le pouvoir pour le concrétiser. Intervenir dans la question de la langue semblait aux politiciens de l’époque, et leur semble encore aujourd’hui, très périlleux, puisque leurs électeurs étaient aussi bien francophones qu’anglophones et que leur répartition dans les différentes circonscriptions électorales était très inégale, aussi bien à la ville qu’à la campagne.
Un incident s’est produit qui a déclenché une crise linguistique d’une telle ampleur que le gouvernement de l’époque, l’Union nationale, n’a eu d’autre choix que d’intervenir pour le régler. Cet incident a pris la forme d’une querelle scolaire dans une petite commission scolaire de la banlieue de Montréal à propos de la langue d’enseignement à l’école primaire, une querelle locale entre les Canadiens français et les Italiens qui s’est propagée comme un feu de brousse à tout le Québec et a suscité la passion de tous les citoyens québécois, francophones, anglophones et allophones. Ce fut la crise de Saint-Léonard dont le récit ouvre ce chapitre.
La crise de Saint-Léonard a provoqué la proposition du bill 63 par le gouvernement de l’Union nationale. Ce parti en a perdu les élections en 1970 et c’est le Parti libéral de Robert Bourassa qui a entrepris de mettre en œuvre cette première loi linguistique, en demandant à l’Office de la langue française de s’occuper en priorité des articles relatifs à la langue de travail et de la publicité. L’Office a pu alors conduire d’importants travaux d’exploration dans le but de transformer les dispositions abstraites de la loi en éléments de programmes applicables. Pendant ce temps, l’échec de la loi 63, fondée sur une stratégie d’incitation, a conduit le gouvernement libéral à concevoir et à faire adopter la loi 22, sur la base des résultats des travaux de l’Office et en s’inspirant des recommandations de la commission Gendron.
Aux élections de 1976, le Parti québécois a pris le pouvoir à la surprise de tout le monde. Son programme électoral prévoyait de revoir la loi 22, parce qu’elle faisait une place si grande à la langue anglaise que cette langue conservait tout son prestige dans les domaines les plus déterminants et qu’elle maintenait, de ce fait, la langue française dans le rôle de langue d’appoint.
Ce sera là l’essentiel du présent chapitre.
1. La crise de Saint-Léonard
Dans les années 1950 et le début des années 1960, Saint-Léonard était un paisible village agricole situé au nord-est de la ville de Montréal, mais un village en train de se muer en une ville. De 1956 à 1968, sa population était passée de 2 500 habitants, en majorité des Canadiens français, à 25 000 citoyens dont 30 % étaient des immigrants récents en provenance d’Italie. Ces immigrants occupaient des lotissements au sud du village, à la limite des terres agricoles, aux frontières administratives de la ville de Montréal.
Rien ne permettait de prévoir que cette bucolique banlieue jouerait le rôle de détonateur et serait à l’origine de la politique linguistique du Québec.
Pour comprendre les événements dont nous nous apprêtons à évoquer le déroulement, il est nécessaire de rappeler les dispositions de la constitution du Canada relatives à la répartition des enfants dans les écoles du Québec.
La Constitution garantissait aux parents du Québec le choix d’envoyer leurs enfants soit à une école catholique, soit à une école protestante. Cette disposition constitutionnelle avait eu une conséquence imprévue : un lien fortuit s’était établi au fil des années entre religion et langue de l’école, puisque les catholiques étaient alors quasi uniquement de langue française et les protestants, de langue anglaise. D’un point de vue strictement juridique, le choix de l’école était fondé sur la religion et non sur la langue.
Sur tout le territoire du Québec, le système scolaire catholique appliquait d’une manière intransigeante le critère de la religion. Même les enfants de langue française, mais de religion protestante, étaient forcés de fréquenter l’école anglaise protestante. Par contre, le système scolaire protestant, plus ouvert, accueillait les enfants de toutes les religions, y compris ceux qui étaient de religion catholique… et les anglicisaient!
Cependant, les parents de religion protestante mais de langue française ont demandé et obtenu de la commission scolaire protestante la création d’un secteur de langue française dans le système scolaire protestant. En réaction, la commission scolaire catholique a créé des classes bilingues à l’intention des enfants anglophones ou allophones, à condition qu’ils soient catholiques.
En conséquence, les parents obtenaient ainsi, dans les faits, la liberté de choix de la langue d’enseignement.
En 1962-1963, 75 % des enfants de parents immigrants fréquentaient les classes anglaises et poursuivaient ensuite leurs études secondaires en langue anglaise.
Or les immigrants étaient de plus en plus nombreux, surtout à Montréal, et ils s’intégraient massivement à la communauté de langue anglaise, dont la langue, pensaient-ils, leur offrait et offrirait à leurs enfants un meilleur destin socioéconomique. Les premiers résultats des travaux de la commission Laurendeau-Dunton confirmaient cette intuition : même au Québec, il était plus rentable d’être unilingue de langue anglaise que bilingue anglais-français, le pire étant, du point de vue économique, d’être uniquement de langue française. À la longue, ce choix de la langue anglaise par les immigrants aurait pour effet d’augmenter l’importance numérique de la minorité anglophone et de réduire d’autant celle de la majorité francophone. La langue française s’en trouverait, en conséquence, de plus en plus marginalisée. Les francophones en prennent conscience et, peu à peu, l’inquiétude se manifeste publiquement.
C’est dans ce contexte que la crise de Saint-Léonard se déclenche.
En 1963, la Commission scolaire de Saint-Léonard, de qui relève l’enseignement de niveau primaire sur ce territoire, décide de créer des classes dites « bilingues », surtout à la demande des parents italophones. Cette décision se prend en deux temps.
Le 8 mai, le commissaire Léon Saulnier propose[54] une nouvelle répartition des classes à l’école élémentaire Jérôme-Le Royer (école du quartier de Saint-Léonard à forte concentration italienne) : en première année, classes en français pour tous les enfants; de la 2e à la 5e année, les classes seraient ou françaises ou bilingues français/anglais; les classes de 6e et de 7e année seraient entièrement françaises ou anglaises. La résolution est adoptée à l’unanimité.
Le 10 juillet de la même année, le commissaire Léo Pérusse propose de modifier la répartition des classes adoptée le 8 mai. Certains attendus de sa proposition révèlent les préoccupations des commissaires. La ville de Saint-Léonard compte un assez grand nombre de citoyens d’origine ethnique ni française ni anglaise. Cette partie de la population croit au bilinguisme du Canada, que les parents italiens conçoivent comme le fait d’avoir le choix entre l’une ou l’autre langue. Les commissaires d’école sont tout autant favorables au bilinguisme, mais sont contre les écoles uniquement anglaises dans la province de Québec pour les enfants des immigrants. Le commissaire Pérusse propose donc que les classes des 1re, 2e et 3e années soient ou françaises ou bilingues, ces dernières accessibles uniquement aux élèves qui ne sont pas de langue française; que les classes de 4e, 5e, 6e et 7e année soient ou françaises ou anglaises pour les seuls élèves des classes bilingues des années précédentes[55]. La proposition est adoptée, mais sur dissidence du commissaire Saulnier qui préférerait que les classes de la première année soit en français seulement pour tous les enfants. Il faut cependant préciser que les classes « bilingues » n’avaient de bilingue que le nom : en réalité, 70 % de l’enseignement se donnait en anglais dans ces classes.
Les commissaires espéraient que la fréquentation d’une école à majorité de langue française favoriserait la francisation et l’intégration des enfants de langue italienne. Douce illusion : les élèves italiens jouaient en anglais dans la cour de récréation et choisissaient massivement de poursuivre leurs études secondaires en langue anglaise. Devant cet échec évident, après quatre années d’essai, la commission scolaire procède à une réorganisation radicale des structures du cours élémentaire le 20 novembre 1967 sur proposition du commissaire Pérusse, proposition adoptée à l’unanimité.
À partir de la rentrée des classes de septembre 1968, l’enseignement dans les classes des trois premières années se donnera uniquement en français à tous les élèves et cet enseignement en français pour tous s’étendra progressivement aux autres années jusqu’en 1972. De plus, comme les commissaires « sont conscients de la nécessité pour nos enfants de maîtriser la langue anglaise, tout comme ils sont conscients de sauvegarder au Québec la culture française, ils décident également que la langue anglaise serait enseignée à partir de la première année dès l’ouverture des classes en septembre 1968[56] ». Ils constituent à cette fin un comité de dix personnes avec mandat d’étudier les méthodes d’enseignement des langues secondes les plus appropriées et de donner leur avis sur ce point aux commissaires. Le rapport de ce comité est déposé lors de la réunion du 19 mars 1968, à temps pour procéder à l’engagement du personnel requis pour l’année scolaire 1968-1969.
Les parents italiens non seulement protestent contre cette décision d’imposer l’enseignement en français à leurs enfants, mais ils haussent leurs exigences et réclament pour eux non plus des classes bilingues, mais la fréquentation d’une école élémentaire entièrement de langue anglaise avec enseignement du français comme langue seconde. Une association des parents anglophones, l’Association of Parents of Saint-Léonard, se crée pour défendre l’école anglaise, soutenue financièrement par le milieu anglophone des affaires et les contributions des Anglais du Québec et même d’ailleurs au Canada. Notons qu’à Saint-Léonard, les « vrais » anglophones étaient alors à peine 1 % de la population, les « anglophones » de l’Association étaient, en réalité, des italophones anglicisés qui s’identifiaient davantage à la communauté de langue anglaise qu’à celle de la majorité de langue française pour des motifs strictement économiques.
En réaction, les parents de langue française créent, le 28 mars 1968, leur propre association, le Mouvement pour l’intégration scolaire (MIS), pour soutenir l’école française pour tous les enfants, indépendamment de leur langue maternelle et pour contrebalancer la pression des parents italophones sur la commission scolaire et sur l’opinion publique.
La réunion suivante des commissaires, le 9 mai, à laquelle beaucoup de parents assistent, est très houleuse. Deux propositions sont présentées.
La première par le commissaire Paul Drouin :
Considérant que l’enseignement du français et/ou de l’anglais dans les écoles de la commission scolaire de Saint-Léonard soulève une certaine controverse; considérant qu’il y a disparité dans les opinions émises par les différents corps intermédiaires qui se sont prononcés sur le sujet, en particulier sur la langue d’enseignement; considérant que les parents n’ont pas eu l’opportunité de faire valoir individuellement leurs idées dans ce domaine; considérant qu’il est juste et opportun qu’ils soient consultés à ce sujet, il est proposé qu’une consultation populaire soit tenue le 10 juin 1968.
La proposition est acceptée à l’unanimité.
La seconde est présentée en fin de séance par le commissaire Jacques Deschênes lorsqu’il se rend compte qu’il avait eu tort, au moment du vote de la résolution précédente, de croire que la commission scolaire prendrait une décision en conformité avec les résultats de la consultation. Les nombreux attendus de sa proposition sont, eux aussi, très révélateurs des opinions en présence. Citons, entre autres :
- Attendu que des groupes de pression se sont formés de part et d’autre et que le problème dégénère rapidement en sujet de discorde et de dissension au sein de notre communauté;
- Attendu que l’immobilisme actuel des commissaires sème l’équivoque et la confusion dans la population et trouble les bonnes relations chez les enseignants, les parents et les enfants de notre communauté;
- Attendu que chaque jour d’inaction accentue davantage ce conflit et envenime davantage le climat social;
- Considérant que 81 % de la population du Québec est francophone et que 90 % des parents de Saint-Léonard parlent français;
- Attendu que l’enseignement dit « bilingue » défavorisera l’adaptation sociale de l’élève à son milieu, en l’empêchant de participer pleinement à l’évolution rapide actuelle de notre société vers un avenir intégralement français;
- Attendu que le cloisonnement en deux systèmes scolaires défavorise les relations harmonieuses entre tous les élèves d’un même voisinage;
- Il est proposé qu’à partir de septembre 1968, l’enseignement dit « bilingue » soit maintenu en augmentant progressivement la proportion des cours dispensés en français pour tous les élèves ayant déjà commencé leurs études soit en anglais, soit au cours « bilingue » et pour eux seuls;
- Qu’un système permanent de classes spéciales, dites classes « d’accueil » ou classes « d’adaptation » soit institué progressivement pour tout élève n’ayant pas au préalable une acquisition jugée suffisante de la langue de base;
- Que la possibilité soit étudiée pour que tout élève non canadien français et non catholique soit admis à nos écoles et dispensé du cours de religion, si les parents le désirent;
- Que la commission scolaire entreprenne, d’ici septembre 1968, une campagne intense d’information publique, en français et en italien, afin de bien expliquer aux parents les justifications de ces transformations et leurs modalités[57].
Devant le refus du commissaire Deschênes de scinder sa proposition, elle est rejetée à quatre voix contre la sienne.
Au cours de cette réunion, les discussions entre les commissaires, entre les commissaires et le public qui y assistait et entre les factions entre lesquelles se partageaient les participants laissaient prévoir un durcissement des relations entre les protagonistes de langue française et de langue italienne, d’autant plus que des élections à la commission scolaire sont prévues pour le 10 juin suivant et que deux postes de commissaires sont à pourvoir.
L’Association des hommes d’affaires et professionnels canadiens italiens de Saint-Léonard envoie un mémoire au premier ministre Daniel Johnson dans lequel ils soutiennent que les Canadiens italiens (sic) veulent que leurs enfants puissent étudier dans les deux langues « afin de devenir d’authentiques citoyens canadiens[58] ».
Le 4 juin 1968, le journal Le Devoir publie un article sous le titre « Les catholiques anglophones interviennent dans le conflit ethnique de Saint-Léonard ». On y apprend qu’un comité d’envergure provinciale tente de bloquer la consultation, prévue pour le 10 juin, soupçonnant les commissaires de vouloir « renforcer la politique qui consiste à priver un grand nombre de parents de leur liberté de choix de la langue d’enseignement ». En réalité, aucun texte juridique ne confirmait l’existence de cette pseudo-liberté de choix, la constitution du Canada ne garantissant que le choix de l’école selon la religion.
Pendant ce temps, les candidats aux élections scolaires font campagne, appuyés chacun par leurs partisans, les uns regroupés autour du Mouvement pour l’intégration scolaire, les autres autour de l’Association of Parents of Saint-Léonard.
Cette dernière organise une réunion qui se tient dans les trois langues pour inciter les électeurs à voter contre les candidats du MIS accusés d’être séparatistes et pour inviter les parents italiens à boycotter la consultation. Plus de 400 personnes y participent. Le même soir, dans un lieu voisin, le MIS organise une réunion (500 personnes) de financement, avec la participation de chansonniers. Des policiers armés prêts à intervenir surveillent les deux groupes, mais aucun affrontement ne se produit.
Le 10 juin, le MIS fait élire ses deux candidats et devient ainsi majoritaire à la commission scolaire avec l’appui du commissaire Jacques Deschênes.
Le 27 juin 1968, les commissaires d’école de Saint-Léonard décident à la majorité que le français sera progressivement la seule langue d’enseignement des classes élémentaires à partir de septembre de la même année. Le 10 juillet suivant, les commissaires mettent fin à la querelle au sujet de l’enseignement de l’anglais en décidant à la majorité qu’il commencera à partir de la 5e année conformément au programme du Ministère, à raison d’une période par jour et en recourant à une pédagogie audiovisuelle. Le 14 août, l’expérience des classes d’accueil est étendue à trois écoles de la commission scolaire, décision prise à l’unanimité.
Sur ces entrefaites, une deuxième affaire Saint-Léonard éclate.
Le 7 août 1968, la Commission scolaire régionale Le Royer, de qui relève l’enseignement secondaire, décide de transformer l’unique école secondaire française de Saint-Léonard, l’école Aimé-Renaud, en école anglaise pour accommoder les élèves italiens qui choisissent l’enseignement secondaire en anglais. Les élèves francophones seront éparpillés dans les autres écoles de la commission par transport scolaire, solution la plus économique selon le président de la commission, André St-Onge.
Cette décision renforce la colère des parents francophones de Saint-Léonard.
Le 14 août, la Commission scolaire de Saint-Léonard proteste contre cette décision « qui favoriserait une minorité d’élèves au détriment de la majorité, qui devront voyager une grande distance et occuper des locaux moins convenables » et qui « consacrerait dans les faits l’existence d’une école secondaire proprement anglaise à Saint-Léonard ». En conséquence, les commissaires demandent le maintien de l’enseignement français à l’école Aimé-Renaud et chargent leur « représentant à la commission régionale de faire toutes les démarches utiles en ce sens ».
Le 30 août au soir, opération spectaculaire, une première au Québec : des élèves, forts du soutien populaire, occupent l’école au nom de « Aimé-Renaud en français ». Le MIS organise une manifestation d’appui à cette revendication des élèves.
Journalistes et politiciens sont plus réservés. Dans un même numéro du Devoir, le directeur, Claude Ryan, dénonce cet activisme des élèves dans son éditorial alors que son journaliste, Jean-Marc Léger, en souligne le bien-fondé. René Lévesque est très réservé sur cette question de la langue de l’école, question trop délicate et trop chaude pour une telle approche.
Le 4 septembre, la Commission scolaire Le Royer, à la demande du ministre de l’Éducation, Jean-Guy Cardinal, et après consultation des parties en cause, prend la décision de maintenir l’école Aimé-Renaud comme école secondaire pour les étudiants de langue française de Saint-Léonard et de loger les étudiants « anglophones » dans une nouvelle école primaire transformée temporairement en école secondaire, ce qui met fin à l’occupation de l’école.
Au primaire, la rentrée scolaire est fixée au lundi 8 septembre 1968.
Début septembre, le ministre de l’Éducation, Jean-Guy Cardinal, propose un compromis : créer pour les élèves italiens une école privée de langue anglaise subventionnée à 80 %. Les parents italophones réclament le droit à la langue de leur choix pour leurs enfants, les francophones estiment que le ministre tente de réintroduire l’anglais au mépris de la volonté de la population. Les nationalistes jurent que jamais l’école privée anglaise n’ouvrira ses portes.
Le 3 septembre 1968, la LIS (nouvelle appellation du MIS, devenu la Ligue d’intégration scolaire, après contestation par les membres du MIS de son président, Raymond Lemieux, jugé trop radical) organise une assemblée rue Jean-Talon. Une centaine d’Italiens tentent d’empêcher Raymond Lemieux de parler. La réunion tourne à la bagarre, la police intervient. Raymond Lemieux, qui a été légèrement blessé pendant l’échauffourée, promet de reprendre la manifestation la semaine suivante.
Le 5 septembre, les représentants de la LIS et le ministre Cardinal arrivent à un compromis : 1) l’enseignement public reste français, 2) une heure d’anglais par jour pour les élèves italiens de première année, 3) dispositions pédagogiques transitoires en 2e année pour les enfants italiens des classes bilingues, 4) classes bilingues pour eux à partir de la 3e année. Les deux représentants italiens à cette réunion, John Papa et Luigi Barone, se dissocient de ce compromis, appuyés par l’Association of Parents of Saint-Léonard : c’est l’enseignement tout en anglais qu’ils réclament, rien d’autre. L’Association recommande aux parents italiens de ne pas envoyer leurs enfants à l’école lors de la rentrée.
Le jour de la rentrée, la majorité des parents italiens ne suivent pas la consigne de boycottage : 60 % des parents italiens conduisent leurs enfants à l’école, soit 1 200 des 2 000 élèves. Les autres sont accueillis par le Protestant School Board contre une contribution de 25 $ par mois.
Le 10 septembre 1968, la LIS convoque le public à une manifestation d’appui à l’école française. Le chef de police, Sylvio Langlois, interdit la manifestation. Plus de 1 000 manifestants se présentent quand même au lieu de rassemblement. La police municipale, renforcée par la Sûreté du Québec, bloque la rue Jean-Talon. Pendant qu’on parlemente, les manifestants contournent le barrage policier. Les contre-manifestants italiens sont là, devant eux, dont un certain nombre de fiers-à-bras armés de bâtons et de chaînes de vélo, bien décidés à casser du « séparatiste ». C’est la bagarre. La police charge, la foule se disperse en désordre, il y a de la casse contre les magasins de la rue Jean-Talon, le maire Léo Ouellet proclame la Loi sur l’émeute.
On en reste là de part et d’autre. Pour l’instant, l’affaire est localisée à Saint-Léonard et n’a aucune répercussion dans les autres écoles de la région de Montréal ou du Québec.
Ce sont les politiciens qui prennent le relais.
2. L’affaire du bill 63
À partir de ce moment, le débat prend de l’ampleur et se transforme en une question de politique scolaire pour tout le Québec.
Le 22 novembre 1968, Jean-Jacques Bertrand, qui a succédé comme premier ministre à Daniel Johnson décédé entre-temps, annonce sur les ondes d’une radio de langue anglaise (CFCF) son intention de présenter la semaine suivante un projet de loi confirmant le droit de la minorité anglaise de faire éduquer ses enfants dans la langue de son choix, alors que le choix constitutionnel ne porte que sur la religion.
Cette déclaration improvisée n’a pour objet que de soutenir le candidat anglophone de l’Union nationale, John Lynch-Stanton, à l’élection partielle de Notre-Dame-de-Grâce.
Ni le conseil des ministres, ni le caucus des députés ne sont au courant de cette intention. Tempête dans le parti de l’Union nationale et chez les nationalistes québécois. Devant cette forte opposition, le premier ministre n’a donc d’autre choix que de renvoyer son projet à plus tard, après les élections partielles dans la circonscription de Notre-Dame-de-Grâce et dans celle de Bagot où Jean-Guy Cardinal est candidat.
Le 9 décembre 1968, le premier ministre, entêté, revient à son intention et dépose le projet de loi 85, qui accorde à tous les parents le libre choix de la langue d’enseignement. L’opposition à ce projet de loi est de nouveau très vive, même au sein de l’Union nationale. La seule manière de s’en sortir pour le gouvernement est de renvoyer le projet au comité parlementaire de l’Éducation. Durant les audiences du comité, aucune possibilité de compromis ne se dégage entre les différents groupes qui y présentent des mémoires.
Le projet de loi est abandonné.
Il réapparaît en 1969, sous la forme cette fois du projet de loi 63, le fameux bill 63. Il est présenté à l’Assemblée nationale le 23 octobre 1969 sous le titre Loi pour promouvoir l’enseignement de la langue française au Québec.
Le texte est très court et ne vise qu’à régler l’affaire de Saint-Léonard, plus précisément la question du choix de la langue d’enseignement par les parents immigrants. Il s’en tient strictement à cette question sans tenir compte de la situation globale de la langue française face à la langue anglaise, qui est à l’origine du désir des parents immigrants de faire instruire leurs enfants en langue anglaise. Il ne traite aucun des éléments d’une éventuelle politique linguistique dont commence à se préoccuper l’opinion publique québécoise.
L’article 1 du projet de loi donne le mandat au ministre de l’Éducation de s’assurer que les enfants du système scolaire de langue anglaise acquièrent une connaissance de la langue française.
L’article 2 pose d’abord le principe que la langue d’enseignement est le français, mais ajoute que « les cours sont donnés en langue anglaise à chaque enfant dont les parents ou les personnes qui en tiennent lieu en font la demande lors de son inscription ». La liberté de choix des parents quant à la langue d’enseignement est, selon ce texte, complète et universelle. Aucune restriction n’y est posée. Elle est accordée aussi bien aux parents francophones qu’aux parents anglophones ou allophones, qui pourront envoyer leurs enfants à l’école anglaise sous prétexte d’y apprendre l’anglais, partout au Québec. Il n’est pas question non plus du nombre des enfants qui deviendraient ainsi admissibles à l’enseignement en anglais dans toutes les régions du Québec.
L’article 3 oblige le ministre de l’Immigration à prendre les dispositions nécessaires pour que les immigrants apprennent le français dès leur arrivée au Québec. Le texte se termine (article 4) par la mention de la date d’entrée en vigueur de ces mesures, soit le 1er juillet 1970, sans se soucier du fait que ni le ministère de l’Éducation, ni les commissions scolaires, ni le ministère de l’Immigration n’auront le temps d’ici là de s’organiser pour appliquer la nouvelle loi.
Dès sa présentation, le bill 63 étend à l’ensemble de la population québécoise les tensions locales qu’avait générées la décision de la Commission scolaire de Saint-Léonard et provoque à l’Assemblée nationale un débat houleux, le premier à porter spécifiquement sur la question linguistique. Ainsi s’amorce, pour ainsi dire dans l’improvisation du moment, le débat social et politique au sujet du statut de la langue française au Québec et, par ricochet, de celui de la langue anglaise. Le débat en chambre durera du 23 octobre 1969 au 28 novembre de la même année.
L’Assemblée nationale est alors composée des députés de trois partis : le parti de l’Union nationale au pouvoir, le Parti libéral dirigé par Jean Lesage qui joue le rôle d’opposition officielle et un unique député du nouveau Parti québécois, René Lévesque.
D’entrée de jeu, l’opposition officielle se rallie au principe de la liberté de choix des parents prévue à l’article 2 du projet de loi.
René Lévesque, qui déteste toute forme de radicalisme à la manière de Saint-Léonard, est cependant convaincu que le Québec doit respecter le droit constitutionnel des anglophones à un système scolaire de langue anglaise aux frais de l’État. Il propose un amendement à l’article 2 du texte proposé : l’école anglaise pour les « vrais » anglophones, l’école française pour les francophones et les allophones mais avec amélioration de l’enseignement de l’anglais, langue seconde. Après un long et houleux débat, l’amendement est rejeté.
Jean Lesage, pour sa part, reproche au gouvernement de n’avoir inséré dans ce texte de loi aucune disposition pour faire de la langue française une langue nécessaire pour gagner sa vie, par exemple en incitant les entreprises à faire du français la langue de travail. Il cite à l’appui de cette objection le programme politique du Parti libéral adopté deux ans plus tôt (en 1966) en prévision des prochaines élections sous le titre Le Québec français :
Pour conserver au Québec son caractère français, des mesures seront prises qui garantiront la vitalité de la langue, en même temps qu’elles permettront à la majorité de la population de vivre en français, où que ce soit sur le territoire québécois. Des mesures seront prises qui assureront au Québec un visage français et à la langue française la place prioritaire qui lui revient dans l’administration et les services publics, dans les relations industrielles, le commerce et, de façon générale, dans tous les secteurs de l’activité humaine. Donc, sans porter atteinte aux droits inaliénables de la minorité anglophone, la langue française deviendra au Québec la principale langue de travail et de communication[59].
Pour atteindre ce but, poursuit Jean Lesage, il faudrait une loi qui aurait dû être adoptée bien avant aujourd’hui. Et il ajoute avec insistance qu’il faut revaloriser le rôle de l’Office de la langue française en lui donnant plus d’autorité et en augmentant ses moyens d’action, budget et personnel.
Jean-Jacques Bertrand rétorque que le programme de son parti, également adopté en 1966 sous le titre La Nation et l’État, prévoit de donner au français le statut d’une langue nationale, tout en reconnaissant l’existence des deux langues officielles.
Le 4 novembre, à la suite de l’intervention de Jean Lesage, Jean-Jacques Bertrand annonce que le gouvernement proposera un nouvel article au texte initial du projet de loi pour élargir le rôle de l’Office de la langue française en lui confiant la responsabilité de favoriser l’implantation de la langue française comme langue de travail dans les entreprises du Québec et de conseiller le gouvernement en la matière. Le député libéral Jérôme Choquette propose de confier un mandat supplémentaire à l’Office de la langue française, celui de recevoir toute plainte d’une personne dont le droit de travailler en français n’est pas respecté.
René Lévesque estime qu’il est inhumain de demander à des ouvriers de dénoncer leurs employeurs au risque de représailles. Le 18 novembre, il constate que la Chambre est en train de bricoler un embryon de politique linguistique qui s’en tiendrait uniquement à la langue de travail, alors qu’il faudrait y ajouter bien d’autres éléments. Il propose le texte d’un tout autre article, beaucoup plus englobant, qui toucherait la langue de travail, les raisons sociales, les conventions collectives et les contrats de travail, les communications des employeurs avec le personnel, la connaissance du français par les membres des ordres professionnels, l’affichage public (français prioritaire) et la commercialisation des produits de consommation. Cet article prévoyait également des pénalités en cas de violation de la loi. Les deux autres partis rejettent sa proposition.
L’Assemblée nationale accepte enfin de modifier le titre du projet de loi qui devient Loi pour promouvoir la langue française au Québec. Elle est sanctionnée le 28 novembre 1969 telle que modifiée par l’Assemblée nationale.
Le débat en chambre révélait que, si tous les partis étaient d’accord sur la nécessité d’une politique linguistique en faveur de la langue française, aucun n’avait une idée bien précise de son contenu éventuel ni de la manière d’aborder la langue de travail. Tous s’en tenaient à des généralités, comme le démontre l’improvisation du nouveau mandat confié à l’Office de la langue française.
Le débat au sein de la population fut tout aussi animé que celui en chambre. L’opposition populaire au bill 63 s’organise rapidement à partir du 25 octobre 1969. L’adoption de ce projet de loi, le 28 novembre 1969, y mettra fin temporairement. Car le militantisme linguistique des francophones demeurera très vigilant, au moins jusqu’à l’adoption de la Charte de la langue française en 1976, qui le calmera. Il reprendra un peu lors des modifications du texte original à la suite des arrêts de la Cour suprême. Il semble s’être dilué de nos jours dans d’autres préoccupations, l’environnement et la mondialisation de l’économie, avec sa conséquence, l’hégémonie mondiale de la langue anglaise. Mais nous anticipons. Revenons au bill 63.
Dès que le texte initial du bill 63 est connu, l’opinion publique se scinde spontanément et immédiatement en deux groupes antagonistes, entre approbation et opposition. Le clivage apparaît nettement : le monde des affaires, représenté par le Conseil du patronat ou les chambres de commerce et toutes les associations qui s’inspirent du seul principe du respect des droits individuels se bornent à approuver le principe du projet de loi, sans plus. Les opposants, au contraire, se regroupent et exposent publiquement leurs arguments.
Le 25 octobre, une centaine d’organismes de toute vocation et d’importance variable réunis dans le Mouvement Québec français (MQF) fondent le Front commun du Québec français pour contrecarrer le projet du bill 63. Le Front commun énonce clairement sa position : 1) il s’oppose au principe du libre choix de la langue d’enseignement pour tous les parents; 2) cette disposition revient à donner à la langue française et à la langue anglaise le même statut juridique, du moins dans le domaine scolaire, ce qui est une première dans l’histoire du Canada; 3) le gouvernement doit concevoir et soumettre à la population une politique globale de la langue française plutôt que de se préoccuper de la seule situation scolaire des minorités révélée par l’affaire de Saint-Léonard; 4) à l’unanimité, les associations présentes demandent que l’Assemblée nationale proclame l’unilinguisme du Québec à tous les niveaux, sans préciser davantage ce qu’elles entendent par là. Ce dernier point servira ni plus ni moins que d’épouvantail pour discréditer l’action du Front commun, à cause du radicalisme et du manque de nuances d’une telle position de principe.
Ce qui n’empêche pas que les adhérents au Front commun se multiplient rapidement. S’y joignent l’Association des écrivains, alors animée par le poète Gaston Miron, le mouvement syndical dans son ensemble avec Michel Chartrand comme porte-parole, notamment le syndicat des métallos de la Fédération des travailleurs du Québec (FTQ), les syndicats des fonctionnaires et des professionnels du Québec, les syndicats d’enseignants et des professeurs d’université. Les élèves et les étudiants du Québec, animés par les associations étudiantes du secondaire, des cégeps et des universités, se joignent au mouvement.
Des assemblées d’information se tiennent dans tous les milieux pour discuter du projet de loi et des raisons de s’y opposer. Les intellectuels y participent activement et diffusent à tous ces publics ce qu’ils savent de la situation réelle de la langue française au Québec, des conséquences prévisibles de la dénatalité des francophones par rapport à l’augmentation du nombre des immigrants et de la tendance de ces derniers à s’intégrer à la communauté de langue anglaise, toutes choses bien analysées par la commission Laurendeau-Dunton. Rapidement, l’unanimité se fait contre le principe même du bill 63 : le libre choix de la langue d’enseignement accélérera le déclin du français au Québec. L’opposition est surtout très forte à Montréal, ville et région où se concentrent les immigrants récents et où le recul des francophones est le plus perceptible et le plus menaçant.
Le vendredi 31 octobre, le Front commun convoque une grande manifestation à Québec, devant le parlement. De 15 000 à 20 000 personnes répondent à l’appel, en provenance des quatre coins du pays par tous les moyens de transport. L’assemblée se déroule dans la joie et l’ordre. Elle prend fin vers 21 heures et la foule se disperse calmement. Le service d’ordre tente vainement de convaincre un groupe d’irréductibles (plus ou moins 1 500 personnes) de quitter les lieux. Ils prennent plutôt les policiers comme cibles avec tous les projectiles possibles. Les policiers répliquent à coup de gaz lacrymogènes. L’affrontement est brutal.
Le débat se déplace dans les médias.
Dans Le Devoir du 1er novembre, Léon Dion, alors professeur de Sciences sociales à l’Université Laval et qui jouissait d’une grande autorité morale et intellectuelle au Québec, publie un long article au sujet du bill 63. Il écrivait :
J’estime, pour ma part, que le gouvernement n’est pas présentement en possession des données de base requises à la préparation d’un tel projet. J’estime en outre que toute loi sur les langues est, à ce moment-ci, prématurée et qu’elle risque, si elle est votée, de produire des effets imprévisibles et non désirables. Ces données de base nous seront fournies lors de la parution prochaine du troisième volume de la Commission d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme et complétées plus tard lors de la publication du rapport de la commission Gendron. […] La décision malheureuse du Premier ministre de présenter néanmoins un projet de loi sur les langues ne peut pas s’expliquer seulement par un entêtement personnel. Elle trahit […] une ignorance flagrante de l’état d’esprit d’une partie particulièrement bien articulée de la population […], la majeure partie du monde des intellectuels.
Le 4 novembre suivant, trois démographes de l’Université de Montréal, Hubert Charbonneau, Jacques Henripin et Jacques Légaré, rendaient publics les résultats de leur analyse des tendances démographiques au Québec. Ils concluaient :
Il est évident que c’est surtout le jeu des mouvements migratoires qui explique cette chute plus ou moins prononcée [de l’importance relative des francophones]. C’est ce facteur qui, dans le contexte où nous sommes, joue contre les francophones, même dans le cas des hypothèses favorables. Il en découle donc assez clairement que si l’on veut assurer le maintien de l’importance relative des francophones, surtout à Montréal, c’est sur la francisation des immigrants qu’il faut faire porter les efforts.
Ce n’est donc pas une loi sur la langue d’enseignement qui réglera le problème, encore moins si elle accorde aux enfants d’immigrants le droit de fréquenter l’école de langue anglaise, accélérant par le fait même leur tendance à s’angliciser.
Malgré tous ces avis, malgré l’opposition d’une grande partie des citoyens, le gouvernement persiste et fait voter la version amendée de son projet de loi.
Ainsi se termine l’affaire de Saint-Léonard.
Les italophones sont satisfaits et retrouvent le droit d’envoyer leurs enfants à l’école de langue anglaise. Des parents francophones en profiteront pour en faire autant. Mais ainsi commence également, dans l’improvisation et la confusion, l’histoire de la politique linguistique du Québec dont les nombreux chapitres sont à venir. C’est également la fin de l’Union nationale qui ne survivra pas au bill 63, sauf un dernier sursaut lors des élections de 1976, bref mais suffisant pour perturber le vote des électeurs.
Dispositions de la Loi pour promouvoir la langue française
Le texte français original de la loi est cité en italique.
Article 1Le ministre de l’Éducation doit prendre les dispositions pour assurer une connaissance d’usage de la langue française aux enfants à qui l’enseignement est donné en langue anglaise.
Article 2L’enseignement obligatoire se donne en langue française.
Il se donne en langue anglaise à chaque enfant dont les parents ou les personnes qui en tiennent lieu en font la demande lors de son inscription.
Cet enseignement doit se conformer à l’article 1.
Article 3Le ministre de l’Immigration doit prendre les dispositions nécessaires pour que les personnes qui s’établissent au Québec acquièrent dès leur arrivée ou même avant qu’elles quittent leur pays d’origine la connaissance de la langue française et qu’elles fassent instruire leurs enfants dans des institutions d’enseignement où les cours sont donnés en langue française.
Article 4Le mandat de l’Office de la langue française est modifié :
L’Office de la langue française doit, sous la direction du ministre :
- a) veiller à la correction et l’enrichissement de la langue parlée et écrite;
- b) conseiller le gouvernement sur toute mesure législative ou administrative qui pourrait être adoptée pour faire en sorte que la langue française soit la langue d’usage dans les entreprises publiques et privées du Québec;
- c) élaborer, de concert avec ces entreprises, des programmes pour faire en sorte que la langue fran çaise y soit la langue d’usage et pour assurer à leurs dirigeants et à leurs employés une connaissance d’usage de cette langue;
- d) conseiller le gouvernement sur toute mesure législative ou administrative qui pourrait être adoptée en matière d’affichage public pour faire en sorte que la langue française y soit prioritaire;
- e) créer un centre de recherches linguistiques et coordonner dans le Québec toute activité de recherches en ce domaine.
Le paragraphe suivant ajoute un dernier élément au mandat de l’Office de la langue française :
L’Office, avec tous les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la Loi des commissions d’enquête, peut entendre toute plainte de tout employé ou tout groupe d’employés à l’effet que son droit à l’usage de la langue française comme langue de travail n’est pas respecté.
3. La mise en œuvre de la loi 63 par l’Office de la langue française[60]
Lors des élections du 29 avril 1970, le Parti libéral dirigé par monsieur Robert Bourassa prend le pouvoir, cinq mois jour pour jour après l’adoption du bill 63 et la modification du mandat de l’Office de la langue française.
Le nouveau gouvernement met en application la loi 63, mais en concentrant son attention sur la langue de travail, pour remplir un engagement de son programme électoral intitulé Québec : au travail! Ce programme énonçait clairement ses intentions sur ce point : « Le peuple québécois doit vivre en français dans un milieu technologique nord-américain. Il y a là un avantage et un défi. Il nous faut assumer notre spécificité tout en participant aux grands mouvements du progrès scientifique. » D’où l’engagement de faire du français la langue de travail : « L’objectif du prochain gouvernement libéral sera de rendre le français prioritaire au Québec et d’en faire la langue d’usage et de travail. […] Les milieux des affaires devront accepter cette réalité, car il y va non seulement de l’épanouissement culturel des Québécois mais aussi de l’originalité de l’ensemble fédéral canadien. L’Office de la langue française sera chargé de la réalisation de ce programme. » Cet organisme étant alors rattaché administrativement au ministère des Affaires culturelles, le dossier linguistique est confié au titulaire de ce ministère, François Cloutier. Sur le plan scolaire, le gouvernement Bourassa met en application les dispositions de la loi qui accordaient à tous les parents le libre choix de la langue d’enseignement, dont il ne sera plus question pendant les quatre années suivantes, jusqu’à l’adoption de la loi 22.
Selon les instructions du ministre Cloutier, l’Office de la langue française conduit, de 1970 à 1974, des travaux qui serviront de base à la conception d’une stratégie cohérente de modification de la situation du français au Québec. L’essentiel de ces travaux servira, le moment venu, à la conception et à la rédaction de la Loi sur la langue officielle (dite loi 22, 1974) et, par la suite, à la mutation de cette loi en Charte de la langue française (loi 101, 1977).
Cependant, la direction de l’Office ne disposait d’aucun modèle dont il aurait pu s’inspirer pour aménager la coexistence harmonieuse du français et de l’anglais sur le territoire du Québec. En effet, le modèle le plus connu, celui de la Suisse, était fondé sur l’unilinguisme des cantons et il était, historiquement et politiquement, inapplicable au Québec. La Belgique, alors en pleine crise sociale, s’orientait vers la partition du pays en deux zones linguistiques en suivant, grosso modo, la frontière linguistique historique entre langues romanes et langues germaniques, la Wallonie francophone au sud et le pays flamand néerlandophone au nord. Le principe de l’unilinguisme des régions était si vigoureusement réclamé que, par exemple, la vieille Université Louvain (Leuven), fondée en 1432, se scinda en deux universités distinctes en 1968, avec la fondation de Louvain-La-Neuve. D’autre part, le modèle dictatorial à la manière de l’URSS ou de la Yougoslavie de l’époque était incompatible avec le système démocratique britannique dont le Canada était l’héritier. Le Québec devait inventer sa propre solution.
L’Office mène ses travaux simultanément et sur les sujets les plus susceptibles d’avoir une influence sur le statut et le prestige du français, notamment du point de vue socioéconomique, soit : la langue de travail, l’affichage, les raisons sociales et la publicité, le commerce et les affaires, l’administration publique.
L’Office se doit, à cette époque, d’agir selon son nouveau mandat conformément à la loi 63. Il tient compte également des engagements du Parti libéral en ce qui concerne la langue française. L’Office prend appui sur les études commandées par la commission Laurendeau-Dunton et sur celles de la commission Gendron au fur et à mesure qu’elles deviennent disponibles. Enfin, il peut s’inspirer de l’expérience d’Hydro-Québec où le français était devenu la principale langue de travail depuis la nationalisation des ressources hydroélectriques et aussi, de l’expérience de SIDBEC, qui avait entrepris sa propre francisation depuis que cette aciérie était devenue entreprise d’État.
a) La langue de travail
Deux mois après son élection, soit le 29 juin 1970, le premier ministre Robert Bourassa convoque les présidents, vice-présidents et directeurs des 500 plus grandes entreprises établies au Québec. Son message à ces dirigeants d’entreprise est clair : le gouvernement est fermement décidé à prendre toutes les mesures pour faire du français la langue de travail, partout au Québec. En conséquence, il invite les entreprises à collaborer avec l’Office pour atteindre rapidement cet objectif. Il insiste sur le fait qu’il compte uniquement sur la persuasion et la bonne volonté de tous, sans songer à recourir à la coercition pour franciser les entreprises. Cette réunion sera suivie, dès le 29 septembre, d’une rencontre entre l’Office et les directeurs du personnel et des relations publiques des mêmes entreprises.
La déclaration du premier ministre Bourassa s’était rapidement répandue dans le monde du travail et des affaires du Québec, mais personne ne savait trop ce qu’elle signifiait, ni pour les anglophones (I do not know exactly what it means, disaient-ils en chœur), ni pour les francophones (C’est vague, il faut essayer de deviner leur pensée).
La commission Gendron réagit immédiatement et donne mandat à un chercheur, Jean-Claude de Brouwer, du Centre de sondage du Québec, d’explorer les réactions des membres de l’élite économique à leur propos[61]. L’enquête se déroule dans les premiers mois de l’année 1971, auprès d’un échantillon de cadres francophones et anglophones. Ses résultats reflètent les situations et les faits observés alors. Ils sont très significatifs des attitudes du monde industriel à cette époque face à une éventuelle modification des règles régissant l’emploi des langues dans la gestion et la production des entreprises.
L’enquête révèle les motifs évoqués par les uns et par les autres pour ne pas être favorables à l’action du gouvernement en vue d’augmenter l’utilisation de la langue française comme langue de travail[62]. Les principaux motifs évoqués sont : On ne peut pas forcer les gens (argument de 41 % des anglophones, de 47 % des francophones); On ne peut progresser avec le français (32 % des anglophones, 41 % des francophones); Le maintien ou l’expansion du bilinguisme est préférable (36 % des anglophones, 16 % des francophones); Cela empêcherait de nouveaux investissements, provoquerait des déménagements de sièges sociaux (22 % des anglophones, 19 % des francophones); L’anglais est la langue des affaires (27 % des anglophones, 9 % des francophones); L’État ne doit pas intervenir (27 % des anglophones, 16 % des francophones).
En somme, les élites économiques, tant francophones qu’anglophones, s’accommodaient fort bien du fait que l’anglais était la langue du travail au Québec, du bilinguisme obligatoire qui en découlait, donc du fait que, pour progresser dans l’entreprise, il fallait savoir l’anglais. L’État ne doit pas s’en mêler, c’est une question que chacun doit régler pour soi.
Malgré ces objections, 71 % des francophones et 47 % des anglophones étaient d’avis que l’implantation du français comme langue de travail était plausible et même vraisemblable. Pour y être favorables, les francophones posaient comme condition qu’aucune contrainte ne soit exercée (52 % d’entre eux) et que l’usage de la langue anglaise soit maintenu (37 %). Chez les anglophones, les principales conditions étaient le maintien de l’usage de la langue anglaise (58 %) et la limitation de l’emploi du français aux niveaux inférieurs et intermédiaires des postes de travail (21 %). Sur ce dernier point, 17 % des francophones étaient du même avis que les anglophones. Les élites de chaque langue protégeaient leurs privilèges.
Enfin, les opinions sur la rentabilité éventuelle de l’emploi du français comme langue de travail étaient contradictoires selon que l’informateur était francophone ou anglophone. Pour 67 % des francophones, ce serait rentable, alors que 89 % des anglophones étaient d’un avis contraire (tableau de la page 214 de l’ouvrage de Jean-Claude de Brouwer).
Les réunions convoquées par le premier ministre et par l’Office étaient prématurées, quoique politiquement nécessaires pour amorcer le virage de la langue de travail. En effet, le gouvernement ne disposait alors d’aucun plan d’action pour faire du français la langue de travail. De plus, l’Office de l’époque avait organisé ses activités et recruté son personnel en fonction de son mandat de 1963, de veiller à la qualité du français au Québec, et n’était pas prêt à assumer le mandat que le gouvernement Bertrand venait à peine de lui confier par la loi 63.
Le ministre Cloutier s’en rend compte. En mars 1971, il nomme un nouveau directeur à la tête de l’Office, Gaston Cholette, avec rang de sous-ministre pour bien souligner l’importance qu’il accorde à cette fonction. Il lui confie une double responsabilité : réorganiser l’Office et orienter en priorité les travaux vers le dossier de la langue de travail. Par la suite, il précisera qu’il souhaite une action directe dans les usines et il se montre de plus en plus agacé par une approche surtout linguistique qui perdure.
Commence alors, en l’absence de tout modèle d’une semblable démarche, une réorganisation complète de l’Office et une longue période de tâtonnement (1971-1974) à la recherche d’une manière de transformer un slogan politique, « Faire du français la langue de travail », en un plan d’action réaliste, applicable et contrôlable.
La lourdeur des règles de la fonction publique québécoise empêche Gaston Cholette de modifier rapidement la composition du personnel de l’Office et d’en augmenter l’effectif. Il doit avoir recours à des expédients, emprunter des personnes à d’autres ministères et même à des entreprises privées, ou encore engager par contrat des personnes-ressources. La fonction publique autorise tout de même neuf nouveaux postes, ce qui lui permet entre autres de recruter un directeur linguistique, en la personne de l’auteur de ces lignes. Gaston Cholette s’entoure ainsi d’une nouvelle équipe, en partie provisoire, avec laquelle il entreprend d’inventer de toutes pièces une stratégie de francisation des entreprises.
À l’évidence, le point de départ qui s’impose d’emblée est le circuit des communications d’une entreprise pour comprendre par qui, vers qui et dans quelle langue, écrite ou orale, s’échangent des messages de diverses natures et de plus ou moins grande importance.
En premier lieu, l’Office s’inspire d’une analyse effectuée pour le compte de la commission Gendron par la firme Ducharme, Déom et Associés et dont l’auteure, Thérèse Heurtebise, est membre de l’équipe provisoire recrutée par Gaston Cholette. Cette analyse distingue les communications externes des communications internes selon le lieu d’origine ou de destination du message. Les communications avec les actionnaires, avec les médias, avec les clients, avec les fournisseurs, avec les gouvernements et organismes sont des exemples de communications externes, alors que les communications avec le personnel (gestion, exécution des tâches, recrutement, embauche, formation), l’affichage de sécurité, l’identification et les modes d’utilisation de la machinerie, les relations de travail (conventions collectives et traitement des griefs) sont des exemples de communications internes.
L’examen de ces divers types de communications et l’identification des contraintes qu’elles exercent tant sur l’emploi du français que de l’anglais mettent en évidence le fait que la langue anglaise est, à cette époque, la langue de la direction des entreprises et la langue française, en général très anglicisée, celle des employés d’exécution, avec, entre ces deux univers, une couche de personnel bilingue pour faire le pont. Autre constatation, s’il est possible de généraliser l’emploi du français dans l’entreprise, il est cependant impossible d’exclure un certain usage de la langue anglaise, notamment dans les communications externes. En conséquence, une partie du personnel des entreprises devrait continuer à être bilingue. D’où la nécessité stratégique de mieux circonscrire la notion de bilinguisme et d’en restreindre la pratique aux seuls employés en contact avec l’extérieur de l’entreprise plutôt que de le rendre obligatoire à l’ensemble du personnel et d’en faire une condition d’embauche pour tous les postes. L’Office précise ainsi, graduellement, la notion de bilinguisme fonctionnel[63] sur la base des exigences linguistiques d’une fonction, c’est-à-dire en graduant la connaissance de l’anglais requise pour remplir une tâche selon une échelle qui va d’une connaissance minimale à une parfaite aisance. Cet angle d’analyse ne sera pas retenu par la suite comme élément du programme de francisation des entreprises. Nous tirerons les conséquences de cette décision plus loin. Au début des années 1970, on constatait que ce n’était qu’un petit nombre de personnes qui assumaient les communications externes, en général le personnel de direction et celui des relations publiques. Il en va tout autrement aujourd’hui, depuis l’introduction dans les entreprises des nouvelles technologies d’information et de communication, surtout d’Internet, qui ont considérablement augmenté le nombre d’employés en contact avec l’extérieur de l’entreprise. Par voie de conséquence, l’emploi de la langue anglaise s’est accru, de même que le besoin d’un certain niveau de bilinguisme fonctionnel pour un plus grand nombre de personnes, ne serait-ce que pour consulter des documents dans Internet.
Par contre, on pouvait poser en principe que toutes les communications internes pouvaient et devaient se dérouler en langue française. L’entreprise en avait le plein contrôle : elle décidait de la langue qu’il fallait utiliser et elle se préoccupait ou devait se préoccuper de la qualité des messages diffusés, contenu et forme, par souci d’efficacité et puisque sa réputation était en cause. Dans les faits, on constatait alors que les communications internes s’effectuaient surtout en langue anglaise, au mieux dans un français anglicisé, du fait qu’une grande partie des cadres n’avaient aucune connaissance de la langue française et ne pouvaient en faire emploi. Le passage au français impliquerait donc, de toute évidence, un important effort de traduction vers le français ou de rédaction en français d’une foule de documents, de même qu’une radicale transformation de la composition linguistique du personnel cadre, soit par l’enseignement du français, soit par le recrutement de personnes bilingues.
Enfin, dernière évidence découlant de l’examen des communications : la nécessité de disposer de la terminologie française, administrative et technique, requise par leur francisation était incontournable. L’Office a donc entrepris, avec la collaboration des entreprises, une grande opération de transfusion de termes français dans tous les types de communications pour remplacer les termes anglais dont l’usage s’était répandu avec l’industrialisation du Québec par des entreprises de langue anglaise, canadiennes d’abord, américaines ensuite. Le même besoin de terminologie française était observable dans tous les autres secteurs de l’activité économique, par exemple en publicité et pour la commercialisation des produits de consommation courante.
De ce simple examen des communications externes et internes se dégageaient déjà des éléments d’une stratégie pour faire du français la langue de travail. Il était, cependant, impossible d’apprécier l’impact réel des modifications requises sur la situation des entreprises du Québec, ni de jauger la difficulté de les mettre en application dans la réalité de l’activité d’une entreprise tout en évitant d’en réduire la productivité.
L’Office se devait d’aller voir sur place la situation du français dans la vie réelle d’une entreprise avec, comme objectif déclaré, de découvrir les moyens de l’améliorer. Il lui fallait trouver des entreprises qui se prêteraient volontairement à cette démarche exploratoire, en sachant qu’elles s’engageaient de ce fait dans un processus de francisation qui était loin d’être populaire dans le monde des entreprises.
Gaston Cholette réussit, avec difficulté et grandes précautions, à convaincre treize entreprises, de différents secteurs d’activité, à se prêter à cette expérimentation, soit : deux entreprises du domaine bancaire, la Banque Royale du Canada et la Banque de Montréal, deux raffineries, BP de Ville d’Anjou et Aigle d’Or de Saint-Romuald, deux industries papetières, DOMTAR de Beauharnois et CIP de Trois-Rivières, une industrie de textile, Dominion Textile de Saint-Jean, un commerce de détail, General Cigar à Rosemont, enfin cinq entreprises manufacturières, la Compagnie générale électrique du Canada, usine de Québec et de Montréal-Est, Canada Packers de Pointe-Saint-Charles, Canadian Industries de Shawinigan, Canadian Johns-Manville à Asbestos et Noranda Metal Industries à Montréal-Est.
Ces expériences-pilotes se sont déroulées en trois phases.
La plus longue et la plus difficile, qui a occupé l’équipe de l’Office tout près de deux ans, a été de procéder, dans chaque entreprise, à l’analyse de la situation des langues, c’est-à-dire de décrire la répartition des communications orales et écrites entre l’anglais et le français. L’Office voulait, à partir de ces cas, mettre au point une grille qui permettrait par la suite de systématiser et de généraliser cette étape préalable. Il était évident, en effet, qu’il fallait d’abord bien décrire la situation des langues pour la modifier, s’il s’avérait que la place de la langue française dans la vie de l’entreprise était trop réduite pour en être la langue de travail. L’expérience acquise, de même que la grille d’analyse qui avait ainsi été conçue et expérimentée, servira de base plus tard à la mise en application de la loi 22 et de la loi 101.
En deuxième lieu, il fallait déterminer les mesures à prendre pour modifier la situation révélée par l’analyse dans le but d’intensifier et de généraliser l’emploi de la langue française sans cependant compromettre l’activité et la rentabilité de l’entreprise. Étant donné qu’à cette époque, le gouvernement suivait à l’égard des entreprises une politique d’incitation, l’Office en était réduit à proposer à chaque entreprise ses recommandations pour faire du français la langue de travail sans pouvoir les lui imposer, ce qui revenait à dire que chaque entreprise était laissée libre de se franciser ou non, ou encore de choisir celles de ses activités qu’elle accepterait de franciser.
Dans ces conditions, le suivi de l’application des mesures proposées par l’Office à chaque entreprise et l’évaluation de leur efficacité n’ont pu qu’être effleurés, ce qui était pourtant la phase décisive des expériences d’implantation du français comme langue de travail.
À la fin de 1973, l’Office peut tirer les conclusions de ses travaux dans les entreprises-pilotes.
Ils lui avaient permis de préciser graduellement la notion de français, langue de travail, et d’en donner au gouvernement, aux entreprises et à la société une définition pragmatique en décrivant, en somme, le comportement d’une entreprise lorsque le français y est la langue normale et habituelle des activités.
Définition du français, langue de travail, par l’Office de la langue française
Le français est la langue unique des communications internes.
Dans ses relations avec les fournisseurs, l’entreprise utilise le français et exige que les inscriptions sur les produits et les notices techniques d’emploi et d’entretien du produit soient rédigées en langue française.
Les communications de l’entreprise avec ses clients individuels au Québec se font dans la langue du client; avec d’autres entreprises ou avec des clients de l’extérieur du Québec, elle suit la même règle en leur indiquant, toutefois, qu’elle peut aussi le faire en français.
Le français est la langue des communications avec les organismes officiels au Québec et au Canada.
Entre succursales québécoises de la même entreprise, les communications se font en français.
Les communications avec le siège social se font de préférence en français.
Comment les entreprises pilotes ont-elles réagi à cette définition et aux mesures qui en découlaient et qu’elles devraient adopter pour s’y conformer?
À l’exception de la raffinerie Aigle d’Or et des deux établissements de la Compagnie générale électrique, qui ont accepté le jeu et qui se sont engagés dans un effort systématique de francisation, les autres entreprises ont considéré la définition et les mesures proposées par l’Office comme une sorte de menu à la carte dans lequel elles pouvaient choisir ce qui leur convenait, en général les mesures les plus apparentes, par exemple les communications avec le personnel et avec les organismes du gouvernement, l’affichage dans l’entreprise, l’enseignement du français aux cadres anglophones. Dans la plupart des cas, ce sont les sièges sociaux qui prenaient les décisions, surtout préoccupés de l’image publique de l’entreprise et inquiets des effets d’entraînement qu’auraient ces mesures sur tous leurs autres établissements et sur le siège social lui-même, qu’il soit au Québec ou hors Québec. En somme, les entreprises ne voulaient pas prendre l’initiative de la francisation et elles attendaient toutes que le gouvernement leur dise ce qu’il attendait d’elles.
L’Office informe le ministre Cloutier de ce bilan et lui propose d’adopter une position plus dirigiste en invitant toutes les entreprises québécoises de 500 employés ou plus à s’engager dans le processus suivant : adhérer à la définition du français langue de travail, faire l’analyse de la situation du français de chacun de leurs établissements, soumettre à l’Office un programme d’action propre à rendre la situation du français conforme à la définition, enfin rendre publique leur politique eu égard à l’emploi du français et de l’anglais. Pour les aider à remplir ce programme, l’Office leur fournirait une trousse qui leur permettrait de procéder eux-mêmes à la francisation de leurs opérations, donc de faire du français la langue de travail de tous leurs établissements.
Le ministre accepte que l’Office prépare d’abord la trousse avant de recommander au gouvernement de s’engager dans cette voie. Cependant, en mai 1974, il déclare que l’Opération 500 serait vouée à l’échec si elle n’était soutenue par un cadre législatif qui énoncerait les volontés du gouvernement en matière de langue. Le 21 mai, le projet de loi 22, Loi sur la langue officielle du Québec, est donc présenté à l’Assemblée nationale. Il suscitera un vif débat à l’Assemblée nationale et de grands remous dans l’opinion publique, tant francophone qu’anglophone.
b) L’affichage public, la publicité et les raisons sociales
Dans une situation de bilinguisme sauvage comme l’était le Québec avant les lois linguistiques, ces trois gestes commerciaux publics révélaient au grand jour le rapport de force entre l’anglais et le français. En déambulant dans les rues, le citoyen ou le visiteur voyait partout des messages en langue anglaise, parfois en langue française. Il se rendait ainsi compte que l’usage de la langue anglaise était généralisé dans l’activité commerciale.
C’était vrai depuis la Défaite/Conquête de 1760, depuis que le conquérant avait interdit toute relation commerciale avec la France et depuis que les marchands anglais s’étaient emparés du commerce. Alexis de Tocqueville avait constaté en 1813 les effets de ces deux événements[64] : « On n’entend parler que du français dans les rues. Cependant, toutes les enseignes sont anglaises. […] Je doute qu’il en soit longtemps ainsi », notait-il.
En effet. Les Canadiens, devenus entre-temps les Canadiens français, mettront beaucoup de temps à s’affirmer et à modifier leur situation, mais ils y parviendront, même si, pour y arriver, ils devront accepter de toujours vivre sur la corde raide linguistique en Amérique du Nord.
Dans le domaine du commerce, les Canadiens français découvrent la valeur symbolique de l’affichage public et de la publicité. Ils réclament de manière de plus en plus pressante que les choses changent en faveur du français, notamment que leur langue soit visible dans l’affichage et la publicité. Un mot d’ordre cristallise cette revendication : donner un visage français aux rues des villes et des villages du Québec. Les partis politiques de l’époque en feront un article de leurs programmes électoraux. Tous confieront à l’Office de la langue française le soin de trouver les moyens d’atteindre ce but.
Ce n’était pas une mince affaire. L’Office devait, dans ce domaine comme dans celui de la langue de travail, transformer un slogan en stratégie d’action en trouvant réponse à trois questions. De quels éléments est composé ce que l’on nomme globalement l’affichage public? Quel cheminement suit un message commercial depuis sa conception jusqu’à sa diffusion? Comment serait-il possible d’intervenir pour augmenter la présence et la qualité du français dans cette activité économique de toute première importance sociolinguistique?
L’affichage public, après examen[65], est apparu composé d’un mélange de deux principaux types de messages. D’une part, des enseignes permanentes à la devanture des établissements, elles-mêmes composées de deux éléments linguistiques distincts, une raison sociale, elle-même souvent accompagnée d’un slogan ou de la promotion du type d’activité de l’établissement ou des services qu’il offre au public. La formulation de ces éléments était laissée à l’entière initiative du propriétaire. Des stratégies d’intervention différentes s’imposaient dans l’un et l’autre cas : pour les raisons sociales, s’informer et tenir compte des règles juridiques d’officialisation; quant au contexte de la raison sociale, il fallait le considérer comme un cas particulier de message publicitaire. La stratégie de modification des raisons sociales et des enseignes devait également prendre en considération le temps nécessaire pour en changer et les coûts qu’entraînerait ce changement. D’autre part, des messages publicitaires écrits, en général fréquemment renouvelés, mis à la vue du public sous diverses formes, affiches de produits, annonce de soldes, campagne de promotion, panneaux-réclames, etc. Les mêmes messages ou de semblables messages pouvaient se retrouver dans les journaux et revues, parfois même diffusés à la radio ou à la télévision.
Ces messages relevaient de la publicité, qui allait de l’artisanat au professionnalisme des grandes agences, du Québec ou d’ailleurs. Pour l’Office, c’était un monde à explorer à la recherche d’une manière réaliste d’y intervenir en faveur de la langue française.
L’Office décide alors de concentrer ses travaux exploratoires sur les deux aspects les plus présents dans l’affichage, les raisons sociales et la publicité.
Une raison sociale est généralement composée de trois éléments : d’un générique, mot ou groupe de mots tirés du lexique de la langue qui précisent la nature d’un commerce (épicerie, boulangerie, garage, etc.) ou l’activité principale d’un établissement (atelier de réparation, agence de voyages, concessionnaire, etc.); d’un spécifique, le nom par lequel un établissement se distingue de tous les autres du même domaine d’activité commerciale. Ce peut être un nom propre, un sigle, un mot inventé, un mot de la langue, des chiffres, tout en somme pour être unique. En dernier lieu, une raison sociale comporte souvent un indice d’appartenance juridique, par exemple : inc. (pour « incorporée »), enr. (pour « enregistrée »), cie (pour « compagnie »).
Pour obtenir l’exclusivité d’une dénomination commerciale (d’une raison sociale), il faut la déclarer auprès des services juridiques compétents, conformément à la loi. Au Québec, deux procédures sont possibles. Ou bien l’on fait enregistrer la dénomination commerciale par le Service des raisons sociales du ministère de la Justice, démarche simple et peu coûteuse, ou bien l’on procède à l’incorporation de la future société devant le Service des compagnies du ministère des Institutions financières, démarche plus complexe et plus coûteuse. Une incorporation peut se faire aussi devant les services canadiens et selon les lois du Canada. La personne, physique ou morale, a le choix selon que la clientèle qu’elle entend atteindre est au Québec seulement ou à la fois au Québec et ailleurs au Canada. Conclusion pour l’Office : c’est au moment du dépôt de la dénomination commerciale ou au moment de l’incorporation d’une société qu’il est possible d’intervenir pour exiger que la dénomination soit française, ou à la fois française et anglaise, à condition, bien entendu, que les lois le permettent, quitte, si ce n’est pas le cas, à devoir les modifier. C’est également à ce moment qu’il est possible de juger de la qualité linguistique et du bon goût de la formulation proposée par le requérant. La collaboration du personnel des services compétents est donc indispensable.
Or, à cette époque, pour décider, du point de vue linguistique, d’accepter, de refuser ou de proposer de modifier le projet de raison sociale soumis par le demandeur, ce personnel ne disposait que de vagues critères, alors que les critères juridiques étaient très précis. Chaque fonctionnaire se fiait à son jugement et à son bon goût et se montrait plus ou moins exigeant. Cette lacune devait être corrigée[66].
L’Office procède d’abord à l’examen des raisons sociales des 500 plus grandes entreprises, les mêmes qu’avait convoquées le premier ministre Bourassa au sujet de la langue de travail. À partir de leurs noms anglais, on tentait, par traduction, de leur trouver une version française. Cette démarche a mis en évidence que la désignation de l’activité principale de l’entreprise est souvent moins rigoureuse en anglais qu’en français et qu’il est pour ainsi dire impossible, en terminologie française, d’admettre les approximations synonymiques de la langue anglaise. Il ne fallait donc pas fonder le lien juridique entre le nom anglais et le nom français sur le fait que l’un était la traduction exacte de l’autre, mais plutôt sur le fait que les deux noms étaient déposés en même temps et qu’ils étaient juridiquement considérés comme désignant, l’un et l’autre, la même entreprise.
L’Office change d’approche. Un échantillon des noms des entreprises du domaine de l’automobile en activité au Québec est constitué et on cherche ensuite la façon de donner un nom français à chacune d’entre elles, à la fois en trouvant les termes qui désignent les diverses activités de ce secteur et qui seraient utilisables comme génériques des raisons sociales, en même temps qu’il fallait préciser dans quel ordre devraient apparaître les trois parties de la raison sociale pour se conformer à la syntaxe de la langue française.
Ces travaux permettent à l’Office de formuler les règles d’écriture des raisons sociales[67], qu’il propose comme guide linguistique au personnel des Ministères concernés.
Restait à examiner le cas particulier des marques de commerce à consonance anglaise, dont l’Office constatait l’omniprésence dans la dénomination et la publicité des produits de consommation courante, par exemple Kodak, Windex, mais aussi dans les raisons sociales, l’exemple le plus connu à ce moment-là étant Canadian Tire. L’Office, en collaboration avec les juristes du ministère des Institutions financières, a alors découvert le statut juridique très particulier des marques de commerce. En effet, l’examen de ce statut montrait que leur existence, leur intégrité et leur utilisation étaient régies, depuis 1883, par les dispositions de la Convention d’Union de Paris (1883), accord commercial international que le Canada avait signé et que le Québec devait, en conséquence, respecter. L’Office ne pouvait donc pas exiger la francisation des marques de commerce avec la même liberté et la même autorité que celle des noms génériques des produits, qui sont des mots du lexique courant, comme le remplacement de « windshield » par « parebrise » ou de « barley » par « orge ». L’Office en a conclu que si le gouvernement du Québec voulait éviter cette forme légale de contamination linguistique de la publicité commerciale et de l’affichage public, un seul moyen d’intervention s’avérait possible : il fallait convaincre l’entreprise de substituer volontairement un équivalent en langue française à la marque anglaise comme nom d’un produit pour la vente au Québec, ou comme raison sociale à la devanture de ses succursales québécoises. Nous reviendrons plus longuement sur la question des marques de commerce utilisées en guise de raison sociale plus loin, lorsque nous examinerons les points faibles actuels de l’application de la Charte de la langue française.
En conclusion à cette question des raisons sociales, une remarque s’impose cependant à l’évidence : la francisation des raisons par incitation, selon l’esprit de la loi 63, a été un échec. En 1973, le ministre William Tetley, ministre des Institutions financières, avait écrit personnellement aux 120 000 firmes inscrites au registre du Service pour les inviter à se donner et à utiliser un nom français pour leurs affaires au Québec. Moins de 250 de ces entreprises ont eu la politesse de répondre au ministre Tetley. Il a ensuite écrit aux présidents des 500 plus grosses entreprises du Québec (toujours les mêmes) : neuf seulement se sont portées volontaires. Il était évident, en avait conclu le ministre, que les entreprises n’acceptaient ni d’être contraintes à l’usage du français, ni d’en faire usage volontairement. « Ce n’est pas dans notre intérêt », disaient-elles en chœur.
L’Office a également inventorié les moyens d’intervenir dans le domaine de la publicité.
À la différence des raisons sociales, aucune disposition juridique d’ordre linguistique ne s’appliquait à cette époque à la publicité commerciale. Le choix de la langue du message, de même que son contenu culturel, était totalement laissé à l’initiative de l’émetteur du message, qu’il agisse de son propre chef ou qu’il fasse affaire avec une agence de publicité.
Au début des années 1970, 90 % des messages publicitaires, selon Maurice Watier, alors président de la maison Maurice Watier Publicité, étaient conçus en anglais, surtout à Toronto, puis ensuite traduits en français avec plus ou moins de bonheur. Le message s’inspirait de la culture anglo-saxonne et des habitudes de consommation des anglophones nord-américains. Les théoriciens torontois du marketing prétendaient qu’entre les consommateurs québécois et ceux du reste du Canada, il n’y avait qu’une différence de langue et de pouvoir d’achat. En conséquence, il n’était pas nécessaire de concevoir des messages différents pour l’un et l’autre groupe, la traduction suffisait amplement.
Cependant, un publicitaire québécois, Jacques Bouchard, fondateur et pdg du Publicité Club, était d’un tout autre avis. Il soutenait que la publicité destinée au marché québécois était nettement plus efficace si le message s’inspirait de la culture québécoise, s’il était véhiculé par des voix, un accent, des personnages et des images du Québec, surtout s’il rejoignait le subconscient des consommateurs québécois. Dès 1962, il avait eu l’intuition du profil psychologique de ce consommateur et il avait, par la suite, procédé à l’identification et à la description de ce qu’il appelait « les cordes sensibles » qui le font vibrer. D’un test à l’autre, il vérifie, approfondit son hypothèse et s’en inspire pour concevoir des campagnes publicitaires, commerciales ou politiques, dont certaines remportent un grand succès populaire, par exemple Lui y connaît ça, pour la brasserie Labatt, avec Olivier Guimond comme personnage. C’est Jacques Bouchard qui a lancé la publicité « à la québécoise ». En 1978[68], il publie la forme la plus achevée de sa grille. Tous les publicitaires de cette tendance sont les descendants de Jacques Bouchard. Bien évidemment, le profil du consommateur québécois s’est modifié depuis l’époque Bouchard. Certaines cordes vibrent moins, par exemple le complexe d’infériorité du minoritaire, le fatalisme du « petit pain ». D’autres vibrent avec plus de force, l’environnement et l’écologie, l’appartenance au continent nord-américain, la recherche du confort, le plaisir de vivre.
Telle était la situation du monde de la publicité au moment où l’Office commence à s’y intéresser.
L’approche de l’Office est pragmatique : faire l’inventaire des supports publicitaires, décrire pour chacun les étapes de confection (conception du message, réalisation matérielle, installation), découvrir les intervenants le long de cette chaîne, s’informer de l’existence et de la portée de règlements qui s’y appliquaient, le cas échéant. Furent ainsi distingués :
- les panneaux-réclames. Principaux intervenants : une agence de publicité, qui conçoit le message pour un client, choisit avec lui la ou les langues de diffusion dont il veille à la qualité linguistique et à la bienséance; une entreprise de location d’espace de présentation, grands panneaux extérieurs ou surface sur ou dans des véhicules de transport en commun; enfin, un imprimeur qui reproduit l’affiche. L’installation des panneaux-réclames est souvent soumise à des règlements. Le moyen d’intervention : agir auprès des agences de publicité et de location d’espace, les unes et les autres peu nombreuses;
- les enseignes lumineuses. Intervenants : une agence de publicité ou le propriétaire d’un commerce qui en prend l’initiative lui-même; un fabricant d’enseignes lumineuses; les municipalités qui gèrent par règlement la taille et l’emplacement de ces enseignes. Mode d’action : intervenir auprès des fabricants et surtout auprès des municipalités pour les convaincre d’édicter un article de leurs règlements qui porterait sur la langue;
- les enseignes non lumineuses. Elles sont multiples, en général de moyenne ou de petite taille, le plus souvent conçues par le propriétaire du commerce qui en commande lui-même la réalisation à l’une ou à l’autre des nombreux fabricants disponibles. Il devient difficile d’intervenir dans un secteur aussi éclaté;
- les affiches de réclame. Elles sont conçues directement par le commerçant, par la chaîne de magasins, le fabricant d’un produit ou par l’agence de cinéma ou de théâtre, parfois avec l’aide technique d’une agence de publicité. La réalisation de l’affiche est souvent confiée à un graphiste. Elles sont reproduites par impression. Leur durée de vie est courte et leur renouvellement, constant. Elles sont présentes partout, dans les vitrines des magasins, les pages des journaux et des revues, sur les écrans de télévision, présentées sur toutes sortes de supports le long ou au-dessus des allées d’un magasin, sur les comptoirs des produits, partout où elles peuvent accrocher le regard. Cet univers est sans cesse en mouvement. Il est presque impossible pour l’Office d’influencer le contenu ou l’aspect linguistique des affiches de réclame. Il arrive parfois que la pression des consommateurs y parvienne indirectement. Seule une intervention juridique de l’État peut modifier cet état de chose;
- les affichettes préfabriquées et les plaques gravées. La variété des messages diffusés par ces moyens est réduite à quelques courtes phrases : à vendre, logement à louer, défense de passer, chien méchant, etc. Ces affichettes et plaques sont produites par quelques entreprises seulement, auprès desquelles il serait facile d’intervenir, surtout pour les rassurer sur la qualité linguistique du texte ou sur la conformité du symbole aux conventions nationales et internationales.
Puisque le recours à une disposition juridique coercitive était, à cette époque, exclu par le gouvernement qui s’en tenait à la politique d’incitation de la loi 63, l’Office ne pouvait que tenter de convaincre les différents intervenants d’utiliser la langue française dans la publicité et de veiller à ce que le message soit de bonne qualité linguistique, du point de vue orthographique (ne pas écrire journeaux, par exemple) et du vocabulaire (en évitant, par exemple, les faux-amis du type altération pour retouche). Les convaincre également de profiter du renouvellement des affiches et des panneaux-réclames pour les modifier en faveur du français.
Ce mode d’intervention n’eut pas un grand succès. La progression du français dans l’affichage publique demeurait désespérément lente.
c) La commercialisation des produits de consommation courante
Depuis 1964, une loi du ministère de l’Agriculture du Québec (Loi sur les produits agricoles et les aliments) et son règlement d’application (Règlement sur les aliments) rendaient obligatoire la présence du français dans l’étiquetage de ces produits, y compris dans les menus et les cartes de vins des restaurants. En cas d’infraction, la loi prévoyait de fortes amendes. L’industrie de l’alimentation et de la restauration, des grossistes aux détaillants, n’eut d’autre choix que de se plier à la loi.
Un mode de collaboration s’était alors établi entre l’Office de la langue française et le ministère de l’Agriculture. Les inspecteurs du ministère veillaient au respect de la loi, l’Office s’occupait de l’aspect proprement linguistique, terminologie des produits et vérification de la qualité de la langue des étiquettes, des menus et des cartes de vins. L’intervention linguistique de l’Office s’était rapidement et logiquement étendue aux circulaires commerciales et aux affichettes d’identification des aliments dans les comptoirs et des produits sur les tablettes des magasins.
La terminologie diffusée par l’Office s’écartait souvent de celle arrêtée par les services du gouvernement fédéral. Les nécessités du commerce interprovincial imposaient cependant un minimum de concertation entre les deux paliers de gouvernement dans un domaine aussi névralgique que la rédaction des étiquettes de produits : il ne pouvait y avoir plusieurs termes différents, d’une administration à l’autre, pour désigner le même produit. L’Office réclame avoir autorité en matière de langue française, terminologie et qualité de la langue, propose que les organismes fédéraux se concentrent sur la qualité de la langue anglaise et qu’une relation de consultation s’établisse entre les deux équipes de fonctionnaires responsables de ces travaux. Les responsabilités ne seront jamais aussi clairement partagées. La sérénité et l’efficacité de la collaboration linguistique entre Québec et Ottawa fluctueront toujours selon l’harmonie des relations entre les personnes en poste, ministres et gestionnaires des services.
En 1970, deux projets de loi sur la protection du consommateur sont présentés, l’un au Québec (projet de loi 45), l’autre à Ottawa (projet de loi C-180). Dans son projet de loi, le fédéral voulait étendre au commerce le principe des deux langues officielles du Canada en rendant obligatoire la présence du français et de l’anglais dans l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation. De plus, le fédéral s’appuyait sur le fait qu’il a la responsabilité constitutionnelle du commerce à travers tout le Canada pour imposer sa loi à toutes les provinces, y compris au Québec. Les deux gouvernements en discutent et acceptent de part et d’autre la règle du bilinguisme français/anglais obligatoire sur les étiquettes et l’emballage des produits de consommation courante, mais sans exclure la présence d’autres langues comme c’était déjà la pratique dans les pays de la communauté européenne. La concertation linguistique entre Québec et Ottawa devient encore plus nécessaire.
L’Office se réclame de cette nouvelle préoccupation de la protection du consommateur pour étendre ses travaux aux textes des contrats d’adhésion, par exemple les contrats d’assurances, les baux, les hypothèques, qui étaient jusqu’alors rédigés uniquement en langue anglaise ou dans une langue française de traduction, farcie de calques et d’anglicismes. L’Office explore aussi tout le champ des garanties, des modes d’emploi et des manuels d’utilisation, textes et documents qui accompagnent souvent la mise en marché des produits.
Grâce à ces travaux linguistiques exploratoires, l’Office peut, en toute connaissance de cause et avec réalisme, proposer au gouvernement le texte d’une disposition de loi de portée générale relative à la présence du français dans le domaine du commerce. Le voici, dans sa version originale citée dans l’ouvrage de Gaston Cholette (page 398) :
L’usage du français est obligatoire dans toute inscription relative à l’emballage, l’étiquetage et le mode d’emploi d’un bien de consommation; aucune autre inscription rédigée dans une autre langue ne doit l’emporter sur celle rédigée en français.
On satisfait aux exigences du présent article lorsque les inscriptions en langue française sont au moins équivalentes à celles rédigées en d’autres langues, sur une même face ou sur une face de même importance.
L’exploration par l’Office du monde de l’affichage public, de la publicité, des raisons sociales, de la commercialisation des produits aura été très utile. La conception et la rédaction du chapitre des législations linguistiques consacré à la langue du commerce et des affaires s’inspireront directement des renseignements obtenus par l’Office et de l’expertise acquise par les linguistes qui y avaient travaillé.
d) La terminologie[69]
De tout temps, la recherche terminologique était une étape du processus de traduction des textes à contenu spécialisé : pour passer d’un texte anglais à son équivalent en français, il fallait trouver en français les termes correspondant aux termes anglais pour la même notion. Les terminologues de cette époque partaient d’un mot anglais et cherchaient sa traduction en consultant une grande variété de documents, les dictionnaires bilingues surtout, mais aussi des lexiques, des documents officiels de normalisation, des catalogues français, et même des textes spécialisés rédigés en français, toujours à la recherche du mot juste. On arrivait ainsi à colliger des paires de mots qu’il était ensuite possible de réunir sous forme d’un lexique plus ou moins spécialisé mais répondant à des besoins réels.
Les linguistes de l’Office ont rapidement pris conscience que cette manière de travailler, au mot à mot, n’était pas adaptée aux travaux qu’ils devaient mener. Il ne s’agissait pas pour eux de traduire des textes, mais de traiter des ensembles de mots appartenant tous au même domaine spécialisé, par exemple tous les noms des produits laitiers, ou le vocabulaire d’un contrat d’assurance, ou les termes courants d’une automobile, ou les termes de l’exploitation forestière, du raffinage du pétrole, etc. Les mots ne sont pas isolés, mais se définissent les uns par rapport aux autres dans une relation d’opposition, un peu comme les voyelles du français se distinguent par opposition les unes aux autres. De l’anglais au français, les ensembles de mots ne sont pas nécessairement les mêmes. Il se peut fort bien que les oppositions ne soient pas symétriques d’une langue à l’autre. Citons deux exemples connus de cette dissymétrie : la langue anglaise n’a que le mot river là où le français fait la distinction entre fleuve et rivière et, à l’inverse l’anglais fait la distinction entre ox (la bête) et beef (la viande) pour le seul terme français bœuf.
Il fallait donc que l’Office mette au point une autre manière de travailler à partir d’ensembles de mots appartenant aux lexiques de deux langues différentes entre lesquels il fallait ensuite créer un pont d’équivalence. Peu à peu, à partir des travaux de l’Office, une méthode de travail en terminologie systématique fut mise au point, par opposition à la terminologie ponctuelle du mot à mot. Pour diffuser cette nouvelle approche de la terminologie, l’Office a publié un guide de travail en terminologie dans le but d’uniformiser les travaux des entreprises et des organismes du Québec et d’en garantir une qualité égale[70]. Cette méthode de travail s’est peu à peu diffusée à travers le monde.
D’autre part, l’Office avait pour mission de guider les usagers dans le choix des termes français, c’est-à-dire de leur proposer celui des termes qui était le mieux approprié comme équivalent d’un mot anglais lorsque le choix existait, car il y a des synonymes en terminologie. Prenons l’exemple cocasse emprunté au domaine de la sidérurgie, le mot pizza pour ce qui est, en réalité, un laitier, le résidu d’une poche de coulée parfois versée sur le plancher de l’usine et qui se colore, se boursoufle en refroidissant. Il ne s’agissait pas de condamner pizza, métaphore amusante inventée par les gens de l’usine, mais de mettre le terme technique standard laitier en circulation. Cette mission est toujours celle de l’Office : privilégier l’efficacité de la communication entre spécialistes du même domaine, ici ou ailleurs dans le monde francophone, et améliorer la qualité de la langue de spécialité chez tous les Québécois, langue véhiculée comme langue de travail mais aussi par la publicité, les médias, les textes de vulgarisation, les étiquettes de produits.
La responsabilité des vocabulaires de spécialités appartient d’abord et avant tout aux spécialistes eux-mêmes. Ce sont eux qui les utilisent, qui les entretiennent au fil des innovations, qui les diffusent dans des textes de toutes sortes et par l’enseignement. L’Office se devait de les consulter et de les associer à ses travaux de terminologie, l’Office ne pouvait être pour eux qu’un soutien, un stimulus pour les encourager à veiller à la qualité et à la valeur internationale de leurs vocabulaires. D’autre part, ces spécialistes se retrouvent à tous les niveaux de technicité dans les entreprises. Ce sont eux en définitive qui avaient, et qui ont toujours, la responsabilité de la qualité de la langue de travail. L’Office devait donc travailler aussi avec les techniciens, les ingénieurs, les gestionnaires des entreprises. D’autant que ce serait eux qui assureraient l’entretien de la langue de travail quand le français serait devenu la langue normale de l’entreprise à la suite d’un programme de francisation exigé par l’Office. L’Office ne pouvait pas être éternellement dans l’usine et il ne pouvait pas non plus être partout à la fois. Il fallait donc, de toute évidence, partager avec les entreprises les travaux de terminologie et la responsabilité de l’emploi et de la mise à jour de leurs vocabulaires. Un nouvel aspect du rôle de l’Office se précisait ainsi, un rôle de concertation, d’animation et de diffusion.
C’est dans ce but que l’Office a créé la banque de terminologie, pour stocker, gérer et diffuser les milliers de paires de mots anglais-français qu’il produisait ou que les entreprises lui confiaient. Ce fut l’origine de ce qui est aujourd’hui le Grand dictionnaire terminologique disponible dans Internet.
e) Un concept outil prometteur : la notion d’aménagement linguistique
L’action de l’Office ouvrait, pour ainsi dire, un nouveau champ de la linguistique (le terme de sociolinguistique viendra plus tard), le changement linguistique planifié, ce que les Américains commençaient alors à nommer Language Planning, d’où le calque planification linguistique qu’a d’abord utilisé l’Office.
Mais ce terme ne passait pas, à cause de son allure trop fonctionnarisée, pas assez participative. Or le mot aménagement était alors très en vogue, comme dans aménagement du territoire, aménagement des ressources naturelles. Tout naturellement le terme aménagement linguistique s’est substitué au calque du terme américain. Il apparaît pour la première fois dans le titre d’une étude publiée sous ma signature en qualité de directeur de l’Office en 1972, Éléments d’une théorie de l’aménagement linguistique, titre alors prétentieux qui annonçait plus simplement une intention qu’une réelle capacité de concevoir à ce moment-là une véritable théorie de l’aménagement linguistique. Le terme était commode pour désigner l’ensemble des activités et des préoccupations de l’Office de la langue française.
L’expression est aujourd’hui d’emploi universel pour désigner l’ensemble des mesures sociales qui influencent l’emploi de la langue par les locuteurs d’une même communauté linguistique, que ces mesures soient prises par un gouvernement ou qu’elles proviennent de l’initiative d’un organisme privé, par exemple une académie, dont le modèle le plus renommé est l’Académie française. D’où le schéma suivant qui présente toute l’étendue de la notion d’aménagement linguistique :
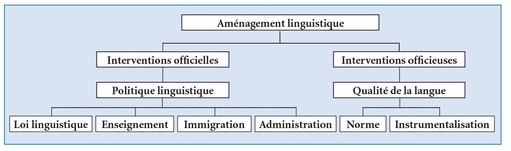
Ce schéma met en évidence le fait que la loi linguistique n’est qu’un segment de la politique linguistique. Les autres segments, tout aussi déterminants pour l’avenir d’une langue, sont la politique d’enseignement de la et des langues, la politique d’immigration et celle de l’usage de la et des langues par l’administration publique, les ministères et les organismes qui en dépendent. La détermination de la norme linguistique échappe à l’autorité d’un gouvernement, elle jaillit plutôt de l’ensemble des locuteurs d’une même langue. L’explicitation et la description techniques de cette norme reviennent aux sociologues, aux linguistes et à tous ceux et celles qui produisent des ouvrages de référence, grammaires, dictionnaires, lexiques, traités de prononciation, etc. Nous reviendrons sur cette question dans le chapitre III de la deuxième partie de ce livre.
4. L’échec de la loi 63 et la promulgation de la loi 22, Loi sur la langue officielle du Québec
La politique linguistique par incitation de la loi 63, confirmée par l’engagement du gouvernement Bourassa, première manière, de ne pas avoir recours à la coercition, a été un échec total. Ni l’emploi ni le statut de la langue française n’ont été modifiés par cette approche, ni comme langue de travail, ni comme langue de l’affichage public, ni comme langue du commerce et des affaires, malgré les efforts de l’Office de la langue française entre 1970 et 1974.
Par contre, la liberté de choix de la langue d’enseignement qu’accordait la loi 63 à tous les parents du Québec a eu des conséquences rapides et désastreuses dans le domaine scolaire. C’est vraiment à ce moment que le Québec a perdu, pour longtemps, la capacité d’intégrer en langue française les enfants immigrants et les immigrants adultes.
Le fait d’accorder à tous les parents le libre choix de la langue d’enseignement provoque une tendance vers l’école de langue anglaise, faible mais réelle chez les francophones, très forte et constante chez les allophones.
Louis Duchesne, du service de la démographie scolaire du ministère de l’Éducation du Québec, publie en novembre 1973 la première étude statistique de cette tendance sous le titre La situation des langues dans les écoles du Québec et de ses régions administratives (1969-70 à 1972-73)[71]. Il démontre à l’évidence que les effectifs de l’école de langue française diminuent constamment.
Chez les francophones, 1,9 % des élèves (25 300) étudient à l’école anglaise en 1972-73 contre 1,6 % (22 300) en 1969-70. La tendance est plus forte à Montréal (2, 9 %, soit 18 500 élèves) qu’ailleurs au Québec (0,9 %, soit 6 800 élèves).
Chez les allophones, en 1972-73, 86,3 % des enfants vont à l’école de langue anglaise, soit 60 800 élèves. À Montréal, c’est 90,3 % des enfants et 51,7 % ailleurs au Québec.
L’école française n’accueille donc qu’une très faible proportion des enfants non francophones (1,4 % en 1972, soit 18 500 élèves), alors que la population de l’école de langue anglaise devient de plus en plus hétérogène du point de vue de la langue maternelle des enfants puisque 30 % de ses élèves sont non-anglophones (77 600 élèves) dont le tiers (25 300 élèves) est de langue maternelle française.
Plus tard, en 1981, après l’adoption des lois 22 et 101, Michel Paillé, alors démographe au service du Conseil de la langue française, a étudié à nouveau l’évolution de la composition scolaire selon la langue des enfants entre 1969 et 1981, c’est-à-dire avant et après que l’accès à l’école de langue anglaise n’a plus relevé du seul choix des parents. Il a publié ses résultats dans une étude intitulée Attraction des deux principales langues d’enseignement sur les divers groupes linguistiques au Québec, 1969-1970 à 1980-1981[72].
Il confirme les tendances qu’avait observées Louis Duchesne.
De 1969-1970 à 1973-1974, la tendance vers l’école de langue anglaise augmente d’année en année chez les francophones et elle se met à diminuer à partir du moment où la liberté du choix de l’école est soumise au respect de certaines conditions édictées soit par la loi 22, soit par la loi 101. En effet, Paillé constate que l’indice d’attraction de l’école anglaise sur les francophones augmente de 1969-1970 à 1973-1974 de 0,12 à 0,20, à l’époque du libre choix de la loi 63, et diminue régulièrement par la suite de 0,17 à 0,13 entre 1976-1977 et 1980-1981 sous l’effet des dispositions de la loi 22 entre 1974 et 1976 et de la loi 101 à partir de 1977.
Chez les allophones, on observe le même revirement des tendances. De 1969 à 1973-1974, à l’époque du libre choix, l’école de langue anglaise est la plus favorisée, avec la pointe la plus forte en 1972-1973. Puis, de 1976 à 1981, la tendance s’inverse en faveur de l’école de langue française, surtout sous l’influence des dispositions de la Charte de la langue française. Durant ces années, l’indice d’attraction de l’école française sur les allophones passe de 0,17 en 1969-1970 à 0,46 en 1981, dernière année de l’étude, alors que l’indice d’attraction de l’école anglaise diminue légèrement, de 6,59 en 1969-1970 et 5,18 en 1980-1981. Le déficit de l’école française demeure donc toujours réel.
Le pourcentage des élèves allophones qui étudient en langue française au Québec[73] a continuellement augmenté de la manière suivante au primaire et au secondaire : en 1971, 14,6 %, en 1981, 43,4 %, en 1991, 76,4 %, en 2001, 78,7 %. Au collégial, il augmente d’abord puis stagne : en 1981, 15,6 %, en 1991, 41,3 %, en 2001, 41,2 %. Au niveau universitaire, les statistiques ne sont disponibles que pour 1991, 42,2 % et 2001, 45,4 %.
Il est donc évident que le fait d’imposer comme règle générale pour tous les enfants la fréquentation de l’école en langue française et d’imposer des conditions à la fréquentation à l’école de langue anglaise a réduit l’accès des enfants francophones à l’école de langue anglaise et a favorisé la francisation des enfants allophones. On peut aussi raisonnablement pensé qu’a contrario, un rétablissement du libre choix provoquerait de nouveau un retour à l’école anglaise des enfants francophones et allophones, peut-être encore plus marquée qu’à l’époque de la loi 63, à cause de la mondialisation de la diffusion de la langue anglaise et de l’inefficacité de l’enseignement de la langue anglaise dans les écoles publiques québécoises. L’entêtement du gouvernement à ne pas renouveler radicalement l’enseignement de la langue anglaise comme langue seconde devient de plus en plus inacceptable pour tous les parents et incompréhensible pour tous les citoyens et pour les spécialistes de la pédagogie des langues secondes.
À l’évidence, l’application du principe du libre choix de la langue d’enseignement favorise l’anglicisation des enfants tant francophones qu’allophones.
L’échec de la loi 63 démontrait qu’une future loi linguistique devrait traiter en priorité, et régler, deux épineuses questions : limiter l’accès à l’école anglaise aux seuls anglophones de manière à favoriser la scolarisation en français des enfants allophones, et même francophones, et faire du français la langue de travail et de l’activité économique.
Après un détour de tout près de quatre ans, on revenait au point de départ, aux lendemains de l’affaire de Saint-Léonard. Le bill 63 n’avait pas été la bonne réponse à la crise sociale et linguistique qu’elle avait provoquée.
Mais, cette fois, pour légiférer, le gouvernement était mieux informé. D’une part, il disposait des travaux de la commission Gendron dont le rapport prônait pour le Québec, comme nous l’avons vu, une forme de bilinguisme institutionnel français/anglais. D’autre part, il connaissait également les résultats des travaux de l’Office de la langue française qui proposait dans son bilan la généralisation de la langue française au Québec en restreignant l’emploi de la langue anglaise aux seules situations où il était démontré que l’emploi de cette langue était nécessaire, soit pour communiquer avec l’extérieur du Québec, soit dans les communications avec les citoyens individuels de langue anglaise, à leur demande, soit enfin pour protéger le consommateur tant de langue française que de langue anglaise.
Le Québec, et le gouvernement Bourassa, était devant ce choix en mai 1974.
Mais il était prévisible que la loi qu’arrêterait le gouvernement Bourassa ne pouvait être qu’un compromis entre l’engagement électoral du Parti libéral de faire du français la langue de travail, la préférence du gouvernement Bourassa pour une approche autant que possible non coercitive et l’échec constaté de la politique d’incitation prônée par le loi 63.
La loi 22, Loi sur la langue officielle, est sanctionnée le 31 juillet 1974. On trouvera un résumé des principales dispositions de cette loi à l’annexe I.
À vouloir contenter à la fois les francophones et les anglophones, le gouvernement Bourassa a mécontenté tout le monde avec sa loi 22.
Les francophones étaient en profond désaccord avec cette loi.
D’abord, elle leur semblait ni chair ni poisson, entre la diminution de l’exigence du bilinguisme, du moins selon le principe du français, seule langue officielle, et l’autorisation de l’emploi de la langue anglaise saupoudrée partout dans tous les articles de la loi. En somme, à leurs yeux, la loi 22 était du même esprit que la Loi sur les langues officielles du gouvernement fédéral, sauf que le bilinguisme était dissimulé derrière le français, langue officielle.
Ensuite, les dispositions destinées à faire du français la langue de travail leur apparaissaient très timides, peu contraignantes, peu aptes à modifier en profondeur la situation du français et des francophones dans les entreprises du Québec.
Enfin, la procédure des tests linguistiques pour sélectionner les enfants admissibles à l’école de langue anglaise leur semblait faible et aisément contournable. L’avenir leur donnerait raison sur ce point.
De leur côté, les anglophones acceptaient mal qu’un gouvernement libéral ait pris position en faveur d’une seule langue officielle, le français, sans même aucune allusion au statut de la langue anglaise. Ils comprenaient bien que cette disposition signifiait que la communauté de langue anglaise devenait une minorité linguistique parmi d’autres, tout comme les francophones ailleurs au Canada. Surtout, ils n’acceptaient absolument pas que l’accès à l’école de langue anglaise ne soit plus laissé à la seule décision des parents, mais plutôt restreint par l’obligation faite aux enfants de connaître la langue anglaise. Les allophones étaient d’accord avec eux sur ce point, puisque l’école anglaise ne pourrait plus aussi facilement admettre leurs enfants. En conséquence, la population des écoles anglaises cesserait de croître, diminuerait même, et avec elle la possibilité d’augmenter l’importance démographique de la minorité de langue anglaise.
Les électeurs de chaque groupe linguistique s’en souviendraient lors des prochaines élections.
Robert Bourassa déclenche des élections le 19 octobre 1976, soit deux ans après l’adoption de la loi 22 et un an avant la fin du mandat de son gouvernement. La date du vote est fixée au 15 novembre. La campagne électorale serait très courte, quatre semaines tout au plus.
5. L’élection du Parti québécois et l’adoption de la Charte de la langue française (loi 101)
Le Parti québécois prend le pouvoir pour la première fois le 15 novembre 1976, avec une forte majorité de députés et 41 % des voix. Robert Bourassa lui-même est battu dans le comté de Mercier par Gérald Godin, poète et journaliste. Il quitte la direction du Parti libéral le 20 novembre suivant. René Lévesque lui succède comme premier ministre le 25 novembre.
Il forme un Conseil des ministres de dix-huit personnes, dont les têtes d’affiche du parti, Jacques-Yvan Morin, Robert Burns, Claude Morin, Jacques Parizeau, Camille Laurin, Bernard Landry, Pierre Marois, Claude Charron, Lise Payette, pour ne citer que les plus connus d’alors ou encore présents dans l’actualité.
Il nomme le Dr Camille Laurin, psychiatre tout comme son collègue François Cloutier, ministre d’État au développement culturel et il lui confie le dossier de la réforme de la loi 22. Dans son esprit, il s’agit d’en corriger les déficiences les plus criantes, surtout la fameuse question des tests linguistiques, véritable passoire sans efficacité pour réduire la fréquentation de l’école anglaise par les enfants de parents immigrants et leur anglicisation subséquente. La commission scolaire anglophone elle-même, la Protestant Schoolboard of Greater Montreal, admettait accueillir des enfants « inadmissibles » (Le Devoir, 6 octobre 1976). En 1976, 15 % seulement des demandes d’admissibilité à l’école anglaise était refusées[74].
Le ministre devait également respecter l’engagement du programme électoral de 1976 : « Sous un gouvernement du Parti québécois, le français deviendra la seule langue de l’État, des municipalités, des commissions scolaires et de l’ensemble des institutions de caractère public, des raisons sociales et de l’affichage. »
Le Dr Laurin s’entoure d’une petite équipe de conseillers de haut niveau, Guy Rocher, sociologue, de l’Université de Montréal, qu’il nomme sous-ministre, le regretté Fernand Dumont, sociologue lui aussi, de l’Université Laval, surtout intéressé aux questions de culture, de culture québécoise en particulier, David Payne, qui sera surtout chargé des relations avec la communauté de langue anglaise, et Henri Laberge, spécialiste de l’enseignement comme chef de cabinet. Cette petite équipe prend appui sur les analyses des commissions Parent, Laurendeau-Dunton et Gendron, de même que sur les travaux de l’Office de la langue française (dénommé Régie de la langue française pendant la durée de la loi 22) et sur l’expertise de son personnel.
Le Dr Laurin se préoccupe en tout premier lieu de préciser les grands principes qui devront guider la conception d’une nouvelle politique linguistique pour le Québec et de les soumettre démocratiquement à la connaissance et à la discussion des citoyens québécois de toute langue et de toute tendance idéologique ou politique. Le gouvernement libéral précédent n’avait pas cru bon de le faire avant de procéder à la préparation de la loi 22. Il demande donc à son équipe de préparer un énoncé de politique, un livre blanc selon le vocabulaire de l’époque, et il participe activement à son élaboration.
Cet énoncé de politique a été présenté à l’Assemblée nationale et au peuple du Québec fin mars 1977 et diffusé largement dans tous les foyers du Québec en une édition populaire, sous le titre La politique québécoise de la langue française.
Il est nécessaire et très éclairant pour la suite des choses d’en rappeler les grandes lignes.
Le chapitre premier rappelle les principales observations des commissions d’enquête précédentes regroupées autour de huit thèmes qui définissaient la situation objective de la langue française et des francophones à cette époque.
Ces thèmes étaient ainsi synthétisés :
Si l’évolution démographique du Québec se maintient, les Québécois francophones seront de moins en moins nombreux; Les immigrants marquent une forte tendance à s’intégrer au groupe minoritaire anglophone; Dans l’entreprise, le français est, dans une très large mesure, la langue des petits emplois et des faibles revenus; L’anglais est la langue des affaires; La Confédération canadienne défavorise les francophones, notamment au Québec; Beaucoup de Québécois sont insatisfaits de la qualité de la langue française au Québec; Nos attitudes collectives sont ambiguës; Pourtant existe une volonté de redressement.
Le contenu de ce premier chapitre est évidemment périmé aujourd’hui, après trente ans d’application de la Charte, mais il était alors de pleine actualité. Cependant, il montrait clairement, et c’est encore vrai aujourd’hui, que la Charte de la langue française n’était pas inspirée par un désir de revanche, mais bien par la nécessité de modifier la situation inacceptable des francophones et de leur langue qu’avaient décrite en détail la commission Laurendeau-Dunton et la commission Gendron. Aujourd’hui, cette situation s’est améliorée, ce qui incite certains observateurs, surtout anglophones, à demander qu’on en assouplisse les dispositions ou même qu’on l’abolisse purement et simplement. C’est oublier que les forces économiques jouent toujours en Amérique, et de plus en plus avec la mondialisation, en faveur de la langue anglaise et qu’en conséquence la langue anglaise conserve au Québec un grand pouvoir d’attraction sur les immigrants et parfois même chez les Québécois de langue française. La Charte est nécessaire aujourd’hui comme hier pour faire contrepoids à ces tendances lourdes.
Le deuxième chapitre énonce quatre principes autour desquels s’articulera la future Charte de la langue française.
Principe premier : « au Québec, la langue française n’est pas un simple mode d’expression mais un milieu de vie ». Deuxième principe : « on doit respecter les minorités, leurs langues, leurs cultures ». Troisième principe : « il est important d’apprendre d’autres langues que le français ». Quatrième principe : « le statut de la langue française au Québec est une question de justice sociale ». Chacun de ces principes sera plus longuement explicité au début de la deuxième partie de ce livre.
Le troisième chapitre annonce les grandes orientations des dispositions de la future Charte de la langue française, domaine par domaine. D’abord dans les domaines que l’on pourrait dire institutionnels : l’administration publique, les entreprises, les relations de travail, les ordres professionnels, le commerce, la publicité et l’affichage public, l’enseignement et l’accès à l’école de langue anglaise. Ensuite, les dispositions qui touchent plus particulièrement les citoyens : la garantie de la liberté de choix de la langue des communications individuelles, la possibilité d’utiliser d’autres langues que le français, y compris l’anglais, dans les communications avec l’État et avec les services qui en relèvent, notamment dans des secteurs névralgiques comme la santé, l’immigration, la sécurité, les relations contractuelles, laissées au libre choix des contractants, sauf pour les contrats d’adhésion ou les contrats imprimés, qui devront être rédigés en français ou dans une autre langue, le plus souvent l’anglais. Enfin, on y décrit les fonctions des organismes d’application de la loi, un Conseil de la langue française, un Office de la langue française, un organisme de surveillance et une Commission de toponymie.
Le quatrième et dernier chapitre insiste sur le fait qu’une loi, aussi contraignante qu’elle soit, ne peut à elle seule modifier la situation de la langue et des francophones du Québec. Toute la société doit participer à cette transformation, les citoyens autant que les groupes intermédiaires et les institutions. L’effort doit être concerté. La loi doit pouvoir compter sur l’appui et la vigilance des citoyens francophones pour que les dispositions de la loi s’incarnent dans la vie quotidienne. Ils doivent surtout veiller à réclamer le droit à l’emploi de la langue française et à être servi en langue française que leur garantira la future Charte. Le ministère de l’Éducation, les cégeps et les universités sont responsables de la qualité de l’enseignement du français, de l’apprentissage en français des métiers, des techniques, des sciences et des disciplines professionnelles, de l’intégration en français des enfants et des adultes allophones, de l’enseignement des langues et littératures secondes ou étrangères, tout particulièrement du français et de la culture québécoise dans les institutions de langue anglaise. D’autres ministères ont aussi leur rôle à jouer, les ministères à vocation économiques, celui des Institutions financières et de l’Industrie et du Commerce, le ministère des Affaires municipales, le ministère de l’Immigration, le ministère des Relations internationales, le ministère de la Justice. Enfin, les corps intermédiaires sont aussi concernés, les syndicats, les associations professionnelles, les divers groupes de pression.
C’est pour refléter cette nécessaire concertation que le ministre Laurin avait nommé la loi linguistique proposée Charte de la langue française, pour bien indiquer que toutes les autres lois du Québec et toutes les décisions des organismes de la société devraient tenir compte des règles qu’elle édicte. Cela ne signifiait pas l’intention qu’elle ait préséance sur la Charte des droits de la personne.
L’énoncé de politique, on le voit, ne se bornait pas à présenter et à justifier la future loi linguistique. Il proposait un projet global d’une société québécoise de langue française. Il distinguait avec clairvoyance la fonction de la législation, qui était de fixer les règles d’emploi du français, de l’anglais et des autres langues, et les responsabilités des autres ministères, des institutions et des corps intermédiaires, de même que de chaque citoyen dans cette entreprise collective. Nous étions loin alors de la tendance d’aujourd’hui à ne considérer que l’aspect juridique de la politique linguistique en oubliant que chacun, personne ou institution, y a un rôle à jouer tout aussi essentiel.
Le projet de loi 1, Charte de la langue française, fut déposé devant l’Assemblée nationale le 27 avril 1977. Il devait par la suite changer de numéro d’ordre pour devenir le projet de loi 101 au moment de sa présentation finale.
Le débat fut intense aussi bien au sein du conseil des ministres que dans le grand public, dans les médias et en commission parlementaire lors de l’examen du projet de loi 1. Il portait à la fois sur l’énoncé de politique et sur les articles du projet de loi.
En particulier, les ministres et le monde des affaires craignaient que la loi proposée ne provoque un déplacement des activités économiques vers l’extérieur du Québec. Or l’activité économique du Québec et de Montréal avait depuis longtemps commencé à se déplacer vers l’Ouest, surtout depuis l’ouverture de la voie maritime qui avait enlevé à Montréal son statut de dernier port en eau profonde accessible aux navires marchands de fort tonnage. Toronto était déjà la métropole économique du Canada[75].
Le régime linguistique qui conviendrait aux sièges sociaux des entreprises posait des problèmes très spécifiques. D’une part, il fallait s’assurer que le comportement linguistique du siège social ne nuirait pas à la francisation des succursales québécoises de l’entreprise, ni par des directives contraires, ni par l’imposition généralisée de la langue anglaise dans toutes les communications, administratives ou techniques. D’autre part, il fallait tenir compte du fait que le personnel d’un siège social se renouvelait constamment, qu’il était le plus souvent multiethnique et composé de personnes de langues différentes pour lesquelles l’anglais était le plus souvent la seule langue commune. Le milieu des affaires était inquiet des obligations linguistiques que la future loi imposerait aux sièges sociaux, qu’ils soient situés au Québec ou ailleurs. Le conseil des ministres partageait leur inquiétude, le ministre Laurin était perplexe.
Il prend la décision d’envoyer en Europe une mission de dirigeants d’entreprise pour aller s’informer de l’emploi des langues dans les sièges sociaux de grandes entreprises installés dans des pays de langues et de situations linguistiques différentes.
La mission se déroule du 6 au 17 juin 1977. Le rapport, unanime, est remis au ministre Laurin dès le retour de la mission, à temps pour qu’il puisse s’en inspirer[76].
La délégation était composée des personnes suivantes, citées par ordre alphabétique : André Brisson, vice-président et directeur général de la Banque de la Nouvelle-Écosse, Jean-Claude Corbeil, directeur, Terminologie, Régie de la langue française, Camille Dagenais, président du conseil et chef de direction du Groupe SNC, Pierre Desmarais II, président du Conseil du patronat, Maurice Forget, président de la Régie de la langue française, Pierre Fréchette, vice-président (Québec) de la Banque Royale du Canada, Daniel Johnson, secrétaire de Power Corporation of Canada, Pierre Laporte, directeur Recherche et Évaluation, Régie de la langue française, Pierre Laurin, directeur de l’École des HEC de Montréal, Brian Mulroney, vice-président exécutif de Iron Ore Company of Canada, l’Honorable Maurice Sauvé, vice-président de la Consolidated-Bathurst.
Les membres de la mission ont visité les sièges sociaux de dix-neuf entreprises : en Hollande (Philips et Unilever), en Belgique (Société générale de Banque et Petrofina), en Suisse (Union de Banque Suisse, Sulzer Frères, Brown Boveri, Hoffman-Laroche, Ciba-Geigy, Nestlé), en Allemagne (Siemens), en France (toujours à Paris : le ministère des Affaires étrangères, Creusot-Loire, Pechiney, I.B.M. Europe, Imetal, C.I.I. Honeywell Bull, Air France et Renault). Les rencontres avec les hauts dirigeants de ces entreprises se déroulent suivant un guide d’entrevue préparé par la direction de la recherche de la Régie de la langue française et agréé par les membres de la mission.
Au terme de leur mission, les membres ne font pas de recommandations au ministre. Ils s’en tiennent à des observations et à des conclusions d’ordre général, mais qui peuvent orienter ses réflexions et influencer le traitement réservé aux sièges sociaux par la future législation.
Extraits du rapport de la mission sur les sièges sociaux, juin 1977
Il nous est apparu que l’attitude des multinationales face aux questions linguistiques est fondamentalement inspirée par des considérations pragmatiques.
Les choix linguistiques des sièges sociaux sont toujours en parfaite harmonie avec le respect des langues prépondérantes, soit dans le pays, soit sur le territoire régional où est situé le siège social.
Plus l’entreprise s’internationalise dans ses activités […], plus s’accentue la tendance à déléguer aux nationaux la gestion des filiales établies à l’étranger.
L’entreprise communique avec ses clients dans leurs langues.
L’accueil des étrangers est une pratique normale au sein des sièges sociaux. Elle ne semble pas causer de problème nulle part et d’autant moins que les étrangers dans la grande majorité des cas, surtout si leur séjour est prolongé, ont tendance à apprendre la langue du pays.
Le fonctionnement harmonieux d’un siège social aux dimensions internationales est lié à un comportement de tolérance vis-à-vis l’utilisation de différentes langues.
Il apparaît donc plus approprié de s’inspirer d’une philosophie incitative plutôt que coercitive lorsque l’on veut influencer le comportement linguistique des sièges sociaux.
Une communauté linguistique, relativement peu nombreuse, a intérêt à posséder un système d’éducation qui favorise non seulement le bilinguisme, mais aussi le multilinguisme, car sa situation l’oblige à s’adapter aux autres.
Nous sommes d’avis que le Gouvernement du Québec ne devrait pas légiférer sur le comportement linguistique des sièges sociaux autrement que pour inciter des pratiques conformes aux conclusions précédentes, et pour exiger que les sièges sociaux communiquent avec le gouvernement en français, de même que pour exiger une communication en français entre les sièges sociaux et leurs établissements au Québec.
La Charte de la langue française fut sanctionnée le 26 août 1977 après le plus intense débat qu’une loi ait provoqué et à la suite d’une longue commission parlementaire (du 19 juillet au 26 août). Un résumé substantiel des dispositions de cette première version de la Charte est présenté à l’annexe II.
Ce fut le projet de loi le plus populaire des débuts du gouvernement Lévesque. Selon un sondage de l’époque, 65 % des francophones montréalais approuvaient la Charte et 55 % en province. Cet attachement à cette loi ne s’est jamais démenti.
L’adoption de la loi 101 provoqua une profonde modification de la situation de la langue française et, par ricochet, de la société québécoise. Les entreprises du Québec se sont francisées rapidement et les Québécois francophones ont accédé aux postes de direction. Du coup, les francophones ont repris confiance en leur langue qui leur permet dorénavant de faire de meilleures carrières. L’écart de revenu entre francophones et anglophones est disparu. La connaissance et l’emploi de la langue française est maintenant rentable. Les anglophones du Québec sont devenus de plus en plus bilingues et ont changé d’attitude envers les francophones. Les allophones se sont mis, eux aussi, à apprendre le français, d’autant que leurs enfants fréquentent l’école française. L’emploi obligatoire de la seule langue française dans l’affichage public et la publicité pendant de longues années a modifié radicalement le visage du Québec.
On peut soutenir que la Charte de la langue française est certainement le texte de loi qui a le plus profondément transformé la société québécoise.
Un texte de loi est vivant. Il évolue au rythme des changements que subit la société, changements sociaux mais également technologiques. Il évolue surtout au fil des jugements rendus par les cours, notamment, au Canada, par la Cour suprême, à la suite de la contestation de certaines de ses dispositions devant les tribunaux.
Il nous restera donc, dans le chapitre II de la deuxième partie de ce livre, à suivre ce qui est advenu de la Charte de la langue française entre son adoption en 1977 et aujourd’hui.
Mais auparavant, il nous faut évoquer les débuts et l’évolution de la politique d’immigration, qui est un volet tout aussi essentiel de la politique linguistique pour l’avenir d’une société québécoise de langue et de culture françaises.
Chapitre III – La politique québécoise d’immigration
La politique d’immigration du Québec s’amorce et se développe en même temps que la législation linguistique. L’une et l’autre ont la même origine, la crise scolaire de Saint-Léonard (1967-1969), dont nous avons décrit les événements précédemment. À cette occasion, les Québécois ont pris brutalement conscience que des immigrants récents tournaient le dos à la société québécoise de langue française, qu’ils choisissaient massivement de s’intégrer à la minorité de langue anglaise et qu’ils préféraient, en conséquence, que leurs enfants apprennent l’anglais plutôt que le français. Ainsi, à la longue, la société québécoise risquait, du moins à Montréal, de cesser d’être majoritairement de langue française. Ces faits étaient connus des démographes et des fonctionnaires, quelques politiciens s’en inquiétaient, ces idées étaient dans l’air du temps, mais elles demeuraient abstraites, confinées dans les milieux intellectuels ou traditionnellement nationalistes comme la Société Saint-Jean-Baptiste. Cette fois, à Saint-Léonard, c’était concret et public. La querelle entre les Québécois de langue française et les activistes italiens faisait la manchette des médias, surtout après l’affrontement violent rue Jean-Talon, devant l’école Jérôme-Le Royer.
On connaît la suite des événements. La crise scolaire s’intensifiant, le gouvernement de l’Union nationale de l’époque, alors dirigé par Daniel Johnson, crée, le 5 novembre 1968, le ministère de l’Immigration. Le 9 décembre 1968, le même gouvernement, cette fois sous la direction de Jean-Jacques Bertrand, prend deux initiatives. Il crée la commission Gendron, avec le double mandat de faire le point sur la situation de la langue française au Québec face à la langue anglaise et d’examiner les droits linguistiques des citoyens du Québec. Le même jour, il dépose le projet de loi 85 qui accordait à tous les parents le libre choix de la langue d’enseignement. Ce projet est rapidement abandonné, mais il reviendra devant l’Assemblée nationale en octobre 1969 sous la forme du fameux bill 63, dont nous avons suivi les péripéties et la transformation subséquente en loi 22 et loi 101.
La politique d’immigration est le deuxième volet le plus stratégique de la politique linguistique. L’immigration est, aujourd’hui, aussi préoccupante pour l’avenir de la société québécoise que l’emploi de la langue française comme langue de travail. Le lien entre ces deux éléments est d’ailleurs étroit et évident.
En 1968, le gouvernement se trouvait face à une double tâche pour concevoir une politique d’immigration. Il lui fallait définir les objectifs d’une telle politique, ce qui sera l’objet principal de la loi créant le ministère de l’Immigration. Il devait également s’insérer dans le processus administratif de sélection des futurs immigrants dont l’initiative et les modalités avaient été abandonnées au gouvernement fédéral par toutes les provinces, y compris par le Québec. Pour que le Québec puisse participer à la sélection de ses immigrants, la négociation avec le gouvernement du Canada serait longue et difficile.
1. Les objectifs de la politique d’immigration
Depuis la création du Ministère en novembre 1968, les objectifs du Québec en matière d’immigration sont demeurés remarquablement stables. Au fil des années et à l’occasion des modifications successives du mandat et de la désignation du Ministère, ces objectifs se sont précisés, mais en s’inspirant toujours d’une conception de l’immigration spécifiquement québécoise.
Le premier objectif va de soi, « faciliter l’établissement au Québec d’immigrants », mais déjà avec une nuance qui définit le type d’immigrants que le Québec recherchera et le rôle qu’il leur assigne, « contribuer à son développement et participer à son progrès ». En conséquence, la sélection des immigrants se fera selon les besoins en main-d’œuvre et en fonction des emplois disponibles (art. 3 de la loi de 1968). À partir de 1994, on explicite ce critère en ajoutant au mandat du Ministère le soin de définir les « objectifs quant au nombre de ressortissants étrangers admissibles au cours d’une période donnée en tenant compte, notamment, des besoins démographiques, économiques et socioculturels du Québec » (alinéas 3 et 8 de l’art. 18.4 de la loi de 1994).
Le second objectif est encore plus caractéristique de la politique québécoise : établir et maintenir un service d’accueil et d’aide pour faciliter l’installation des immigrants à leur arrivée au Québec (alinéa d de l’art. 3 de la loi de 1968). De plus, pour faciliter l’intégration des immigrants au monde du travail, le gouvernement doit prendre les dispositions nécessaires pour que leur soient offerts des cours d’adaptation technique et professionnelle ainsi que d’enseignement général et pour que leurs diplômes et études soient ou reconnus ou pris en compte (ibid., art. 6). Il n’est alors fait aucune mention de la connaissance de la langue française. Cette lacune est corrigée l’année suivante par l’article 3 de la loi 63, qui ajoute un alinéa à l’article 3 de 1968 : prendre les dispositions pour que les personnes qui s’établissent au Québec acquièrent dès leur arrivée ou même avant qu’elles quittent leur pays d’origine la connaissance de la langue française. Depuis lors, ce mandat figure dans toutes les versions de la loi québécoise sur l’immigration.
Le troisième et dernier objectif de la politique d’immigration est propre au Québec. Sa formulation en 1968 tient davantage du vœu que de l’énoncé d’un mandat : favoriser la conservation des coutumes ethniques (art. 4). Ce vœu se transformera peu à peu en une véritable politique des communautés culturelles, dont les objectifs spécifiques seront le respect de leur identité, de leurs apports à la culture québécoise et le souci de leur insertion dans la société d’accueil. Le mandat du Ministère en sera complètement transformé, puisqu’il deviendra le moteur d’une délicate dynamique sociale qui fermente toujours au sein de la société québécoise.
La première formulation de ce nouvel objectif de la politique d’immigration date de juin 1981, moment où le Ministère devient le ministère des Communautés culturelles et de l’Immigration : « Le ministre, dit la loi, est également responsable de la planification, de la coordination et de la mise en œuvre des politiques gouvernementales relatives à l’épanouissement des communautés culturelles et à leur entière participation à la vie nationale. Il est également chargé des programmes qui visent à maintenir et à développer les cultures d’origine ainsi qu’à assurer les échanges et le rapprochement avec la communauté francophone. » (art. 4 de la loi de 1981) Le même objectif est englobé dans une politique des relations du gouvernement avec les citoyens lors de la transformation, en 1996, du Ministère en ministère des Relations avec les citoyens et de l’immigration. Le mandat confié au Ministère devient très large : « Le ministre est responsable de la promotion des droits et libertés de la personne et favorise l’exercice par les citoyens de leurs responsabilités civiques et sociales. Il est chargé de promouvoir la solidarité entre les générations, en tenant compte des besoins des familles, des jeunes et des aînés, l’ouverture au pluralisme et le rapprochement interculturel, favorisant ainsi l’appartenance au peuple québécois. Il est aussi chargé de l’immigration et de l’intégration des immigrants. » (art. 10 et 13 de la loi) En 2006, le Ministère est renommé à nouveau ministère de l’Immigration et des communautés culturelles. Le mandat qui lui est confié gagne en précision ce qu’il a perdu en idéalisme : « Le ministre élabore et propose au gouvernement des orientations et des politiques sur l’immigration et l’intégration des immigrants ainsi que sur les relations interculturelles. Les fonctions du ministre en matière de communautés culturelles consistent plus particulièrement à : soutenir les communautés culturelles pour favoriser leur pleine participation à la société québécoise; encourager l’ouverture de la société au pluralisme; faciliter le rapprochement interculturel entre les Québécois. » (art. 3 et 5 de la loi)
En somme, le Québec poursuit, en immigration, deux objectifs fondamentaux, l’intégration des immigrants et sa conséquence, la transformation de la société québécoise en une société plurielle mais de langue française au sein de laquelle puissent cohabiter des cultures différentes. Ces deux objectifs sont difficiles à concilier. Ils maintiennent une tension continuelle entre la communauté d’accueil et les communautés culturelles, tension alimentée par l’application et surtout par l’interprétation juridique des deux chartes des Droits de la personne, à cause du flou de la notion d’accommodement raisonnable.
2. La participation du Québec à la sélection des immigrants
Dès la création du ministère de l’Immigration, la loi prévoyait l’établissement de bureaux d’immigration à l’extérieur du Québec et l’envoi de fonctionnaires québécois pour y recruter des immigrants (art. 5 de la loi de 1968).
Le gouvernement du Québec savait pertinemment qu’il pénétrait ainsi sur le terrain controversé des relations internationales, domaine où Paul Martin (père)[77], au moment où il était secrétaire d’État aux Affaires extérieures sous le gouvernement Pearson, avait affirmé au nom du gouvernement fédéral que le Canada ne possède qu’une seule personnalité internationale au sein de la communauté des nations et qu’en conséquence, il est le seul responsable de la direction des affaires extérieures. Pierre Elliott Trudeau sera du même avis par la suite. Le Québec soutenait, au contraire, que, dans tous les domaines dont la Constitution canadienne de 1867 lui confiait la gestion exclusive, sa compétence s’étendait aux relations internationales et que ces domaines devenaient, de ce fait, de compétence partagée entre les deux niveaux de gouvernement. À l’appui de cette opinion, on évoquait la doctrine Gérin-Lajoie[78] et le précédent de la signature, en 1964, d’un accord avec la France en éducation.
Le bon fonctionnement des bureaux québécois d’immigration à l’étranger exigeait donc qu’il y ait négociation entre les deux gouvernements, ce que prévoyait l’article 7 de la loi de 1968. « Le ministre peut conclure tout accord avec le gouvernement du Canada et tout organisme de celui-ci ainsi qu’avec tout gouvernement ou organisme, conformément aux intérêts et aux droits du Québec, pour faciliter l’exécution de la présente loi. »
Les négociations avec le gouvernement fédéral s’amorceront rapidement. Elles définiront progressivement le rôle du Québec par rapport à celui du Canada en matière d’immigration. Elles seront longues, délicates, mais elles donneront, en définitive, satisfaction aux deux parties. Il y eut quatre rencontres de négociations entre les ministres des deux gouvernements responsables de ces questions, qui se succèdent en se complétant, à la manière des poupées russes. Chacune donna lieu à la signature d’une entente entre les deux gouvernements. La dernière en date est du 5 février 1991.
Une première entente entre le Canada et le Québec est signée le 18 mai 1971 par Otto E. Lang, ministre de la Main-d’œuvre et de l’Immigration du Canada, et François Cloutier, ministre de l’Immigration du Québec.
Elle a strictement pour objet « de permettre et faciliter la présence » de deux fonctionnaires du ministère de l’Immigration du Québec dans les « bureaux fédéraux de l’Immigration en dehors du Canada », partout où la « présence québécoise pourrait être demandée et jugée possible, soit de façon plus immédiate, à Athènes, Beyrouth, Bruxelles, Lisbonne et Rome » (art. 2 de l’entente). Cette présence fera l’objet d’un bail de location d’espace entre les deux parties. À Paris et à Londres, la question ne se posait pas puisque le Québec y disposait déjà de délégations générales qui étaient en mesure de s’occuper d’immigration.
Elle décrit également le mode de collaboration entre les fonctionnaires des deux gouvernements et précise la fonction du représentant du Québec. L’agent fédéral transmet à l’agent québécois copie de la demande d’admission des candidats jugés admissibles selon les critères du Canada et qui se proposent d’immigrer au Québec. L’agent québécois recevra chaque candidat « afin de le renseigner davantage sur la vie et les conditions de travail au Québec ». Après cette entrevue, il donne son avis sur la candidature. « L’agent d’orientation du ministère de l’Immigration du Québec ne fera pas fonction d’agent recruteur. Une demande d’immigration se doit d’être décidée à la lumière des lois, règlements et critères de l’immigration canadienne » (art. 10). Cette entente n’a pas pour objet et n’aura pas pour effet d’accorder au Québec une position privilégiée par rapport aux autres provinces (art. 11).
Une deuxième entente est conclue le 17 octobre 1975 par Robert Andras, ministre de la Main-d’œuvre du Canada, et Jean Bienvenue, ministre de l’Immigration du Québec, en présence de François Cloutier, ministre des Affaires intergouvernementales du Québec.
En introduction à cette entente, un des considérants invoque l’article 95a de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique (1867), qui spécifie que la législature de chaque province peut faire des lois relatives à l’agriculture et à l’immigration, à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec aucun des actes du Parlement du Canada, ce qui est admettre la compétence constitutionnelle du Québec en immigration. Un autre reconnaît qu’il est important d’assurer un recrutement adéquat et une sélection judicieuse des immigrants qui résideront au Québec, tout particulièrement des immigrants francophones ou aptes à le devenir.
L’entente complète et précise l’accord Lang-Cloutier précédent.
Le personnel du Québec exercera ses fonctions en étroite collaboration avec l’agent du Canada responsable des questions d’immigration (art. 4). Celui-ci informera l’agent du Québec de toutes les demandes d’admission au Canada des requérants qui comptent s’établir au Québec et il prendra en considération son avis avant d’accepter ou de refuser une demande (art. 6). L’agent du Québec reçoit chaque candidat pour le renseigner sur la langue, les conditions de travail et les aspects socioculturels propres à l’endroit où il compte résider (art. 7). La décision finale est prise en fonction de la loi et du règlement du Canada et selon les critères canadiens d’immigration (art. 6d).
Une troisième entente est signée entre Jacques Couture, ministre de l’Immigration du Québec, et J.S.G. Cullen, ministre de l’Emploi et de l’Immigration du Canada le 20 février 1978, en présence de Claude Morin, ministre des Affaires intergouvernementales du Québec, et Marc Lalonde, ministre d’État chargé des Relations fédérales-provinciales du Canada.
Les considérants de cette entente s’inspirent de l’entente Andras-Bienvenue. La juridiction en immigration est conjointe. Il importe d’assurer une sélection cohérente et harmonieuse des immigrants et des travailleurs temporaires en fonction des capacités d’accueil économiques, démographiques et socioculturelles des régions de destination, d’autant plus que le Québec entend se prononcer sur la venue et la sélection des ressortissants étrangers en fonction de leur capacité à s’intégrer rapidement et avec succès à la société québécoise.
En conséquence, les parties contractantes collaboreront dans tous les domaines touchant leur flux migratoire et la démographie. Elles participeront conjointement à la sélection des personnes qui souhaitent s’établir au Québec, à titre permanent ou temporaire, selon des critères à la fois canadiens et québécois.
Chaque partie conçoit sa propre grille d’analyse des candidatures et attribue une valeur relative à chaque facteur retenu. Elle informe l’autre de sa grille d’évaluation et de la valeur relative accordée à chaque critère.
Le Québec procède à l’analyse des dossiers des candidats dont c’est la destination selon sa grille d’analyse et juge qui est admissible et qui ne l’est pas.
L’entente ajoute une étape de présélection qui accorde le droit à chaque partie d’écarter d’office tout requérant qui obtient moins de 30 % au total des points de la grille d’évaluation, sans avoir à consulter l’autre partie.
Les deux parties se communiquent mutuellement tous les renseignements utiles à l’évaluation et au traitement des candidatures.
L’entente définit les catégories d’immigrants et fixe les modalités de sélection qui s’appliquent dans chaque cas :
- Dans le cas des immigrants indépendants, l’accord du Québec sur chaque candidature est requis pour admettre au Canada toute personne qui a le Québec comme destination.
- Dans celui des parents aidés, c’est-à-dire soutenus financièrement à leur arrivée par un parent déjà établi au Canada ou au Québec, le Québec donne son avis, mais le Canada peut admettre un requérant qu’il n’a pas sélectionné. Il doit informer le Québec des motifs de sa décision.
- Les réfugiés : il revient au Canada de déterminer qui est réfugié au sens de la convention des Nations Unies. La sélection se fait conjointement, mais en tenant compte de l’aspect humanitaire des candidatures.
- Les visiteurs : l’accord du Québec est requis pour tous ceux qui y viennent, les travailleurs temporaires ou saisonniers, les étudiants, les enseignants et les personnes qui désirent y recevoir soins et traitements médicaux.
- Les immigrants investisseurs, nouvelle catégorie d’immigrants créée par le Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration de 1978 auquel le Québec a souscrit. Le Canada et le Québec s’entendent sur la définition d’immigrants investisseurs, sur le montant du placement minimal requis et celui de la garantie. Ils définissent de concert les catégories d’entreprises et de commerces admissibles. Le Québec s’engage à administrer son programme d’immigrants investisseurs en conformité de cet accord. La sélection de ces immigrants est conjointe et l’avis du Québec est requis pour tous ceux qui veulent s’y installer.
Enfin, l’entente crée deux organismes, un Comité fédéral-provincial d’application pour coordonner sa mise en œuvre et un Comité mixte pour assurer une collaboration permanente entre la Commission de l’Emploi et de l’Immigration du Canada et le ministère de l’Immigration du Québec sur toute question relative à la démographie et à l’emploi qui ont des incidences sur l’immigration des ressortissants étrangers qui souhaitent s’établir au Québec.
L’entente la plus récente date du 5 février 1991 entre mesdames Barbara McDougall, ministre de l’Emploi et de l’Immigration du Canada, et Monique Gagnon-Tremblay, ministre des Communautés culturelles et de l’Immigration du Québec, en présence de Gil Rémillard, ministre québécois de la Justice et ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes.
S’inspirant de l’entente Couture-Cullen, elle porte sur trois points principaux : les niveaux d’immigration, la sélection des immigrants selon les diverses catégories, leur accueil et leur intégration.
a) Les niveaux d’immigration
Le Canada établit chaque année les niveaux d’immigration pour l’ensemble du pays et prend en considération l’avis du Québec sur le nombre d’immigrants que ce dernier désire recevoir (art. 5).
Le Québec s’engage à accueillir un pourcentage des immigrants reçus chaque année, y compris les réfugiés, égal à celui de sa population dans l’ensemble de la population canadienne.
b) La sélection des immigrants selon les diverses catégories
Dans le cas des immigrants indépendants, l’article 12 établit une nette distinction entre la sélection et l’admission : le Québec est le seul responsable de la sélection des immigrants dont c’est la destination, le Canada est le seul responsable de leur admission, qu’il ne peut cependant refuser aux candidats sélectionnés par le Québec (art. 12).
Dans le cas des immigrants des catégories de la famille et des parents aidés, le Canada est seul responsable de l’admission. Il lui revient de décider si un immigrant est membre d’une famille (art. 13). Les critères de sélection des immigrants de la catégorie de la famille sont définis par le Canada et appliqués par le Québec à ceux dont c’est la destination (art. 14). Dans le cas des parents aidés à destination du Québec, la sélection se fait selon les critères du Québec (art. 15). Il revient au Québec de faire le suivi de l’engagement financier du membre de la famille qui s’est porté garant de la personne (art. 21). Seront admis les parents aidés qui satisfont aux critères du Québec ou du Canada (art. 16).
Les réfugiés identifiés comme tels par le Canada et à destination du Québec sont admis par le Canada, à condition qu’ils satisfassent aux critères de sélection du Québec (art. 18 et 19).
c) L’accueil et l’intégration
Les services d’accueil et d’intégration linguistique et culturelle des immigrants qui s’installent au Québec sont confiés en totalité au gouvernement québécois (art. 24), avec compensation financière (art. 26). Cela ne s’applique pas aux services d’intégration économique offerts par le Canada de façon égale à tous les résidents du pays (art. 27).
La responsabilité des services relatifs à la citoyenneté est du ressort exclusif du Canada (art. 28).
Les responsabilités de l’un et de l’autre gouvernement en immigration se partagent aujourd’hui de la manière suivante.
Le Canada et le Québec fixent de concert le nombre annuel d’immigrants et de réfugiés qui seront admis au Canada. Le Québec a droit d’en recevoir une proportion égale à celle de sa population dans l’ensemble canadien.
Le Canada et le Québec procèdent à la sélection des candidatures chacun selon sa propre grille d’évaluation. L’avis du Québec prévaut dans le cas des immigrants indépendants et des visiteurs, de même que dans le choix des immigrés qu’il accepte de recevoir. Les deux gouvernements s’échangent tous les renseignements utiles à la prise de la décision finale d’admission, décision qui appartient au gouvernement du Canada.
L’accueil et l’intégration des immigrants et des réfugiés au Québec est de l’entière responsabilité du gouvernement québécois. Le gouvernement du Canada lui verse en compensation financière ce qu’il aurait dû débourser pour offrir, au Québec, des services analogues à ceux dont il assume le financement dans les autres provinces. Le Québec est donc totalement responsable de ce qu’il advient des immigrants qu’il sélectionne et reçoit.
Au cours des années qu’a duré cette négociation, le gouvernement du Québec a publié de nombreux documents pour préciser et expliciter la manière dont la société québécoise concevait l’immigration. Il faut porter attention à la date de publication de chacun de ces documents, car les idées ont sans cesse évolué en même temps qu’évoluaient les rôles des deux gouvernements.
3. Les étapes de l’intégration
L’intégration est la seconde facette de la politique d’immigration.
Tout comme bilinguisme, le mot intégration est un mot séduisant, sécurisant, passe-partout, qui dissimule des phénomènes sociaux et personnels complexes, souvent angoissants ou conflictuels, parfois douloureux pour les personnes qui ont quitté leur pays.
D’une part, il désigne un mode de relation entre la personne immigrante et les personnes avec lesquelles elle entre en relation à son arrivée, une manière de concilier l’image qu’elle se forge de la société d’accueil et l’image que celle-ci lui renvoie de son statut de nouvel arrivant. L’intégration se joue entre deux partenaires, entre des personnes d’abord et toujours, dans tous les gestes de la vie quotidienne, mais aussi entre des groupes quand les immigrants sont nombreux à venir du même pays, à être de la même culture, de la même langue ou de la même religion.
D’autre part, l’intégration est un cheminement personnel qu’entreprend l’immigrant vers la société d’accueil. Il se fait par étapes, qui sont autant de formes d’intégration, de la minimale à la plus complète. Nous en distinguons trois, que nous avons naguère décrites en les appliquant au processus d’intégration à la société québécoise, pour être plus proche de la réalité[79].
Au terme de la première étape de ce cheminement, la personne est capable de communiquer en français, la langue commune des citoyens québécois. Elle connaît les principales institutions québécoises, dont elle sait comment utiliser les services et les ressources. Elle peut gagner sa vie en utilisant au besoin la langue française et vaquer aux diverses occupations de la vie en société. Elle est autonome et indépendante du groupe de soutien ou de refuge dont elle a peut-être bénéficié à son arrivée. C’est l’intégration minimale de fonctionnement et l’objectif premier de la politique d’intégration du Québec. La connaissance de la langue française est la condition de départ du processus d’intégration de fonctionnement. Son influence ne va pas au-delà, en ce sens que rien ne garantit que celui qui connaît le français évoluera vers une forme plus poussée d’intégration à la société québécoise. On constate en effet que la plus grande partie des immigrants s’en tient à l’intégration de fonctionnement, quand ils y arrivent.
À cette forme minimale d’intégration, la personne immigrante peut ajouter, plus ou moins tôt, l’intention de jouer un rôle dans la vie collective, dans une sphère qui lui convient, la vie du quartier, la participation au débat public, l’action syndicale, les associations communautaires ou professionnelles, l’action politique militante. De ce fait, elle participe au projet collectif de société de la même manière et avec les mêmes possibilités que toute autre personne et y exerce une influence à la mesure de son action. C’est l’intégration de participation, étape que chacun vit à sa manière, avec plus ou moins d’intensité et d’engagement.
Plus ou moins rapidement, au cours de cette intégration de participation, la société québécoise cesse, à ses yeux, d’être une société d’accueil, elle devient la sienne, à part entière. La personne conçoit alors, sans restriction, son avenir et celui de ses enfants comme membres de la société d’adoption. C’est l’intégration d’aspiration, celle où la personne se sait et se sent liée à l’avenir de la société québécoise, ce qui la pousse souvent à s’impliquer dans les débats de l’heure, non plus pour s’y opposer parce qu’ils menaceraient un groupe d’appartenance, mais pour y faire valoir son point de vue et sa propre conception de l’avenir collectif.
La responsabilité de la réussite de l’intégration dépend autant de l’attitude des Québécois que côtoie l’immigrant à son arrivée et tous les jours de sa nouvelle vie que de son attitude à lui à leur endroit et à l’endroit de leur mode de vie. Elle dépend aussi du climat des relations entre la société d’accueil et les communautés immigrantes, lorsque celles-ci s’organisent en groupe de pression pour la promotion ou la défense d’intérêts particuliers. Dans l’un et l’autre cas, les risques de tension et même d’affrontement sont toujours réels.
Tout comme une pièce de monnaie, l’intégration est un processus à deux facettes, l’intégration sociale et l’intégration linguistique.
4. L’intégration sociale
Au tournant des années 1960, tous les gouvernements successifs, d’un parti ou de l’autre, ont commencé à s’inquiéter de l’inexistence de toute politique qui encadrerait la présence des immigrants au Québec. Leur première et constante préoccupation a été d’inventer une manière de les intégrer dans la société québécoise de langue française en sachant très bien qu’il leur fallait obtenir à l’égard d’un éventuel plan d’action à la fois l’adhésion des membres de la communauté d’accueil et celle des personnes immigrantes, membres ou non d’une communauté culturelle déjà constituée.
Trois documents clés jalonnent la mise au point d’un tel plan. En 1967 est préparé un document de prise de conscience du problème sous le titre Rapport du Comité interministériel sur l’enseignement des langues aux Néo-Canadiens[80], commandé par le ministre Marcel Masse[81], qui proposait déjà comme solution essentielle l’enseignement du français à tous les immigrants, enfants et adultes, et, en conséquence, la création d’un système scolaire fondé sur la langue et non sur la religion. Le rapport ne sera pas rendu public. En 1981, le Parti québécois propose un plan d’action dont le titre résume bien le propos, Autant de façons d’être Québécois, fondé sur le principe de la convergence des cultures d’origine vers la culture québécoise majoritaire de langue française. Selon ce plan d’action, la politique d’immigration devait poursuivre trois objectifs stratégiques : assurer le maintien et le développement des communautés culturelles, sensibiliser les Québécois francophones à leur apport ainsi qu’à leur participation à la vie publique et favoriser l’intégration des immigrants à la société québécoise. Enfin, en 1991, le gouvernement du Parti libéral rendait publiques ses orientations en immigration dans un document intitulé Au Québec, pour bâtir ensemble, Énoncé de politique en matière d’immigration et d’intégration, document rédigé alors que Robert Bourassa était premier ministre et sous l’autorité de la ministre de l’Immigration de l’époque, Monique Gagnon-Tremblay. Cette politique inspire toujours l’action du ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles. C’est donc celle dont nous tiendrons compte maintenant pour traiter de l’insertion des immigrants.
Un même thème traverse ces trois prises de position du gouvernement québécois en matière d’immigration : le seul lien, personnel et social, acceptable et satisfaisant entre les anciens et les nouveaux Québécois est l’engagement réciproque à travailler ensemble à être heureux dans une société commune prospère et tolérante. D’où la proposition d’un contrat moral entre les deux parties sur la base des principes et des valeurs autour desquels se définit la société québécoise d’aujourd’hui. D’une part, il est légitime que les immigrants soient informés de ces principes et valeurs et qu’ils apprennent graduellement à les partager, « étant donné que l’immigration constitue un privilège que [leur] accorde la société d’accueil » (p.16 de l’Énoncé). D’autre part, la société québécoise doit assumer les responsabilités et les devoirs qu’elle a à l’égard des personnes qu’elle a choisi de recevoir. Sur ces deux points, la position actuelle du Québec est explicite, loyale et honnête. Tous les immigrants en sont informés dès leurs premières démarches auprès des services québécois d’immigration à l’étranger et dès leur premier contact avec les services d’accueil du Ministère[82].
La société à laquelle les immigrants ont librement accepté de se joindre se définit par les traits suivants (p. 16 de l’Énoncé) :
- une société dont le français est la langue commune de la vie publique;
- une société démocratique où la participation et la contribution de tous sont attendues;
- une société pluraliste ouverte aux multiples apports dans les limites qu’imposent le respect des valeurs démocratiques fondamentales de la société québécoise et la nécessité de l’échange intercommunautaire.
Chacun de ces traits entraîne ses propres paradoxes dont il faut avoir conscience.
a) Premier trait : une société dont le français est la langue commune de la vie publique.
Le ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles reprend à son compte l’objectif central de la politique linguistique et presque dans les mêmes termes.
Aux yeux du Gouvernement comme de ceux de la vaste majorité du peuple québécois, l’apprentissage du français et son adoption comme langue commune de la vie publique constituent des conditions nécessaires à l’intégration. En effet, la langue est non seulement l’instrument essentiel qui permet la participation, la communication et l’interaction avec les autres Québécois, mais elle est également un symbole d’identification. Pour l’immigrant, l’apprentissage du français vient appuyer le développement de son sentiment d’appartenance à la communauté québécoise (p. 17 de l’Énoncé).
Pour les membres de la société d’accueil, pouvoir communiquer en français avec les nouveaux arrivants est le signe le plus perceptible de leur volonté de s’intégrer à la communauté française et les incite à les connaître et à les intégrer plus facilement.
Le gouvernement du Québec, par le ministère de l’Immigration et le ministère de l’Éducation, met à la disposition des immigrants, récents et plus anciens, des services d’enseignement du français selon des formules très variées, adaptées aux besoins et à la disponibilité des personnes. Nous en traiterons au point suivant.
La communauté d’accueil s’attend donc à ce que les immigrants et leurs descendants apprennent le français et en fassent la langue de leur vie au Québec. En contrepartie, les immigrants s’attendent à ce que les Québécois francophones leur parlent en français, toujours et partout, même si leur connaissance de la langue n’est ni encore complète ni toujours conforme à la norme.
On constate cependant des torts de part et d’autre.
Les Québécois francophones ont trop souvent tendance à parler anglais avec les immigrants et à ne pas avoir la patience de jouer leur rôle de moniteur de français à l’égard des immigrants en cours de francisation. Les immigrants estiment alors, avec raison, les témoignages sont nombreux, que les Québécois francophones les snobent, qu’ils méprisent le résultat des efforts qu’ils font pour apprendre le français, qu’ils les renvoient à leurs langues d’origine ou à la langue anglaise, puisque les Québécois anglophones ne sont pas si pointilleux sur la manière de parler anglais. Ainsi, les Québécois francophones trahissent eux-mêmes leurs propres objectifs en politique linguistique et en politique d’immigration, qu’ils ont pourtant réclamés de leurs gouvernements à grands cris et avec force manifestations, fleurdelisé à l’appui. Nous avons déjà dénoncé cette tendance des francophones en conclusion du chapitre précédent.
De même qu’en traitant du français, langue de travail, nous avons déploré le fait que les immigrants adultes, surtout pressés de se trouver du travail, de gagner leur vie, ce qui est tout à leur honneur et parfaitement compréhensible, soient souvent forcés de travailler en langue anglaise. Les raisons en sont nombreuses. Les entreprises privées assujetties à la Charte de la langue française exigent presque toujours la connaissance de la langue française comme condition d’embauche. En conséquence, les immigrants trouvent plus facilement, et trop souvent, de l’embauche dans les entreprises qui ne sont pas soumises à la loi 101, ou dans des entreprises qui ont immédiatement besoin de leurs compétences avant même qu’ils apprennent le français, ou dans des commerces plus tolérants, qui comptent sur un autre employé francophone pour servir les clients de langue française. L’apprentissage de la langue française en est retardé d’autant, compromis même.
De plus et surtout, il n’est pas toujours évident pour les immigrants récents que la langue commune de la société québécoise est le français.
En effet, beaucoup de ministères offrent aux citoyens québécois des services en langue anglaise, destinés en principe aux membres de la minorité de langue anglaise, citoyens du Québec qui ont droit à des services dans leur langue, du moins était-ce ce qu’ils prétendaient et réclamaient au moment du débat de la Charte de la langue française.
Sur ce sujet, la politique du Québec s’est précisée. Règle générale, l’Administration « favorise l’unilinguisme français dans ses activités [83] ». Tous ses services et documents sont disponibles en langue française, mais aussi parfois en langue anglaise ou en d’autres langues selon la nature des services et les circonstances. Le contribuable québécois de langue anglaise peut communiquer en anglais avec l’Administration et en obtenir sur demande des documents en langue anglaise si ces documents sont suffisamment importants pour qu’il vaille le coût de les traduire. Par contre, les services et les documents sont disponibles en français, en anglais ou dans une autre langue quand la santé et la sécurité des personnes sont en jeu, quand les services sont destinés à des communautés de langue anglaise ou de langue autochtone bénéficiant de droits reconnus par la loi, ou quand ils sont destinés à des immigrants à leur arrivée au Québec, pour faciliter leur installation.
Depuis lors, surtout depuis que les services de l’Administration sont accessibles par téléphone ou par Internet, l’offre de service en langue anglaise s’est généralisée. Tous les systèmes téléphoniques des ministères commencent par un message en français et en anglais offrant le choix entre l’une ou l’autre langue pour poursuivre. Le portail du gouvernement du Québec est trilingue, français, anglais, espagnol, et encore a-t-il fallu insister pour qu’il soit en espagnol, évitant ainsi qu’il ne soit que bilingue français-anglais. Dans le site de plusieurs ministères, on identifie les documents selon qu’ils sont disponibles en français seulement ou à la fois en version française et anglaise. En somme, bien que le français soit la seule langue officielle du Québec, l’image que projette l’Administration québécoise au téléphone et dans Internet est celle d’une administration bilingue, à la manière de celle du gouvernement fédéral. L’immigrant récent qui connaît l’anglais ou qui s’intègre à la minorité anglophone a donc accès à des services du Québec en langue anglaise, ce qui l’incite encore moins à faire l’effort d’apprendre en plus la langue française comme troisième langue.
D’autre part, le Québec informe les nouveaux arrivants qu’apprendre le français ne signifie pas qu’ils doivent cesser de parler et d’employer leurs langues, mais qu’au contraire, le Québec considère que le maintien de leurs langues d’origine constitue un atout économique, social et culturel pour l’ensemble de la population québécoise.
Le nouvel arrivant a un peu de mal à s’y retrouver, à concilier l’emploi de sa langue à la maison et l’incitation à apprendre le français comme langue de la vie publique, d’autant qu’il observe rapidement qu’on peut employer la langue de son choix dans les communications privées, y compris la langue anglaise.
b) Le deuxième trait du contrat moral qu’offre le Québec aux immigrants découle du fait que la société québécoise est, depuis très longtemps, une société profondément démocratique. Il en découle des engagements et des devoirs réciproques entre l’État et les citoyens, de même qu’entre les citoyens. Avant d’être un système politique abstrait, la démocratie est une manière de vivre en société selon laquelle la liberté et les droits de chaque citoyen sont limités par la liberté et les droits des autres. Ce n’est ni simple à vivre, ni simple à apprendre pour qui n’a pas vécu dans un cadre politique semblable.
À l’égard des immigrants qu’elle reçoit, la société québécoise prend trois engagements principaux. Premier engagement : respecter leurs droits et libertés conformément à la Charte québécoise des droits et libertés de la personne, de la même manière et dans le même esprit d’égalité qu’elle le fait pour tout autre citoyen du Québec, sans discrimination aucune. Second engagement : leur garantir la même égalité des chances et la même justice sociale qu’aux autres citoyens, en leur donnant l’assurance de travailler à pallier les difficultés qui surgiront inévitablement avant qu’ils soient parfaitement intégrés. Dernier engagement : durant la première phase de leur insertion dans la société québécoise, leur offrir une forme de soutien socioéconomique et atténuer « les barrières institutionnelles ou sociétales qui les empêchent d’avoir un égal accès à l’emploi, au logement et aux services publics ou privés » (p. 18 de l’Énoncé).
En contrepartie, la société québécoise est en droit d’attendre des immigrants qu’ils dépassent la simple intégration de fonctionnement, qu’ils cessent rapidement de se considérer comme des nouveaux arrivants de passage, qu’au contraire, ils s’engagent dans la vie économique, sociale, culturelle et politique du Québec et qu’ils deviennent vraiment et consciemment des membres actifs de la société d’accueil devenue la leur.
c) Le troisième et dernier trait du contrat moral entre les Québécois et les immigrants est l’acceptation de part et d’autre du pluralisme de la société. Le caractère démocratique de la société québécoise a eu comme conséquence, pour les Québécois mais aussi pour les immigrants, que la société, en quelques décennies, est devenue très largement pluraliste, avec tous les problèmes qu’entraîne une mutation aussi subite.
La société québécoise d’autrefois avait vécu difficilement et avait tenté de concilier la cohabitation obligée de deux peuples et de deux cultures, entre une majorité de langue française et de religion catholique, les Canadiens français, et une minorité dominante de langue anglaise et de religion protestante, les Canadiens anglais.
Cette société a subi une première mutation au moment de la Révolution tranquille. Les rapports entre la majorité et la minorité se sont modifiés en faveur de la majorité. La religion catholique a perdu de son autorité politique et morale en faveur d’une société de plus en plus laïque où la religion est du domaine de la vie privée. La langue française est devenue la langue officielle du Québec par la Charte de la langue française qui en a imposé l’emploi dans tous les secteurs de la vie publique. La culture québécoise a pris son essor, en littérature, en cinéma, en arts, dont les médias, radio et télévision, ont soutenu l’activité et diffusé les œuvres. Les Québécois demeurent très attachés aux acquis de la Révolution tranquille et entendent qu’ils ne soient pas compromis par l’immigration récente.
Car l’immigration provoque une autre mutation de la société québécoise. Il lui faut maintenant absorber de nombreuses et nouvelles cultures, souvent très éloignées de ce qu’elle est par la langue, la religion, les coutumes, la manière de concevoir la vie politique, la vie en société et la vie familiale. En fait, la société québécoise doit apprendre à concilier des appartenances et des identités culturelles multiples avec son propre sens de l’identité. La société québécoise s’est librement engagée dans cette seconde mutation en recrutant et en accueillant des immigrants. Mais elle attend d’eux que, dans leur manière d’être au Québec, les immigrants respectent les lois et les valeurs de la société québécoise, notamment le principe de l’égalité des hommes et des femmes et le caractère laïque de la société, selon le principe que la pratique d’une religion est un geste privé qui s’exerce dans des lieux également privés et sans empiéter sur l’espace public. Pour sa part, la société québécoise considère que la reconnaissance des cultures d’origine est compatible avec le partage d’une culture commune, que ces cultures peuvent féconder et enrichir, que c’est même la seule manière d’éviter le repli communautaire, culturel et religieux, source de tous les préjugés et prétexte invoqué par les extrémistes de tout bord pour provoquer des affrontements entre groupes d’appartenance différente. Tel est le défi de l’immigration, que doivent relever ensemble les immigrants et les membres de la société d’accueil.
La situation la plus douloureuse est celle des immigrants qui ont quitté leur pays et les lieux de leurs souvenirs, laissé derrière eux parents et amis, un mode de vie familier, pour tout reprendre à zéro dans un pays neuf et inconnu. Qu’ils l’aient fait volontairement ne change rien au déchirement et à l’inconfort qu’une mutation si totale implique. Pour sa part, la société québécoise subit une mutation tout aussi déchirante et angoissante, d’autant plus qu’elle est totalement imprévisible. Elle ne sera plus jamais la même. Elle vit et elle vivra de plus en plus un métissage culturel provoqué par les influences réciproques des cultures les unes sur les autres et sur la culture québécoise. Les relations entre Québécois et Québécoises de toutes les origines et cultures diffuseront ces influences dans le tissu social, d’autant plus profondément que, tôt ou tard, elles seront consacrées par des mariages ou des unions libres dont naîtront les jeunes Québécois de demain. La mutation la plus profonde est encore à venir.
Le contrat moral d’intégration sociale proposé par la société québécoise aux immigrants est un idéal qui se définit et se précise par son application au jour le jour, d’un incident ou d’une crise à l’autre. Il est, en réalité, un compromis entre la liberté personnelle et la contrainte sociale qu’imposent les principes et obligations de la vie en société, même dans les sociétés les plus démocratiques. Il faut donc prévoir que la réalité de l’intégration sociale fera évoluer le détail du contrat moral, mais en demeurant fidèle aux mêmes principes fondamentaux.
Il est regrettable que le contrat moral soit mal connu, ignoré même des anciens et des nouveaux Québécois, que les uns et les autres soient davantage braqués sur leurs droits que sur leurs devoirs. Le ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles doit rapidement intégrer dans ses objectifs de diffuser la connaissance du contrat moral pour que chacun soit conscient des exigences qu’il implique pour tous les citoyens du Québec, anciens et nouveaux. Ainsi, les citoyens disposeraient de balises et de critères pour interpréter la notion d’accommodement raisonnable et juger, cas par cas, si on peut ou si on doit y avoir recours.
5. L’intégration linguistique
Tous les gouvernements du Québec ont toujours été conscients de l’importance de l’intégration linguistique des immigrants et y ont consacré des ressources importantes. Cet objectif est constant. Le Plan stratégique 2005-2008 du ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles maintient le cap : « La connaissance du français constitue un catalyseur pour l’intégration à la société québécoise et facilite grandement l’insertion en emploi. La langue constitue un facteur clé d’intégration et de participation puisqu’elle favorise l’accès non seulement au travail, mais aussi [nous dirions surtout] à la vie sociale et culturelle du Québec [nous ajouterions à la vie citoyenne]. »
Durant les dix dernières années, le Québec a reçu en moyenne 35 000 immigrants par année[84], toutes catégories confondues. La variation annuelle est considérable, entre 26 509 en 1998-1999 et 44 246 en 2004-2005. Une certaine proportion d’entre eux sont de langue française ou ont une connaissance de base du français, insuffisante cependant pour qu’ils puissent intégrer le marché du travail. La proportion de ces immigrants « francophones » n’a cessé d’augmenter année après année, malgré le fait que le critère de la connaissance du français soit plus difficilement applicable dans le cas des réfugiés ou des regroupements familiaux. En 1996-1997, la proportion des francophones était de 39 %, en 2005-2006, elle est de 57,3 %. L’action du ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles pour recruter des immigrants francophones va donc dans la bonne voie et elle est efficace. La moyenne des francophones est de 16 500 par année contre 18 300 non-francophones. Ces chiffres donnent une idée du nombre annuel d’immigrants que le Ministère doit accueillir et tenter de franciser s’ils ne connaissent pas le français à leur arrivée. D’autant que, chaque année, de nouveaux immigrants arrivent qui viennent grossir le nombre d’immigrants en voie de francisation et d’intégration, au risque de noyer sous le nombre les objectifs de la politique d’intégration linguistique.
La stratégie de francisation n’est pas la même selon qu’il s’agit des adultes ou des enfants.
La Charte de la langue française confie au ministère de l’Éducation la responsabilité de la francisation des enfants de parents immigrants.
On se souviendra que, règle générale, tous les enfants du Québec doivent fréquenter l’école française, sauf les enfants dont le père ou la mère est citoyen canadien et a reçu un enseignement primaire en anglais au Canada[85]. Tous les enfants de parents immigrants sont donc orientés vers l’école française.
Les enfants qui ne savent pas le français au moment de leur arrivée à l’école sont regroupés dans des classes d’accueil dont le principal objectif est de leur faire apprendre le français pour qu’ils puissent par la suite s’intégrer aux classes régulières.
La francisation des enfants a des répercussions sur les parents. Souvent, les enfants sont les seuls à savoir suffisamment le français pour servir ni plus ni moins que d’interprètes entre leurs parents, les services publics, parfois les clients du commerce familial. Les enfants en tirent une grande fierté. Ils apportent à la maison la connaissance du français et y initient leurs parents, leur montrant que ce n’est pas si compliqué à apprendre.
Par contre, l’action du ministère de l’Éducation a ses propres limites et déficiences.
D’une part, les mariages entre francophones et anglophones vont accroître l’admissibilité législative des enfants à l’école de langue anglaise, puisque l’un des parents remplit alors les conditions de la loi 101. En 2004, 457 Québécois francophones ont épousé une anglophone, 660 Québécois anglophones une francophone, soit 1 117 mariages exogames. En 2005, 475 Québécois francophones ont épousé une anglophone et 709 Québécois anglophones une francophone, soit 1 184 mariages. En seulement deux ans, les enfants à naître de 2 301 familles devenaient ainsi admissibles à l’école de langue anglaise par l’un des parents[86].
D’autre part, les ententes que le ministère de l’Éducation a conclues avec des communautés culturelles qui gèrent leurs propres écoles, par exemple les écoles de la communauté grecque ou de la communauté juive hassidique, n’ont pas eu le succès escompté. Elles n’ont pas favorisé une meilleure connaissance de la langue française chez leurs élèves, ni modifié leur attitude à l’endroit de la communauté française, ni ne les ont incités à poursuivre leurs études en langue française dans le cas des écoliers grecs. Cette stratégie des ententes particulières est à revoir, certainement faut-il au minimum les encadrer mieux et mieux en suivre l’application.
De plus, une étude récente de Statistique Canada[87] a révélé que seulement 25 % des enfants nés au Québec de parents immigrés allophones ont adopté le français comme langue d’usage public bien qu’ils aient fait leurs études primaires et secondaires en langue française et bien que leurs parents aient adopté le français plutôt que l’anglais dans une proportion de 56 %. Leurs enfants boudent la langue française. Ces chiffres recoupent une étude de Charles Castonguay, mathématicien de l’Université d’Ottawa bien connu pour ses analyses statistiques de l’attraction du français sur les non-francophones, publiée par l’Office québécois de la langue française en 2005[88]. Peut-être le ministère de l’Immigration devrait-il ajouter les écoliers aux cibles de ses campagnes de promotion de la langue française.
Le ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles a l’entière responsabilité de la gestion de la francisation des immigrants adultes.
Le dispositif de francisation offre aux immigrants adultes le choix entre suivre des cours à temps plein ou à temps partiel. Les immigrants adultes ont une préférence marquée pour la formation à temps partiel qui leur permet de travailler en même temps qu’ils suivent des cours de français. De 1997-1998 à 2005-2006, une moyenne de 8 440 immigrants adultes ont suivi des cours à temps plein contre 12 905 à temps partiel. Les immigrants ne sont pas tenus de suivre des cours de français l’année de leur arrivée au Québec[89]. Ils choisissent souvent de s’insérer dans le marché de travail dès leur arrivée. Le Ministère n’est pas en mesure de connaître ce que décident des immigrants adultes l’année de leur arrivée. Le Ministère a cependant constaté que la demande pour les cours de français avait tendance à augmenter lorsque le marché du travail était moins favorable, et, inversement, qu’une baisse du taux de chômage provoquait une diminution de la demande des cours de français. La très grande majorité des immigrants adultes s’inscrivent à des cours de français moins d’un an après leur arrivée (entre 85 % et 90 %) ou depuis moins de trois ans (85 %).
Les immigrants ont également le choix entre différents lieux d’apprentissage. Car, depuis septembre 2004, le Ministère confie à des partenaires institutionnels le soin d’enseigner le français aux immigrants. L’objectif est de les insérer dans les mêmes milieux de formation que tous les autres adultes québécois qui suivent des cours.
Les cours se donnent maintenant dans les cégeps (en 2005-2006, choix de 69 % des immigrants qui suivent les cours à temps plein et de 8,6 %, à temps partiel), dans les universités (à temps plein, 16,5 %, à temps partiel, 0,5 %), dans des commissions scolaires (4,2 % à temps plein et 1,9 %, à temps partiel), dans des organismes communautaires (10,3 % à temps plein et 83 % à temps partiel). Des cours à temps partiel sont parfois organisés par des entreprises privées, des associations professionnelles ou syndicales (6 %).
Le Ministère a toujours eu soin d’intégrer à l’enseignement de la langue l’initiation à la réalité du Québec : la dispersion de la population sur un territoire très contrasté en même temps qu’homogène, les grandes étapes de son histoire, la vitalité de sa culture, les valeurs morales qui la caractérisent dont la Charte québécoise des droits de la personne proclame l’essentiel, une organisation de la vie collective inspirée de la démocratie britannique. C’est à cette société que les immigrants sont invités à s’intégrer, dans le respect du contrat moral décrit au point précédent. Au fil des années, le ministère de l’Immigration a développé un matériel pédagogique et des documents d’information qui permettent d’atteindre ce double objectif, langue française et civilisation québécoise.
Les partenaires en francisation du Ministère sont tenus de poursuivre les mêmes objectifs et dans le même esprit. Ils peuvent enrichir les contenus de l’enseignement, mais ils doivent répondre aux attentes du Ministère conformément aux contrats de service qu’ils signent avec lui.
Le ministère de l’Immigration a consacré 44,3 millions de dollars uniquement à la francisation des immigrants, soit 38 % de son budget. Ce budget couvre les salaires des enseignants, le soutien financier des immigrants inscrits aux cours, le matériel pédagogique, la contribution aux contrats d’enseignement conclus avec d’autres institutions, notamment les organismes communautaires, enfin l’encadrement administratif du service et des contrats avec les partenaires. Au budget du Ministère, il faut ajouter les frais qu’assument, pour la francisation des adultes, les universités, les cégeps et le ministère de l’Éducation par le réseau des commissions scolaires.
La francisation des immigrants est essentielle à leur intégration linguistique à la société québécoise, intégration de fonctionnement et de participation assurément. La familiarité ainsi acquise avec la société québécoise de langue française peut les inciter à la faire leur au point d’en partager les aspirations et le destin. Pour notre part, nous ne croyons pas qu’il faille pour cela que les immigrants abandonnent l’usage de leurs langues d’origine et que leurs enfants cessent de les connaître. Ce serait priver le Québec d’un potentiel linguistique de plus en plus indispensable dans notre ère de mondialisation des échanges économiques et documentaires. Pour notre part, ce qui nous préoccupe le plus, c’est de constater que si les allophones utilisent de plus en plus le français pour les besoins de la vie au Québec et pour communiquer avec les francophones, ils communiquent souvent entre eux en langue anglaise. Si cette observation s’avérait juste et si elle se généralisait, cela signifierait qu’il y a deux langues communes au Québec, le français comme langue de la vie publique et langue de communication avec les francophones, l’anglais pour communiquer entre allophones de langues différentes et avec les anglophones. Le statut de la langue anglaise s’en trouverait conforté et le statut du français d’autant affaibli.
6. L’autre modèle d’intégration : le multiculturalisme
Le projet du Québec en immigration est très explicite : il demande aux immigrants qui choisissent de s’y installer qu’ils « s’enracinent en terre québécoise en apprenant à connaître et à comprendre leur nouvelle société, son histoire et sa culture » (p. 19 de l’Énoncé). Cette culture se veut fidèle à ses origines françaises et européennes. Mais, c’est aussi une culture dynamique et en mutation continuelle comme toutes les cultures vivantes soucieuses d’un avenir dans le prolongement des acquis du passé. Une culture qui se sait assez vigoureuse pour absorber sans se dénaturer les contributions des immigrants. C’est cette culture que le Québec propose aux immigrants de partager et d’enrichir, au lieu de s’y opposer en s’enfermant dans leurs cultures d’origine. C’est une entreprise ambitieuse, mais essentielle.
Cependant, la réalisation du projet québécois d’immigration est rendue d’autant plus difficile que le gouvernement du Canada propose aux immigrants un tout autre modèle de société où deux langues sont officielles, le français et l’anglais, au choix des citoyens, et toutes les cultures sur le même pied d’égalité selon le principe du multiculturalisme. Des immigrants récemment installés au Québec, mais qui ont reçu solennellement leur nouvelle citoyenneté du Canada, s’inspirent souvent de ce modèle pour contester celui du Québec ou tout au moins ne pas trop s’en préoccuper.
L’idéologie du multiculturalisme du Canada est née en même temps qu’était adoptée la Loi sur les langues officielles du Canada en 1969. Le gouvernement Trudeau de l’époque voulait à tout prix éviter que la décision de faire du français une langue officielle soit interprétée par les Canadiens de toute langue et de toute culture comme la reconnaissance d’un statut privilégié à la communauté de langue française. Au contraire, a proclamé le gouvernement canadien, le Canada est une mosaïque de cultures et de langues, sur un même pied d’égalité. La communauté canadienne de langue française est l’une d’entre elles, une minorité linguistique parmi tant d’autres, plus ancienne peut-être, mais sans que cette ancienneté lui confère un privilège historique.
Depuis lors, le multiculturalisme est utilisé par le reste du Canada, y compris par le gouvernement canadien, pour contrer la prétention du Québec d’être une province distincte, encore moins une nation, de langue et de culture françaises. L’obstination de la société québécoise à demeurer elle-même, à ne pas se fondre dans le grand tout canadien, à vouloir intégrer les immigrants pour mieux se perpétuer, agace profondément le reste du Canada. Depuis la campagne à la direction du parti libéral en 2006, le discours politique tend à se modifier radicalement. Non seulement la société québécoise serait une société distincte, mais le Québec serait une nation. Le virage est trop radical et trop subit pour qu’on puisse en évaluer le sérieux, encore moins les conséquences, d’autant plus que l’opinion canadienne devra ou le faire sien ou le répudier lors des prochaines élections fédérales. La question est à suivre.
Il y a quelque chose de mensonger et de nocif dans l’idéologie du multiculturalisme.
De mensonger, parce que, tout en proclamant l’égalité des cultures, la société canadienne anglo-saxonne impose en réalité la sienne comme culture commune à tous les immigrants, qui se joignent sans rechigner à cette société américanisée de langue anglaise que leur imposent tous les gestes de la vie quotidienne, publique et économique. C’est exactement ce que se propose de faire le Québec, mais ouvertement et nettement plus difficilement puisqu’il lui faut contrebalancer la pression de l’environnement nord-américain où sa langue et sa culture sont dramatiquement minoritaires.
De nocif, parce que les langues et les cultures des communautés culturelles sont alors relayées à la vie privée et à la vie communautaire, où elles jouissent d’une sorte d’impunité qui les encourage à réclamer le respect de tous leurs particularismes. Les chartes de droits et libertés de la personne leur servent de point d’appui juridique, d’autant que les juges de la Cour suprême les interprètent avec grand libéralisme. La conséquence du multiculturalisme est le repli communautaire militant, l’illusion qu’en venant au Canada, les immigrants ont le droit de continuer à vivre exactement comme s’ils n’avaient pas changé de pays. Toutes les dérives sont possibles, des plus folkloriques aux moins compatibles avec les valeurs de la société canadienne et québécoise, comme le droit d’être polygame, d’avoir recours à des tribunaux religieux pour vivre selon la loi islamique, de traiter les femmes selon leurs coutumes et non selon le principe de l’égalité des hommes et des femmes, d’avoir droit à des locaux de prière dans les immeubles publics. Le communautarisme augmente l’insécurité des membres des communautés culturelles, retarde leur intégration dans la société globale, magnifie les signes de différence en lieu et place des signes d’appartenance à la société d’accueil, provoque chez des Canadiens des réactions de rejet à l’égard de tous les membres de la même communauté, indistinctement et sans tenir compte des convictions personnelles de leurs membres.
Le projet québécois d’intégration, bien qu’il soit très nuancé et très ouvert à la différence, est lui-même contaminé par l’idéologie du multiculturalisme. Les Québécois francophones ont peur d’être accusés d’ethnocentrisme en maintenant l’idée d’une culture commune à laquelle tous les citoyens québécois sont conviés d’adhérer. La conséquence directe de cette idéologie est la rectitude linguistique. Tout le monde surveille ce qu’il dit de crainte d’être accusé d’une déviation quelconque, surtout de racisme et de xénophobie. La langue de bois est de plus en plus devenue la langue usuelle de la vie publique.
L’idée d’une culture commune en partage est pourtant l’essentiel d’un projet d’immigration, autant pour les personnes immigrantes que pour la société qui accepte de les recevoir. Les personnes immigrantes ne changent pas de pays dans l’intention d’y vivre comme si elles n’avaient jamais quitté leurs pays d’origine. L’intention contraire conduit tout droit au communautarisme, au repliement sur la culture d’origine, au ghetto ethnique. La société d’accueil ne reçoit pas les immigrants sans se douter que leur intégration la modifiera. Si elle le refuse, cela conduit à la ségrégation, à l’exclusion des personnes immigrantes de la vie citoyenne, au racisme.
Le projet de contrat moral proposé par la société québécoise aux immigrants est la seule réponse possible au dilemme précédent. Il accorde des droits et impose des devoirs aussi bien aux Québécois déjà là qu’aux Québécois nouvellement arrivés.
Au contraire, la notion d’accommodement raisonnable est souvent invoquée par des immigrants comme argument pour réclamer le respect d’un droit et pour imposer à la société d’accueil le devoir à leur donner satisfaction. Dans cette logique, les immigrants n’ont plus de devoirs, seulement des droits, ce qui constitue une dangereuse déviation du projet d’immigration.
On comprend dès lors pourquoi la politique d’accommodement a connu tant de dérives. À force d’y avoir recours à tort et à travers, elle risque fort d’être répudiée. De toute urgence, il faut lui donner des balises.
Il n’y a qu’un seul moyen d’échapper à la fois au communautarisme, aux dérapages de l’accommodement raisonnable, au malaise des uns et des autres et à l’intransigeance des intégristes de tout bord, c’est de faire connaître, de mettre de l’avant et d’appliquer le contrat moral entre immigrants et membres de la société d’accueil.
Le ministère de l’Immigration et des Relations avec les citoyens doit, de toute urgence, vulgariser la notion de contrat moral auprès de tous les Québécois, anciens et nouveaux, et en faire l’axe central de la politique québécoise d’accueil et d’intégration des immigrants.
Deuxième partie – L’actualité de la politique linguistique
La Charte de la langue française de 1977 répondait aux aspirations des Québécois francophones de l’époque, bien au fait de la situation de la langue française face à la langue anglaise et bien déterminés à la modifier en faveur de leur langue et en faveur de tous ceux et celles qui la parlaient. Tous et toutes approuvaient largement la stratégie de changement inscrite dans le texte de la loi.
Depuis lors, de nombreux événements se sont produits, qui ont transformé en profondeur la société québécoise en même temps que la situation sociolinguistique antérieure.
Une cascade de contestations juridiques s’est abattue sur la Charte de la langue française dès les premiers jours de son adoption. Chaque cause s’est déplacée d’instance en instance jusqu’en Cour suprême. Ces procédures juridiques, complexes, ont souvent eu comme conséquence d’imposer au législateur québécois de devoir modifier le texte de la loi.
Le débat sur la qualité de la langue s’est intensifié. La querelle du joual s’est nuancée, en s’éloignant du manichéisme des positions initiales, entre le bien dont l’idéal était le français de Paris, et le mal, symbolisé par la langue populaire urbaine du Québec, surtout de Montréal. Il reste tout de même des séquelles de ce dualisme primaire qui refait surface périodiquement. La question n’est plus aujourd’hui l’existence du joual, mais bien celle de l’existence et de la description de la norme du français standard propre au Québec et son corollaire, la légitimité de la variation de la langue française d’un pays à l’autre de la francophonie.
Enfin, les opinions et les attitudes des Québécois, qu’ils soient ou non de souche, à l’endroit de la question de la langue française sont aujourd’hui nettement moins unanimes qu’au moment de la loi 101. Le beau consensus de l’époque est disparu. Au sentiment du destin collectif de la société québécoise s’est substitué, chez les citoyens, le souci de l’avenir personnel dans un contexte économique nettement plus compétitif. La Charte de la langue française a créé chez les Québécois francophones le sentiment que la langue française était dorénavant en sécurité, qu’elle ne courait plus aucun risque, que sa perpétuité était garantie. Ce sentiment pourrait rapidement devenir illusoire si on ne s’inspire plus des principes de la Charte de la langue française pour construire l’avenir du Québec, surtout en ce moment de grande ouverture vers l’international où domine largement la langue anglaise.
Tels sont les thèmes que nous nous proposons d’explorer dans les chapitres de cette deuxième partie.
Mais au préalable, il est indispensable de revenir aux principes et objectifs qui ont inspiré la conception de la politique linguistique du Québec, sous ses deux aspects fondamentaux, le statut et la qualité de la langue et la politique d’immigration, dont nous avons déjà traité. C’est essentiel : on ne peut s’en tenir, comme on a trop tendance à le faire de nos jours, au seul texte de la loi linguistique, à la seule Charte de la langue française, souvent même à un seul article ou à un seul alinéa d’un article en particulier. La Charte n’épuise pas le sujet de la politique linguistique. Sa fonction est double : définir en détail les effets de la déclaration du français comme langue officielle du Québec et guider le comportement linguistique de tous les citoyens québécois en matière de langue. C’est important, évidemment. Le plus important, cependant, est d’avoir conscience du type de société que la politique linguistique avait pour objet de définir et, plus crucial encore, de juger si, comme citoyens, nous sommes collectivement toujours en accord avec cette conception de la société québécoise.
Chapitre I – Les principes et objectifs de la politique linguistique au Québec
En mars 1977, le ministre Camille Laurin publiait un livre blanc sur La politique québécoise de la langue française au nom du gouvernement du Québec[90]. Il en soumettait le contenu à l’appréciation et à la discussion des membres de l’Assemblée nationale et du peuple du Québec. Nous l’avons déjà longuement résumé dans la cinquième section du chapitre II de la première partie. Nous expliciterons ici les principes qui ont guidé la conception de la loi linguistique que le gouvernement du Parti québécois se proposait alors de faire adopter. C’était la première fois qu’un gouvernement procédait de la sorte. En 1974, le gouvernement libéral n’avait pas jugé nécessaire de le faire et était passé directement à la rédaction et à la présentation du projet de loi 22 sans consulter les citoyens et sans révéler les motifs qui en avaient guidé la conception.
Les principes du livre blanc de 1977 s’inspirent d’une conception de la société québécoise que propose le gouvernement du Parti québécois aux citoyens du Québec, une société à majorité de langue française, qui reconnaît l’apport de la minorité historique de langue anglaise, qui se veut respectueuse des Premières Nations amérindiennes et inuites, de même que des communautés culturelles d’immigration plus ou moins récente.
Ces principes se présentent donc à la fois comme les moyens d’intégrer dans un même projet de société la diversité des composantes culturelles et linguistiques de la société québécoise autour d’une même langue commune, le français. Du même souffle, le gouvernement énonce les objectifs sociolinguistiques de la politique linguistique. On ne peut, encore aujourd’hui, dissocier les objectifs de la politique linguistique du projet de société qui les a inspirés et qui les inspire toujours.
En août 1977, l’auteur, alors conseiller technique auprès du ministre Laurin lors de la préparation et de la rédaction de la Charte de la langue française, explicite pour sa part les Principes sociolinguistiques et linguistiques de la Charte de la langue française dans une communication présentée lors de la septième Biennale de la langue française à Moncton[91].
La consultation de ces deux documents permet de redécouvrir les principes qui ont alors inspiré la conception de la politique linguistique et la rédaction du texte de la loi 101. À cette époque, le terme politique linguistique englobait à la fois la politique linguistique proprement dite et sa formulation législative.
En 1996, Louise Beaudoin, alors ministre responsable de la Charte de la langue française, juge nécessaire d’en rappeler les principes initiaux au moment où elle se propose de relancer la politique linguistique en fonction du contexte social et linguistique de l’époque. Elle publie, à son tour, un nouvel énoncé de politique sous le titre Le français, langue commune, Promouvoir l’usage et la qualité du français, langue officielle et langue commune du Québec, Proposition de politique linguistique.
Les notes qui suivent résument le contenu de chacun de ces documents, le plus souvent en reprenant le texte original.
1. Les principes du livre blanc du ministre Camille Laurin (1977)
Le premier chapitre du livre blanc résume à grands traits la situation de la langue française révélée à la fois par la commission Laurendeau-Dunton et la commission Gendron. Le deuxième présente quatre principes qui guideront la conception de la politique linguistique proposée au peuple québécois.
Premier principe : au Québec, la langue française n’est pas un simple mode d’expression mais un milieu de vie.
Être attentif à l’état de la langue, veiller à sa santé et à sa rigueur, travailler à son développement, c’est s’attacher à l’une des composantes principales de ce qu’il est convenu maintenant d’appeler « la qualité de la vie ».
Autant la pluralité des langues est utile et féconde sur un même territoire, autant il est nécessaire qu’au préalable, un réseau de signes communs, une même langue, rassemble les hommes. Sans quoi ne sauraient subsister la cohésion et le consensus indispensables au développement d’un peuple.
En affirmant que, dans la société québécoise, tous doivent connaître la langue française, le gouvernement veut simplement s’assurer que le Québec soit une société normale, une communauté foncière de langue semblable à toutes celles qui existent dans toutes les autres sociétés, y compris dans le reste du Canada où l’anglais est la langue commune des échanges et des communications entre les citoyens de langues différentes.
Pour ces motifs, le français doit devenir la langue commune de tous les Québécois.
Deuxième principe : on doit respecter les minorités, leurs langues, leurs cultures.
En effet, l’exercice par le Québec de son droit d’être français n’interdit nullement aux groupes et aux individus de connaître et de parler une ou plusieurs autres langues.
Les « groupes minoritaires » pourront évidemment conserver leurs langues respectives et les transmettre à leurs enfants.
Le gouvernement reconnaît que, dans le Québec, il existe une population et une culture anglaises. Même si elles se sont trop longtemps isolées dans un réseau d’institutions parallèles à celles des francophones, cette population et cette culture constituent une composante irréductible de notre société.
Implantées ici en des temps plus récents, d’autres minorités existent au Québec. L’assimilation à toute vapeur de tous les nouveaux immigrants, au point qu’en une ou deux générations ils ont perdu toute attache avec leurs pays d’origine, n’est pas un objectif souhaitable. Une société qui permet à ses groupes minoritaires de conserver leur langue et leur culture est une société plus riche et probablement plus équilibrée. Cela pourrait être le cas du Québec.
Si ce principe s’applique pour les Québécois d’origine étrangère, il est encore plus valable pour les Inuits et les Amérindiens québécois. Mais il y aurait certainement lieu d’accroître l’aide du gouvernement québécois pour la sauvegarde et la promotion des langues et cultures des premiers habitants de notre territoire.
Troisième principe : il est important d’apprendre d’autres langues que le français.
Le Québec est isolé dans un environnement politique et culturel entièrement de langue anglaise. Cette omniprésence de cette langue a façonné l’inconscient linguistique des Québécois francophones depuis presque 250 ans. Ils ne sont jamais neutres à son égard, comme dans les autres pays où elle est une langue étrangère parmi d’autres qui ne compromet en rien la langue nationale.
Dans notre monde qui rapetisse de jour en jour, le multilinguisme individuel, de tout temps un avantage, devient de plus en plus une nécessité. L’amélioration de l’enseignement d’une autre langue que le français est une nécessité pour le Québec et ne doit pas être considérée comme une entrave à la francisation.
C’est d’ailleurs dans la mesure où la survie de la langue française sera assurée ici que les programmes d’enseignement d’une deuxième langue pourront être envisagés dans leur juste perspective et devenir réellement efficaces, quand la langue anglaise aura cessé d’être, aux yeux d’un grand nombre, le symbole lancinant d’une domination culturelle et économique perpétuelle.
Quatrième principe : le statut de la langue française au Québec est une question de justice sociale.
Les inégalités économiques sont une source d’injustice; les inégalités culturelles ne le sont pas moins.
Depuis longtemps, les travailleurs francophones du Québec sont défavorisés dans de trop nombreuses entreprises parce que la langue de travail y est, dans des proportions variées, la langue anglaise. Cette situation tend à maintenir la masse des travailleurs de langue française dans une position inférieure : elle va par ailleurs dans le sens de la promotion d’un autre groupe qui possède déjà de meilleurs postes, des émoluments plus alléchants, un certain degré de pouvoir et de prestige.
On n’a guère le choix : ce qui est demandé à la majorité francophone du Québec, c’est de ressaisir le pouvoir qui lui revient, non pour dominer, mais pour s’imposer au rang et dans tout l’espace qui convient à son importance. Garantir l’usage de sa propre langue, cela fait partie de la tâche d’établir historiquement un peuple de manière qu’il ne soit plus vulnérable à la dissolution, à une pauvreté qui serait une injustice commise par sa propre main.
2. Les principes sociolinguistiques et linguistiques de la Charte (1977)
En août 1977, l’auteur explicite pour sa part les Principes sociolinguistiques et linguistiques de la Charte de la langue française comme thème de la communication qu’il présente à la septième Biennale de la langue française à Moncton. De l’avis même du ministre Laurin, ces principes avaient largement contribué à faire du texte de la loi 101 un « virage historique et un facteur de cohésion sociale[92] ». On peut donc, à bon droit, les rappeler.
Quatre principes sociolinguistiques ont inspiré le livre blanc de 1977.
Premier principe : la société québécoise ne doit pas être une société bilingue.
Le Québec a rejeté le bilinguisme comme institution en déclarant le français, seule langue officielle. Dans les entreprises, un certain emploi d’une autre langue était admis selon le principe du bilinguisme fonctionnel, c’est-à-dire à condition que des motifs sérieux motivent l’emploi d’une autre langue et que la langue française soit d’usage universel, celui d’une autre langue, restreint et motivé.
Le bilinguisme individuel est assuré par l’enseignement des langues secondes à l’école.
Deuxième principe : ce sont les institutions qui déterminent une situation linguistique donnée et qui peuvent en conséquence la modifier, et non les individus.
La Charte de la langue française est, en conséquence, constituée surtout de dispositions qui ont pour objet de déterminer le comportement linguistique des institutions, c’est-à-dire la langue de la législation et de la justice, la langue de l’Administration, la langue des organismes parapublics, notamment les ordres professionnels, la langue de travail, la langue du commerce et des affaires, la langue de l’enseignement.
Troisième principe : chaque institution est responsable de sa propre situation linguistique et de la qualité de la langue de ses communications, internes et externes.
Ce principe a guidé la conception administrative de la loi, c’est-à-dire le choix de la stratégie et des moyens à mettre en œuvre pour en assurer l’application.
Les dispositions de la loi se répartissent en deux groupes. Le premier groupe est constitué de dispositions dont l’application est immédiate et découle de mesures que doivent prendre des personnes ou des institutions. Exemple : la publicité, les raisons sociales. Le deuxième groupe est formé des dispositions dont l’application exige d’une part l’examen de la situation présente, d’autre part la nécessité d’étaler dans le temps la réalisation de certaines d’entre elles. Exemple : la transformation linguistique des entreprises.
Quatrième principe : une réalité aussi abstraite que la langue se révèle aux yeux des usagers à travers certaines de ses manifestations, qui jouent alors le rôle d’images collectives.
Le commun des mortels utilise la langue sans savoir ce qu’elle est et sans trop s’en préoccuper.
Lorsqu’on veut modifier une situation linguistique, par voie législative ou non, on amorce des changements dont la majorité d’entre eux, d’une part, se dérouleront lentement, d’autre part, ne se produiront pas d’une manière apparente, justement parce qu’ils se feront au jour le jour et qu’on oubliera la situation de départ au fur et à mesure qu’elle se modifie.
Enfin, les images collectives doivent coïncider avec les images intérieures, avec ce que l’on pense que l’on est. Si l’on se sait de langue française et que ce que l’on voit autour de soi est dans une autre langue, on en vient à douter de sa propre réalité ou à se considérer comme un étranger chez soi.
D’où des dispositions de la loi dont l’effet est facilement perceptible : les raisons sociales, l’affichage, la publicité et la terminologie.
Les principes linguistiques sont également au nombre de quatre.
Premier principe : les langues techniques et scientifiques ont une nette tendance à la normalisation, la langue commune beaucoup moins.
L’idéal du technicien et du scientifique est que, dans sa propre langue, un seul mot désigne une réalité et qu’une réalité soit toujours exprimée par le même mot.
La langue commune ne poursuit pas les mêmes objectifs. On y observe une prolifération de synonymes, dans des rapports de concurrence et de complémentarité dont on ne sait pratiquement rien.
Deuxième principe : La qualité de la normalisation terminologique repose entièrement sur la rigueur de la méthode de travail en terminologie.
Les travaux de terminologie doivent être menés par des personnes spécialement formées à cet effet, avec la collaboration constante des spécialistes du domaine visé, techniciens, ingénieurs, professeurs, etc. La méthode de travail doit être rigoureuse et reposer sur des sources d’une grande qualité ou dont on est capable d’évaluer la fiabilité. Toute erreur commise au cours du travail compromet la qualité de la normalisation et donc, la qualité de la langue de spécialité.
Troisième principe : l’usage officiel de la langue exerce une influence normative sur les comportements linguistiques des usagers.
Chaque usager subit inconsciemment l’influence de la langue officielle, en lisant les journaux, en écoutant la radio, en regardant la télévision, en prenant connaissance de tous les textes que lui fait parvenir l’Administration, en étudiant ou en consultant les documents techniques dont il a besoin pour son travail, en absorbant les messages publicitaires.
Tout particulièrement, le ministère de l’Éducation porte l’entière responsabilité de l’enseignement de la langue maternelle, de l’enseignement en français des sciences et des techniques, y compris de la terminologie de ces disciplines.
Quatrième principe : pour désigner une réalité nouvelle, l’emprunt demeure le moyen le moins opportun.
Une réalité dont on ignore le nom ou dont on ne connaît que le mot étranger peut s’exprimer de trois façons : par le mot français qui la nomme, qu’il faut chercher sérieusement et trouver; par un néologisme, lorsque la preuve est faite que nous sommes en présence d’un vide dans le vocabulaire; ou par un emprunt, lorsqu’on ne peut vraiment pas faire autrement.
3. Les principes de l’énoncé de politique de la ministre Louise Beaudoin (1996)
À la suite d’un bilan de la situation de la langue française après vingt ans d’application de la Charte de la langue française[93], Louise Beaudoin, alors ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de l’application de la Charte, publie et soumet au peuple québécois une nouvelle proposition de politique linguistique sous le titre Le français, langue commune, Promouvoir l’usage et la qualité du français, langue officielle et langue commune du Québec.
Cette proposition réactualise l’énoncé des principes de la politique linguistique.
Premier principe : la langue française est au cœur de l’identité québécoise.
En utilisant cette langue plutôt qu’une autre, les Québécoises et les Québécois ressentent et manifestent leur profond sentiment d’appartenance à leur milieu familial et communautaire d’abord, à la société globale ensuite.
Dans un sens beaucoup plus dynamique, qui convient à la société québécoise depuis la Révolution tranquille, l’idée d’identité renvoie à une culture en mutation et en action, à l’idée d’un présent lié au passé, certes, mais ouvert sur l’avenir qui se façonne lentement au gré de l’évolution du monde.
Ce principe fonde alors l’intention légitime d’évoluer en continuité avec les lignes de forces de la culture québécoise, tout en y intégrant, à sa façon, les apports des autres cultures dans un esprit d’ouverture et de fraternité.
Deuxième principe : la langue française est le fondement de la cohésion de la société québécoise.
Toute langue joue un important rôle de cohésion sociale.
La langue maternelle manifeste l’appartenance à une communauté et à une culture originales, différentes des autres, tout aussi riches et dignes de respect.
On comprend alors que les Québécoises et les Québécois, tout au long de leur histoire et malgré les circonstances souvent défavorables, soient demeurés fidèles à leur langue maternelle et aient persisté à vouloir non seulement en maintenir l’usage mais aussi l’affirmer comme langue caractéristique de leur coin d’Amérique.
Les Québécoises et les Québécois, à travers leur propre expérience, comprennent d’instinct et respectent profondément l’intention des membres des autres groupes linguistiques de vouloir maintenir la connaissance de leur langue maternelle et en assurer la transmission à leurs enfants.
Puisque plusieurs ensembles linguistiques coexistent sur le même territoire, la langue commune à tous, au Québec le français, sert à la cohésion sociale de tous les citoyens, par-delà les différences de langues maternelles.
Enfin, l’usage généralisé de la langue française symbolise le fait que tous les citoyens du Québec partagent le même destin, sans distinction de lieu, ni distinction de langues maternelles d’origine, dans le respect des droits de la communauté anglophone et des nations autochtones.
Troisième principe : les apports de toutes les minorités à la société québécoise sont une richesse et un avantage.
Dès la conception et l’élaboration de la Politique québécoise de la langue française, le gouvernement du Québec a manifesté son intention de modifier en profondeur la dynamique des relations entre les différentes composantes de la société québécoise.
Il faut dépasser l’isolement, substituer à l’existence parallèle de divers groupes linguistiques un sentiment de solidarité dans un même destin collectif. Cette solidarité doit s’organiser autour des axes suivants : a) l’acceptation et la reconnaissance du français comme langue commune; b) la responsabilité des personnes morales et des citoyens à l’égard de la langue commune et à l’égard de l’application de la Charte de la langue française; c) le respect mutuel de la culture de chacun; d) l’union des réseaux de contacts et des compétences linguistiques pour stimuler l’activité culturelle et économique de l’ensemble du Québec.
Quatrième principe : la connaissance d’autres langues est un enrichissement personnel et social.
L’affirmation du français comme langue officielle et langue commune du Québec n’entre pas en contradiction avec l’intérêt et la nécessité d’apprendre d’autres langues.
L’enseignement de l’anglais, langue seconde, doit se faire sur la base d’une bonne connaissance du français, écrit et parlé. L’enseignement du français, langue seconde, parlé et écrit, vise à faciliter la participation des citoyens à la société québécoise.
D’autre part, l’énoncé de 1996 explicite le fait que la politique linguistique ne peut se limiter à la seule approche législative, mais qu’elle comporte également une approche sociale et qu’elle devra, de plus en plus, s’appuyer sur une approche de concertation internationale si on veut contenir l’hégémonie universelle de l’anglo-américain.
L’approche législative
La Charte de la langue française est l’assise principale de la politique linguistique et elle est d’une importance déterminante.
Cependant, elle ne peut tout régler à elle seule. Toutes les autres politiques adoptées par le gouvernement doivent l’appuyer et la confirmer : l’enseignement du français, langue maternelle, langue seconde et langue de l’alphabétisation; l’immigration et l’intégration des immigrants à une société de langue française, le comportement linguistique de l’ensemble de l’Administration.
La Charte peut difficilement assurer la qualité de la langue française au Québec, qui échappe à tout contrôle juridique.
L’approche sociale
Cette approche prend la relève et complète l’approche législative sans évidemment en réduire l’importance.
Elle vise à créer un environnement en langue française qui soit dynamique, accueillant et attrayant, qui puisse influencer les choix et les comportements linguistiques de tous les citoyens du Québec.
Elle vise également à projeter l’image d’une société dont la performance culturelle, scientifique et économique s’exprime en français et se situe à un haut niveau d’excellence, une société qui offre aux immigrants les meilleures chances de s’épanouir, de se réaliser, une société qui leur assurera la prospérité, à eux et à leurs enfants.
L’approche de concertation internationale
La concertation internationale est l’outil le plus efficace pour contrer la tendance de l’anglais à s’imposer comme la seule langue du commerce mondial et des nouvelles technologies de l’information.
Elle vise à promouvoir le plurilinguisme en lieu et place de l’unilinguisme anglais dans toutes les instances où s’élaborent les règles du marché mondial, où se rédigent les normes techniques et où se conçoivent les technologies de l’information, dont Internet est le prototype.
4. Une remarquable continuité
Comme on le voit, à l’orée du XXIe siècle, le gouvernement du Québec est demeuré fidèle aux objectifs de la politique linguistique de 1977, du moins si on en juge par le discours officiel puisque la volonté gouvernementale de les mettre en application a énormément fluctué au cours des années selon les partis au pouvoir et selon les préoccupations à la mode de chaque époque. Chose certaine, aucun gouvernement n’a, ouvertement, abandonné l’un de ces objectifs.
Il n’est pas certain, cependant, que les Québécois francophones soient restés aussi convaincus de la pertinence de chacun de ces principes. Les opinions sur ces sujets sont nettement plus fragmentées aujourd’hui. Surtout, on constate de plus en plus fréquemment une contradiction marquée entre leurs comportements individuels au jour le jour et leur attachement collectif à la loi 101. L’individu contredit souvent le citoyen.
Il est donc devenu urgent aujourd’hui que les Québécois redécouvrent et se réapproprient les principes et les objectifs de la politique linguistique, qu’ils se rendent compte collectivement qu’ils sont aussi pertinents maintenant qu’ils l’étaient en 1977 et qu’ils ne se réduisent pas au seul texte de la Charte de la langue française.
On pourrait les résumer de la manière suivante.
La politique linguistique québécoise et la Charte de la langue française ont pour objectif fondamental de faire contrepoids aux forces dominantes du marché linguistique qui jouent toutes en faveur de la langue anglaise en Amérique du Nord : force démographique (poids relatif des langues en présence), force économique (statut de l’anglais comme langue internationale des échanges économiques), force scientifique et technologique (prédominance de l’anglais dans les activités scientifiques et dans les technologies de l’information), force politique enfin (puissance des États-Unis et initiative internationale du Québec restreinte par son statut constitutionnel).
D’où les points forts de la politique linguistique du Québec, toujours d’actualité :
- la langue d’enseignement, pour intégrer les enfants issus de l’immigration à la société québécoise, dont le français est le fondement de l’identité et la langue de la vie démocratique;
- la langue du travail et la francisation des entreprises, pour assurer à la langue française une motivation économique solide, gage de succès personnel de chaque citoyen et incitatif à connaître le français pour les anglophones et les allophones;
- la langue du commerce et des affaires, chapitre qui complète le précédent et qui garantit aux consommateurs une protection minimale de par l’emploi de la langue française dans tous les documents de nature commerciale ainsi que dans l’affichage commercial pour préserver l’image d’une société de langue française;
- la langue de l’Administration et des organismes parapublics, comme leviers économiques et exemples d’un fonctionnement normal et efficace en langue française.
Les forces dominantes sont et seront toujours en action. Le Québec doit et devra, en conséquence, les contrer constamment.
Les adversaires de la Charte prétendent que la langue française n’est plus menacée au Québec et qu’on pourrait alors en abandonner ou en atténuer certaines dispositions. Le sort de la langue française s’est en effet amélioré, mais justement parce que la Charte est efficace : elle n’atténue pas la vigueur et la constance des forces dominantes, elle les contient.
La politique québécoise ne vise pas à nier les droits de la communauté de langue anglaise. Elle a pour objet de créer les conditions d’usage et d’épanouissement de la langue française au Québec, face à la concurrence continentale et internationale de la langue anglaise. En cela, elle rejoint les préoccupations de tous les pays de langue française et, d’une certaine manière, celles des pays où une langue côtoie une autre langue fortement majoritaire et de grand rayonnement, par exemple en Catalogne où le catalan fait face à la langue espagnole ou encore les langues des pays Baltes face au russe.
La politique québécoise est respectueuse des autres langues en usage au Québec. Elle garantit à la minorité anglophone, à sa culture et à sa langue, des conditions de maintien et d’épanouissement nettement plus favorables que celles des minorités de langue française dans le reste du Canada. De plus, c’est au Québec que les langues autochtones et inuktitut se maintiennent le mieux dans l’ensemble du Canada parce que la politique québécoise est ouvertement favorable aux langues des Premières Nations depuis les accords de la Baie-James et du Nord québécois (1975). Le Québec favorise également la vitalité des cultures et des langues d’origine comme apport à la culture québécoise, dans le respect du français langue commune.
À cause justement de cette ouverture à l’égard des autres langues, l’ambiguïté du bilinguisme demeure constante au Québec. La distinction entre bilinguisme individuel et bilinguisme institutionnel de l’Administration et des entreprises s’est perdue. La même confusion entoure le fait que différentes communautés culturelles et linguistiques cohabitent dans la grande région de Montréal. On en vante alors le caractère multiculturel dont on tire argument pour faire la promotion de Montréal. Mais s’agit-il du multiculturalisme à la manière de la politique fédérale, inventée par Pierre Elliott Trudeau au moment où il était premier ministre du Canada en réaction au nationalisme québécois qu’il disait d’origine ethnique? Ou s’agit-il plutôt du résultat de l’un des principes de la politique linguistique du Québec, celui de considérer cette diversité comme un enrichissement pour la société québécoise, en harmonie cependant avec l’affirmation du français comme langue officielle et langue commune? On ne le sait trop.
Nous reviendrons constamment sur ces idées dans l’analyse de l’actualité de la politique linguistique, objet de cette deuxième partie du livre.
Chapitre II – L’évolution de la législation linguistique
En premier lieu, nous décrirons les modifications apportées au texte initial de la Charte de la langue française, surtout à la suite des arrêts de la Cour suprême, mais également de la prise en compte par le gouvernement de la généralisation des technologies de l’information et de la communication, en prenant soin d’indiquer clairement le chapitre de la Charte qui est en cause. Cette description est forcément juridique, donc d’une lecture plus aride, mais le lecteur pourra ainsi se faire sa propre idée, documents à l’appui, de la portée de ces modifications sur l’économie générale de la Charte.
Par la suite, et par voie de conséquence pour ainsi dire, nous tenterons de diagnostiquer les gains et les points faibles de la Charte de la langue française, du moins de la manière dont elle est mise en application par les organismes dont c’est le mandat.
1. Les modifications apportées à la charte de la langue française
Le texte de la Charte de la langue française de 1977 a été modifié à six reprises entre 1983 et 2002[94].
Les raisons en sont multiples.
Il a fallu tenir compte des arrêts de la Cour suprême du Canada à la suite des contestations des dispositions de la Charte de la langue française relatives à la législation et à la justice, à l’accès à l’école de langue anglaise et à l’affichage public. Le gouvernement du Québec n’avait pas d’autre choix.
Les gouvernements successifs ont introduit des modifications plus ou moins importantes au texte original ou au texte de la version précédente, tout particulièrement pour tenir compte de la commercialisation de produits découlant des nouvelles technologies de communication et de l’introduction de ces techniques dans les communications des entreprises. De nouveaux éléments se sont ainsi ajoutés au programme de francisation des entreprises et au chapitre sur la langue du commerce et des affaires.
À plusieurs reprises, la stratégie de mise en œuvre de la Charte de la langue française a été modifiée. La Commission de surveillance a été abolie, puis rétablie, puis à nouveau supprimée. La composition du comité de francisation[95] des entreprises est devenue paritaire. De nouveaux articles se sont ajoutés pour étendre aux cégeps et aux universités du Québec l’obligation de se doter d’une politique en faveur de l’emploi et de la qualité de la langue française à tous les niveaux de leurs activités. Les mandats des organismes d’application ont été modifiés.
La législation et la justice
Rappelons les dispositions de la Charte de la langue française de 1977 à ce sujet :
- Article 7 – Le français est la langue de la législation et de la justice au Québec.
- Article 8 – Les projets de loi sont rédigés, déposés à l’Assemblée nationale, adoptés et sanctionnés en français.
- Article 11 – Les procès se déroulent en français, à moins que toutes les parties à l’instance ne consentent à ce qu’elles plaident en langue anglaise[96].
Ces dispositions, comme on s’y attendait, furent immédiatement contestées devant les tribunaux en vertu de l’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 qui stipule que « les lois du parlement du Canada et de la législature de Québec devront être imprimées et publiées dans ces deux langues » (le français et l’anglais). La cause se rendit jusqu’en Cour suprême.
En 1981, la Cour suprême du Canada, par l’arrêt Blaikie, conclut que le Québec était tenu de respecter cette obligation de bilinguisme en matière de législation tout au long du processus législatif (présentation des projets de lois, adoption, sanction et publication) et qu’en conséquence, les articles 7 et 8 de la Charte de la langue française étaient inconstitutionnels et devenaient inopérants.
La Cour suprême étendit cette obligation de bilinguisme aux règlements d’application des lois.
Le même article de la Constitution de 1867 précise que, dans toute plaidoirie ou pièce de procédure « par-devant tous les tribunaux ou émanant des tribunaux de Québec, il pourra être fait également usage, à faculté, de l’une ou de l’autre de ces langues ». La Cour déclare donc également inconstitutionnel et inopérant l’article 11 de la Charte de la langue française et étend l’usage facultatif du français ou de l’anglais aux tribunaux exerçant des fonctions quasi judiciaires.
En 1993, la loi 86 modifie les dispositions de la Charte de la langue française de 1977 pour rendre le texte conforme à l’arrêt de la Cour suprême :
- Article 7 – Le français est la langue de la législation et de la justice au Québec sous réserve de ce qui suit :
- 1o les projets de loi sont imprimés, publiés, adoptés et sanctionnés en français et en anglais, et les lois sont imprimées et publiées dans ces deux langues;
- 2o il en est de même des règlements;
- 3o les versions françaises et anglaises des textes visés aux paragraphes 1o et 2o ont la même valeur juridique;
- 4o toute personne peut employer le français ou l’anglais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux du Québec et dans tous les actes de procédure qui en découlent.
- Article 9 – Tout jugement rendu par un tribunal judiciaire et toute décision rendue par un organisme exerçant des fonctions quasi-judiciaires (sic) sont traduits en français ou en anglais, selon le cas, à la demande d’une partie, par l’Administration tenue d’assumer les coûts nécessaires au fonctionnement de ce tribunal ou de cet organisme.
On ne revient cependant pas aux textes bilingues sur deux colonnes, comme c’était la coutume avant la Charte de la langue française. Les textes de lois ou de règlements sont publiés en deux versions séparées, française et anglaise.
L’accès à l’école de langue anglaise
Les dispositions de la Charte de la langue française de 1977 étaient les suivantes :
- Article 72 – L’enseignement se donne en français dans les classes maternelles, dans les écoles primaires et secondaires, aussi bien dans le réseau public que dans les établissements privés subventionnés.
- Article 73 – Par dérogation à l’article 72, peuvent recevoir l’enseigne ment en anglais, à la demande de leur père et de leur mère.
- a) les enfants dont le père ou la mère a reçu au Québec l’enseignement primaire en anglais;
Ce dernier alinéa fut désigné par la suite sous le nom de clause Québec.
En 1977, la clause Québec était parfaitement constitutionnelle puisque le Québec disposait d’une compétence exclusive en matière d’enseignement.
Pour contrer l’effet de cette clause qui avait comme conséquence d’exclure de l’école anglaise les enfants des parents qui migraient d’une autre province du Canada vers le Québec, à moins que leur province d’origine n’ait conclu un accord de réciprocité avec le Québec (article 86 de la Charte de la langue française de 1977), l’administration fédérale choisit d’inclure, dans le projet de rapatriement de la Loi constitutionnelle du Canada une Charte des droits et libertés qui comporterait un article traitant de cette question.
L’article 23 de cette Charte spécifie que :
- Les citoyens canadiens :
- a) dont la première langue apprise et encore comprise est celle de la minorité francophone ou anglophone de la province où ils résident,
- b) qui ont reçu leur instruction, au niveau primaire, en français ou en anglais au Canada et qui résident dans une province où la langue dans laquelle ils ont reçu cette instruction est celle de la minorité francophone ou anglophone de la province, ont, dans l’un ou l’autre cas, le droit d’y faire instruire leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans cette langue.
Ce droit, cependant :
- a) s’exerce partout dans la province où le nombre des enfants des citoyens qui ont ce droit est suffisant pour justifier à leur endroit la prestation, sur les fonds publics, de l’instruction dans la langue de la minorité.
L’alinéa b) de cet article fut par la suite connu sous le nom de clause Canada.
En 1982, le Parlement britannique adopte la nouvelle constitution du Canada sans le consentement du Québec. La clause Canada devient donc constitutionnelle, avec, comme conséquence, l’invalidation de la clause Québec, immédiatement contestée devant les tribunaux.
En 1984, la Cour suprême déclare que la clause Québec est incompatible avec l’article 23 de la Charte canadienne et qu’elle est, de ce fait, inconstitutionnelle et inopérante.
En 1993, la loi 86 modifie l’article 73 de la Charte de la langue française de 1977 pour le rendre conforme à l’arrêt de la Cour suprême, mais en ajoutant, au texte original de l’article 23, la condition que l’enseignement reçu au Canada constitue « la majeure partie » de cet enseignement.
Le nouveau texte de l’article 73 de Charte de la langue française se lisait maintenant comme suit :
- Peuvent recevoir l’enseignement en anglais, à la demande de l’un des parents :
- 1o les enfants dont le père ou la mère est citoyen canadien et a reçu un enseignement primaire en anglais au Canada, pourvu que cet enseignement constitue la majeure partie de l’enseignement primaire reçu au Canada.
- 2o les enfants dont le père ou la mère est citoyen canadien et qui ont reçu un enseignement primaire ou secondaire en anglais au Canada, de même que leurs frères et sœurs, pourvu que cet enseignement constitue la majeure partie de l’enseignement primaire ou secondaire reçu au Canada.
Des parents contestent à nouveau l’article 73 modifié devant les tribunaux. Ils soutiennent que la condition de la « majeure partie » est une restriction inconstitutionnelle à l’article 23 de la Charte canadienne. D’autres parents, francophones cette fois, estiment que l’article 73 est discriminatoire puisqu’il restreint l’accès à l’école de langue anglaise aux seuls enfants dont le père ou la mère, citoyen canadien, a reçu un enseignement primaire en anglais au Canada ou aux enfants de parents canadiens qui ont fréquenté l’école primaire ou secondaire de langue anglaise au Canada. De ce fait, les enfants de parents francophones ou allophones se trouvent privés du droit de choisir l’école de langue anglaise.
Les deux causes se rendent jusqu’en Cour suprême, qui décide de les traiter en même temps. La Cour rend sa décision en mars 2005.
La première cause porte sur la restriction ajoutée par le législateur québécois, « que cet enseignement constitue la majeure partie de l’enseignement primaire reçu au Canada ». La Cour suprême résume le fond de la question, du point de vue juridique, de la manière suivante :
[…] il s’agit en l’espèce de déterminer si la tentative du législateur québécois de définir les catégories de titulaires de droits établis à l’art. 23 de la Charte canadienne des droits et libertés au moyen du critère de la « majeure partie » énoncé à l’art. 73 de la Charte de la langue française constitue une restriction inconstitutionnelle des droits en question. Nous estimons que non; l’adjectif « majeure » doit cependant recevoir un sens « qualitatif » plutôt que « quantitatif » pour juger si la fréquentation de l’école anglaise par un enfant découle d’une réelle appartenance de cet enfant au groupe linguistique minoritaire.
La Cour examine longuement les critères dont il faudrait tenir compte pour évaluer l’aspect « qualitatif » de l’admissibilité d’un enfant à l’école de la minorité ou de la majorité.
« Le paragraphe 23 (2), rappelle la Cour au paragraphe 30 de son arrêt, a pour objet de garantir le droit à la continuité de l’instruction dans la langue de la minorité, de préserver l’unité familiale et de favoriser la liberté de circulation et d’établissement. Les rédacteurs voulaient qu’un enfant qui a étudié ou qui étudie dans une langue officielle puisse terminer ses études dans cette langue, là où elle est minoritaire. » On peut donc, à bon droit, affirmer que l’article 23 (2) n’a pas pour objet le choix de la langue d’enseignement, encore moins de donner aux parents la liberté de choix de la langue d’enseignement, surtout lorsqu’il s’agit de personnes qui ont immigré récemment au Canada, au Québec dans ce cas-ci, ce qui est l’objet spécifique de l’article 73 de la Charte de la langue française.
En effet, « la continuité de l’instruction dans la langue de la minorité » se comprend facilement quand il s’agit d’enfants de familles francophones ou anglophones. Ce critère est nettement pertinent dans le cas des enfants francophones hors Québec qui n’ont pas toujours facilement accès à un enseignement en langue française. Mais il est plus difficile à appliquer dans le cas des enfants des nouveaux immigrants pour qui le français et l’anglais sont deux langues étrangères d’apprentissage plus ou moins récent. Il se peut même que, pour ces enfants, l’une ou l’autre langue soient totalement inconnues si la langue parlée à la maison est la langue d’origine des parents. Le choix, par les parents, de la langue de l’école pour leurs enfants est davantage l’indice du choix de la communauté d’intégration que l’indice de la « continuité dans la langue de la minorité ».
La Cour s’attache donc à préciser l’interprétation qu’il convient de donner au texte de l’article 23 (2), c’est-à-dire à la clause Canada, pour en respecter l’esprit. La Cour écrit au paragraphe 33 de l’arrêt :
Pour procéder à une évaluation téléologique [selon ses objectifs] du critère d’admissibilité prévu au par. 23 (2), il faut donc prendre en considération, l’ensemble de la situation de l’enfant, y compris le temps passé dans chaque programme, l’étape des études à laquelle le choix de la langue d’instruction a été fait, les programmes qui sont offerts ou qui l’étaient et l’existence ou non de problèmes d’apprentissage ou d’autres difficultés. De cette façon, il est possible de déterminer si le cheminement scolaire global d’un enfant satisfait aux exigences du par. 23 (2).
La Cour passe ensuite en revue chacun de ces critères pour conclure, au paragraphe 48, que :
[…] le critère de la « majeure partie » s’il est défini qualitativement, c’est-à-dire au sens de « partie importante », apporte une précision valable à l’expression « parcours ou cheminement scolaire ». Le critère de la « majeure partie » doit se prêter aux nuances et à la subjectivité requises pour déterminer si l’admission d’un enfant, compte tenu de la situation personnelle de celui-ci, cadre avec l’objet du par. 23 et avec la nécessité particulière de protéger et renforcer la communauté linguistique minoritaire.
La manière dont la Cour considère les classes d’immersion est révélatrice de l’esprit de cet arrêt. Au paragraphe 50, elle écrit :
À l’extérieur du Québec, les programmes d’immersion sont conçus pour donner une formation dans la langue seconde aux enfants qui fréquentent les écoles destinées à ceux et à celles qui adoptent la langue de la majorité. Ils sont offerts dans des écoles de la majorité linguistique faisant partie du système scolaire de cette majorité. Il leur manque donc l’élément culturel essentiel à l’instruction dans la langue de la minorité. […] Par conséquent, même si rien dans le libellé du par. 23 (2) n’assujettit à des limites strictes la nature de l’instruction, il serait contraire à l’objet de la disposition d’assimiler les programmes d’immersion à l’enseignement dans la langue de la minorité.
La Cour conclut que la condition de la « majeure partie » est constitutionnelle si elle est appliquée dans cet esprit.
L’arrêt de la Cour suprême a comme conséquence d’introduire dans l’interprétation de la clause Canada une large part d’appréciation subjective de la part de chacun des intervenants. En cas de litige, il laisse aux arbitres et aux juges une grande latitude pour évaluer chaque cas particulier. Le critère de la « majeure partie » de l’art. 73 de la Charte de la langue française en sort nettement affaibli, même s’il est jugé constitutionnel.
Dans la seconde cause, des parents membres de la majorité francophone du Québec tentent, juge la Cour, « de se prévaloir du droit à l’égalité [garanti par les Chartes des droits et libertés de la personne] pour bénéficier d’un droit qui n’est garanti au Québec [par l’art. 73 de la Charte de la langue française] qu’à la minorité anglophone et de modifier les catégories de titulaires des droits visés à l’art. 23. Ce n’est pas acceptable ».
Dans son argumentaire, la Cour estime que « leur objectif [à ces parents francophones] qui consiste à faire instruire leurs enfants en anglais ne correspond tout simplement pas à l’objectif visé à l’art. 23 de la Charte canadienne ». La Cour précise que « l’art. 73 n’a pas pour objet d’ “exclure”, mais plutôt de mettre en œuvre l’obligation constitutionnelle positive qui incombe à toutes les provinces d’offrir à leur minorité linguistique l’enseignement dans la langue de cette minorité ». De plus, la Cour ajoute, en s’inspirant du raisonnement du juge en Chef lors de l’arrêt Mahé de 1990, que « de toute évidence, l’art. 23 renferme une notion d’égalité entre les groupes linguistiques des deux langues officielles du Canada [francophone et anglophone], auxquels il accorde un statut spécial par rapport à tous les autres groupes linguistiques du Canada ». En conséquence, « il serait déplacé d’invoquer un principe d’égalité destiné à s’appliquer universellement à “tous” pour interpréter une disposition qui accorde des droits particuliers à un groupe déterminé ». Enfin, « au Québec, une autre dimension s’ajoute au problème en ce que la présence d’écoles destinées à la communauté linguistique minoritaire ne doit pas servir à contrecarrer la volonté de la majorité de protéger et de favoriser le français comme langue de la majorité au Québec, sachant que le français restera la langue de la minorité dans le contexte plus large de l’ensemble du Canada ».
La cause est donc rejetée.
L’affichage public et les raisons sociales
La Charte de la langue française de 1977 stipulait que :
- Article 58 – Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou par les règlements de l’Office de la langue française, l’affichage public et la publicité commerciale se font uniquement dans la langue officielle, sauf :
- a) la publicité véhiculée par un média d’une autre langue que le français et les messages de type religieux, politique, idéologique ou humanitaire, sans but lucratif (art. 59);
- b) l’affichage dans les établissements d’au plus quatre personnes, y compris le patron, à condition que le français apparaisse d’une manière au moins aussi évidente que l’autre langue (art. 60);
- c) l’affichage public des activités culturelles d’un groupe ethnique particulier qui peut se faire à la fois en français et dans la langue de ce groupe (art. 61);
- d) l’affichage public dans les établissements spécialisés dans la vente de produits typiques d’une nation étrangère ou d’un groupe ethnique particulier qui peut se faire à la fois en français et dans la langue de ce groupe (art. 62).
- Article 59 – L’article 58 ne s’applique pas à la publicité véhiculée par des organes d’information diffusant dans une autre langue que le français ni aux messages de type religieux, politique, idéologique ou humanitaire, pourvu qu’ils ne soient pas à but lucratif.
- Article 63 – Les raisons sociales doivent être en langue française.
La règle de l’affichage public uniquement en français est rapidement contestée devant les tribunaux au nom de la liberté d’expression et du droit à l’égalité des articles 2 et 15 de la Charte canadienne des droits de la personne. La cause est portée devant la Cour suprême du Canada.
En 1988, la Cour suprême déclare (arrêt Ford) que l’unilinguisme français de l’affichage et de la publicité était contraire à la liberté d’expression et au droit à l’égalité garantis par la Charte canadienne des droits et libertés.
Cependant, la Cour était d’avis que le législateur québécois serait en droit d’exiger la « nette prédominance du français » pour donner un visage plus français à l’affichage public.
Soulignons que la règle de la « nette prédominance du français » a été proposée par la Cour suprême comme un compromis acceptable pour valoriser le visage français du Québec. Ce ne fut pas une invention tatillonne du gouvernement du Québec, comme on le pense souvent. Par contre, l’application de cette règle a obligé les fonctionnaires de l’Office de la langue française à évaluer si oui ou non le texte français était « nettement prédominant », au besoin en mesurant et en comparant les deux textes en présence. Les médias anglophones s’en sont donné à cœur joie pour ridiculiser la démarche de l’Office, alors qu’il lui fallait bien, en saine justice, vérifier s’il y avait violation ou non de la règle. Apprécier la « nette prédominance » est toujours très difficile, à cause de la multiplicité des procédés graphiques de conception d’une affiche et des divers éléments auxquels il est possible d’avoir recours pour la créer : la disposition des textes, la couleur, la lumière, la situation sur la voie publique, la taille et le nombre des affiches quand chaque langue figure sur des supports différents, etc.
En décembre de la même année, le gouvernement libéral du Québec tente une première modification de la Charte de la langue française pour tenir compte de l’arrêt de la Cour suprême. Il adopte, par la loi 178, les dispositions suivantes, en distinguant l’affichage à l’extérieur et à l’intérieur des commerces :
58. L’affichage public et la publicité commerciale, à l’extérieur ou destinés au public qui s’y trouve, se font uniquement en français.
58.1 À l’intérieur des établissements, l’affichage public et la publicité commerciale se font en français.
Ils peuvent aussi y être faits à la fois en français et dans une autre langue, pourvu qu’ils soient destinés uniquement au public qui s’y trouve et que le français figure de façon nettement prédominante.
En plus, le gouvernement se prévaut de la clause dérogatoire prévue à la Charte canadienne des droits et libertés pour soustraire ces dispositions à toute contestation juridique pendant les cinq prochaines années, soit jusqu’en décembre 1993.
Ces nouvelles dispositions déplaisent autant aux francophones qu’aux anglophones du Québec.
En 1989, des opposants anglophones, ne pouvant plus avoir recours aux tribunaux, déposent une plainte devant le Comité des droits de l’homme des Nations Unies, alléguant que la Charte de la langue française (version loi 178) était en contravention des articles 19 (liberté d’expression), 26 (droit à l’égalité) et 27 (droits des minorités) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Le Comité a jugé la plainte recevable et a donné son avis en mai 1993 en concluant :
- que la règle de l’unilinguisme dans l’affichage extérieur violait la liberté d’expression;
- que le droit à l’égalité était respecté puisque les dispositions s’appliquaient aussi bien aux francophones qu’aux anglophones;
- que la règle de la protection des minorités ne s’appliquait pas puisque les anglophones du Québec ne pouvaient être considérés comme une minorité linguistique au sens de l’article 27 du Pacte.
En 1993, la clause dérogatoire prévue à la loi 178 est venue à échéance. Plutôt que de la renouveler, le gouvernement libéral de Robert Bourassa, de nouveau premier ministre, choisit de modifier la loi en s’inspirant de l’arrêt de la Cour suprême de 1988 et en tenant compte de l’avis du Comité des droits de l’homme des Nations Unies.
Il propose et fait adopter la disposition suivante de la loi 86 :
58. L’affichage public et la publicité commerciale doivent se faire en français.
Ils peuvent également être faits à la fois en français et dans une autre langue pourvu que le français y figure de façon nettement prédominante.
L’article 58 ne s’applique pas à la publicité véhiculée par des organes d’information diffusant dans une autre langue que le français ni aux messages de type religieux, politique, idéologique ou humanitaire, pourvu qu’ils ne soient pas à but lucratif.
L’article 59 du texte de 1977 n’a jamais été modifié et demeure en vigueur.
Notons que le principe de l’affichage public uniquement en français, selon le texte original de la loi 101, s’est appliqué de 1977 à 1993, soit durant 16 ans. Le comportement des agences de publicité en a été transformé en profondeur. Le paysage publicitaire de tout le territoire québécois est devenu nettement français. Les attitudes aussi bien des francophones que des anglophones à l’endroit de la publicité en français se sont modifiées.
Le principe de la « nette prédominance » du nouvel article 58 a été, à son tour, contesté devant les tribunaux.
La Cour d’appel du Québec a jugé que cette disposition était parfaitement valide.
La Cour suprême a refusé d’entendre le recours des plaignants puisque la règle de la « nette prédominance » était sa propre proposition.
Les opposants ont donc décidé de porter à nouveau cette cause devant le Comité des droits de l’homme des Nations Unies, qui devra d’abord juger de la recevabilité de la plainte et, en cas d’acceptation, entendre les parties et rendre son avis.
Ce processus est en cours.
La francisation des entreprises
En 1993, la loi 86 ajoute un nouvel article au chapitre de la francisation des entreprises dans le but de maintenir l’utilisation généralisée de la langue française dans les entreprises qui ont obtenu leur certificat de francisation :
-
Article 146 – Toute entreprise qui possède un certificat de francisation délivré par l’Office de la langue française a l’obligation de s’assurer que l’utilisation du français y demeure généralisé à tous les niveaux selon les termes de l’article 141 [qui énonce les éléments du programme de francisation].
Elle doit remettre à l’Office, à tous les trois ans, un rapport sur l’évolution de l’utilisation du français dans l’entreprise.
Depuis 1977, la Charte de la langue française obligeait « les entreprises employant cent personnes ou plus à instituer un comité de francisation d’au moins six personnes dont au moins le tiers nommé pour représenter les travailleurs de l’entreprise ».
En 2002, par l’article 18 de la loi 104, le gouvernement modifie la composition des comités de francisation à la suite d’une recommandation de la Commission des États généraux sur la situation et l’avenir de la langue française au Québec (rapport Larose) de manière à rendre égal le nombre des représentants de l’employeur et des travailleurs.
Les nouvelles technologies de l’information et de la communication
Elles n’existaient pas en 1977. La Charte de la langue française ne pouvait donc pas en traiter.
Leur emploi s’est généralisé rapidement à partir de 1980. Elles ont transformé les moyens de communiquer, de s’informer, de traiter et de stocker l’information. Elles se sont développées d’abord aux États-Unis, en langue anglaise. De nouveaux produits sont arrivés sur le marché, en version anglaise uniquement. A commencé alors le long combat pour obtenir des produits en langue française, en commençant par des claviers qui tiennent compte des caractéristiques de l’orthographe du français ou d’une autre langue.
Ces nouvelles technologies, et les produits qui en découlent, étaient de plus en plus utilisées aussi bien par le grand public que par les entreprises.
Pour tenir compte de cette transformation des habitudes de travail dans les entreprises et de ses effets sur l’utilisation de l’anglais et du français, le gouvernement ajoute, en 1993, par la loi 86, un nouvel élément au programme de francisation :
- 9° l’utilisation du français dans les technologies de l’information.
En 1997, la loi 40 (gouvernement du Parti québécois, Louise Beaudoin ministre responsable) ajoute un nouvel article à la Charte de la langue française au chapitre de la langue du commerce et des affaires, pour rendre plus accessible et plus équitable l’accès à des produits informatiques en langue française :
- 52.1. Tout logiciel, y compris tout ludiciel ou système d’exploitation, qu’il soit installé ou non, doit être disponible en français, à moins qu’il n’en existe aucune version française.
Les logiciels peuvent être disponibles également dans d’autres langues que le français, pourvu que la version française soit accessible dans des conditions, sous réserve du prix lorsque celui-ci résulte d’un coût de production ou de distribution supérieur, au moins aussi favorables et possède des caractéristiques techniques au moins équivalentes.
L’emploi et la qualité de la langue française dans les établissements d’enseignement collégial et universitaire
À la suite des audiences et du rapport de la Commission des États généraux sur la situation et l’avenir de la langue française au Québec (rapport Larose), le gouvernement du Parti québécois (Bernard Landry, premier ministre, et Diane Lemieux, ministre responsable) ajoute un nouveau chapitre à la Charte de la langue française sur ce thème (loi 104, 2002).
L’article 88.1 de cette loi oblige ces établissements à se doter « d’une politique relative à l’emploi et à la qualité de la langue française ».
Cette politique doit traiter des éléments suivants (article 88.2) :
- °de la langue d’enseignement, y compris celle des manuels et d’autres instruments didactiques, et de celle des instruments d’évaluation des apprentissages;
- °de la langue de communication de l’administration de l’établissement, c’est-à-dire celle qu’elle emploie dans ses textes et documents officiels ainsi que dans toute autre communication;
- °de la qualité du français et de la maîtrise de celui-ci par les élèves, par le personnel enseignant, particulièrement lors du recrutement, et par les autres membres du personnel;
- °de la langue de travail;
- °de la mise en œuvre et du suivi de cette politique.
La politique des établissements de langue anglaise « doit traiter de l’enseignement du français comme langue seconde, de la langue des communications écrites de l’administration de l’établissement avec l’Administration et les personnes morales établies au Québec ainsi que de la mise en œuvre et du suivi de cette politique ».
L’article 88.3 précise que les établissements doivent transmettre leurs politiques au ministre de l’Éducation et qu’ils doivent produire « un rapport faisant état de leur application », mais uniquement sur demande du Ministre. Toutes les universités du Québec et tous les collèges d’enseignement se sont conformés à cette nouvelle exigence de la loi. On ne sait trop ce qu’il est advenu de l’application de ces politiques.
Les organismes de la Charte
La même loi 104 restructure en profondeur les organismes d’application de la Charte de la langue française.
Elle abolit de nouveau la Commission de surveillance, supprimée une première fois en 1993 par le gouvernement libéral (loi 86) et rétablie en 1997 par le gouvernement du Parti québécois (loi 40). Le mandat de l’ex-Commission de surveillance est confié à l’Office québécois de la langue française (article 38).
Elle renomme et redéfinit les mandats de l’Office et du Conseil de la langue française.
L’Office québécois de la langue française :
- définit et conduit la politique québécoise en matière d’officialisation linguistique, de terminologie ainsi que de francisation de l’Administration et des entreprises (art. 159);
- surveille l’évolution de la situation linguistique du Québec, notamment en ce qui a trait à l’usage et au statut de la langue française ainsi qu’aux comportements et attitudes des différents groupes linguistiques (art. 160);
- veille à ce que le français soit la langue normale et habituelle du travail, des communications, du commerce et des affaires dans l’Administration et les entreprises. Il aide à définir et à élaborer les programmes de francisation (art. 161);
- peut assister et informer l’Administration, les organismes parapublics, les entreprises, les associations diverses et les personnes physiques en ce qui concerne la correction et l’enrichissement de la langue française parlée et écrite au Québec. Il peut également recevoir leurs observations et suggestions sur le sujet (art. 162);
- établit les programmes de recherche nécessaires (art. 163);
- peut conclure des ententes à ce sujet avec des personnes, des organismes, des gouvernements, des organisations internationales (art. 164).
Pour soutenir l’Office dans sa tâche, la loi lui adjoint deux nouveaux comités, le Comité d’officialisation linguistique et le Comité de suivi de la situation linguistique, l’un et l’autre composé de deux personnes représentant l’Office (le président et le secrétaire) et de trois personnes qui n’en sont pas membres pour un mandat d’au plus quatre ans. L’idée est de créer ainsi un lien réel entre l’Office et la société québécoise (art. 165.11 et 165.12).
Le Conseil supérieur de la langue française :
- conseille le ministre responsable de l’application de la loi sur toute question relative à la langue française, soit que le ministre lui soumette une question, soit que le Conseil en prenne lui-même l’initiative (art. 187);
- peut recevoir et entendre les observations de personnes ou de groupes, ou encore effectuer ou faire effectuer les études et recherches qu’il juge nécessaires. Il informe le public sur toute question relative à la langue française au Québec (art. 188).
Ainsi s’est déroulée la saga juridique et, par la suite, législative de la Charte de la langue française depuis son adoption.
L’avenir de la Charte, une responsabilité collective
Au vu de tout ce qui précède, on pourrait penser que seuls les gouvernements ou les tribunaux peuvent provoquer des modifications à la législation linguistique. Ce serait une grave erreur de perspective.
Pour que les tribunaux interviennent, il faut qu’au préalable un citoyen ou un groupe de citoyens prennent l’initiative de contester devant eux une disposition de la loi et qu’ils aient les moyens d’assumer les coûts de la poursuite. Par exemple, ce sont des parents francophones qui prétendent devant la cour que l’article 73 régissant l’accès à l’école de langue anglaise est discriminatoire puisqu’il prive les enfants francophones du droit de fréquenter l’école de langue anglaise. Lorsqu’une cause vient devant la cour, la mécanique juridique s’enclenche, de la Cour de première instance jusqu’à la Cour d’appel du Québec et même jusqu’en Cour suprême, si le plaignant persiste. Les frais s’accumulent, car rien n’est gratuit. L’arrêt de la Cour suprême est définitif et exécutoire.
D’autre part, pour qu’un gouvernement prenne l’initiative de présenter devant l’Assemblée nationale un projet de loi instituant ou modifiant la loi linguistique, il faut qu’il y soit poussé ou bien par les citoyens ou par ses propres électeurs, ou bien par un jugement d’une cour ou un arrêt de la Cour suprême. Nous en avons donné plusieurs exemples précédemment. Ainsi, c’est la décision des commissaires d’école de Saint-Léonard qui a provoqué la crise scolaire et linguistique qui a amené le gouvernement à intervenir en adoptant le bill 63, lui-même à l’origine des lois 22 et 101. Et ce sont les arrêts de la Cour suprême qui, le plus souvent, ont forcé les gouvernements à modifier la Charte de la langue française pour s’y conformer.
En dernière analyse, les juges et les gouvernements ne sont que les agents du changement. Ni les uns ni les autres n’en sont la source. Ce sont les citoyens, individuellement ou collectivement, qui sont à la source du changement. C’est vrai pour la législation linguistique comme pour beaucoup d’autres lois à portée sociale.
Dans ces domaines en particulier, le changement juridique est, en démocratie, un processus social qui met en cause trois groupes d’acteurs, les citoyens, les juges et les gouvernements. Les acteurs les plus importants sont les citoyens, dont on masque l’action et l’influence sous des appellations abstraites, opinion publique ou société civile, termes qui, d’une certaine manière, déresponsabilise le citoyen en tant que personne en le noyant dans un magma sans nom et sans visage à l’égard duquel il lui est aisé d’être d’accord ou de prendre ses distances, mais sans se compromettre. Si les citoyens, seuls ou en groupes plus ou moins constitués, ne manifestent pas leurs intentions, ni ne protestent, rien ne bougera, la chose juridique demeurera ce qu’elle est, le statu quo se perpétuera.
D’où la très grande importance de la liberté de parole et des relais qui lui permettent de se manifester et de se diffuser, les médias, les associations, les commissions d’enquête, les tribunaux, les gouvernements, les intellectuels.
Être citoyen, ce n’est pas être spectateur, c’est être le moteur du changement social, l’architecte de la société en mouvement, à condition cependant d’être soucieux du bien commun, de n’être pas enfermé dans la bulle des seuls intérêts individuels, ou de ne pas avoir remis son destin entre les mains d’organismes, eux-mêmes uniquement préoccupés de la défense de leurs intérêts ou figés dans leurs rôles.
Tel est donc l’état actuel de la législation linguistique québécoise.
Quels en sont les gains et les points faibles? Nous tenterons maintenant de répondre à la question.
2. Les gains et les points faibles de la législation linguistique
La législation linguistique a-t-elle modifié la dynamique de la concurrence linguistique en faveur de la langue française, malgré ou grâce aux modifications qu’elle a subies et en dépit de la mondialisation des échanges économiques?
La question, en réalité, est plus large. Devant quelle tâche nous trouvons-nous aujourd’hui si nous voulons collectivement poursuivre la promotion de la langue française au Québec, dans la situation éternellement périlleuse où elle se trouve au coin nord-est de l’Amérique du Nord?
Pour répondre à ces questions, on ne peut s’en tenir au seul aspect de la législation linguistique, c’est-à-dire à l’application de la Charte de la langue française. La Charte n’est qu’un volet de la politique linguistique qui en comporte trois autres tout aussi déterminants : la mission confiée au ministère de l’Éducation (le français langue d’enseignement et l’enseignement du français, langue maternelle et langue seconde), la politique d’immigration (sélection et intégration sociale et linguistique des immigrants) dont nous avons traité précédemment, enfin la responsabilité attribuée à l’Administration de donner l’exemple d’une institution dont la langue de travail est le français.
Chacun de ces volets a ses points faibles et ses propres difficultés d’application. La manière d’y remédier constitue déjà l’amorce d’une stratégie de renouvellement et de revitalisation de la politique linguistique québécoise.
Nous ne traiterons ici que les points qui sont les pivots de la stratégie de changement que se proposait de provoquer la Charte de la langue française, c’est-à-dire la langue de travail, la fréquentation de l’école française par les enfants allophones, l’affichage public et la langue du commerce et des services. Par la suite, au chapitre suivant, nous traiterons de la qualité de la langue elle-même, de l’efficacité de l’enseignement du français, langue maternelle et langue seconde, et de la manière dont l’Administration remplit son rôle.
Le français, langue de travail
C’est l’élément le plus important de la politique linguistique québécoise. De son efficacité dépend la motivation socioéconomique de la langue française et son pouvoir d’attraction.
Pour promouvoir la langue française comme langue normale et habituelle de travail, le législateur québécois a édicté une batterie de mesures partagées en deux chapitres, la langue de travail, dont les dispositions touchent tous les employeurs, et la francisation des entreprises, qui ne concerne que les entreprises de cinquante personnes et plus. Ces mesures forment un tout et se complètent.
Après trente ans d’application, ces mesures ont-elles été efficaces?
Rappelons-en le contenu rapidement.
Le chapitre sur la langue de travail règle la langue des communications des entreprises et des associations de salariés, y compris les offres d’emploi, de la langue des conventions collectives et de leurs annexes, de l’exigence de la connaissance d’une autre langue comme condition d’embauche, ce fameux article 46 dont il sera amplement question ici.
L’essentiel du chapitre relatif à la francisation des entreprises gravite autour de l’identification des conditions qui définissent la situation d’une entreprise dans laquelle le français est la langue de travail (l’article 141). Toute entreprise de cinquante personnes et plus où la situation du français n’est pas conforme à cette définition a l’obligation de détenir un certificat de francisation et, pour y arriver, chacune doit appliquer un programme de francisation dont la définition, le suivi et le maintien sont confiés à un comité de francisation paritaire entreprise-employés.
Aucune mention dans cet article de la possibilité de devoir employer la langue anglaise, ou une autre langue, dans l’exécution de certaines tâches, dans l’esprit du bilinguisme fonctionnel mentionné précédemment dans la description des travaux exploratoires de l’Office de la langue française.
Pourquoi ce silence? En fait, parce que c’est l’article 46 qui traite de cette question. Le premier alinéa interdit à tout employeur d’exiger la connaissance d’une autre langue ou d’un niveau spécifique de connaissance de cette langue pour l’accès à un emploi ou à un poste. Les alinéas suivants précisent qu’il revient à l’employeur de faire la preuve que cette connaissance est nécessaire, mais uniquement si une personne conteste cette exigence soit devant la Commission des relations de travail, soit sous forme de grief présenté par son syndicat, soit en ayant recours à l’arbitrage de l’Office de la langue française. Ce qui ne s’est produit que très rarement et uniquement par des travailleurs syndiqués, donc déjà protégés par une convention collective.
On semble avoir oublié cet article 46 ou avoir jugé que, dans la réalité de la procédure d’embauche ou de promotion, un individu isolé ne peut pas contrer un employeur, actuel ou potentiel.
Dans ces circonstances et dans l’état actuel de la législation linguistique, l’employeur a toute liberté d’exiger la connaissance de la langue anglaise en invoquant les exigences de la tâche et sans avoir à démonter au préalable la pertinence de cette exigence ni du niveau de connaissance requis. L’anglais est, aujourd’hui comme avant la loi 101, perçu comme une condition d’embauche et de promotion, à la grande surprise des immigrants de langue française et des immigrants allophones qui comprennent rapidement qu’ils doivent connaître l’anglais pour trouver du travail et que, parfois, cette seule langue suffit, surtout dans les entreprises de 49 personnes et moins.
À la fin de 1977 et au début de 1978, au moment où l’Office de la langue française préparait le guide de francisation des entreprises selon l’article 141, on aurait pu s’inspirer de la notion de bilinguisme fonctionnel pour inclure dans les exigences linguistiques des fonctions non seulement la connaissance de la langue française, mais également les conditions d’un éventuel recours à l’anglais en fonction des exigences de la tâche, ne serait-ce que pour encadrer l’argument habituel des « relations de l’entreprise avec l’étranger » de l’article 142.
On ne l’a pas fait, sans doute parce qu’on jugeait que cela aurait été trop compliqué pour l’entreprise. Or, dans toute entreprise, l’employeur doit décrire les exigences des fonctions, soit pour définir la tâche de chaque poste et les exigences qui en découlent, soit pour fixer le niveau de rémunération, avec la collaboration du syndicat s’il s’agit d’un emploi syndiqué. En général, on tient alors compte de critères comme le niveau de responsabilité et d’autonomie, les qualités personnelles, leadership et aptitude au travail d’équipe, les qualifications exigées, niveau de scolarité et type de formation spécialisée, l’expérience acquise. On aurait très bien pu insérer dans ce processus les exigences linguistiques des fonctions dans les qualifications requises, sans que ce soit plus arbitraire, ni plus délicat ni plus difficile que l’évaluation des autres critères.
Cela dit, où en est la francisation des entreprises en 2006 et la situation de la langue française comme langue de travail? Selon les études disponibles, le bilan peut se faire soit d’une manière objective ou subjective. Objectivement, on sait le nombre d’entreprises qui détiennent un certificat de francisation et on connaît les attitudes des entreprises à l’endroit de la francisation. D’un point de vue subjectif, il est possible, à partir des réponses à la seule question du recensement de la population par Statistique Canada en 2001 relative à la langue de travail, de décrire les caractéristiques linguistiques de la main-d’œuvre québécoise et d’avoir une bonne idée de la perception des citoyens québécois au sujet de la langue employée au travail.
La certification des entreprises semble plafonner autour de 80 %, avec une marge additionnelle constante d’environ 10 % de nouvelles entreprises en cours de francisation. Ce plafonnement s’expliquerait par des causes à la fois politiques, économiques et administratives, selon Bernard Salvail, ex-directeur de la francisation des entreprises à l’Office de la langue française, maintenant à la retraite de la fonction publique[97].
Causes politiques : les décisions des tribunaux et les réactions des gouvernements pour y donner suite ont été perçues par les entreprises et par les travailleurs comme un affaiblissement de la volonté politique de faire respecter la loi, ce qui a provoqué chez elles une nette baisse de la motivation à l’égard des objectifs de la francisation et une diminution conséquente de leur collaboration avec l’Office.
Causes économiques : les difficultés économiques des entreprises québécoises causées par la concurrence mondiale accrue ont fait passer la francisation au second plan de leurs préoccupations. Les licenciements répétés ont amené les syndicats et leurs membres à mettre en veilleuse le dynamisme des comités de francisation, en principe chien de garde du processus de francisation.
Causes administratives : ratés importants de la part de l’Office dans le suivi et le contrôle des phases de la francisation, défaut des entreprises à s’inscrire au programme quand elles atteignent la frontière des 50 employés, l’Office devant lui-même les repérer, retard accumulé aux échéances prévues par la loi de la part des entreprises nouvellement inscrites dans le processus, piètre participation du comité de francisation à l’analyse de la situation linguistique de l’entreprise, à la définition et au suivi du programme de francisation, arrivée constante de nouvelles entreprises soumises à un programme de francisation.
En somme, on constate maintenant une sorte de négligence ou même de résistance passive de la part des entreprises face au processus de certification. L’Office est ainsi forcé de jouer maintenant un rôle qui n’est pas celui que lui attribue la loi, celui de moteur de la francisation que la loi attribue à l’entreprise et au comité de francisation.
D’un point de vue plus subjectif, comment les travailleurs québécois perçoivent-ils l’importance relative de la langue française et de la langue anglaise comme langue de travail? En arrière-plan, et pour ainsi dire au préalable, comment peut-on décrire aujourd’hui la qualification professionnelle et linguistique de la main-d’œuvre, francophone, anglophone et allophone, ce qui influence à la fois les aptitudes au travail et les revenus des uns et des autres?
Une publication récente de la Direction de la recherche de l’Office québécois de la langue française donne des éléments de réponse à chacune de ces deux interrogations[98]. Ce document se fonde sur l’analyse plus raffinée des réponses des citoyens à la nouvelle et seule question relative à la langue de travail ajoutée, en 2001, au questionnaire de recensement de la population canadienne. Il se présente sous forme d’une série d’indicateurs et de tableaux statistiques répartis en deux parties.
La première partie retrace les caractéristiques actuelles de la main-d’œuvre du Québec selon le niveau de scolarité et le niveau de bilinguisme, que les travailleurs soient francophones, anglophones ou allophones. Il en ressort les conclusions suivantes.
Le niveau de scolarité de l’ensemble des travailleurs a nettement augmenté de 1991 à 2001, et davantage dans la région métropolitaine de Montréal (indicateur 2.3). D’autre part, les indicateurs du ministère de l’Éducation, édition 2006[99], confirment que l’accès d’une personne au marché du travail est d’autant plus facile et assuré que son niveau de scolarité est élevé. Ainsi, la probabilité d’embauche est de 14,8 % pour une personne sans diplôme du secondaire, de 23,9 % si elle détient un diplôme d’études secondaires, de 56,3 % si elle a réussi des études collégiales ou universitaires. A contrario, le taux de chômage est deux fois plus élevé chez les personnes qui n’ont qu’un diplôme du secondaire que chez celles qui ont un diplôme d’études collégiales ou un titre universitaire (tableau 6.3). Or, des trois groupes linguistiques considérés, les francophones sont les moins nombreux à dépasser le diplôme d’études collégiales et à détenir un diplôme d’études universitaires (indicateur 2.4). En conséquence, la structure d’emploi selon la langue maternelle se maintient en faveur des anglophones et même des allophones au détriment des francophones, qu’on retrouve en plus grande proportion au bas de l’échelle comme employés, aussi bien en province que dans la région de Montréal (indicateur 2.6).
Enfin, le taux de connaissance du français et de l’anglais[100] augmente en même temps dans l’ensemble du Québec entre 1991 et 2001 (indicateur 2.5a), le taux de bilinguisme également, mais moins rapidement chez les francophones que chez les anglophones et les allophones. En 2001, les taux de bilinguisme d’un groupe linguistique à l’autre selon la langue d’origine sont les suivants (indicateur 2.5b) : ensemble du Québec : chez les francophones, 48,4 %, chez les anglophones, 76,7 %, chez les allophones, 64,1 %; en province, dans le même ordre, 37,2 %, 72,4 % et 49,1 %; dans la région de Montréal, 64,3 %, 78,3 % et 65,8 %; enfin, dans l’île de Montréal, 72,1 %, 76,6 % et 64,1 %. Conclusion : le taux de bilinguisme des francophones est toujours inférieur à celui des anglophones et des allophones, sauf à Montréal où les francophones sont plus bilingues que les allophones.
En conséquence, les écarts de revenus entre les travailleurs, autrefois attribuables à la langue maternelle, sont maintenant causés, indépendamment de la langue maternelle du travailleur, par son niveau de scolarité et son aptitude au bilinguisme français/ anglais. Ces deux facteurs seront de plus en plus déterminants dans une économie mondialisée du savoir et des services où les technologies de l’information et de la communication seront dominantes. Les travailleurs francophones n’ont pas d’autre choix que d’être davantage scolarisés, plus bilingues et même plurilingues, sinon les francophones reviendront collectivement à la période des emplois subalternes et du petit pain.
La seconde partie du document explore la perception qu’ont les travailleurs de leur langue de travail au jour le jour, le français, l’anglais ou une autre langue.
La question du recensement au sujet de la langue de travail se lit comme suit :
- 48 a) Dans cet emploi, quelle langue cette personne utilisait-elle le plus souvent?
- 48 b) Cette personne utilisait-elle régulièrement d’autres langues dans cet emploi?
Quelques remarques s’imposent d’entrée de jeu au sujet du libellé de la question. On demande aux répondants d’indiquer la perception personnelle qu’ils ont de la langue ou des langues qu’ils utilisent au travail le plus souvent ou régulièrement, sans que le questionnaire du recensement précise davantage la question. De fait, les répondants n’ont pas tous interprété de la même façon la nuance entre le plus souvent et régulièrement. Quoi qu’il en soit, les perceptions révélées en réponse à la question demeurent très révélatrices lorsqu’on les croise avec la langue maternelle et le lieu de résidence du répondant à cause du grand nombre des réponses. De plus, comme c’était la première fois en 2001 que la question était posée, il faudra attendre les résultats du recensement de 2006 pour évaluer en quelle direction les perceptions des répondants évolueront.
Voyons quelle perception ont les francophones et les anglophones de leur principale langue de travail.
Selon le lieu de travail et la langue maternelle, les réponses des francophones se répartissent ainsi (indicateur 2.10) : pour l’ensemble du Québec, 92,8 % d’entre eux disent travailler en français et 22,5 % en anglais; en province, 96,3 % en français et 31,5 % en anglais; dans la région de Montréal, 88,4 % disent travailler en français et 19,5 % en anglais; dans l’île de Montréal, 84,9 % en français et 16,3 % en anglais.
Les anglophones répondent qu’ils travaillent en français ou en anglais selon la répartition suivante : dans l’ensemble du Québec, 68,7 %, en anglais et seulement 3,6 % en français; en province, 61,8 % en anglais et 1,7 % en français; dans la région de Montréal, 70,9 % et 6 %; dans l’île de Montréal, 74,3 % et 8,4 %.
Première évidence : le taux d’utilisation de la langue anglaise est partout nettement plus élevé chez les francophones que celui de la langue française chez les anglophones. Par contre, l’utilisation du français par les anglophones augmente légèrement en se rapprochant de Montréal, alors que celui de l’anglais diminue chez les francophones.
L’examen de la fréquence d’utilisation du français et de l’anglais au travail selon la langue maternelle et le lieu de travail (indicateur 2.14) donne une image plus précise et plus nuancée de l’utilisation du français comme langue de travail par les travailleurs du Québec.
Chez les francophones, l’utilisation relative du français et de l’anglais se distribue ainsi, toujours selon le lieu de travail : en province, français uniquement, 81,2 %, anglais aucunement, 81,3 %, anglais de façon complémentaire, 15,1 %; dans la région de Montréal, français uniquement, 54,9 %, français principalement, 33,5 %, anglais aucunement, 55,1 %, de façon complémentaire, 33,4 %; dans l’île de Montréal, français uniquement, 46,9 %, français principalement, 38 %; anglais aucunement, 47,2 %, de façon complémentaire, 37,9 %.
Chez les anglophones, l’utilisation relative de chaque langue se répartit ainsi : en province, anglais uniquement, 35,8 %, anglais principalement, 26 %, anglais de façon complémentaire, 19,2 %; français aucunement, 36,2 %, de façon complémentaire, 25,8 %; dans la région de Montréal, anglais principalement, 39,9 %, anglais uniquement, 31,1 %, de façon complémentaire, 14,8 %, français de façon complémentaire, 39,6 %, français aucunement, 31,6 %, principalement, 14,8 %; dans l’île de Montréal, anglais principalement, 41,7 %, anglais uniquement, 32,6 %, de façon complémentaire, 12,8 %, français de façon complémentaire, 41,4 %, aucunement, 33,1 % principalement, 12,8 %.
Les uns et les autres estiment donc travailler principalement dans leur langue maternelle respective. C’est la grande surprise de la compilation des réponses à la question 48, réponses paradoxales à première vue.
Comment cette perception peut-elle être possible?
Observons d’abord que la même question vaut pour tous les travailleurs québécois. Or, la réalité de la langue de travail est très variable selon plusieurs facteurs[101]. Elle dépend de la nature des lieux de travail, car ils ne sont pas assujettis aux mêmes exigences de la loi 101. Le français est la langue habituelle de travail dans la fonction publique québécoise; cependant, les personnes à l’emploi des commissions scolaires relevant du ministère de l’Éducation se partagent entre deux réseaux linguistiques distincts et certains organismes du ministère de la Santé sont autorisés par la loi 101 à utiliser l’anglais comme langue de travail. La même disposition s’applique à certains organismes municipaux. La loi 101 impose des obligations précises aux entreprises privées de service ou de production et aux entreprises commerciales ou d’affaires. Elle dépend aussi, autre évidence, des exigences linguistiques de la fonction occupée par le répondant. Ainsi, dans une entreprise où le français est la langue principale de travail, une personne peut fort bien utiliser tous les jours surtout l’anglais si sa fonction la met constamment en relation avec l’étranger, surtout avec les États-Unis. Elle dépend enfin de l’environnement linguistique du lieu de travail défini par la répartition du personnel selon la langue d’usage, notamment de la langue maternelle du supérieur hiérarchique.
De plus, la question est globale et ne distingue pas les communications orales des communications écrites, les communications internes et externes, ni la fréquence d’utilisation des technologies informatiques de communication, notamment Internet.
Enfin, chaque personne répond pour elle-même, selon sa fonction et sa vie quotidienne, et non en pensant à la situation générale de l’entreprise où elle travaille. Il s’agit uniquement d’une perception personnelle.
Dans les entreprises privées en particulier, les travailleurs seraient-ils encore d’avis qu’ils travaillent principalement dans leur langue maternelle? Les réponses aux questions du recensement ne fournissent aucun indice qui permette de répondre à la question, d’autant que la distinction n’est pas faite entre les entreprises de plus de 50 employés et les autres. On ne peut donc tirer aucune conclusion des réponses au recensement de 2001 pour évaluer l’efficacité de la francisation des entreprises au Québec.
Qu’en est-il de la langue de travail des allophones?
D’après leurs réponses (indicateur 2.10), les allophones travaillent principalement soit en français, soit en anglais avec une légère avance pour le français : dans l’ensemble du Québec, en français, 42,7 %, en anglais, 35,4 %; en province, 49 % et 23,2 %; dans la région de Montréal, 42 % et 36,8 %, dans l’île de Montréal, 40,1 % et 38,9 %. Mais la situation est très instable. En effet, d’une période d’immigration à l’autre, l’Office établit (graphique 2.19a) que le pourcentage de travailleurs immigrants dont la langue de travail est le français augmente entre 1961 (36,2 %) et 1980 (49,9 %), puis diminue légèrement mais constamment jusqu’en 2001 (49,2% en 1990, 46,1 % en 1995 et 44,6 % en 2001). La courbe de l’anglais, langue de travail, est évidemment inversée : 45,8 % en 1961, 29,9 % en 1990, 32,3 % en 1995 et 37,8 % en 2001. Il se peut que cela tienne à la langue maternelle des immigrants selon la distinction de Charles Castonguay[102] entre anglotropes, c’est-à-dire les immigrants plus enclins vers la langue anglaise et ayant plus de facilité à l’apprendre, et francotropes, plus portés vers la langue française, avec plus de facilité à la parler. Le pouvoir d’attraction de la langue française diminue depuis 1991, ce qui est très préoccupant.
Les entreprises du Québec de 49 employés et moins ne sont pas assujetties à un programme de francisation. Elles sont cependant soumises aux dispositions universelles du chapitre sur la langue de travail et du chapitre sur la langue du commerce et des affaires, notamment l’obligation d’offrir leurs services en langue française.
Dans ces entreprises, la langue de travail est, en général, celle du propriétaire qui embauche son personnel en toute liberté et utilise la langue de son choix avec ses employés. La seule contrainte qui pèse vraiment sur lui est de devoir servir en français les clients francophones et de veiller à ce que ses employés puissent en faire autant. Souvent, la connaissance du français est minimaliste. Dans beaucoup de ces petites entreprises, par exemple dans les restaurants, la langue de travail du personnel, y compris des francophones, est la langue anglaise, alors que la langue de service est le français avec les francophones et l’anglais avec les autres clients. De plus, la situation n’est pas la même d’une ville à l’autre ni d’un quartier à l’autre de la même ville, selon l’environnement démographique, ce qui s’observe facilement à Montréal.
Cette situation a une incidence sur les immigrants récents qui trouvent plus facilement du travail dans ces petites entreprises s’ils ne savent pas le français à leur arrivée. Ils auront alors tendance par la suite à s’orienter vers la communauté de langue anglaise, qui aura été pour eux la communauté d’accueil, surtout s’ils ne peuvent pas facilement se libérer pour apprendre le français. Nous reviendrons sur ce point dans le chapitre consacré à la politique d’immigration.
À la lumière de ce qui précède, il est clair que le dispositif législatif relatif à la langue de travail a besoin d’un sérieux coup de barre. Au moins deux modifications s’imposent de toute urgence.
L’exigence de la connaissance de la langue anglaise doit cesser de se généraliser, de redevenir la condition essentielle d’embauche comme autrefois, au moment de la commission Gendron. Il faut imposer à l’employeur qui exige la connaissance de la langue anglaise, le devoir de légitimer cette exigence, c’est-à-dire de faire la démonstration que la connaissance de la langue anglaise est nécessaire à l’exécution de la tâche pour laquelle il recrute du personnel. Actuellement, il revient au postulant de devoir protester s’il lui semble que cette exigence n’est pas légitime, alors que, le plus souvent, sa situation ne lui permet pas de le faire puisque c’est lui qui est demandeur, de travail ou de promotion. Le fardeau de la preuve doit se déplacer sur l’employeur, et dans toutes les entreprises, petites ou grandes. La mécanique d’application de la francisation des entreprises devra donc être modifiée en conséquence, en prenant appui sur l’alinéa 8 de l’article 141, qui précise que l’entreprise doit se doter d’ « une politique d’embauche, de promotion et de mutation » qui favorise la généralisation du français comme langue de travail.
La liberté totale dont jouissent les entreprises de 49 employés et moins n’est plus acceptable et joue contre la généralisation de l’emploi du français comme langue de travail. D’abord, elles sont très nombreuses, au-delà de 20 000 d’après le rapport Grant[103], et surtout situées dans la région de Montréal, là où sont concentrés les immigrants. Elles emploient plus de 450 000 personnes, dont beaucoup d’immigrants récents. Le Conseil supérieur de la langue française conclut à leur propos, dans son dernier avis à la ministre sur la langue de travail, « que la francisation des milieux de travail ne peut être pleinement réalisée, si [les entreprises de moins de 49 employés] sont exclues » du processus de francisation. Il faut donc « à cet égard que des travaux soient entrepris pour trouver une formule allégée de certification adaptée à leur taille ». La recommandation du Conseil nous semble non seulement judicieuse, mais impérative et urgente.
La loi définit avec précision le rôle et les responsabilités des comités de francisation. La loi 101 les a même rendus paritaires pour donner une importance égale à l’employeur et aux représentants des employés. Cependant, on constate que, laissés à eux-mêmes, isolés dans leurs entreprises respectives, ces comités font preuve de peu d’initiative et d’autorité. Le gouvernement doit de toute urgence donner à l’Office québécois de la langue française les moyens humains et financiers requis pour soutenir, dynamiser et responsabiliser les comités de francisation[104], en les regroupant au besoin par secteurs d’activité. Les États généraux sur la situation et l’avenir de la langue française en ont fait la recommandation en 2001, mais en vain.
Enfin, le dispositif administratif d’application du programme de francisation devrait être modifié pour prendre en compte la langue parlée dans les entreprises du Québec. En effet, le mécanisme actuel de certification des entreprises est quasi uniquement fondé sur l’emploi du français dans les documents et sur l’affichage interne, donc sur la langue écrite. On n’y tient pour ainsi dire aucun compte de la langue parlée, donc de l’emploi des termes français dans les communications orales. La mise à niveau des terminologies françaises dans la vie quotidienne des employés et des gestionnaires est, en conséquence, extrêmement lente. Les vieilles habitudes des termes anglais perdurent, si ce n’est de l’emploi de la langue anglaise elle-même. Une forme très anglicisée du français se maintient dans les entreprises du Québec. Même si la formation technique et professionnelle des jeunes leur donne aujourd’hui une connaissance naturelle des termes français, du moins de plus en plus souvent, ils sont happés et contaminés dès leur premier emploi par la langue réelle des entreprises et reprennent les mauvaises habitudes de leurs aînés. La langue parlée dans les entreprises ne se modifie que très peu et trop lentement.
La fréquentation des écoles françaises par les enfants allophones
C’est l’un des objectifs fondamentaux de la législation linguistique depuis l’affaire de Saint-Léonard et le plus grand succès de la Charte de la langue française.
La Cour suprême a confirmé, comme nous l’avons indiqué au point précédent, la constitutionnalité du premier alinéa du nouvel article 73, tout particulièrement de la condition que le gouvernement du Québec y a ajoutée, « pourvu que cet enseignement constitue la majeure partie de l’enseignement primaire reçu au Canada ». La Cour a également jugé que cet article n’était en rien discriminatoire. La contestation juridique des conditions d’accès à l’école de langue anglaise est donc terminée, du moins en ce qui concerne ces deux points.
Cette question réglée, l’attention s’est concentrée sur l’objectif implicite de la fréquentation de l’école française par les enfants immigrants, leur intégration à la majorité de langue française. Le ministère de l’Éducation a récemment défini « les grands axes [de l’action de l’école et du milieu environnant] pour favoriser l’intégration scolaire des élèves immigrants et immigrantes et [les] préparer à participer à la construction d’un Québec démocratique, francophone et pluraliste [105] ».
À cet égard, la Charte de la langue française a totalement modifié la situation antérieure.
Autrefois, le système scolaire provoquait la division complète de la population scolaire selon la religion, enfants catholiques d’un côté, enfants protestants ou d’une autre religion de l’autre. De ce fait, beaucoup d’enfants, surtout de familles immigrantes, n’avaient d’autre choix que de s’inscrire à l’école protestante, plus accueillante. Nous avons déjà évoqué ce point lors du rappel des travaux de la commission Parent, au premier chapitre. Ce clivage entraînait le développement chez les enfants d’identités fortement distinctes, pour ne pas dire antagonistes, catholiques et francophones d’une part, protestants et anglophones de l’autre, la religion partageant les enfants allophones entre les deux.
À ce système s’est substituée une école de langue française ouverte aux enfants de toutes origines et de toutes langues, où le partage d’une langue commune, le français, favorise le brassage de la population scolaire, la découverte de la culture et de la religion des autres enfants et la naissance entre eux de l’amitié au-delà de ces appartenances premières. De plus, l’acquisition de la langue de la majorité favorise chez les enfants, souvent chez leurs parents par ricochet, la participation à la vie au sein de la société québécoise et, plus tard, leur garantira l’accès au monde du travail et à la mobilité socioprofessionnelle[106].
Une fois la scolarité obligatoire terminée, est-ce que les enfants allophones ont tendance à poursuivre leurs études dans des cégeps de langue française, ce qui indiquerait, du moins certains le pensent, qu’ils choisissent de s’insérer dans la communauté de langue française? Rien n’est moins certain. Un bon nombre choisissent un cégep de langue anglaise. D’ailleurs, des francophones en font autant. Pourquoi?
Pour des raisons très simples : aussi bien les allophones que les francophones optent pour un cégep de langue anglaise pour améliorer leur connaissance de la langue anglaise, ou, chez ceux qui sont faibles en français, par crainte d’échouer le test de français à l’entrée du cégep et de se faire imposer des cours de rattrapage.
Pour contrer cette tendance, certains proposent d’étendre l’obligation, pour les francophones et les allophones devenus de jeunes adultes, de s’inscrire à un cégep de langue française à la fin de la scolarité obligatoire. Cette proposition revient périodiquement. Elle était d’actualité en 2000, à l’époque de la Commission des États généraux sur la situation et l’avenir de la langue française au Québec[107], et elle est revenue à la surface lors du dernier congrès du Parti québécois.
Ce serait se leurrer sur la cause réelle de ce choix. Le problème de fond, déjà à l’origine de la crise de Saint-Léonard, est celui de l’échec de l’enseignement de la langue anglaise dans les écoles publiques ou dans les écoles privées subventionnées soumises au programme du ministère de l’Éducation. Le ministère de l’Éducation s’entête à maintenir un enseignement de la langue anglaise à petites doses, formule pédagogique qui a largement fait les preuves de son inefficacité, de génération en génération. Le gouvernement actuel a même poussé cette logique en décidant de commencer cet enseignement homéopathique dès la première année du primaire, sans même se demander s’il disposait du personnel adéquat. Tous les spécialistes de l’enseignement des langues secondes sont d’un avis contraire : l’enseignement d’une langue seconde est efficace à la condition d’être intensif. On obtient de meilleurs résultats en concentrant les heures d’enseignement sur une période d’une certaine durée qu’en les dispersant tout au long de la scolarité. Ce consensus se maintient depuis au moins l’invention des classes d’immersion à Saint-Lambert au début des années 1960, dans la banlieue de Montréal. Le débat entre immersion et enseignement intensif remonte à cette époque.
Si les élèves, francophones et allophones, savaient l’anglais à la fin du secondaire, s’ils avaient la conviction qu’ils maîtrisent la langue anglaise au niveau de performance propre à leur âge, car on passe une vie à apprendre une langue, que ce soit la langue maternelle ou une langue seconde, ils ne ressentiraient pas le besoin de s’inscrire à un cégep de langue anglaise.
Les jeunes adultes allophones qui ont eu de faibles résultats en langue française durant leurs études secondaires craignent le test de français obligatoire lors de l’inscription au collégial. C’est vrai aussi pour les francophones dans la même situation. C’est donc l’efficacité de l’enseignement du français au secondaire qui est en cause ici. Il en sera question plus longuement au chapitre suivant.
Les raisons sociales et l’affichage public[108]
Nous avons vu, au deuxième chapitre de la partie précédente, que l’affichage public est composé en réalité de trois éléments principaux : les raisons sociales (appelées maintenant noms d’entreprise), le contexte des raisons sociales et les messages publicitaires. En général, la présentation des raisons sociales à la devanture des établissements commerciaux est très soignée, sur des supports permanents. Par contre, les messages publicitaires se renouvellent constamment.
Le chapitre VII de la Charte de la langue française traite de ces sujets sous le titre « La langue du commerce et des affaires ». Les articles 63 et 67 concernent spécifiquement la langue des raisons sociales.
- Article 63 – Le nom d’une entreprise doit être en langue française.
- Art. 67 – Peuvent figurer, comme spécifiques, dans le nom d’une entreprise, conformément aux autres lois ou aux règle ments du gouvernement, les patronymes et les toponymes, les expressions formées de la combinaison artificielle de lettres, de syllabes ou de chiffres ou les expressions tirées d’autres langues.
Le Règlement sur la langue du commerce et des affaires précise les modalités d’application de ces deux articles. Deux articles sont ici pertinents :
- Article 25 – Dans l’affichage public et la publicité commerciale, peuvent être rédigés uniquement dans une autre langue que le français : […] 4° une marque de commerce reconnue au sens de la Loi sur les marques de commerce, sauf si une version française en a été déposée.
- Article 27 – Peut figurer comme spécifique dans une raison sociale, une expression tirée d’une autre langue que le français, à la condition qu’elle soit accompagnée d’un générique en langue française.
Telles sont les règles juridiques qui régissent les raisons sociales.
Qu’en est-il de la réalité, telle qu’elle apparaît aujourd’hui à toute personne qui voit, même distraitement, la devanture des établissements commerciaux?
On constate d’abord que de plus en plus d’entreprises commerciales se réclament de l’alinéa 4 de l’article 25 du règlement pour afficher une marque de commerce en guise de raison sociale. En juillet 2006, nous avons mené une petite enquête maison pour mieux juger de l’importance de cette tendance et de son effet sur le visage français des rues et centres commerciaux de Montréal. Nous avons visité trois centres commerciaux de la région de Montréal et observé les façades de la partie ouest de la rue Sainte-Catherine, entre les rues Peel et Atwater.
Il était évident que beaucoup de magasins s’affichent actuellement sous une marque de commerce généralement de langue anglaise.
Les unes sont formées de mots empruntés directement au lexique de la langue anglaise, des mots simples, connus de tous, plus ou moins amalgamés ou transformés, sans laisser cependant de doute sur leur origine linguistique. Souvent aussi, l’ordre des mots suit la syntaxe anglaise déterminant-déterminé, ce qui confirme l’appartenance de la raison sociale à la langue anglaise. En voici de nombreux exemples : Access, Best Buy, Big Time, Bikini Village, Blockbuster Video, Body Shop, Burger King, Canadian Tire, Children’s Place, Coffee Time, Eggspectations, Feet First, Fly, Foot Locker, Freedom, French Connection, Games Workshop, Gap Kids, Golf Town, Guess, Guess Factory Store, Jazz, Linen Chest, MEXX Kids, Mountain Equipment, Old Navy, Old River, Payless Shoesource, Pink. Republic Collection, Roots, Silver & co, Seasun, Smart Set, Stitches, Subway, Sunglass Hut, StyleXchange, Therapeutic Touch, Trade Secrets, Unic, United Colors of Benetton, United Colors of Benetton Kids, Urban Behaviour, Urban Style. Longue énumération, mais nécessaire pour prendre conscience de l’ampleur du phénomène. Dans l’un des centres, de semblables raisons sociales apparaissaient à la devanture d’un magasin sur quatre, dans l’autre, d’un sur six.
Parfois, un ajout en français accompagne la raison sociale de langue anglaise ou d’une autre langue. Exemples : Fabrika, Sandwicherie européenne; KrispyKreme Doughnuts, Beignets et Café; Linen Chest, Le supercentre de la mode; Mmmuffins, Cafés & Boissons, Viennoiseries; Sukiyaki, Un délice japonais; Vanellis, Le festival des pâtes; Winners, Le prix des marques démarquées.
Enfin, il arrive, mais rarement l’avons-nous vu, que la raison sociale est à la fois en français et en anglais, avec nette prédominance du français. Les deux seuls exemples relevés étaient des entreprises d’origine asiatique : SOUPES ET NOUILLES, Soups & Noodles; Chef Noodle, NOUILLES DU CHEF.
D’autres marques sont des noms propres, des patronymes, à consonance anglaise. Elles sont tout à fait conformes à la loi 101, mais elles augmentent la présence de la langue anglaise dans l’affichage. Quelques exemples de magasins renommés suffiront : Aldo, Birks, Browns, Crabtree & Evelyn, Reitmans, Rogers, San Francisco, Sears, Tommy Hilfiger.
Enfin, les noms de commerce en langue anglaise ne sont presque jamais accompagnés d’un générique en langue française comme l’exigerait l’article 27 du Règlement sur la langue du commerce et des affaires.
Les établissements dont le nom est une marque de commerce sont souvent des franchises d’une entreprise internationale. Les succursales de ces chaînes de magasins se retrouvent dans toutes les villes du Québec et sur toutes les rues d’une ville, souvent à plusieurs exemplaires si la rue commerçante est longue, comme la rue Sainte-Catherine par exemple. La répétition de ces noms tourne à l’obsession.
Par contre, la publicité, c’est-à-dire les messages à la devanture des magasins ou dispersés à l’intérieur des établissements, est, dans la grande majorité des cas observés, conforme à la loi 101, en français avec nette prédominance. On peut discuter des moyens pris pour rendre le français prédominant, mais l’intention de lui donner préséance est évidente. C’est particulièrement vrai des centres commerciaux dont il semble bien que la direction veille à faire respecter la Charte de la langue française pour éviter de se retrouver pris à parti pour des motifs linguistiques. Les chaînes de magasins ou les grandes surfaces comme La Baie ou Sears font de même. Les cas d’unilinguisme anglais sont rares dans la publicité.
L’impression qu’ont les francophones du Québec, que l’affichage public s’anglicise constamment, vient de la prolifération incontrôlée des noms de commerce en langue anglaise.
Dans la vie de tous les jours, il ne semble pas que les Québécois francophones soient très préoccupés par les noms de commerce en langue anglaise. Par contre, le moindre article traitant de la présence de la langue anglaise dans l’affichage public, photos à l’appui, provoque de nombreux commentaires et soulève l’indignation générale, en réveillant les thèmes traditionnels du discours linguistique, l’affichage s’anglicise, la loi 101 n’est pas respectée. C’est ce qu’on pourrait appeler le phénomène Wall-Mart : on se scandalise en paroles du comportement de ce commerçant, on en dénonce l’antisyndicalisme et l’exploitation de la main-d’œuvre dans les pays en voie de développement, mais on continue d’y faire ses achats.
Un événement récent survenu à la fin de 2006 et le tapage médiatique qui s’ensuivit confirment ce jugement sévère. La compagnie ESSO annonça son intention de nommer On the Run ses dépanneurs jusqu’alors connus sous le nom de Marché Express, en invoquant comme argument que c’était sous cette marque de commerce que ses établissements étaient connus partout ailleurs dans le reste du Canada et aux États-Unis. La réaction des consommateurs francophones fut si spontanément et si majoritairement hostile à ce changement de nom que la compagnie abandonna son projet quelques jours seulement après l’avoir annoncé. Il n’en fallut pas plus pour que la question des raisons sociales en langue anglaise fasse tout à coup la manchette des journaux et des médias électroniques et que les sondeurs partent à la recherche des opinions des Québécois francophones. Les résultats d’un sondage SOM-La Presse publiés dans ce quotidien le dimanche 21 janvier 2007 montrait clairement le paradoxe des Québécois francophones à ce sujet. D’une part, « 68 % des Québécois n’aiment pas les bannières anglophones », titrait l’article, mais, d’autre part, pour 56,8 % d’entre eux, le même sondage indiquait que le fait qu’un commerce s’affiche en anglais n’avait aucune influence sur la fréquentation de ce commerce contre seulement 33,5 % qui réagissaient plus ou moins négativement, sans qu’on sache cependant s’ils allaient jusqu’à boycotter le commerce.
Est-il possible d’agir pour endiguer ou même pour renverser la tendance des commerçants à faire affaire sous des noms anglais? Posons la question plus nettement : peut-on obliger toutes les entreprises commerciales à respecter les dispositions de la loi 101 et les contraindre à s’afficher sous un nom français?
En réalité, nous touchons ici les limites du pouvoir du Québec de légiférer en matière de raisons sociales, du moins dans deux cas à l’origine des noms de commerces en langue anglaise au Québec, celui des raisons sociales des entreprises à charte fédérale et les marques de commerce.
Nous avons vu précédemment qu’une société commerciale a le choix de s’incorporer ou de déposer une raison sociale selon la loi fédérale ou provinciale. Si la procédure se fait au fédéral, l’entreprise obtient le droit d’utiliser son nom partout au Canada, même si ce nom est en anglais seulement. Le gouvernement du Québec ne peut pas alors obliger cette entreprise à utiliser un autre nom en prenant appui sur la Charte de la langue française. Le Québec ne disposerait alors que d’un seul moyen de faire respecter l’esprit de la loi 101, convaincre le gouvernement fédéral de modifier sa loi en exigeant des entreprises qu’elles déposent et qu’elles utilisent un nom français pour faire affaire au Québec, en invoquant son caractère distinct que le Parlement fédéral a fini par reconnaître. On voit d’ici le débat qu’une modification semblable provoquerait au Parlement et dans le milieu des affaires. Ce n’est pas pour demain!
Le cas des marques de commerce est nettement plus complexe. Il met en cause la compétence constitutionnelle du gouvernement fédéral et celle du Québec, d’une part, et, d’autre part, les traités et conventions en matière de commerce international.
Les marques de commerce relèvent de la compétence exclusive du gouvernement fédéral en vertu de l’article 91,2 de la Loi constitutionnelle de 1867. C’est lui, et lui seul, qui peut attribuer ce statut juridique à une dénomination ou le lui reconnaître au Canada si elle est d’origine étrangère.
De plus, conformément à la même loi, l’adhésion du Canada à un traité ou à une convention internationale relève de la seule compétence du gouvernement fédéral. Sa signature engage toutes les provinces et territoires du Canada, sans exception.
La convention internationale en cause ici est la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, qui date du 20 mars 1883 et dont le texte original est en français. Il a été régulièrement mis à jour depuis lors, la dernière révision datant d’octobre 1979. Le Canada y a adhéré en 1925. Le Canada a alors intégré à sa Loi sur les marques de commerce les principes de la Convention qui s’y rapportent.
L’article 6 de cette convention édicte les deux règles générales suivantes :
- Les conditions de dépôt et d’enregistrement des marques de fabrique ou de commerce seront déterminées dans chaque pays de l’union par sa législation nationale;
- Toutefois, une marque déposée par un ressortissant d’un pays de l’Union dans un quelconque des pays de l’Union ne pourra être refusée ou invalidée pour le motif qu’elle n’aura pas été déposée, enregistrée ou renouvelée au pays d’origine.
Le premier alinéa de l’article 6,5 explicite la portée de la deuxième règle, en précisant que « toute marque de fabrique ou de commerce régulièrement enregistrée dans le pays d’origine sera admise au dépôt et protégée telle quelle [c’est nous qui soulignons] dans les autres pays de l’Union ».
En conséquence, une marque de commerce déposée dans un autre pays est admise telle quelle au Canada, donc dans la forme et dans la langue de son enregistrement initial dans le pays d’origine. Conformément à l’article 6,5, le Canada ne peut exiger la moindre modification de cette marque, encore moins une traduction en français.
C’est cette convention et le fait que le Canada a compétence exclusive en matière de marque qui sont à l’origine du quatrième alinéa de l’article 25 du Règlement sur la langue du commerce et des affaires et de la prolifération des raisons sociales anglaises à la devanture des magasins. Remarquons, comme contre-argument, que c’est la même convention qui permet au Cirque du Soleil de présenter ses spectacles sous ce nom ou aux compagnies françaises d’utiliser leurs noms partout dans le monde. Les entreprises à le faire sont peu nombreuses et ne provoquent certainement pas une déferlante de noms français dans le monde. C’est plutôt l’inverse qui se produit, les sociétés françaises ou les sociétés québécoises de langue française ont tendance à se donner un nom anglais ou, à tout le moins, un nom passe-partout du point de vue linguistique.
Le Québec ne dispose ici que de deux moyens d’action. L’un, à très long terme et très délicat sur le plan juridique, serait de prendre l’initiative de faire modifier la clause telle quelle de la Convention de Paris au nom du respect des langues nationales et de la diversité linguistique mondiale, sur le modèle d’une démarche analogue pour obtenir le vote d’une convention internationale pour la protection de la diversité culturelle mondiale, dont l’UNESCO a fini par prendre l’initiative. Il se pourrait que nombre de pays soient sensibles à une démarche semblable. L’autre, de mise en œuvre plus immédiate, quoique tout aussi difficile, est de convaincre une à une les entreprises de se donner volontairement un nom français pour leurs activités au Québec. Le seul argument convaincant serait qu’il ferait alors de meilleures affaires, ce qui serait difficile à démontrer puisque, manifestement, leurs noms anglais ne leur nuit en rien.
Force est de constater que les dispositions de la loi 101 relatives aux raisons sociales sont davantage incitatives que coercitives, du moins dans le cas des entreprises à statut fédéral et lorsque la raison sociale est en réalité une marque de commerce protégée par les dispositions du droit commercial international.
La langue de service
Le fait que les commerces de 49 employés et moins ne sont pas soumis au chapitre de la langue de travail de la loi 101 et que les immigrants récents qui ne connaissent pas le français y trouvent souvent leur premier emploi a comme conséquence que les clients de langue française ne peuvent pas toujours être servis par eux dans leur langue. On observe souvent cette situation dans des restaurants de cuisine étrangère ou, récemment, dans les dépanneurs de la région de Montréal, surtout depuis que les immigrants investisseurs en deviennent propriétaires, ou encore dans les établissements des quartiers où se concentrent les immigrants au moment de leur arrivée.
Ce n’est certainement pas toujours mauvaise volonté de la part de ces personnes. L’obligation de gagner leur vie les pousse sur le marché du travail avant même qu’ils aient eu le temps, ou qu’on leur ait donné le temps, d’apprendre le français, avant même qu’ils aient pris conscience du pays du Québec où ils sont arrivés. Leur malaise est d’ailleurs souvent visible. Certains tentent de se défendre en invoquant le bilinguisme du Canada ou le fait qu’ils sont en Amérique. Leur faire mauvaise tête n’est pas une solution. Leur parler anglais non plus, puisqu’on confirme ainsi que l’anglais suffit, ici aussi. La seule conduite possible est de leur parler français, en phrases simples, en ralentissant le débit, sans démissionner, sans aller ailleurs en cas d’insuccès total.
Pour corriger cette situation, les francophones n’ont qu’un seul moyen : faire pression sur le gouvernement du Québec pour que la société québécoise, la nôtre, assure l’enseignement du français à tous les immigrants adultes dès leur arrivée, avant même qu’ils se lancent à la recherche d’un emploi, et, en conséquence, de leur attribuer durant la période d’apprentissage les moyens de subsister, eux et leurs familles. C’est une évidence. Il faudra y consacrer beaucoup d’argent, c’est vrai. Il vaudrait sans doute mieux réduire le nombre annuel des immigrants non francophones et les accueillir correctement que d’en accepter des masses et les laisser se débrouiller tout seuls. Nous en reparlerons au chapitre de la politique d’immigration.
Le mécanisme des plaintes et des enquêtes
Les dispositions de la loi sur la langue touchent un très grand nombre de personnes, d’entreprises et d’organismes sur l’ensemble du territoire. Pour vérifier la mise en application de la loi et s’assurer que chacun la respecte, la Charte de la langue française accorde à l’Office québécois de la langue française un pouvoir d’enquête. La Charte prévoit également que les citoyens peuvent venir en aide à l’Office. Elle les autorise à porter plainte lorsqu’ils sont témoins et d’avis qu’il y a violation d’une disposition de la loi.
Les articles de la loi 101 à ce sujet sont les suivants :
- Art. 166 – L’Office peut, pour l’application de la présente loi, effectuer des inspections et des enquêtes.
- Art. 167 – L’Office agit d’office ou à la suite de plainte.
- Art. 168 – Toute plainte doit être faite par écrit; elle indique les motifs sur lesquels elle se fonde ainsi que l’identité du plaignant. L’Office prête assistance au plaignant pour la rédaction de sa plainte.
- Art. 177 – Lorsque l’Office conclut qu’il y a eu contravention à la présente loi ou aux règlements pris pour son application, il met en demeure le contrevenant présumé de se conformer dans un délai donné. En cas de défaut, l’Office défère le dossier au procureur général pour que celui-ci intente, s’il y a lieu, les poursuites pénales appropriées.
L’Office reçoit entre 3 000 et 4 000 plaintes par année. Les motifs de plaintes se modifient constamment d’une époque à l’autre. Actuellement, 60 % des plaintes concernent les inscriptions sur les produits (art. 51), 10 à 15 % l’affichage, alors qu’autrefois c’était l’inverse. Le tiers des plaintes proviennent d’organismes qui s’en sont fait une vocation, qui peut expédier à l’Office de 700 à 900 plaintes dans une même année, dont on demande le traitement immédiat. Au moindre retard, l’expéditeur dénonce la lenteur ou même la négligence de l’Office dans les journaux ou auprès de la ministre responsable de la Charte. La pression sur l’Office est constante.
Le personnel de la Direction du traitement des plaintes compte de 15 à 20 personnes. Chaque plainte implique que l’Office fasse enquête, qu’un enquêteur se déplace pour aller constater les faits sur les lieux, dans toutes les régions, qu’il juge s’il y a vraiment violation de la loi et qu’il fasse rapport, preuve à l’appui, que la plainte soit fondée ou pas. Le personnel est entièrement occupé à vérifier les plaintes une à une, il est complètement débordé et n’arrive pas à donner suite à toutes les plaintes au fur et à mesure qu’elles arrivent.
D’un autre point de vue, l’approche par les plaintes est strictement négative, et même contreproductive. Pour au moins deux raisons. D’une part, s’il s’avère que la plainte est fondée, le mal est déjà fait et dure peut-être depuis des années. On n’a donc rien prévenu et on ne fera que corriger une situation particulière. D’autre part, le citoyen qui est l’objet de la plainte se sent personnellement visé, surtout dans le cas des inscriptions sur les produits, alors qu’il n’y est strictement pour rien et qu’il ne fait que vendre ce qui est disponible sur le marché, tout comme ses concurrents. Les vrais responsables des inscriptions sur les produits, du texte des modes d’emploi et de l’emballage sont les fabricants, les importateurs et les distributeurs. Par rapport à eux, le commerçant est un consommateur, tout comme ses clients.
En ce qui touche à la mise en marché des produits de consommation courante, il faut changer complètement de stratégie et privilégier les enquêtes. Plutôt que traiter les plaintes une à une, il vaudrait mieux les considérer comme autant d’indices pour identifier un malaise dans une catégorie de produits, comme les produits d’importation propres à une cuisine exotique ou certains aliments destinés à des animaux de compagnie peu populaires, les serpents par exemple. Le résultat de l’enquête donnerait à l’Office les raisons d’intervenir auprès des personnes ou des organismes qui peuvent vraiment modifier la mise en marché de chaque catégorie de produits pour la rendre conforme à la loi 101, soit directement auprès du fabricant, soit par l’intermédiaire des associations de marchands. On pourrait agir de la même manière en affichage lorsque les plaintes touchent un même quartier ou une même rue commerçante.
Ou encore, autre moyen d’action, l’Office pourrait concevoir et tenir des réunions d’information à l’intention des immigrants investisseurs, des marchands de produits exotiques ou des marchands d’un même domaine ou secteur commercial. Il n’est pas certain que tous connaissent les dispositions de la loi qui les concernent, d’autant que le texte n’est pas de lecture facile et qu’il est surtout connu par la rumeur publique, avec toutes les déformations et les préjugés que l’on peut imaginer et que nous avons nous-même constatées lorsque nous avons rencontré les membres de la Chambre de commerce du quartier chinois de Montréal pour régler une avalanche de plaintes contre les marchands de ce quartier exigu.
L’action de l’Office deviendrait alors préventive plutôt que punitive et elle serait certainement plus efficace auprès d’un plus grand nombre de commerçants.
Ce virage serait possible à deux conditions : que l’Office informe les auteurs de plaintes de la manière dont il en tient compte, qu’il les convainque que l’approche globale est préférable et qu’il tienne les citoyens informés des résultats obtenus lors de la publication de son rapport annuel.
Nous ne voulions pas faire ici le bilan des changements provoqués par la loi 101 en trente ans d’application. Il faudrait un autre livre.
Notre intention était plus modeste : montrer que, dans des domaines clés de la Charte de la langue française, tout n’est pas réglé et qu’il reste beaucoup à faire, au besoin en changeant la manière d’intervenir.
Édicter une loi ne suffit pas à modifier une situation. La loi précise des règles de conduite et propose un contrepoids aux tendances lourdes du commerce mondial. Elle est un moteur de changement potentiel, mais à la stricte condition qu’elle soit appliquée avec le soutien du gouvernement et la contribution de chaque citoyen.
Chapitre III – La qualité de la langue
Au Québec, on regroupe sous l’expression qualité de la langue toutes les questions et discussions qui portent sur la langue elle-même et non sur son statut.
D’une part, les avis sont partagés quand il s’agit d’apprécier la manière dont les Québécois parlent et écrivent la langue française. La question qui revient sans cesse depuis la fin du XIXe siècle, avec la même régularité que le retour des saisons, est : l’usage de la langue française s’est-il amélioré depuis que le niveau d’instruction a progressé à la suite de la généralisation de la scolarité obligatoire? Ce qui revient à mettre en cause l’enseignement de la langue française dans les écoles. Poser la question, entre amis ou sur les ondes, c’est provoquer à tout coup une vive opposition entre les deux camps du oui et du non, car chaque Québécois et Québécoise a son opinion sur le sujet.
D’autre part, toute tentative de décrire la langue française en usage au Québec, surtout le lexique, est l’occasion d’affrontements d’autant plus acrimonieux que les arguments sont, souvent, des arguments d’autorité. Cette entreprise est perçue comme une manière détournée de légitimer l’existence d’une forme particulière de la langue française propre au Québec, par ceux et celles qui repoussent une telle prétention. N’est-il pas inévitable, rétorquent leurs opposants, que la langue des colonisateurs français ait subi en terre d’Amérique une évolution différente et parallèle à celle qu’elle a connue en France lorsque les relations avec la mère patrie se sont rompues après la cession de la Nouvelle-France à l’Angleterre?
Et en admettant qu’il soit légitime de décrire l’usage québécois, quels sont les éléments, mots, sens, expressions, prononciations que l’on devrait admettre? Car les avis sont partagés sur la nature de la description. Pour les uns, il s’agit d’un simple constat de la réalité sans autre objectif que celui de décrire avec exactitude et réalisme la langue telle qu’elle est. Pour les autres, toute description a des répercussions normatives, qu’on le veuille ou non, puisque le grand public y verra une consécration des éléments retenus.
La hantise du joual des années 1950 n’est jamais très loin.
Le nœud de ce conflit d’opinions est la notion de norme et, plus précisément, la description d’une norme du bon usage de la langue française au Québec. Ce qui revient à se demander quel français nous voulons collectivement pour le Québec.
Ce sera notre point de départ et le thème de ce chapitre.
1. La notion de norme linguistique
L’anthropologie culturelle, courant de cette discipline naguère fort vigoureux et productif, s’était fixé comme angle d’étude de la culture d’un groupe ethnique l’identification et la description des croyances et des institutions qui leur étaient propres et qui engendraient des structures sociales originales qui, à leur tour, façonnaient la pensée et la personnalité des membres du groupe. On comprend que ces anthropologues se soient beaucoup intéressés au langage et à la langue, fait social par excellence, instrument de cohésion et élément le plus explicite et le plus distinctif d’un groupe culturel.
Il reste de cette époque des travaux qui ont marqué en profondeur la linguistique.
Edward Sapir (1884-1939), disciple de Franz Boas (1858-1942), tous deux spécialistes des langues autochtones des États-Unis et du Canada, concluait de ses travaux que chaque langue est une représentation symbolique de la réalité ambiante selon une vision du monde propre à chaque culture. Chaque langue découpe et exprime la réalité conformément à cette vision (hypothèse Sapir-Whorf), découpage qui affecte surtout le lexique de la langue, puisqu’il exprime les choses telles qu’elles sont vues ou perçues, par exemple les noms des couleurs ou des différents états de la neige chez les Inuits. La morphologie est aussi influencée. Elle variera d’une langue à l’autre selon, par exemple, la conception du temps et de la manière dont une action se déroule dans le temps qui se reflétera dans la conjugaison des verbes. Ainsi, pour indiquer qu’une action se déroule au moment où le locuteur parle, la langue anglaise utilise le participe présent du verbe, exemple « He is eating ». Pour insister sur la même nuance, le français utilise une périphrase, Il est en train de manger. Autre exemple, la culture répartit les choses d’une manière analogique en mâles (le masculin), femelles (le féminin) ou indifférenciées (le neutre), ce qui s’exprimera dans la forme des noms et des adjectifs, alors que la langue anglaise ne le fait pas. L’ouvrage le plus souvent consulté de Sapir est Le langage, une introduction à l’étude de la parole, dont l’édition originale anglaise date de 1921.
Ruth Benedict (1887-1948), elle aussi spécialiste des langues amérindiennes du sud-ouest des États-Unis, a tiré de ses travaux que, dans chaque société, il existe des consensus sur la manière de faire les choses et de se comporter, notamment pour les gestes de la vie communautaire. Ces modèles sociaux, écrivait-elle, s’imposent aux membres individuels du groupe et orientent leur comportement et conduite. C’est le thème de son ouvrage le plus connu, Patterns of Culture, publié en 1934.
En s’inspirant des travaux de Ruth Benedict, Ralph Linton (1893-1953) a concentré son analyse sur la relation entre la société et chacun de ses membres. Il s’est attaché à déceler en quoi chaque comportement individuel pouvait être original, en dépit de la pression qu’exerçaient sur lui les modèles sociaux. Il publie en 1945 The Cultural Background of Personality, traduit en français en 1959 sous le titre Les fondements culturels de la personnalité[109]. Il y propose une définition de la culture et une analyse de la notion de modèle culturel qui s’applique fort bien à la langue comme réalité sociale.
L’analyse de Linton cerne de près le mouvant équilibre entre conditionnement social et liberté de choix individuel. Pour atténuer ce que peut avoir d’abstrait l’appareil conceptuel auquel il a recours, nous l’appliquerons au fur et à mesure à la langue française. Au besoin, nous l’illustrerons d’exemples de comportements plus familiers et plus concrets empruntés à la manière de manger ou de se vêtir.
La culture, écrit Linton, « est la configuration des comportements appris et de leurs résultats, dont les éléments composants sont partagés et transmis par les membres d’une société donnée » (page 33).
Linton a précisé lui-même ce qu’il entendait par chaque terme de cette définition concise.
Configuration : un ensemble structuré d’éléments interreliés, par exemple des récits, des légendes, des héros inspirés d’un passé commun, des croyances dont découlent une conception du sacré et une morale, une filiation parentale qui relie le passé (les ancêtres) au présent, un art, un artisanat, un mode de production qui se traduisent en œuvres et en produits, une relation avec la nature et la manière d’en tirer des ressources, un mode d’échanges économiques entre les membres du groupe et les peuples voisins qui influence le statut des individus et les relations entre eux, toutes choses qui se traduisent en valeurs, normes, règles de conduite, codes symboliques.
Comportements : parler, manger, se vêtir, se reproduire, commercer, créer une famille et élever des enfants, gouverner le groupe et choisir des chefs, etc. Ce terme n’inclut pas les phénomènes non volontaires, comme respirer, digérer, les pulsions instinctuelles comme celle de se reproduire (mais non les manifestations de la sexualité qui sont du domaine de la culture).
Résultats : les produits de l’activité créatrice et inventive des membres de la société sont inclus dans la notion de culture. En effet, certains de ces produits transforment les comportements, parfois profondément. Par exemple, l’évolution des moyens de transport et de communication a modifié substantiellement les modes d’interaction des membres de la société et leurs relations avec les autres groupes culturels devenus plus accessibles et mieux connus malgré l’éloignement physique.
Le téléphone cellulaire est un bon exemple d’un produit dont les effets sur la société sont évidents. Chacun peut observer les modifications qu’il provoque dans nos comportements. Le changement le plus positif est de libérer la communication téléphonique de sa dépendance au poste fixe et du branchement à un fil ou à un câble. D’autres changements sont négatifs, celui, par exemple, de provoquer l’envahissement de l’espace public par les communications privées, souvent au mépris de la discrétion et de la politesse.
Appris, transmis, partagés : ce sont les éléments fondamentaux de la notion de culture. La transmission des traits culturels par les aînés et leur apprentissage par les jeunes, c’est-à-dire le processus de socialisation, assure à la fois la permanence de la culture et son évolution. En effet, les aînés ne transmettent jamais la culture exactement comme ils l’ont eux-mêmes reçue, car ils l’ont transformée, souvent sans en avoir conscience, au cours de leur existence en s’adaptant au changement de leur environnement. Cependant, ces changements sont ténus, ce qui fait que les membres de la société continuent d’agir et de se comporter sensiblement de la même manière qu’autrefois, parce que les codes de conduite sont demeurés sensiblement les mêmes. Le code est d’autant plus précis et explicite que la pratique sociale qu’il guide est importante pour le groupe, par exemple les liens de parenté et les mariages. Les anthropologues culturels se sont donné pour tâche d’observer et de décrire ces codes de conduite, qu’ils ont appelés modèles culturels, en anglais « patterns of culture ».
La langue est à la fois un élément de la culture et le moyen privilégié par lequel elle se manifeste, par la parole et par l’écriture. Elle est le lien le plus puissant entre les membres de la société, l’instrument par lequel chaque individu s’exprime et communique avec les autres membres de son groupe, l’outil de la création littéraire, poésie, roman, récit épique, conte et légende, et de la communication technique et scientifique lorsque la société a atteint ce point de développement. Si la transmission de la langue s’interrompt, la langue meurt, même si elle peut se survivre à elle-même par les textes écrits, comme la langue latine de l’époque romaine. En se transmettant de génération en génération, la langue se maintient tout en se transformant insensiblement, sans que ses locuteurs s’en rendent vraiment compte. Ce n’est qu’en comparant des états de la langue sur une longue période de temps, à condition cependant qu’on puisse disposer, en nombre suffisant, de documents représentatifs de chaque époque, qu’on peut se faire une idée des transformations qu’a subies une langue. C’est le domaine de la linguistique diachronique.
Linton distingue la culture réelle de la culture construite.
La culture réelle est l’ensemble des comportements individuels de tous les membres de la société, chacun vivant et participant à la vie commune à sa manière en cherchant constamment un compromis entre être soi (avoir sa personnalité, protéger son individualité et ses intérêts personnels) et être de la société (partager le souci du bien commun et de la protection des droits collectifs face aux autres groupes culturels).
La manière de se vêtir permet de mieux comprendre cette notion de culture réelle. D’une société à l’autre, on ne s’habille pas de la même manière. Partout, les hommes et les femmes portent des vêtements différents. Chaque société a sa propre conception de la décence, de ce qu’il convient de montrer ou de cacher, selon qu’il s’agit d’une femme ou d’un homme et selon les circonstances. Par contre, chaque personne est libre de choisir la coupe, le tissu, la couleur d’un vêtement.
La culture construite est le produit de l’activité d’un chercheur, d’un observateur, qui tente d’extraire des comportements individuels les éléments communs à tous et d’arriver ainsi à décrire l’essence même de la culture ou de l’un de ses aspects. C’est le domaine des sciences humaines.
Ainsi, ce sont les auteurs de traités, de manuels ou de livres de recettes qui décrivent les caractéristiques de la cuisine d’une culture (la cuisine française par opposition à la cuisine italienne), ou d’une région (la cuisine provençale), ou à un moment de l’histoire (la cuisine en France au Moyen Âge). Ce sont eux également qui discutent des bonnes manières à table ou qui en retracent l’évolution d’une époque à l’autre, par exemple l’histoire de la fourchette en Europe.
De la même manière, il faut distinguer la langue réelle de la langue construite, c’est-à-dire décrite. Cette distinction est fondamentale pour arriver à dégager par la suite la notion de norme.
La langue réelle est la somme de tous les actes de parole ou de leurs transcriptions en écriture, pour les langues qui s’écrivent. Les actes de parole sont les seules manifestations observables de la langue, qui est une réalité psychique déposée dans la mémoire individuelle durant les premières années de l’enfance et tout au long de la vie adulte. La langue est un ensemble de conventions sociales, sonores et sémantiques. Les conventions sonores sont fondées sur le fait que des sons sont dotés d’une fonction, c’est-à-dire qu’ils permettent d’attribuer des significations différentes à des paires de réalisations sonores distinctes par uniquement un seul son, par exemple père et pire, alors que d’autres sons tout aussi différents ne le permettent pas, par exemple, père et la diphtongue paère qui évoquent tous deux le même concept. C’est par convention également que des significations sont attribuées à des mots ou à des organisations de mots, domaines du lexique et de la grammaire (que les linguistes appellent la morphosyntaxe), car le sens se transmet par ces deux moyens. La langue réelle comporte donc deux faces, une face observable, la parole (prononciation ou écriture) et une face psychique, la langue, qui ne peut se déduire que de l’observation des actes de parole. « En séparant la langue de la parole, enseignait Saussure, on sépare ce qui est social de ce qui est individuel, ce qui est essentiel de ce qui est accessoire et plus ou moins accidentel[110]. » Il poursuivait : « Ces deux objets sont étroitement liés et se supposent l’un l’autre : la langue est nécessaire pour que la parole soit intelligible et produise tous ses effets; mais celle-ci est nécessaire pour que la langue s’établisse; historiquement, le fait de parole précède toujours. […] Il y a donc interdépendance de la langue et de la parole : celle-là est à la fois l’instrument et le produit de celle-ci. »
La langue construite est ce qui résulte du travail d’analyse des actes de parole par des personnes qui en font leur objet d’étude. Elle se présente sous forme de description de la langue réelle. Il y a autant de descriptions qu’il y a de chercheurs qui en observent les manifestations. Les oppositions et les contradictions sont fréquentes entre eux. Comme dans toutes les sciences sociales, la vérité, si tant est qu’il y a ici une vérité, découle des consensus qui se dégagent peu à peu, avec le temps, de ces divergences d’opinion.
Le chercheur décrit les actes de parole ou d’écriture soit d’un seul locuteur, ce qui est plus rare, en général la langue d’un écrivain, celle de Racine par exemple, ou encore, le plus souvent, il décrit la langue d’un groupe de locuteurs, par exemple le français de Montréal ou celui de Paris, ou celle d’un sous-ensemble de ce groupe, le français des banlieues de Paris ou le français populaire de Montréal. Au plus haut niveau d’abstraction, il décrit ce qui est commun à tous les locuteurs d’une même communauté linguistique, en supprimant tout ce qui est particulier aux individus, par exemple le français du Québec, ou commun à tous les locuteurs de la même langue indépendamment du pays ou de la région où ils habitent, pour dégager ce qui constitue la langue en soi, par opposition à toutes les autres langues du monde.
Ce travail d’analyse et de synthèse est, en général, exécuté par des spécialistes, les linguistes, les sociolinguistes, les lexicographes et les terminologues, les sémanticiens et sémiologues, les sociologues et les philosophes, en somme un grand nombre de personnes tant les angles d’analyse de la communication par la langue sont variés. Leurs travaux se présentent sous forme d’articles ou d’ouvrages plus ou moins savants, mais aussi sous forme d’ouvrages utilitaires, des grammaires ou des dictionnaires, par exemple. Des amateurs peuvent s’adonner au même type de travail, avec des résultats plus ou moins heureux.
Les descriptions de la même langue sont donc nombreuses. Ne retenons que celles des linguistes pour illustrer ce point. La représentation de la langue qu’ils construisent à partir de leurs observations d’actes de parole peut varier dans toutes les directions. Elle dépend de l’aspect de la langue qui retient leur attention, la phonétique ou la phonologie, la morphologie ou la syntaxe, le lexique ou la sémantique. La représentation dépend aussi du nombre de locuteurs dont on observe les actes de parole, de leur localisation géographique ou de leur situation sociale et du niveau d’abstraction auquel le chercheur situe son analyse : plus le niveau d’analyse s’élève, plus il élimine des variables pour atteindre le plus général. Elle dépend surtout de la position du chercheur par rapport à la norme : sa description se veut-elle, en principe, strictement objective ou se préoccupe-t-il de tenir compte du statut social des faits qu’il observe, c’est-à-dire des jugements que portent sur eux les locuteurs eux-mêmes? Enfin, un chercheur peut s’intéresser à l’histoire de la langue pour retracer son évolution sur une très longue période de temps.
La distinction entre réel et construit s’applique à la notion de modèle culturel.
Un modèle culturel est une certaine conception de la manière dont il faut (modèle réel) ou dont il faudrait (modèle construit ou modèle idéal) se comporter ou agir au sein d’un groupe social donné. Il y a autant de modèles culturels qu’il y a de catégories de comportements sociaux. De plus, chaque sous-groupe de la société peut avoir ses propres modèles, plus ou moins différents et en concurrence, parfois même en conflit.
En linguistique, on appelle normes les modèles culturels qui régissent l’emploi de la langue dans les groupes de locuteurs. Pour une même langue, il peut exister une grande variété de normes selon la complexité de la société et selon que la langue s’est diffusée dans des communautés culturelles distinctes, comme il arrive pour les grandes langues européennes, le français, l’anglais, l’espagnol.
Les locuteurs individuels ne sont pas totalement libres d’employer la langue à leur gré. Du moins leur liberté est-elle relative, soumise à la pression du groupe et au jugement des autres locuteurs.
Un modèle culturel réel correspond à une aire de variabilité possible des comportements à l’intérieur de laquelle les comportements individuels sont jugés acceptables de la part des membres du groupe et à l’extérieur de laquelle ils sont susceptibles de provoquer chez eux des réactions, positives (admiration, félicitation) ou négatives (blâme, punition). Un modèle réel, donc une norme, n’est pas un diktat, l’imposition d’une manière unique de faire quelque chose, de s’habiller ou de parler, il laisse à chaque individu, à chaque locuteur dans le cas de la langue, une certaine initiative de faire les choses à sa manière, mais à condition de respecter les frontières de la variation admise par le groupe. S’il s’en écarte, en parlant ou en écrivant, c’est à ses risques et périls. Ainsi, en littérature, les surréalistes ont poussé à son extrême la transgression linguistique jusqu’à devenir incompréhensibles pour le plus grand nombre des lecteurs.
En linguistique, l’expression norme sociale correspond à celle de modèle réel. Il existe autant de normes sociales qu’il y a de groupes linguistiques différents au sein de la société[111]. Le sociologue Pierre Bourdieu[112] a tiré de cette variation l’idée de marché linguistique. Selon cette métaphore, les membres de la société attribuent une valeur sociale à chaque variante et accordent à l’une d’elles la valeur d’usage légitime, de langue standard, qu’il convient d’utiliser comme langue commune dans toutes les communications institutionnalisées (langue de l’École, langue de l’État, langue littéraire et des médias, langue de l’activité scientifique et économique, langue des débats publics, etc.). Dans ce marché, le statut linguistique de chaque locuteur dépend de la valeur sociale attribuée à la variante de la langue qui est la sienne. Les locuteurs dont la langue maternelle est la langue standard y occupent une position privilégiée, puisqu’elle coïncide avec l’usage légitime reconnu par la société.
Les francophones du Québec ont une idée précise de la manière dont il convient de parler ou d’écrire la langue française au Québec. L’existence d’une norme sociale légitime est incontestable. Toutes les enquêtes arrivent à cette conclusion et au même consensus social sur la nature de cette norme, depuis la première, celle de la commission Gendron, jusqu’à la dernière, celle de l’Office québécois de la langue française en 1999[113]. Aucune étude n’existe qui démontrerait le contraire. Ce n’est donc pas sur l’existence de la norme que porte la discussion mais sur la légitimité et la description d’une norme québécoise.
Un modèle culturel construit est une aire de plus petite surface au centre du modèle réel. Il est le résultat de l’analyse du chercheur ou de l’observateur. La validité d’un modèle construit dépend entièrement de la qualité et de la rigueur de l’analyse, d’une part, de la convergence entre les conclusions des différents chercheurs ou observateurs, d’autre part.
En linguistique, l’expression norme objective recouvre celle de modèle construit. Elle varie selon l’aspect de la langue que décrit le chercheur ou l’observateur, la prononciation, la syntaxe ou le lexique. La langue standard est une forme particulière de modèle construit, qui intègre dans une même description la langue elle-même et l’évaluation sociale des faits de langue dont se dégage la forme la plus admise par l’ensemble des locuteurs.
Un troisième type de modèle existe, le modèle idéal, la norme idéale si on parle de la langue. Il représente l’opinion unanime des membres de la société, des locuteurs de la langue, sur la façon dont il faudrait se comporter en certaines situations, surtout celles qui engagent l’interaction entre tous les membres de la société. Le modèle idéal est une abstraction qui ne coïncide jamais ni avec les modèles réels ni avec les modèles construits. Il est un élément de la culture, une institution, d’autant plus proclamée qu’elle est souvent transgressée par les membres du groupe.
En linguistique, le modèle idéal se confond avec la norme, la langue. C’est la base du discours puriste dont les tenants contestent la légitimité de la variation de la norme réelle et, par la suite, construite et s’opposent fermement à ceux qui soutiennent la théorie de la coexistence de plusieurs normes linguistiques en langue française. Il n’y aurait qu’une langue française et qu’une seule norme, celle de Paris, dont on atténue le caractère centralisateur sous l’euphémisme de français international.
Le débat sur la norme du français au Québec porte uniquement sur ces deux points, la légitimité et la description d’une norme québécoise du français, différente de la norme française et qui se manifeste surtout dans la prononciation et le lexique. La situation n’est pas simple. D’une part, l’attention au Québec se porte depuis longtemps et le plus souvent sur la langue parlée, tout particulièrement au niveau familier et populaire, que l’on compare à la norme française hexagonale, fondée sur la langue écrite urbaine, traditionnellement parisienne et illustrée par les « bons » auteurs. Les deux termes de la comparaison ne sont vraiment pas du même niveau et les conclusions qu’on en tire sont injustes, injustifiées et non recevables en saine logique. D’autre part, la référence aux textes littéraires comme critère de la norme québécoise est plus délicate ici qu’en France, à cause de l’existence de la littérature joualisante, surtout de la grande époque, quand elle avait valeur d’illustration des conséquences de la domination de la langue anglaise, de l’aliénation linguistique conséquente des Québécois qui se manifestait dans la langue et le lexique.
2. Les fonctions de la norme linguistique
Pour tous les usagers de la langue, au Québec comme ailleurs, la norme a pour fonction générale de guider leur emploi de la langue, de leur indiquer comment il convient de parler ou d’écrire pour être compris et accepté des autres locuteurs. Ce rôle découle toujours d’une perception intuitive de la norme lors de l’usage spontané de la langue au jour le jour. En cas de doute ou de malaise, le locuteur individuel cherche autour de lui une réponse, soit en observant les réactions de ses interlocuteurs, ce qui peut lui servir de réponse pragmatique, soit en consultant des locuteurs plus avertis ou des ouvrages de description de la norme, s’il en existe, ce qui lui donne une réponse plus autorisée, plus sûre.
Car il y a bien des manières de parler ou d’écrire la langue de sa propre société, selon les circonstances ou selon les groupes de locuteurs. Au Québec en particulier, l’écart est considérable entre les locuteurs du français selon qu’ils sont instruits ou le sont moins, selon qu’ils maîtrisent ou ne maîtrisent pas les niveaux de langue. Les écarts entre les niveaux de langue sont plus marqués ici qu’en France, surtout en langue orale, entre le niveau populaire urbain, stigmatisé sous le nom de joual et le niveau familier, entre le niveau familier et le niveau soutenu en langue orale et écrite.
La variation est encore plus grande lorsque la même langue s’est diffusée et implantée dans des sociétés distinctes, comme il arrive au français, à l’anglais et à l’espagnol, pour ne mentionner que ces langues qui nous sont familières. Elle est évidente au Québec, dont l’usage de la langue française n’est pas et ne peut pas être identique à celui de France ou d’ailleurs parce que le français sert ici à exprimer un environnement particulier et parce que son destin est différent de celui de la France depuis la séparation d’avec la mère patrie. C’est la principale cause des malaises et des doutes.
L’explicitation de la norme du français au Québec sert à distinguer dans cette variation continue ce qui est acceptable de ce qui ne l’est pas, de l’avis même des locuteurs. Car la description de la norme repose sur une double observation, une observation des usages de la langue et une observation des jugements que les locuteurs eux-mêmes portent sur la valeur sociale qu’ils leur accordent, les jugeant tantôt utilisables en toutes circonstances, tantôt d’un usage restreint selon les circonstances, tantôt inadmissibles, à éviter à tout prix, à moins de vouloir en tirer des effets par violation de ce tabou linguistique. Ce tri, ce classement des faits de langue, répond aux questions des usagers, leur fournit un mode d’emploi nuancé de la langue, en somme leur apporte la sécurité. Le succès d’un dictionnaire comme le Multidictionnnaire de la langue française[114] confirme ce besoin des usagers de la langue.
L’explicitation de la norme sert aussi à préciser la nature du français standard québécois, un usage de la langue française propre au Québec qui maintient cependant la communication avec tous les autres francophones du monde, en langue parlée et en langue écrite. Vouloir décrire cette norme n’est ni une forme d’exhibitionnisme linguistique, ni faire la promotion d’un néo-créole autochtone composé d’un mélange de français et d’anglais, encore moins faire montre de séparatisme linguistique militant. Il s’agit essentiellement de proposer un modèle qui puisse guider l’emploi des variantes du français québécois entre nous et avec les autres francophones.
Enfin, il est impossible d’enseigner une langue sans disposer d’une norme du bon usage de cette langue. L’Association québécoise des professeurs de français (AQPF) avait fermement pris position sur ce point dès 1977 en adoptant la définition suivante du français standard québécois : « le français standard d’ici est la variété de français socialement valorisée que la majorité des Québécois francophones tendent à utiliser dans les situations de communication formelle[115]. » Il restait à décrire cette variété, ce qui n’est pas encore fait aujourd’hui. La tâche est si délicate que chaque essai s’est transformé en polémique et qu’aucun consensus n’existe encore au Québec sur la norme de l’usage québécois.
3. Y a-t-il deux normes linguistiques au Québec[116]?
Assistons-nous actuellement, au Québec, à la concurrence d’une double légitimité linguistique, l’une inspirée de la langue populaire, l’autre de la langue soutenue écrite et de son registre familier en langue parlée?
La première découle de l’emploi, de plus en plus fréquent, de la langue populaire au cinéma, dans les téléromans, chez les humoristes et les chansonniers, à la télévision et à la radio, toutes circonstances où, autrefois, on n’aurait pas employé ce niveau de langue. Cette valorisation sociale de la langue populaire suscite à la fois plaisir et malaise, assentiment et réprobation. Elle génère une certaine confusion quant à la norme du français au Québec, qui s’installe peu à peu dans les esprits. Elle conforte une partie de la population dans l’idée qu’elle n’a pas à modifier son usage de la langue française (prononciation, syntaxe, vocabulaire).
La seconde se fonde sur son emploi par l’Administration et par le personnel politique, par le fait qu’elle est à la fois la langue enseignée à l’école et à l’université (du moins, en principe), la langue d’enseignement de toutes les matières et par le fait qu’elle est illustrée par la littérature (en principe, ici aussi). Enfin, elle est celle de nos relations avec les autres pays de la Francophonie et avec tous les francophiles de la planète. La Charte de la langue française lui a conféré le statut de langue officielle du Québec.
Quelles seraient les conséquences sociales, culturelles et linguistiques de cette dichotomie si elle s’accentuait? Assistons-nous à un relâchement généralisé de la manière de parler et d’écrire, à un affaiblissement du contrepoids de la langue standard?
La question est d’ordre social avant d’être d’ordre linguistique.
Elle renvoie à la manière dont une communauté linguistique conçoit et proclame son identité par et à travers la langue. Elle touche tous les usagers de la langue et, d’une manière toute particulière, les créateurs et les communicateurs, de la radio, de la télévision et des médias écrits, pour qui la langue est l’outil de travail et d’expression.
Cette question implique également qu’on réfléchisse à la manière dont un usage de la langue acquiert sa légitimité, c’est-à-dire comment il devient la norme, la forme standard de la langue, acceptée par l’ensemble de la communauté linguistique comme référence et modèle.
D’où vient cette valorisation du français populaire, pourquoi ce niveau de langue acquiert-il maintenant un certain droit de cité, une certaine forme de légitimité?
La réponse est évidente : ce qui valorise le français populaire parlé est son emploi de plus en plus fréquent chez les créateurs (écrivains, cinéastes, humoristes, publicitaires) et sur les ondes des médias, souvent au nom de la spontanéité, pour donner une allure plus familière, plus conviviale, à une émission.
On constate même un certain militantisme de la langue parlée populaire au nom de l’identité québécoise, comme si notre spécificité culturelle et sociale était ainsi mieux exprimée, comme si elle se cristallisait dans cette langue et dans la tranche de la population dont c’est l’usage, le « vrai monde » dont se font les champions certains politiciens populistes en mal de votes ou d’animateurs et de chroniqueurs en mal de cote d’écoute. D’où vient l’idée que le « vrai monde » comprend mieux quand on massacre le français? Le « vrai monde » comprend tout aussi bien la langue standard dont il a une réelle connaissance, du moins pour la comprendre sans problème. Ce n’est tout de même pas une langue étrangère!
Divers arguments sont avancés pour expliquer, légitimer, excuser le choix de ce niveau de langue, arguments d’ailleurs exposés le plus souvent en un français impeccable par les personnes qui les invoquent.
On a dit que c’est par dérision, surtout au début de la période de la littérature dite « jouale », à l’époque de Jacques Renaud, de Gérald Godin ou des Belles-Sœurs de Tremblay. Ces écrivains voulaient, par ce moyen, illustrer l’état d’aliénation économique et linguistique du peuple québécois. Il s’agissait alors ni plus ni moins que d’un réquisitoire, mais en négatif, pour ainsi dire, en faveur du français en montrant par cette forme de notre langue où nous avaient menés collectivement notre dépendance à la langue anglaise et notre sous-scolarisation chronique si bien démontrée par la commission Parent. Par cet électrochoc, ces écrivains espéraient provoquer une réaction de fierté et, surtout, une réaction politique. La réaction politique s’est produite sous la forme d’une législation linguistique, mais la réaction de fierté ne s’est pas produite. Bien au contraire, le « joual » en est sorti valorisé et s’est transformé en un style littéraire, devenu tout aussi respectable que l’écriture en langue standard, dont beaucoup d’écrivains, de dialoguistes et de chansonniers se réclament aujourd’hui.
Ce passage s’est fait au nom de la vraisemblance, par souci de réalisme linguistique quand on donne la parole, au théâtre ou dans le récit, à des personnages appartenant à un milieu populaire, aujourd’hui souvent défavorisé. Mais c’est une vraisemblance reconstituée. L’écriture, et donc le texte des dialogues, est une construction, une imitation, sous l’entière responsabilité de l’écrivain (ou du dialoguiste au cinéma), dont la réussite dépend de la connaissance qu’il a de cet usage de la langue et du choix des éléments qu’il retient pour recréer la langue populaire, prononciation et vocabulaire surtout. On peut donc pousser plus ou moins loin la reproduction de la langue populaire et tenir plus ou moins compte de la réaction du public ou de sa capacité à comprendre cette langue. La question se pose tout particulièrement au cinéma quand on exporte un film québécois. Dans les textes littéraires, les romans tout particulièrement, on observe de plus en plus un écart entre la langue du récit, c’est-à-dire la langue d’écriture de l’auteur, et la langue attribuée aux personnages, où le souci de vraisemblance est légitime.
Ou encore, on dit que c’est par ironie qu’on a recours à la langue populaire, pour faire rire, à tel point qu’on dirait que ce niveau de langue est devenu la langue normale de l’humour au Québec, comme si c’était la seule manière de faire rire et d’avoir du succès. Pourtant, le clown Sol[117] a démontré le contraire pendant toute sa longue carrière en faisant rire les enfants et les adultes par ses jeux de mots acrobatiques, qui suscitaient dans l’esprit de ses auditeurs des associations d’idées aussi inattendues que drôles.
Chez les linguistes, ou chez les personnes qui discutent de ces questions, on a recours généralement à deux types d’argument : l’usage et la fréquence.
Le concept d’usage est ambigu. À quelle forme de la langue renvoie-t-il : à la forme écrite?, à la forme parlée?, aux deux à la fois? Renvoie-t-il à l’usage québécois du français, à l’usage français bourgeois et parisien à l’exclusion des autres niveaux de langue dans la région parisienne et des particularismes des diverses provinces de France, accent et vocabulaire compris? Pour décrire la norme, suffit-il d’observer l’usage? Depuis Vaugelas, c’est-à-dire depuis le XVIIe siècle, la réponse est non, puisque, comme il l’écrivait, il y a un bon et un mauvais usage de la langue. Suivre l’usage français de Paris met déjà et mettra de plus en plus les locuteurs québécois devant un dilemme concret du fait que le français, en France, est en pleine période d’anglomanie et d’anglicisation accélérée, exactement comme le français au Québec à la fin du XIXe siècle et durant la première moitié du XXe. La source de cette anglomanie française est la même, la domination économique de l’anglo-américain. Faudra-t-il introduire les anglicismes des Français dans la norme du français au Québec, au nom de la norme française, uniquement parce qu’ils ont été admis dans les dictionnaires publiés en France? Ne devrait-on pas, au contraire, maintenir notre attitude de rejet des emprunts inutiles et chercher à convaincre les Français d’en faire autant? Ce serait le comble, pour nous, d’être aujourd’hui anglicisés par les Français! Toutes questions qui, en général, demeurent dans un flou artistique dans les textes ou lors des discussions.
D’autre part, la rectitude politique fait aujourd’hui des ravages, même en linguistique. On ne peut plus dire qu’un usage est bon ou mauvais, comme le faisait Vaugelas à son époque ou Grevisse en intitulant sa célèbre grammaire Le Bon Usage. On évite la condamnation, on préfère parler de niveaux de langue et, même là, on hésite à les hiérarchiser ou à les désigner avec des qualificatifs trop marqués, comme vulgaire ou populaire. Ou encore, on évite le mot « norme », jugé trop prescriptif, trop directif. Selon la mode actuelle, il vaut mieux utiliser l’expression « français de référence » pour désigner le français décrit par les dictionnaires et les grammaires publiés en France. On évite ainsi d’attirer l’attention sur le problème de l’antinomie ou de la complémentarité entre Paris et le reste de la francophonie, y compris le Québec, et donc de remettre en cause la conception de la langue française que véhiculent ces ouvrages, fondée sur le seul usage parisien bourgeois écrit. L’argument de l’usage est donc en soi flou et ne peut être employé qu’avec précaution. Surtout, il ne doit jamais servir d’argument d’autorité.
La fréquence d’un mot, d’une prononciation, d’un tour syntaxique est-elle un meilleur argument?
Le constat de la fréquence découle de l’observation d’un échantillon de langue, d’un corpus disent les linguistes. La validité de l’argument dépend entièrement de critères qui relèvent de la science statistique, taille et représentativité du corpus selon sa composition en fonction des objectifs de la recherche, par exemple pour constituer la nomenclature d’un dictionnaire de la langue standard. Par le traitement informatique de l’échantillon, on peut repérer toutes les formes lexicales qui figurent dans les textes et les classer par ordre de fréquence. On obtient ainsi une image du lexique réel du corpus, sans plus, qu’il faut souvent compléter en y ajoutant le vocabulaire de disponibilité, c’est-à-dire les mots connus de tous mais de faible fréquence qu’on emploie uniquement quand la situation ou le sujet traité l’exigent, des mots comme fourchette, tibia ou radiateur.
La fréquence est une donnée brute, le point de départ de l’analyse sémantique et sociolinguistique à conduire selon d’autres critères. Dans le cas concret de la description du lexique du français en usage au Québec, le plus important n’est pas de savoir si un mot ou un sens est en usage au Québec, depuis quand et à quelle fréquence, mais bien de juger si ce mot, ce sens doit figurer dans le dictionnaire de la langue standard et, si oui, d’indiquer si son emploi est neutre ou s’il est d’usage restreint, ce qu’on peut indiquer par l’ajout de marque du type vieilli, familier, vulgaire, spécialisé.
On revient ainsi au point précédent, à la notion de marché linguistique et à l’obligation de juger de la valeur d’un mot, d’un sens, dans la hiérarchie sociale des usages au sein de la communauté linguistique, en observant la manière dont les locuteurs réagissent et apprécient ces mots ou ces sens et en tenant compte du débat auquel ils donnent parfois lieu. C’est le cas des jurons et des sacres, mais aussi des emprunts à l’anglais, en faisant la distinction entre emprunts nécessaires et emprunts inutiles. Dans ce dernier cas, on constate que le comportement et l’appréciation des locuteurs se modifient selon qu’il s’agit d’une forme lexicale anglaise, par exemple tire, anglicisme inutile évident, ou d’un sens anglais attribué à tort au mot français identique, par exemple filière au sens de « classeur », anglicisme nettement plus difficile à repérer et donc plus fréquent. En définitive, l’analyse linguistique, selon le critère de l’usage et de la fréquence, apporte une certaine objectivité au débat sur la norme, mais n’échappe pas elle-même à la subjectivité pour trancher les cas litigieux, tout comme sont subjectifs les choix des écrivains, des journalistes ou des humoristes. D’où le débat qui entoure la publication de tout dictionnaire qui prétend décrire le lexique standard du français au Québec, débat dont se dégagera peu à peu un consensus sur la norme.
La tendance à valoriser le français populaire que nous dénonçons ici est inquiétante pour au moins trois raisons.
Elle compromet la nécessaire rectification de la langue française au Québec. En effet, nous avons collectivement entrepris, dans les années 1960, de remédier à deux cents ans d’anglicisation et d’ignorance de la langue standard, écrite et parlée. Aujourd’hui, on dirait que cet effort s’affaiblit, à l’école comme dans les médias, qu’on s’accommode d’un héritage douteux plutôt que d’y faire le ménage.
Elle contribue à la fracture sociale du Québec en partageant les locuteurs en deux groupes de plus en plus distincts et antagonistes, chacun se réclamant de son usage.
Elle accentue la confusion qui entoure la description de la norme du français au Québec. Elle brouille l’image que les francophones du Québec projettent de leur langue chez les immigrants et chez les visiteurs. Elle rend plus difficile la compréhension des textes ou des films québécois à l’étranger.
4. Esquisse d’une description de la norme du français au Québec
Le plus grand nombre de textes ou d’ouvrages disponibles sur le sujet traitent surtout, pour ne pas dire uniquement, de la légitimité d’une norme du français propre au Québec. Le débat sur ce point renaît sans cesse, nous n’en sortons pas, bien que les deux thèses en présence aient été défendues avec fougue et brio à la fin de la querelle du joual, la première par Henri Bélanger, dans Place à l’homme, Éloge du français québécois (1972), la seconde, par Jean Marcel, Le joual de Troie (1973). D’autres ouvrages retracent l’histoire de cette confrontation d’opinions, par exemple l’excellente synthèse de Chantal Bouchard, La langue et le nombril, titre pour le moins curieux, à moins de vouloir ainsi exprimer un certain ras-le-bol à l’endroit de cette obsession collective.
Pour être complète, la description de la norme du français standard québécois devrait toucher les trois composantes de ce français, la prononciation, la grammaire (morphologie et syntaxe) et le lexique.
La prononciation
Depuis les débuts de la linguistique dans les universités du Québec, les spécialistes de la phonétique (description physique des sons) et de la phonologie (étude de la fonction discriminative des sons) ont étudié et décrit en détail les sons et la prononciation du français au Québec à tous les niveaux de langue. Les textes savants en ce domaine sont nombreux, les connaissances, disponibles. Par contre, il existe peu de textes de vulgarisation, encore moins un véritable traité de la prononciation du français québécois. Une seule exception notable, l’ouvrage de Luc Ostiguy et de Claude Tousignant, Le français québécois, Normes et usages. Malgré son titre très englobant, il s’agit uniquement d’une étude de la prononciation québécoise à l’intention du personnel enseignant, et du grand public par ricochet.
Au niveau soutenu, la prononciation du français au Québec est très proche du système phonologique du français, mais s’en distingue par quelques traits. Par contre, l’écart augmente au fur et à mesure qu’on passe au niveau familier, puis au niveau populaire urbain. À la limite, on arrive à des phrases incompréhensibles à tout autre francophone qu’à un locuteur d’ici, surtout quand s’y trouvent amalgamés la prononciation, le vocabulaire et la structure de la phrase, par exemple la réponse È là qua watch à la question Ou qua lé, la police?
Grosso modo, on peut classer les faits de prononciation du français au Québec en trois groupes :
- des oppositions de voyelles conformes à la phonologie du français, mais que les locuteurs ne font plus en France :
- maintien de l’opposition é/è : mai/mais;
- maintien de l’opposition è bref et è long : belle/bêle, tète/tête;
- maintien de l’opposition entre a antérieur et a postérieur : patte/pâte, tache/tâche;
- maintien de l’opposition entre in et un : brin/brun.
Ces prononciations font partie de la norme du français québécois.
- des prononciations de voyelles et de consonnes non conformes au système du français, cependant trop profondément ancrées dans l’usage québécois pour qu’on puisse songer à les éradiquer :
- l’ouverture des voyelles i, u, et ou : ri/rite, doux/doute, lu/ lune;
- l’affrication de t et de d devant i et u : maladie/mala(dzi), pendu/pen(dzu), titanic/(tsi)tanic, tuteur/(tsu)teur.
Ces prononciations sont admises avec réserve, en souhaitant que le locuteur québécois les atténue dans sa prononciation du français.
- des prononciations qui ne font pas consensus au Québec et qui, en conséquence, ne peuvent faire partie de la norme québécoise :
- la prononciation très fermée de la voyelle a, qui se rapproche alors du son o, soit en fin de mot, comme dans Canada, tabac, soit à l’intérieur d’une syllabe, comme dans phare qui ressemble à fort, part/port, quart/corps, tard/ tort;
- la diphtongaison des voyelles longues, ga(raa)ge, (baè)te, (taè)te, (faè)te, (caeu)r;
- la prononciation de è en a : ferme devient farme, je vais devient je va et jva si on laisse tomber le e selon les règles d’élision de ce e dit caduc pour cette raison;
- la prononciation du groupe oi (wa) en (wé) comme dans moé, toé, ou parfois en (wè) comme dans poèl (poil) ou même simplement en è, comme dans c’est tout drèt (c’est tout droit);
- la réduction du pronom il à i au singulier (i s’en vient), à i ou iz au pluriel (i s’en vont, iz ont raison);
- la transformation du pronom elle au singulier en a (a s’en vient) ou en al devant voyelle (al est partie). Au pluriel, le pronom elles devient soit è (è sont bonnes, les pommes), soit èz devant voyelle (èz ont été bonnes) ou même iz (iz ont été bonnes). Lorsque le pronom elle précède le verbe est, il se fond avec lui, elle est bonne se réduit alors à è bonne, le è valant alors pour le pronom et le verbe.
- l’escamotage de sons, soit à l’intérieur des mots comme dans univers(i)té, cat(é)chisme, soit de la consonne l et r en fin de prononciation table devient tab, peuple devient peup, soit dans des groupes de mots, dans la cour devient dan cour, sur la table devient su la tab, ou sua tab, finalement sa tab avec un a long pour le distinguer de sa table, dans les devient din, comme dans è tombé din pom.
- en cumulant plusieurs de ces phénomènes, une phrase complète peut se réduire à peu de chose, par exemple tu sais ce que je veux dire se comprime en tsé veux dire, ou encore ça fait que donne fak ou fake comme dans fake jy ai di. Autre exemple, la phrase C’est une fille qui sait où elle va, qui n’a pourtant rien de compliqué, ni de spécialement sophistiqué, donne ctune fill qui sé ousqua va. Dernier exemple, la phrase en français populaire urbain : inqua wère, on wè bin qu’on wé rien (rien qu’à voir, on voit bien qu’on voit rien), ou encore les formes suivantes de la même phrase j(e) vais y aller (niveau neutre), j(e) m’en vais y aller (niveau familier), jm’en va y aller, m’en va jaller (niveau populaire).
Ces quelques indications donnent une idée de la distance entre langue parlée et langue écrite au Québec et de la manière dont il convient ou ne convient pas de parler français au Québec, de l’avis même des locuteurs québécois.
La grammaire, morphologie et syntaxe
La distinction entre la grammaire de la langue parlée et celle de la langue écrite est ici primordiale, aussi bien pour la langue française que pour toutes les langues du monde. La différence entre ces deux formes de la langue touche l’organisation de la phrase (la syntaxe), mais aussi la forme des mots ou des groupes de mots (la morphologie), à cause des phénomènes phonétiques qui la modifient parfois. Ainsi, le groupe écrit je suis peut se prononcer tel quel ou devenir jsuis par élision du e caduc, aussi bien en français hexagonal qu’en français québécois.
La syntaxe de la langue parlée est spontanée, c’est la création d’une forme à une pensée en train de naître, de se préciser, une syntaxe totalement dépendante des circonstances et des émotions du moment, influencée par la présence du ou des interlocuteurs et par leurs réactions. La phrase suit le mouvement de la pensée ou de la conversation en temps réel, au gré des abandons et des reprises, des interruptions et des changements de direction. Il faut avoir, un jour, transcrit un exposé improvisé, qui avait pourtant semblé brillant et élégant, pour se rendre compte des conséquences de la spontanéité : la transcription est trop éloignée de la langue écrite pour qu’on puisse la publier dans sa forme originale.
La phrase écrite naît en des circonstances totalement différentes, dans le calme et la réflexion. L’auteur peut s’arrêter, abandonner une phrase, en reprendre une autre, modifier celle-ci en partie, jusqu’à ce qu’il ait trouvé la phrase qui lui semble être la meilleure expression de sa pensée. De plus, il a autour de lui tous les moyens d’être fidèle à la grammaire, à la stylistique, au lexique. Il est le maître d’œuvre absolu de sa phrase. On comprend pourquoi les grammaires décrivent toujours la morphologie et la syntaxe de la langue écrite.
Les Québécois francophones écrivent le français selon la morphologie et la syntaxe de la langue française.
Par contre, l’écart entre la morphologie et la syntaxe de la langue parlée au Québec et la norme de la langue écrite est variable. L’écart est pour ainsi dire nul en langue parlée soignée. Il augmente de plus en plus en passant à la langue familière, puis à la langue populaire, enfin à la langue triviale, celle des locuteurs les moins scolarisés, la plus éloignée de la norme standard. Car il y a une relation très directe entre la manière d’employer la langue et le niveau de scolarisation des personnes et leur degré de familiarité avec la langue écrite, notamment par la lecture. On comprend que les linguistes québécois se soient surtout intéressés à la langue populaire, qui offre prise davantage à une description comparative que la langue soignée ou même familière. Par contre, peu de linguistes français ont décrit la grammaire de la langue parlée en France, ce qui nous prive de tout point de comparaison.
Voici quelques exemples de faits grammaticaux caractéristiques de la langue parlée québécoise[118]. Les uns s’observent parfois en langue familière, d’autres uniquement en langue populaire ou triviale :
- la morphologie des pronoms personnels il et elle à la suite de l’élision de la consonne « l » et de la transformation du son « è » en « a », l’un et l’autre évoqués précédemment à l’item prononciation;
- la généralisation du pronom relatif que à la place de dont, c’est ce qu’on a besoin;
- la contraction des prépositions de, dans et sur devant les articles le, la, les, également décrite plus haut;
- les formes nominales des pronoms personnels, régulières au singulier, moi, toi, lui, elle, mais suivies par autres au pluriel, souvent prononcé aut (nous-autres, vous-autres, eux-autres), exemple moi, j’en suis certain, eux-aut le sont pas;
- les phrases interrogatives et exclamatives à l’aide de – tu, parfois – ti, ce dernier procédé en perte de vitalité : tu viens-tu?, i vient-tu de loin?, les enfants sont-tu venus?, faut-tu être niaiseux!;
- le curieux emploi de l’adverbe de négation pas, soit en redoublement de la négation : ya pas personne dan cour (il n’y a personne dans la cour), soit devant ou à la suite de la préposition avec pour créer une négation : avec pas de moutarde, à la place de sans moutarde, ouvrir le festival de Toronto pas avec un grand film (sans un grand film);
- la confusion des prépositions à et de en faveur de sur, à la suite d’un verbe, probablement sous l’influence de la préposition anglaise on : parler sur ce sujet (de ce sujet), réfléchir sur son avenir (à son avenir), discuter sur la question (de la question);
- la mise en évidence d’un élément de la phrase est plus fréquente en langue parlée qu’en langue écrite : elle, a veut pas, mon père, yéfort, c’est qui qui vient?; de l’argent, j’en ai besoin.
Certains incluent dans la morphologie la féminisation des noms de titres ou de fonctions. En réalité, il s’agit de créations lexicales, puisque ces formes sont produites en appliquant les règles normales de la formation des féminins en français. Une exception : le traitement des mots épicènes (qui valent à la fois pour un homme et pour une femme, ministre, par exemple), dont on lève l’ambiguïté soit en ajoutant le e caractéristique de la formation du féminin pour bien marquer le sexe de la personne, exemple écrivaine, auteure, professeure, docteure, soit en le faisant précéder d’un article féminin bien qu’il soit, en principe, masculin, exemple la ministre, la consule (avec le e du féminin), la chef de service, ma médecin, qu’on entend de plus en plus souvent.
Le lexique
Le lexique du français au Québec ne peut pas être en tout point semblable à celui de France pour au moins deux motifs.
L’histoire de la langue française au Québec est différente de celle de France depuis les toutes premières années du peuplement de la vallée du Saint-Laurent. La composition de la population de la Nouvelle-France a été, au départ, un échantillon de celle de la France de l’époque, un mélange de personnes qui parlaient tantôt le français d’Île-de-France, tantôt à la fois le français et le dialecte de leur région, tantôt surtout leurs dialectes. Tous vivaient, dans une grande interdépendance, la même aventure dans un environnement qui leur était complètement étranger. Ces nouveaux arrivants sont entrés en contact avec les premiers occupants du pays, les Amérindiens et les Inuits, qui leur ont donné des mots pour désigner leurs coutumes et des réalités inconnues des colons. Il en est sorti une première forme du français caractéristique de la Nouvelle-France, dont le destin a bifurqué brusquement lors de la cession de la Nouvelle-France à l’Angleterre. À partir de ce moment, le français de la Nouvelle-France évoluera en marge du français de France et sera fortement soumis à l’influence de la langue anglaise. Nous avons plus longuement évoqué ces faits dans le premier chapitre de la première partie de ce livre.
Depuis le début de la Nouvelle-France jusqu’à maintenant, les Québécois ont dû et doivent trouver les moyens de nommer leur environnement physique, culturel et politique, qui n’est pas identique à celui de la France dans bien des cas. Il leur faut nommer le territoire, la flore et la faune, les institutions politiques et administratives, les us et coutumes, les nouvelles réalités techniques et technologiques très souvent originaires du voisin américain et donc importées en anglais, ou encore les innovations de la créativité québécoise, choses et mots. Ces mots et ces sens québécois ne constituent pas une proportion importante du lexique utilisé par les Québécois, 15 % au maximum, mais ils leur sont nécessaires. Pour ces raisons, le lexique du français québécois comporte de nombreux mots et sens qu’on ne trouve pas dans les dictionnaires publiés en France, puisqu’ils sont destinés avant tout aux locuteurs français qui n’en ont pas besoin. La variation du lexique est inévitable, nécessaire et parfaitement légitime.
5. La description du lexique du français québécois
Le lexique réel du français au Québec, dans ses différents niveaux d’usage, garde en lui les traces de son passé et de son adaptation à un pays neuf. C’est un ensemble de mots et de sens très composite d’origine et de statut différents.
Dès le milieu du XIXe siècle, les travaux de description de ce lexique ont eu pour objectif de classer ces mots et ces sens en catégories pour mieux ensuite décider de leur sort, selon qu’ils étaient à conserver ou à éliminer. L’attention s’est d’abord concentrée sur les emprunts, surtout à la langue anglaise, pour y distinguer les emprunts, les mots anglais nécessaires, des anglicismes, mots anglais qui faisaient double emploi avec des mots français. C’est l’époque des glossaires de mots et de sens sur le modèle Dites… ne dites pas. La distinction entre emprunts et anglicismes date de cette époque. En réaction, pour ainsi dire, d’autres travaux ont recherché l’origine française des mots et des sens apportés en Nouvelle-France par les colonisateurs français. Certains d’entre eux se sont maintenus dans l’usage québécois jusqu’à nos jours, alors qu’ils ont disparu du français hexagonal ou qu’ils y sont considérés comme vieillis. Les lexicographes français les considèrent comme des archaïsmes, alors que ce sont des mots vivants pour les locuteurs québécois. Le plus bel exemple de ce type de dictionnaire est le Glossaire du parler français au Canada, d’Adjutor Rivard et Louis-Philippe Geoffrion, paru à Québec en 1930. Dans le même esprit, Claude Poirier, de l’Université Laval, a entrepris la rédaction d’un Dictionnaire historique du français québécois dont un tome a paru aux Presses de l’Université Laval en 1998.
L’Office de la langue française, dès sa création, a poursuivi cet effort de classification sous l’étiquette de québécismes. En plus des emprunts et des mots d’origine française, l’Office y a ajouté une nouvelle catégorie, les québécismes de création, soit de forme, motoneige, cégep, traversier, nordicité, soit de sens, tabagie, dépanneur, portage, rang. L’Office a également étendu la notion d’emprunt aux langues amérindiennes, achigan, atoca, à l’inuktitut, kayak, et aux langues d’immigration, souvlaki. L’Office s’est surtout préoccupé de proposer des critères d’acceptabilité des québécismes pour guider l’emploi des mots et sens du lexique québécois, début d’une définition de la norme lexicale. Sur ces sujets, l’Office a publié en 1980 un Énoncé de politique relative à l’emprunt de formes linguistiques étrangères (actuellement en cours de révision) et, en 1985, un Énoncé d’une politique linguistique relative aux québécismes.
Enfin, deux importants colloques se sont tenus durant lesquels les langagiers, linguistes, traducteurs, rédacteurs et professeurs, ont discuté de ce que pourrait être ou devrait être un dictionnaire du français québécois[119].
Les éléments du lexique réel du français québécois sont donc aujourd’hui parfaitement identifiés. On y distingue :
- 1) Des mots de la langue commune à tous les francophones. Lorsque deux ou plusieurs mots sont synonymes, il peut arriver que le mot préféré par les usagers québécois ne soit pas le même que celui privilégié par les usagers français. Par exemple, les Québécois préfèrent congédiement et congédier à licenciement et licencier[120]. Marie-Éva de Villers les nomme québécismes de fréquence.
- 2) Des archaïsmes, de forme ou de sens, c’est-à-dire des mots ou des sens de mots qui se sont maintenus dans l’usage québécois depuis l’époque de la Nouvelle-France mais qui ont disparu de l’usage français contemporain. Exemples : grafigner et grafignure, abrier, brunante, mitaine, batture, marier au sens « d’épouser », goûter au sens d’ « avoir du goût, un goût », jambette au sens de « croc-en-jambe ».
- 3) Des dialectalismes, de forme ou de sens, c’est-à-dire des mots ou des sens qui viennent des dialectes apportés en Nouvelle-France par les premiers habitants de la colonie, dont certains sont encore vivants dans les français régionaux de France, mais sans être mentionnés dans les dictionnaires publiés à Paris. Exemples : écornifler (Anjou, Normandie), bleuet (Normandie), bordée de neige ou bordée seul (Saintonge), blonde au sens de « petite amie » (dans presque tous les dialectes d’origine, Auprès de ma blonde, dit une vieille chanson française), mouiller au sens de « pleuvoir » (Anjou, Aunis, Poitou, Saintonge)[121].
- 4) Des mots français auxquels a été attaché un sens qu’il n’ont pas ou n’ont pas exactement en français commun, souvent par ressemblance et même si la réalité désignée n’est pas la même ici qu’en France. Exemples : chevreuil, à la place de cerf de Virginie, perdrix, alors qu’il n’y a au Québec que des gélinottes, des tétras et des lagopèdes, truite, en lieu et place d’omble de fontaine, de touladi ou omble gris. Tantôt le générique suffit, par exemple dans la vie courante du chasseur et du pêcheur, tantôt il importe d’être plus précis, par exemple lors de la rédaction d’un règlement sur la chasse et la pêche, pour éviter toute contestation juridique sur l’identité de la bête ou du poisson.
- 5) Des mots créés par les usagers québécois par besoin, pour désigner des réalités d’ici ou des nouveautés, soit de toutes pièces, par exemple motoneige, courriel, terminologue, le plus souvent en suivant les règles de la morphologie française, soit de la composition, soit de la dérivation au moyen de préfixes ou de suffixes ou des deux à la fois, soit encore par acronymie (mots dérivés d’un nom propre ou du nom d’une institution). Exemples : aluminerie, bleuetière, microbrasserie, téléavertisseur, cégep et cégépien, péquiste, chicoutimien. Tous les noms féminins des titres et des fonctions entrent dans cette catégorie.
- 6) Des emprunts aux langues amérindiennes et à l’inuktitut, comme caribou, ouananiche, wapiti, wigwam, babiche, kayak, igloo, carcajou , et tous les noms et adjectifs qui dérivent des noms propres des différentes nations autochtones, par exemple montagnais, aujourd’hui innu, inuit, algonquin, mohawk, huron, etc.
- 7) Des emprunts aux langues des immigrants, surtout des noms de mets ou de coutumes, fatouche, gaspacho, kascher ou cachère, wok, loukoum, radicchio, soya ou soja, teriyaki, etc.
Et surtout l’immense catégorie des emprunts à la langue anglaise qui découlent du contact ancien et permanent avec la langue anglaise, au départ avec l’anglais d’Angleterre, aujourd’hui avec celui des autres provinces du Canada et surtout celui des États-Unis, voisins avec qui les contacts sont pour ainsi dire permanents et quotidiens. On y distingue :
- 8) Des emprunts, c’est-à-dire des mots anglais aujourd’hui parfaitement intégrés au lexique du français commun. Josette Rey-Debove[122] en a fait l’inventaire, mais en utilisant comme critère uniquement l’origine linguistique et sans tenir compte de la nécessité de l’emprunt, donc sans distinguer emprunt et anglicisme, comme il est d’usage au Québec. Exemples : bar, bluff, clone, cocktail, cow-boy, geyser, handicap, poker, rail, sandwich, snob, tramway et wagon, presque tous les noms de sports, baseball, football, curling, golf, jogging. Notons cependant que des Québécois prononcent souvent à l’anglaise certains de ces mots, par exemple bacon prononcé « bécun », cottage (prononcé « cottége »), gang (« gagne »), poker (« pokeur » avec un eu fermé), revolver (« révolveur » avec le même eu fermé), tank (« tink »). On pourrait ici parler d’anglicisme de prononciation.
- 9) Des emprunts à la langue anglaise sont cependant propres au Québec. Certains ont même créé des dérivés. Exemples : draver (de to drive) qui a donné drave et draveur, scotch (de scotch-tape, pour le ruban gommé), whip, coroner, hamburger et hot-dog passés en français hexagonal avec la mode du fast-food, alors que smokemeat demeure québécois, etc.
- 10) Des anglicismes, soit les emprunts inutiles à la langue anglaise, des emprunts de luxe qui concurrencent inutilement des mots français. Ils sont les témoins de la prédominance historique de la langue anglaise au Québec, surtout comme langue de travail, la langue du boss. Ils découlent aussi de l’ignorance ou de la négligence des usagers. Ils viennent souvent de loin. Ils sont tout particulièrement nombreux dans la langue parlée. On les trouve parfois aussi dans la langue écrite, avec ou sans les précautions d’usage (mettre le mot entre guillemets ou en italiques, le faire suivre du mot français, etc.). On les remarque de plus en plus souvent sur les ondes des médias électroniques, que le locuteur tente d’excuser en ajoutant, par exemple, comme on dit, si vous me passez le mot, ou de faire passer par une pirouette du type comme on dit en chinois, pirouette qui ne fait que souligner la mauvaise conscience ou le je-m’en-foutisme.
Ces anglicismes se maintiennent en usage parfois très longtemps. Ils se renouvellent de génération en génération. Citons quelques exemples tirés de l’analyse par Marie-Éva de Villers d’une année de textes du Devoir (voir l’annexe II de son essai Le Vif Désir de durer) : babyboomer, backlash, bargain, bookmaker, branding, choker, crew, doorway, engineering, farmer, feeder, guts, pattern, puck, strap, switch, waiter, etc. Actuellement, l’informatique, spécialité devenue usuelle, est une source de nouveaux anglicismes : faire une sauvegarde n’est pas plus compliqué que de faire un « save ».
- 11) Des faux-amis, des mots français auxquels on accole un sens anglais. Ils proviennent du contact permanent et fréquent avec le mot de la langue anglaise qui ressemble fort au mot français. Leur emploi est la plupart du temps dû à l’ignorance du sens exact du mot français en comparaison du mot anglais. Exemples : altération au sens de retouche, supporter pour soutenir (on supporte ses maux mais on soutient un candidat), corporation pour société, définitivement pour certainement, etc.
- 12) Des calques, la traduction mot à mot d’une expression anglaise, par exemple année fiscale (« fiscal year ») pour exercice financier, certificat de naissance (« birth certificate ») pour acte de naissance, à toutes fins pratiques (« for all practical purposes ») pour en pratique, pratiquement, annonces classées (« classified ads ») pour petites annonces, tapis mur à mur (« wall to wall carpet ») pour moquette, appel longue distance (« long distance call ») pour interurbain, etc.
Cette classification des éléments du lexique québécois est statique. Une question importante demeure : quelle est la part de chaque catégorie de mots dans l’ensemble du lexique? Marie-Éva de Villers y a apporté une première réponse en comparant tous les textes d’une année complète (1997) du quotidien Le Devoir aux textes du quotidien Le Monde de la même année.
Les mots communs au Devoir et au Monde, donc les mots du lexique du français (notre première catégorie), représentent 77 % de l’ensemble, les mots propres au Devoir, 11,5 % et ceux du Monde, également 11,5 %[123]. Les mots propres au Devoir se répartissent de la manière suivante : 68 % sont des québécismes de création, 13 %, des québécismes d’emprunt à l’anglais ou à d’autres langues, et encore sont-ils de faible fréquence, 8 %, des québécismes originaires de France et 11 %, des termes spécialisés. Si on excluait du Devoir et du Monde les termes spécialisés dont la présence est imposée par l’actualité nationale et les mots dérivés de noms de lieux (gaspésien, québéciser, alsacien), de patronymes (bouchardien, jospinien) ou les mots créés pour la circonstance (ex-frappeur, ultra-fédéraliste, eurocommunisme), la part des mots de la langue commune s’élèverait à 85 %.
Ces statistiques ne valent que pour la langue écrite de style journalistique. Elles sont tout de même révélatrices de l’usage réel du lexique québécois par les journalistes d’un quotidien important et de bonne réputation. On arriverait sans doute à d’autres conclusions en langue parlée. Car plus on observe la langue parlée, plus le nombre des variantes lexicales augmente selon le niveau d’instruction des locuteurs et leur familiarité avec la langue écrite. De plus, en langue parlée, l’écart entre les niveaux de langue est plus considérable au Québec qu’en France, notamment entre le niveau populaire, familier et soutenu.
D’autre part, au fur et à mesure que le niveau d’instruction augmentait au Québec, que l’analyse des éléments du lexique québécois s’approfondissait et que la différence entre langue parlée et langue écrite devenait plus évidente, les usagers québécois du français sont devenus plus conscients du fait qu’ils ne pouvaient plus employer les mots à tort et à travers. Ils ont perçu intuitivement qu’en plus d’un sens, les mots, et leur prononciation, ont une valeur sociale, une réputation pour ainsi dire, en bien ou en mal, que leur attribue l’ensemble des usagers et à laquelle réagissent les interlocuteurs. Les usagers ont ainsi acquis une sorte de subconscient linguistique qui les guide dans leur emploi de la langue. De plus, au fil des discussions et des commentaires, des critères se sont peu à peu dégagés qui servent soit à évaluer le mode d’emploi d’un mot, soit à juger de la manière d’utiliser une catégorie de mots, par exemple les emprunts à la langue anglaise à l’égard desquels les locuteurs québécois sont plus sévères que les locuteurs français. Ce double phénomène, de la réputation des mots et de l’existence de critères sociaux d’évaluation, est un aspect de la norme réelle d’usage du lexique, dont il faut tenir compte au moment de le décrire.
Toute personne qui se propose de décrire ou d’enseigner le lexique du français québécois se trouve confronté en même temps à la variété des catégories de mots et à celle des appréciations subjectives et collectives accolées à certains d’entre eux.
Préparer un dictionnaire suppose un travail d’observation de l’usage des mots et de leur valeur sociale, un travail de collecte et d’analyse de textes et de témoignages sur les mots pour donner une assise objective à cette observation, en dernier lieu un travail de synthèse, examen du ou des sens d’un mot selon les contextes et pondération des appréciations sociales que leur attribuent les usagers selon les niveaux de langue et les circonstances de communication. On est loin du mythe de la personne qui, dans son bureau, collectionne les mots comme des papillons, les juge et décide de les garder ou de les rejeter à son gré.
En général, on observe la langue écrite, pour au moins deux raisons principales. C’est un usage plus réfléchi de la langue et du lexique et elle se manifeste sous forme de textes, un matériau facile à colliger, à traiter et à examiner.
Autrefois, la collecte des exemples se faisait à la main, en lisant les textes et en notant les renseignements sur des fiches. C’est de cette manière que Paul Robert et son équipe ont réalisé le Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française (le Grand Robert), dont fut ensuite tiré le Petit Robert. Le travail se fait aujourd’hui à l’aide d’ordinateurs, ce qui permet de stocker un plus grand nombre de textes et d’en extraire une masse considérable de mots qu’il est ensuite possible d’examiner un à un et de replacer dans leurs contextes réels en retournant au texte.
Le grand public ignore tout, en général, de la manière dont un dictionnaire de langue se fait. Il faut tout de même le savoir pour juger de la qualité d’un ouvrage. Sans trop entrer dans les détails, nous esquisserons les grandes étapes de la préparation d’un dictionnaire pour saisir le soin qu’on doit apporter à un projet semblable.
Première étape, réunir un corpus, c’est-à-dire le matériau linguistique sur lequel va porter l’analyse lexicale selon le type de dictionnaire qu’on se propose de réaliser, soit des textes représentatifs de différents styles, littéraires, journalistiques, administratifs, scientifiques, didactiques, pièces de théâtre, de chansons, d’essais, de rapports, d’émissions de télévision ou de radio, etc., soit l’ensemble du texte de l’œuvre d’un écrivain ou des articles d’un journal. Citons deux exemples pour illustrer cette démarche. Pour la préparation du Dictionnaire général du français standard en usage au Québec, actuellement en cours de rédaction, l’équipe de l’Université de Sherbrooke a constitué une banque de données textuelles qui comprend quelque 50 millions de mots et plus de quinze mille textes. Autre exemple, le corpus de Marie-Éva de Villers, pour la préparation de l’essai déjà cité, comprend deux sous-ensembles, tous les articles du quotidien Le Devoir de l’année 1997 et tous ceux du journal Le Monde. Ces corpus seront les réservoirs des contextes pour découvrir le sens des mots. On y puisera aussi les exemples pour illustrer les définitions du futur ouvrage. Du corpus, on extrait tous les mots dans la forme qu’ils y ont (singulier ou pluriel, masculin ou féminin dans le cas des adjectifs et des participes, formes conjuguées des verbes, contraction des articles). Par une seconde opération, ces formes distinctes sont ramenées à une seule, le singulier pour les substantifs, le masculin singulier pour les adjectifs, l’infinitif pour le verbe. On ne retient ensuite et on ne compte que les mots différents, 157 000 dans le corpus de Sherbrooke, 25 756 dans Le Devoir et 26 297 dans Le Monde, qu’on peut classer par ordre de fréquence à titre indicatif.
Parallèlement à la collecte des textes, on collige tous les indices et tous les témoignages qui permettent de se faire une idée du statut social d’un mot, soit selon les niveaux de langue, soit selon les contextes et situations d’emploi, soit selon la catégorie à laquelle il appartient, soit selon des critères de politesse ou de bienséance. Les textes fournissent eux-mêmes des indices, mots entre guillemets, en italique ou suivis d’une réserve, d’une remarque ou d’un synonyme. Les commentaires se trouvent dans les chroniques de langue des journaux ou revues, dans les ouvrages correctifs, dans les dictionnaires, et s’étendent parfois sur une longue période de temps, ce qui permet de suivre l’évolution du sentiment linguistique à l’égard d’un même mot.
S’il s’agit de préparer un dictionnaire ou un lexique, il faut ensuite choisir les mots qui y figureront, ce qu’on appelle la nomenclature du futur ouvrage. Cette liste est provisoire et servira de guide de travail, quitte à y ajouter ou à y supprimer des mots. Les critères de sélection sont nombreux, de diverses natures et d’importance inégale. Le plus important, c’est l’emploi réel du mot dans les textes, critère lui-même nuancé par la fréquence du mot et par son utilité, le besoin qu’on en a pour exprimer la réalité. Nous touchons ici la limite de la technique du corpus : un mot peut très bien ne pas y figurer alors qu’il est nécessaire et connu de tous. C’est ce que l’on appelle le vocabulaire de disponibilité, constitué des mots qu’on n’utilise qu’en cas de besoin et dont la fréquence dans les textes peut être ou bien nulle ou bien nettement exagérée, par exemple le mot fourchette ou autocar, ou le mot tsunami devenu hyperfréquent dans les médias au moment où un tel phénomène s’est produit. Autre critère tout aussi important, le statut social du mot, selon qu’il est neutre, d’un emploi courant, ou qu’au contraire, il traîne avec lui comme son ombre une connotation, qui en limite, en guide ou en interdit l’emploi social. Dans ce dernier cas, deux choix s’offrent alors au lexicographe. Ou bien, il élimine du dictionnaire le mot ou le sens d’un mot : pendant des décennies, ce fut le sort des mots con ou merde, merdeux, merder dans les dictionnaires français bien que ces mots aient été très fréquents dans les conversations françaises[124]. Ou il tente de signaler le statut du mot à l’aide d’un système de marques d’emploi, du type littéraire, poétique, familier, vulgaire, emploi critiqué, anglicisme, etc.
Cela fait, on traite les mots un à un pour en déterminer la ou les significations, en retournant aux contextes où ils sont employés dans le corpus et dans la communication réelle, qu’il ne faut jamais perdre de vue. On arrive ainsi à la dernière étape du travail, la rédaction de la définition, qui est, déjà en soi, une opération délicate et soumise à des règles logiques et linguistiques précises.
Reste à imprimer et à diffuser l’ouvrage, et à attendre les critiques et commentaires. Notons que, dans le cas d’un dictionnaire, il n’y a pas de vérité ex cathedra, surtout lorsque aucune tradition n’existe, comme c’est le cas du lexique du français québécois ou du lexique catalan contemporain. Ce n’est qu’à la longue, avec la succession des ouvrages, que les consensus lexicaux s’établissent, comme on l’observe en France où la tradition lexicographique est vieille de plusieurs siècles et riche d’un grand nombre de dictionnaires souvent prestigieux, comme Furetière, Littré, Larousse ou Robert.
On voit donc que faire un dictionnaire est une opération complexe, qui demande talent, temps et moyens humains et financiers. Pierre Larousse a passé sa vie à rédiger son Grand dictionnaire universel du XIXe siècle et Paul Robert et son équipe ont passé au-delà de vingt ans à la confection du Grand Robert, pour ne citer que ces initiateurs des deux grandes entreprises lexicographiques françaises contemporaines.
6. L’enseignement du français au Québec est-il adéquat?
Nous abordons ici un sujet si vaste, si controversé, dont les facettes sont si variées, sur lequel les opinions des parents, des enseignants et des spécialistes sont si contrastées, qu’il est ardu de tenter de décrire l’état de la question aujourd’hui. Pourtant, on ne peut parler de la qualité de la langue au Québec sans traiter de son enseignement et du rôle qu’y joue l’École.
Nous nous en tiendrons à l’enseignement du français à l’école primaire, moment le plus décisif dans l’appropriation du système de la langue par les enfants. Toute carence des connaissances au programme primaire se répercutera tout au long de la scolarité de l’enfant jusqu’à l’université. Notre choix découle également du fait que le « Renouveau pédagogique », nom que l’on donne à la réforme de l’enseignement en cours au Québec, est maintenant appliqué à tous les cycles du primaire et qu’on peut juger de ses effets[125].
Commençons nos réflexions en posant la question initiale : que signifie enseigner le français à l’école, quel est l’objectif primordial de cet enseignement? Pour répondre adéquatement à la question à notre époque d’immigration soutenue, il faut distinguer deux catégories d’enfants. La première, la plus nombreuse, est formée de tous les enfants dont le français est la langue maternelle et de tous les enfants issus de l’immigration dont le français est la langue parlée à la maison ou tout au moins une langue apprise durant l’enfance. La seconde regroupe les enfants de parents immigrants qui ignorent le français, mais que la Charte de la langue française oblige à fréquenter l’école française plutôt qu’anglaise.
La langue que les enfants du premier groupe apportent à l’école est leur langue d’enfance, une langue strictement orale, apprise par imitation de celle des parents et des autres enfants ou des adultes du quartier où ils ont grandi. Elle est imprégnée des caractéristiques linguistiques propres à la langue parlée de la famille et du quartier. C’est une langue pour ainsi dire comportementale, dont l’enfant n’a aucune conscience du mode de fonctionnement. Parler, comprendre et se faire comprendre lui suffisent. À l’arrivée à l’école, les langues d’enfance des écoliers d’une même classe sont plus ou moins hétéroclites et reflètent la plus ou moins grande diversité linguistique du quartier où se situe l’école. Pour ces enfants, l’objectif de l’enseignement du français est de leur faire franchir sans trop de heurts le passage entre leur langue d’enfance et la langue standard commune en usage dans la société où se déroulera leur vie adulte. Ce passage est graduel. Première étape : aller de la langue orale à la langue écrite par l’apprentissage de l’écriture et de la lecture. Étape suivante : apprendre l’orthographe des mots et les règles qui régissent les accords des mots entre eux dans la phrase. Étape ultime : prendre conscience et maîtriser les mécanismes de la langue et les règles sociales qui en guident l’emploi selon les circonstances. L’enfant a devant lui onze ans de scolarité pour réussir ce cheminement, guidé et informé par ses professeurs.
L’objectif de l’enseignement de la langue est tout autre pour les enfants du second groupe. L’objectif premier est de leur apprendre le français comme langue étrangère, avec suffisamment d’efficacité pour qu’ils puissent s’intégrer aux classes des enfants du premier groupe. À cette fin, l’école québécoise a mis sur pied des classes d’accueil dont le mode de fonctionnement dépend de la variété des langues maternelles des enfants, de leur âge et surtout, de la compétence, de l’enthousiasme et de l’initiative pédagogique des professeurs pour mener à bien cette tâche. Par la suite, quand ces enfants rejoignent l’enseignement régulier, l’objectif de l’enseignement du français devient pour eux le même que pour les autres enfants.
La très grande majorité des citoyens québécois sont d’accord sur ces objectifs généraux. Par contre, depuis les premiers balbutiements de la réforme de l’enseignement du français à la suite de la critique virulente du Frère Untel, l’insatisfaction des parents et des citoyens face aux résultats de cet enseignement se maintient. Elle s’était manifestée dans presque tous les mémoires reçus par la commission Larose et lors des audiences régionales ou des journées thématiques consacrées à la langue. Toutes les critiques portaient et portent encore aujourd’hui sur deux points précis : l’échec de l’école à enseigner le code de la langue et la piètre qualité de la langue, orale et écrite, des enfants au terme des onze années de scolarité obligatoire. Au moment où nous écrivons ce texte, le programme du Renouveau pédagogique concentre contre lui cette insatisfaction.
Disons d’abord qu’il faut prendre le titre Renouveau pédagogique au sens strict. En effet, le texte du Programme de formation de l’école québécoise, description détaillée, matière par matière, du contenu du Renouveau pédagogique, expose essentiellement la démarche pédagogique qui est censée donner aux élèves une meilleure connaissance de la langue française que par l’approche traditionnelle. Nulle part dans ce texte ou dans les dépliants d’information destinés aux parents[126], il n’est question de la transmission de connaissances par le professeur. Toute la démarche repose sur l’idée que les enfants découvriront tout par eux-mêmes en réalisant des projets mobilisateurs, en somme sur l’idée que « l’observation de la langue vaut mieux que l’enseignement de la grammaire et de l’orthographe », pour reprendre une formule choc citée dans le dossier que la revue française L’Express[127] a consacré au gâchis de l’enseignement du français en France depuis que la même idéologie pédagogique y sévit.
Nulle part dans la présentation du Programme de formation de l’école québécoise, on ne cite comme objectif de l’enseignement de la langue française la maîtrise par l’enfant de la langue standard commune. Tout au plus est-il « encouragé à utiliser un français de qualité », formule passe-partout qu’on se garde bien de préciser.
L’idée de base du Renouveau est que « le programme de formation repose sur le développement des compétences de l’élève (les souligné sont de nous), c’est-à-dire sur l’utilisation efficace de ses connaissances afin de réaliser des tâches et des activités réelles ».
Le lecteur est en droit de se demander quelles « compétences » on attribue ainsi aux enfants. S’agit-il de la capacité qu’a tout enfant d’apprendre ou de la simple compétence de parler français dans le cas des enfants dont c’est la langue maternelle ou la langue de la maison? Et quelles connaissances lui attribue-t-on, puisqu’en arrivant à l’école, cet enfant n’a de la langue, écrivions-nous plus haut, qu’une compétence orale comportementale et qu’il n’a aucune conscience de la langue en tant que système? Que signifie ce « c’est-à-dire » qui semble établir un lien de cause à effet entre les compétences et les connaissances des élèves?
Le chapitre 5 du Programme de formation de l’école québécoise, qui traite du Domaine des langues, précise ce postulat pédagogique.
« Il (l’élève) fait l’expérience de la rigueur et des efforts qui mènent au plaisir d’une communication réussie. Il découvre graduellement la fierté d’utiliser une langue de qualité et l’importance d’en maîtriser le code. » (page 72) « Soutenu par l’enseignant et par ses pairs, il apprend à utiliser ses connaissances orthographiques, grammaticales, lexicales et textuelles, à consulter des ouvrages de référence et à recourir à des outils technologiques. » (page 77)
Question : où et comment acquerra-t-il les connaissances dont il est question, de l’observation répétée des textes, par les commentaires occasionnels de l’enseignant (et de ses pairs!) à l’occasion de sa participation aux tâches et activités communes, d’un enseignement systématique de la langue de la part du professeur, mais dont le texte ne dit mot. Mystère.
Le texte poursuit (page 77) :
Par l’écriture, il (toujours l’élève) enrichit ses connaissances en syntaxe de même qu’en orthographe d’usage, apprend à effectuer plusieurs accords dans la phrase [lesquels?] et consulte régulièrement différents outils de référence. Dans cette optique [page 76], il reconnaît l’importance de l’orthographe et des règles de grammaire dont le respect aide les lecteurs à lever les ambiguïtés possibles.
Question : comment a-t-il appris ces règles? Autre question : pour consulter, il faut douter : comment l’enfant apprend-il à douter de sa propre langue? Par la communication orale, « il apprend à adapter son langage en fonction du contexte et de ses interlocuteurs, ainsi qu’à choisir le registre de langue approprié ». (page 80)
Question : comment va-t-il apprendre à repérer tout ce qui doit être corrigé dans sa langue, dans celle de ses pairs et dans celle de la société ambiante, les anglicismes, les faux amis, les impropriétés, les erreurs de syntaxe, les accords ratés des participes passés avec avoir, l’ignorance généralisée du pronom dont remplacé par que, etc.? Qui lui dira ce qu’il doit rectifier dans sa prononciation : l’escamotage, la diphtongaison, les substitutions de voyelles? Nulle part dans le texte, on ne parle de cet enseignement correctif, de crainte, sans doute, si l’enseignant s’en inspirait dans son enseignement du français, de traumatiser les enfants en remettant ainsi en cause leur langue d’enfance.
En effet, l’enseignement correctif suppose que les enseignants soient informés des déficiences de la langue parlée au Québec, qu’eux-mêmes utilisent la langue standard en classe et que le choix de ce qui, chez les enfants, doit être amélioré soit connu des enseignants. Or, le linguiste Luc Ostiguy porte un jugement sévère sur la langue parlée des étudiants en sciences de l’éducation qui se destinent à l’enseignement primaire ou à l’enseignement du français au secondaire. « Une majorité de futurs enseignants, conclut-il, ont une connaissance et une capacité à utiliser la langue standard trop limitées pour qu’ils puissent, en classe, assumer pleinement leur rôle de modèle linguistique par rapport à cette dimension de la maîtrise de la langue parlée[128]. » Pour tous les spécialistes en formation des maîtres de français, il est devenu évident que, dans les facultés des sciences de l’éducation, « un effort de sensibilisation et de formation au registre [de langue] soutenu devrait être consenti pour tous les futurs enseignants[129] ».
Quel rôle le Renouveau pédagogique attribue-t-il aux enseignants et aux parents? Il en est question dans les textes des dépliants d’information destinés aux parents.
Le rôle de l’enseignant est subordonné, pour ainsi dire, à celui de l’enfant qui est vraiment l’acteur principal de la classe selon le Renouveau pédagogique. Du moins est-ce l’impression qui se dégage de la description de son rôle là où il en est question. « Si votre enfant est le principal artisan de ses apprentissages », lit-on dans les dépliants de chaque cycle, « c’est cependant le rôle professionnel de l’enseignant ou de l’enseignante de l’observer, de l’encourager, d’apporter les correctifs nécessaires ou de lui fournir l’enrichissement qui va lui permettre d’apprendre de plus en plus et de prendre conscience de la façon dont il apprend ». La fonction d’enseigner, qu’on penserait être l’une des fonctions d’un enseignant, n’est pas évoquée, à moins qu’elle ne soit dissimulée derrière la formule « fournir l’enrichissement ».
Or, tout de la langue ne s’apprend pas par observation et par essai/ erreur, comme le suggère la pédagogie par projet sur laquelle est centré le Renouveau pédagogique. L’acquisition par les élèves de nombre d’éléments de la langue ne peut s’effectuer qu’à travers un enseignement systématique. L’apprentissage de l’aspect technique de la lecture s’acquiert par l’entraînement à créer une association mentale rapide entre lettres et sons, entre langue écrite et langue parlée, qui seule permet de comprendre le sens d’un texte. Le simple défrichage syllabe par syllabe ne suffit pas. À la fin des deux années du premier cycle primaire, l’enseignant doit s’assurer que les enfants ont acquis cette habileté de base. L’orthographe des mots s’apprend par la répétition, qui permet de créer dans la mémoire l’image visuelle de chaque mot associée au geste d’écrire. L’élève maîtrise mieux et plus rapidement l’orthographe grammaticale si l’enseignant lui apprend les règles qui régissent les accords entre certains éléments de la phrase et s’il l’entraîne par des exercices à les mémoriser. Toutes les tentatives de réintroduire dans les classes l’enseignement systématique de la langue, notamment du code, ont échoué ou, tout au moins, le ministère de l’Éducation ne les a pas encouragées. Le Ministère persiste à favoriser la pédagogie par projet, dont les conseillers pédagogiques prennent le relais dans les écoles. Le coup de barre qu’a voulu donner Pauline Marois au moment où elle était ministre de l’Éducation, entre 1996 et 1998, en faisant la promotion de l’enseignement magistral comme complément nécessaire à la pédagogie par projet, est demeuré sans effet.
Quant aux parents, au-delà du fait de créer à la maison un climat favorable au progrès de leurs enfants, on leur demande d’« encadrer adéquatement la réalisation des travaux scolaires, de n’accorder ni trop ni trop peu d’importance à l’évaluation, de chercher à comprendre les attentes de l’école et de faire connaître les leurs ». Or les parents, même scolarisés, ne se reconnaissent plus dans l’enseignement actuel du français. Depuis que le ministère de l’Éducation a opté pour une nouvelle terminologie grammaticale en 1995, les parents et les enfants n’ont plus de vocabulaire commun pour discuter de la phrase et des règles de grammaire. Deux tableaux du Multidictionnaire, repris dans La Nouvelle Grammaire en tableaux[130], pourraient aider les parents à faire le pont entre les termes qu’eux-mêmes ont appris à l’école et ceux que leurs enfants emploient maintenant : le tableau « Terminologie grammaticale » établit la correspondance entre l’ancien et le nouveau vocabulaire, celui intitulé Groupe décrit la manière dont on enseigne maintenant la structure de la phrase et les fonctions qu’y remplissent les mots ou les groupes de mots.
Autre carence du système actuel : il tolère l’ignorance par les élèves de « savoirs » pourtant jugés « essentiels » selon le Renouveau pédagogique (voir la longue liste de ces savoirs aux pages 87 et suivantes du programme).
Cela tient à deux autres aspects de la politique du ministère de l’Éducation.
Le ministère veut à tout prix augmenter le nombre des élèves qui réussissent le parcours scolaire, surtout en français. Josée Boileau écrivait en éditorial du Devoir le 5 septembre 2006 : « L’école, du primaire jusqu’à l’université, est prisonnière d’un double discours. D’une part, elle doit veiller à ce que les apprentissages soient maîtrisés; d’autre part, nous ne tolérons pas l’échec. […] On veut donc des résultats ». En conséquence, le système ne tolère plus qu’un élève redouble une année scolaire pour la simple raison qu’il n’a pas acquis les connaissances au programme. On postule qu’à la longue, il finira par les récupérer. Et on le laisse « progresser » d’une année à l’autre.
Les enseignants ou le Ministère procède donc à l’évaluation des « savoirs essentiels » en français, de manière que le plus grand nombre d’élèves réussissent. Au besoin, si la moyenne générale est trop basse, on « pondère » les résultats de tous les élèves pour réduire le nombre des échecs. De plus, l’évaluation des connaissances est synthétique, en ce sens que la note finale obtenue par un élève résulte de sa performance à tous les « savoirs essentiels » qui sont évalués. Un élève peut très bien obtenir la note de passage en français malgré son échec à certains critères, surtout ceux qui mesurent la connaissance du système de la langue. Les trois auteurs du Grand mensonge de l’éducation [131] constatent et dénoncent les effets de cette manière de procéder à l’évaluation des élèves, au primaire, au secondaire et au collégial. Elle a pour conséquence que beaucoup d’élèves sont d’année en année de plus en plus en retard sur le programme, soit que quelques-uns n’aient pas appris à lire couramment en première et en deuxième année, soit et surtout, qu’ils aient accumulé des déficiences graves en orthographe et en grammaire. Ces retardés scolaires se transforment en élèves en difficulté, dont le nombre croissant dans une classe deviendra un handicap pour les autres enfants du même groupe. Un enseignant de français au secondaire confirmait ce constat dans une lettre au journal Le Devoir du 10 février 2006 :
Plus on avance dans le cheminement scolaire, plus les écarts se creusent entre les élèves forts et les élèves faibles d’un même groupe [les siens ont entre 15 et 17 ans]. […] En français, certains élèves connaissent à peine l’alphabet par cœur, […] d’autres ne peuvent pas accorder des noms et des adjectifs, d’autres ne maîtrisent pas les principes les plus élémentaires de la syntaxe de base. D’autres, au contraire, maîtrisent la langue avec nuance dans la plus grande clarté et ce, sans fautes d’orthographe, de syntaxe ou de ponctuation.
À la longue, les élèves faibles se découragent en constatant que leur ignorance devient insurmontable. C’est certainement l’une des causes principales du décrochage scolaire, dont la proportion augmente sans cesse d’année en année. Un élève sur trois quitte aujourd’hui l’école sans avoir obtenu le diplôme de fin d’études secondaires. Un tel échec de l’école se répercute évidemment sur le destin de ces enfants lorsqu’ils chercheront un emploi sur le marché du travail, dont les exigences à l’embauche sont sans cesse plus élevées. La discrimination de revenu commence à l’école.
Il n’y a qu’une façon de cesser de repousser l’ignorance d’une année à l’autre : prévoir à la fin de chaque année scolaire des cours de rattrapage pour les élèves qui en ont besoin, par exemple dans les premiers jours de juin, après les évaluations ou les examens, avant les vacances d’été, alors que les enseignants sont encore disponibles. Cela vaudrait certainement mieux et serait plus efficace que de commencer à faire du rattrapage à l’université ou au cégep, alors qu’il est quasi impossible de récupérer en quelques semaines onze ans d’ignorance accumulée… et tolérée.
Les remarques qui précèdent valent surtout pour l’école publique. Pour le comprendre, il faut revenir à deux décisions prises à la suite de la commission Parent : la scolarité obligatoire des enfants et le maintien des écoles privées.
Au Québec, comme dans la plupart des pays développés, la fréquentation de l’école primaire et secondaire est obligatoire. Les parents ont le choix d’inscrire leurs enfants à l’école publique ou à l’école privée, ou à des écoles publiques qui s’en rapprochent, du type écoles internationales ou écoles concentrées sur une activité parascolaire, la musique surtout. L’école publique est gratuite et elle est tenue de recevoir tous les enfants, sans distinction. L’école privée sélectionne les enfants, le plus souvent selon leurs aptitudes, parfois selon un autre critère, notamment la religion. Elle exige des parents des droits de scolarité plus ou moins élevés. Les écoles dites internationales ou à concentration sélectionnent aussi les enfants selon leurs aptitudes. Elles exigent des droits d’inscription, mais moins élevés que ceux des écoles privées. Pour beaucoup de parents, elles sont un compromis de plus en plus recherché dont ils ont les moyens. Les écoles privées et à concentration peuvent, à tout moment, retourner à l’école publique un enfant qui ne réussit pas.
En somme, le Québec accepte que le système scolaire soit à deux vitesses, à la limite de la justice sociale et d’une véritable démocratisation de l’enseignement. Dans ces conditions, il est évident que l’école publique perd sur tous les plans, puisque la loi l’oblige de recevoir dans la même classe tous les enfants d’un même groupe d’âge, qu’ils soient plus ou moins intelligents, plus ou moins en retard ou en difficulté, plus ou moins handicapés. L’écart de la qualité de l’enseignement offert par les différents types d’écoles ne cesse de s’accroître, et toujours en faveur de l’école privée au détriment de l’école publique. À moins d’une révolution, la tendance se maintiendra et l’école publique sera de plus en plus discréditée. Nous en sommes là comme société.
À la question initiale que nous posions : l’enseignement du français au Québec est-il adéquat?, notre réponse sera normande : oui et non. Plutôt oui si on parle des écoles privées ou apparentées, plutôt non s’il s’agit de l’école publique, avec cette réserve que, de toute manière, les enfants intelligents s’en sortiront, comme toujours, dans l’une ou l’autre situation.
L’école publique améliorerait beaucoup sa performance, et sa réputation, si le ministère de l’Éducation laissait une plus grande initiative aux enseignants et si, à la place de l’approche pédagogique unique imposée par le Renouveau pédagogique, il permettait que cohabitent dans la même classe différentes manières d’enseigner, donc d’apprendre la langue, par la répétition, par l’enseignement systématique ou correctif et non par la seule observation et la pratique. Si surtout, il fixait comme objectif à l’enseignement du français la connaissance et la maîtrise par les enfants de la langue standard et s’il s’assurait que tout le personnel de l’école en a la connaissance et en fait usage en classe comme langue d’enseignement. Si, en somme, il mettait fin à sa propension au dirigisme pédagogique, la même pédagogie pour tous et partout, qui a toujours caractérisé les réformes successives du programme scolaire au cours des vingt dernières années.
7. L’usage du français au Québec s’est-il amélioré?
Chacun a son opinion sur la question. Je ne puis ici que donner la mienne, qui sera certainement contestée par tous ceux et celles qui sont d’un avis contraire.
Chaque fois que quelqu’un me pose la question, je me souviens du film de René Clair (1952!), Les Belles de nuit, avec Gérard Philipe, la belle Gina Lollobrigida et la discrète Martine Carol (discrète, dans ce film). Le héros est un jeune musicien, professeur de musique à l’école primaire du quartier, mais auteur d’un opéra dont il vient d’envoyer le manuscrit au directeur de l’opéra de sa ville. Quand il s’endort, il rêve d’exploits qui le couvrent de gloire et il s’exclame « Quelle belle époque! » Un personnage plus âgé, le journal à la main, lui rétorque « Quelle sale époque! Ah! de mon temps, monsieur… » et quelqu’un réveille le dormeur. Quand il réussit à se rendormir, son rêve revient mais à l’époque du contradicteur, de nouveau des exploits, de nouveau la gloire, de nouveau « Quelle belle époque! » et de nouveau le même grincheux qui dit « Sale époque! Ah! de mon temps, monsieur… » et le dormeur est de nouveau réveillé. D’épisode en épisode, on remonte ainsi jusqu’à l’âge de pierre où le même lecteur d’une plaque de granit lui réplique « Ah!, monsieur, du temps de ma jeunesse… ».
Chacun répond à la question en se reportant à ses souvenirs, à la grand-mère qui écrivait sans faute bien qu’elle ait peu fréquenté l’école, ou au souvenir que l’on garde de la manière dont on nous enseignait l’orthographe et la grammaire à l’école. La réponse ne peut donc être qu’une opinion personnelle, forcément subjective puisque nous n’avons que des souvenirs de l’état de la langue à l’époque de notre jeunesse, dont il ne nous reste aucune trace concrète pour étayer la comparaison.
Pour ma part, j’estime que l’usage de la langue française s’est amélioré.
La langue s’est améliorée en même temps que le niveau d’instruction s’élevait, en même temps que le français soigné de la radio et de la télévision donnait l’exemple d’une langue française québécoise de qualité, un peu moins guindée aujourd’hui, plus spontanée, donc plus exigeante encore pour le personnel à l’antenne. Elle s’améliore sous la pression des exigences actuelles du monde du travail, puisque le Québec est passé d’une économie primaire, où il était possible de gagner sa vie sans instruction, avec ses muscles, en silence ou en parlant gras, à coups de sacres, à une économie de services qui repose sur la connaissance et sur la qualité de la communication. Cette pression est suffisamment forte pour que les jeunes que le système scolaire a trahis se reprennent en main, retournent à l’école ou s’organisent pour récupérer la compétence linguistique qui leur fait défaut. Elle s’améliore parce que chacun dispose aujourd’hui d’ouvrages de référence faciles à consulter, imprimés ou électroniques, où il peut trouver réponse à ses questions, ce qui n’existait pas il y a à peine vingt ans. Elle s’améliore parce que les Québécois sont maintenant en contact constant avec d’autres francophones du monde, par le cinéma, par la télévision, par le voyage, par les nouveaux Québécois, parce qu’ils entendent, observent, absorbent inconsciemment d’autres manières de parler français qui font contraste avec leur propre langue. Elle s’améliore parce que la langue des jeunes parents est déjà meilleure, très souvent, que celle de leurs parents et qu’en conséquence, la langue d’enfance de leurs enfants sera meilleure que la leur.
En somme, je soutiens qu’elle s’améliore parce que j’ai plus de motifs de le penser que de raisons de soutenir le contraire.
Bien sûr, tout est loin d’être parfait. Bien sûr, je déplore les ratés de l’école publique et je crains fort que l’enseignement du français tel qu’il se fait maintenant ne compromette sérieusement chez les jeunes l’acquisition d’une langue de qualité. Bien sûr, je dénonce la tendance au laisser-aller que l’on observe chez bon nombre de personnes qui devraient, au contraire, servir de modèles. Mais le sens du mouvement général va vers une langue parlée et écrite de meilleure qualité.
À condition cependant que les francophones du Québec demeurent vigilants, critiques et exigeants à l’égard de l’École (de la maternelle à l’université) et à l’égard d’eux-mêmes, à condition surtout qu’ils résistent à la tentation de se satisfaire de peu au lieu de chercher mieux.
Or, je ne suis pas certain que l’avenir de la langue française, et sa qualité, soit une priorité chez les enfants de la loi 101.
Chapitre IV – Le dossier de la langue est-il encore une préoccupation?
Tenter de répondre à cette question est extrêmement aventureux et personnel, tant les points de vue sont divers et tant il y aurait de nuances à apporter, qui pourraient fort bien n’être, en réalité, que des prétextes à ne rien faire.
Ce n’est pas la situation objective de la langue française au Québec qui m’intéresse ici. Aucune langue n’a été l’objet d’autant d’analyses sur une aussi longue durée que le français au Québec, depuis les travaux de la commission Laurendeau-Dunton jusqu’à nos jours. Un ouvrage récent du Conseil supérieur de la langue française[132] en présente une bonne vue d’ensemble.
Je suis davantage préoccupé par les attitudes, individuelles et collectives, des Québécois face à la question linguistique, plus inquiet surtout de savoir si, dans la vie quotidienne de chacun, les comportements réels sont en accord avec les objectifs de l’aménagement linguistique du Québec, s’ils sont encore connus. Chose certaine, tous attachent toujours une grande importance à la Charte de la langue française, du moins dans les grandes circonstances. Mais est-ce suffisant, ne serait-ce pas une manière de se rassurer, d’échapper à toute responsabilité personnelle à l’égard de la langue?
Je me risque donc à formuler mes propres observations en réponse à ces interrogations.
Un faisceau d’indices m’amènent à penser que la situation de la langue française au Québec n’est plus aujourd’hui une inquiétude, encore moins une préoccupation.
Le dossier de la situation de la langue française au Québec n’est plus d’actualité
Entre la crise de Saint-Léonard (1967) et l’adoption de la Charte de la langue française (1977), il s’écoule une dizaine d’années pendant lesquelles la question la plus actuelle était la situation des francophones et de la langue française par rapport aux anglophones et à la langue anglaise, situation nettement favorable à ces derniers et à leur langue comme l’avait amplement démontré la commission Laurendeau-Dunton et, par la suite, la commission Gendron. D’où la seconde préoccupation de l’époque : comment et par quels moyens modifier l’état des choses en faveur de la langue française et donc, des francophones.
Les discussions furent vives et publiques, aussi bien autour du bill 63 et de la loi 22 qu’au moment de la publication du livre blanc de Camille Laurin, qui présentait l’esprit et les intentions de la politique linguistique du gouvernement du Parti québécois. Elles furent encore plus intenses lors de la discussion du projet de loi 101 en commission parlementaire et devant l’Assemblée nationale au moment de l’étude article par article de la future Charte de la langue française. Les médias, tant de langue française que de langue anglaise, suivaient de très près les débats, en rendaient compte abondamment. Les éditorialistes prenaient position. Toute la population était au courant et chacun avait un avis sur le statut que devrait avoir le français au Québec, sur la place de la communauté de langue anglaise, de ses institutions et de sa langue dans le Québec de demain, sur la tendance des allophones à s’intégrer à la minorité anglophone. Chacun avait son avis sur le bilinguisme, mot vague par excellence, dont on discutait beaucoup. La politique linguistique du Québec devait-elle être une politique de bilinguisme institutionnel à la manière de celle du Canada (au nom du réalisme nord-américain) ou d’unilinguisme (pour donner au français une assise juridique, sociale et économique). Cette notion d’unilinguisme excluait-elle totalement la langue anglaise de la politique linguistique ou s’agissait-il plutôt par la loi d’encadrer l’importance économique de la langue anglaise et de considérer le bilinguisme comme une responsabilité individuelle, un élément du plan de carrière que prépare et poursuit chaque citoyen. D’où l’importance de la responsabilité confiée au ministère de l’Éducation d’enseigner efficacement la langue anglaise comme langue seconde. Les idées à l’époque, sur ces sujets, étaient claires et elles prenaient appui sur des analyses précises, bien documentées.
Puis, tout s’est oublié. « Finies, les déclarations d’amour de notre langue, même parmi les souverainistes. Clos aussi, le discours sur l’importance de la bien parler et de l’écrire correctement. En ce sens, la francophonie et la défense du français sont devenues off, pour parler le langage des définisseurs de tendance », écrivait Denise Bombardier dans sa chronique du Devoir du 1er octobre 2006.
Aujourd’hui, les médias n’accordent que peu d’intérêt aux questions linguistiques. Exception notable : le dossier publié par la revue L’actualité dans son numéro du 15 octobre 2004 (articles de Pierre Cayouette, de Ginette Haché, de Lucie Pagé, de Marie-Hélène Proulx et de Jean-Benoît Nadeau). Les médias ne parlent plus de langue française qu’à l’occasion d’une de nos querelles habituelles. Par exemple, on a surtout retenu du dernier congrès du Parti québécois le projet de résolution d’obliger les immigrants à fréquenter les cégeps de langue française. Autre exemple : n’eût été la querelle entre Yves Michaud et Alexandre Stefanescu, codirecteur du dernier ouvrage collectif du Conseil supérieur de la langue française[133], les médias auraient à peine mentionné la publication de cette contribution des intellectuels québécois au renouvellement de la politique linguistique québécoise en proposant des pistes nouvelles fondées sur des analyses sérieuses. Dernier exemple : les médias se sont limités à mentionner discrètement l’avis du Conseil sur la langue de travail[134], sans aucun commentaire et sans aucune analyse du document, bien que, de l’avis général, il s’agisse du chapitre le plus stratégique de la loi 101 et le plus mal en point. Si la francisation des entreprises ne régresse pas, elle plafonne nettement depuis des années. De plus, conséquence de la mondialisation et d’Internet, les occasions de devoir utiliser la langue anglaise augmentent constamment, à tous les niveaux et dans tous les services de l’entreprise, alors qu’à l’époque de la rédaction de la Charte ces communications étaient concentrées dans le service des relations publiques et de la commercialisation.
Personne ne semble s’inquiéter de cette recrudescence de l’emploi de l’anglais comme langue de travail, sauf les immigrants francophones qui ont du mal à trouver des emplois parce qu’ils ne connaissent pas ou insuffisamment cette langue. Serions-nous revenus au point de départ, à l’époque où pour travailler, avoir de bons emplois, avancer dans sa carrière, il était plus important de savoir l’anglais que de bien maîtriser le français?
Il n’y a plus d’urgence dans la question de la langue.
D’une communauté linguistique à l’autre, les citoyens du Québec partagent le sentiment que la législation linguistique a atteint un point d’équilibre qui a instauré une certaine paix linguistique au sein de la société. Personne ne conteste plus la Charte de la langue française, du moins pour le moment. Même Me Julius Grey, grand défenseur des droits individuels et pourfendeur de la loi 101 pour cette raison, écrivait récemment[135] : « Devant la nécessité inébranlable de protéger et de promouvoir la langue française, et le besoin aussi impérieux de respecter les limites de la démocratie libérale et de préserver une place honorable pour la partie anglaise de notre héritage, cette loi, telle qu’amendée, constitue un compromis raisonnable, même si on peut continuer de discuter de certains détails et de son application. »
Il ne resterait donc plus qu’à l’appliquer avec discernement, et à la faire respecter, ce qui relève aussi bien de chaque citoyen que de l’Office québécois de la langue française. On peut se demander si les francophones sont conscients qu’ils ont un rôle et des responsabilités dans l’application de la Charte de la langue française.
La langue n’est plus une préoccupation chez les jeunes, si on en juge par deux documents publiés récemment.
En septembre 2006, la revue L’actualité publiait un numéro spécial pour souligner son trentième anniversaire de parution. Le clou de ce numéro était un grand reportage sous le titre Le Québec dans 30 ans, Les projets des jeunes. Dix jeunes y révélaient ce dont ils rêvent pour le Québec de demain. Ils parlaient de tout, de l’école, de l’environnement, de la qualité de la vie, d’innovation, de santé, de justice sociale, de souveraineté, les thèmes à la mode du jour. Aucune mention, pas même une allusion, au maintien du caractère français du Québec. Le tiennent-ils pour acquis, assuré pour toujours par la Charte de la langue française, au point qu’il ne soit plus nécessaire de s’en préoccuper?
Second document, les manifestes du Début global, formulés et présentés par les jeunes participants, quelque 500, à la troisième école d’été de l’Institut du Nouveau Monde. Le journal Le Devoir du 31 août 2006 a publié quatre de ces textes. Les thèmes qui reviennent sont ceux de tous les jeunes qui ont l’ambition de changer le monde : le rejet du Québec dont ils héritent, le refus de l’individualisme, l’appel au réveil des jeunes pour qu’ils passent à l’action. Aucune allusion à la mutation culturelle et linguistique que subit déjà le Québec comme conséquence de l’immigration et de la pression constante qu’exerce la langue anglaise sur la langue française en raison de la puissance économique des États-Unis et de la mondialisation. De quelle langue et de quelle culture sera ce monde dont ils rêvent? S’en préoccupent-ils? Ou pensent-ils, eux aussi, que la loi 101 a tout réglé et pour toujours?
Car, aujourd’hui, les attitudes des Québécoises et des Québécois à l’endroit de la langue française sont devenues paradoxales.
L’adoption de la Charte de la langue française a provoqué une profonde transformation de la société québécoise, du rapport entre langue française et langue anglaise, dont a découlé une nouvelle dynamique des relations entre francophones, anglophones et allophones. À l’endroit de la langue française, nous sommes collectivement passés d’une stratégie de défense à une stratégie d’affirmation et de promotion.
Mais en même temps, l’adoption de cette législation a eu un effet pervers : la langue française est devenue l’affaire des organismes de la Charte, les citoyens s’en sont détournés et chacun est retourné à ses affaires personnelles en toute bonne conscience.
Dans les grandes occasions, la majorité des francophones se déclarent très attachés à la langue française et affichent une grande confiance en sa vitalité et en sa capacité de faire concurrence à la langue anglaise. C’est du moins la réponse des auditeurs québécois à un récent sondage des radios de langue française de France, de Suisse, de Belgique et du Québec, en net contraste avec celle des auditeurs des autres pays, plutôt pessimistes, qui sont d’avis que l’avenir est à la langue anglaise[136].
Mais les mêmes Québécois sont les premiers à passer à l’anglais sitôt qu’il y a un seul anglophone dans un groupe ou à s’adresser en anglais à un immigrant récent dont le français est hésitant, comme si l’anglais lui était plus familier d’office. Ils ont même de nouveau tendance à tolérer qu’on les serve en anglais dans les commerces, à ne pas réclamer le droit que leur garantit pourtant la Charte de l’être en français, alors qu’il serait normal de protester et de quitter l’établissement en cas de refus. Ces comportements ne démontrent certainement pas une grande confiance en la langue française, ni ne sont la meilleure manière d’inciter les immigrants à parler français ou les commerçants, à respecter la Charte. Ils sont plutôt signe de démission. Ce n’est pas ainsi que le français deviendra la langue commune du Québec et la langue habituelle du commerce et des affaires.
Tous se disent préoccupés de la qualité de la langue française au Québec, déplorent le laisser-aller des professeurs, des animateurs de radio et de télévision et dénoncent avec une belle unanimité l’échec du ministère de l’Éducation à enseigner efficacement la langue standard, orthographe et syntaxe.
Mais ces mêmes Québécois font le succès de ceux des chansonniers, humoristes et animateurs de radio ou de télévision qui n’ont aucun souci de la qualité de la langue. En utilisant la langue populaire, se défendaient-ils les uns et les autres lors d’une émission de Zone libre sur ce sujet, ils prétendaient mieux rejoindre les auditeurs. L’émission a eu du succès, mais rien n’a changé. À preuve, sur les ondes de la première chaîne de Radio Canada, un certain matin, une animatrice demande à un interprète s’il fera encore son prochain disque avec l’accent français. Surprise de l’interviewé qui, manifestement, est Québécois comme elle et qui lui parle en bon et simple français d’ici.
Ce qui intriguait l’animatrice (ce n’est pas Marie-France Bazzo, rassurez-vous), c’était le fait qu’il ne chantait pas en français populaire, comme tous les autres. Étrange position de sa part à l’endroit du français standard québécois, qu’elle confondait avec l’accent français. Manifestement, les idées sur la qualité de la langue sont confuses et les attitudes, peu cohérentes.
Elles le sont aussi au sujet de la place du bilinguisme et du multilinguisme dans la politique linguistique actuelle du Québec. Lorsque le journal Le Devoir coiffe l’article du journaliste Robert Dutrisac du titre « Le temps est venu de doter la loi 101 d’une stratégie sur le bilinguisme[137] », on nage en pleine confusion. Le journaliste, et les « experts » dont il rapporte les opinions parues dans le deuxième tome de l’ouvrage du Conseil supérieur de la langue française oublient, ignorent sans doute qu’une stratégie de bilinguisme a inspiré la conception de la politique linguistique du Québec et que cette stratégie est demeurée constante depuis le livre blanc de Camille Laurin (mars 1977) jusqu’à l’énoncé de politique linguistique de la ministre Louise Beaudoin (1996)[138]. Le débat à propos du bilinguisme et du multilinguisme des citoyens du Québec n’a rien à voir avec la loi 101, mais relève d’un tout autre volet de la politique linguistique, de la responsabilité du ministère de l’Éducation en ce qui a trait à l’efficacité de l’enseignement de l’anglais. Sur ce point, ni le ministère ni les parents n’arrivent à choisir entre l’enseignement précoce à petites doses, que prône aujourd’hui le gouvernement Charest, dont l’échec est évident, et l’enseignement intensif, que tous les experts, depuis longtemps et démonstration à l’appui, considèrent plus efficace. Rien à faire : la hantise du danger du bilinguisme individuel généralisé bloque toute réforme de l’enseignement de l’anglais. La vraie question à débattre est celle-ci : est-ce un danger pour la langue française que les Québécois soient performants en langue anglaise?
Le vrai danger ne serait-il pas qu’ils accordent plus d’importance et de prestige à la langue anglaise qu’à la langue française?
La politique d’immigration massive suscite une sourde inquiétude chez les Québécois et les force à méditer, à redéfinir même le concept d’identité.
Sur ce point, nous sommes tous touchés, les francophones et les anglophones « de souche », les immigrants anciens et les immigrants récents. Pour ces derniers, il n’est pas toujours aisé de savoir et de choisir à quelle société s’intégrer, entre la société d’accueil, la société québécoise de langue française, et la société canadienne, plus abstraite, officiellement bilingue, mais qui leur propose en réalité un modèle de société en apparence plus accueillante, multiculturelle et multilingue[139].
La société québécoise, comme toute société d’accueil, est le lieu d’une délicate et constante négociation entre les anciens et les nouveaux citoyens. Les seconds s’interrogent sur ce qui leur semble essentiel de conserver de leurs cultures d’origine par rapport à ce qu’il convient d’emprunter à leur nouvel entourage culturel et qu’ils doivent accepter ou respecter. Les premiers se posent la question inverse : quels sont les éléments des cultures d’immigration qu’ils doivent accepter, et jusqu’à quel point, et quels sont ceux qu’ils peuvent accueillir jusqu’à les absorber, modifiant ainsi leur propre tradition culturelle? La réponse à ces questions n’est évidente, ni pour l’un, ni pour l’autre groupe, ni davantage pour les juges appelés à interpréter les Chartes des droits et libertés, la québécoise ou la canadienne, ni pour les diverses personnes aux prises dans la vie quotidienne avec les demandes des immigrants.
Ce sont souvent des intellectuels immigrants qui ont le mieux approfondi la notion d’identité, en prenant conscience du fait qu’en eux continuaient à cohabiter, plus ou moins harmonieusement, des appartenances multiples, à une culture d’origine, à une langue maternelle, parfois à une religion, mais aussi à la langue et à la culture de leurs nouveaux pays. L’identité ne leur a plus paru monolithique, mais, au contraire, toujours composite, même chez les citoyens de la société d’accueil[140]. Chez ces derniers, à l’inverse, le sentiment d’être d’une seule et même culture commune est une conviction (une illusion?) qui provient soit de l’influence de l’idéologie identitaire qui fonde la nation, Je me souviens au Québec, Une nation, une langue en France, soit de l’amalgame d’apports culturels différents dont le passage des années a gommé la perception.
Au Québec, la discussion tourne depuis peu autour du pronom NOUS : qui est Québécois, mais aussi, de toute évidence, qui est francophone, puisque la langue française est considérée depuis la Défaite/ Conquête de 1760 comme le trait fondateur de l’identité québécoise par opposition au ROC (rest of Canada), et le signe d’appartenance à la société québécoise par opposition à la société canadienne. La réponse à cette double interrogation partage les Québécois en deux camps. Le premier réunit ceux qui répondent qu’est francophone à part entière toute personne qui participe en français à la vie collective, citoyenne dit-on maintenant, indépendamment de la langue qu’il considère être sa langue maternelle. « Désormais, un francophone, c’est aussi un immigrant qui ne change pas de langue, mais qui se conforme à la loi 101 en faisant du français sa langue de communication publique », affirme Marco Micone[141]. Le second camp est celui des tenants du critère de la langue maternelle, définie comme la langue de l’enfance, de l’enculturation, la langue habituellement parlée à la maison selon la formule de Statistique Canada. Cette définition est à double usage puisqu’elle sert également à comptabiliser vers quelle langue, le français ou l’anglais, se produisent les transferts linguistiques, indice le plus révélateur et le plus sûr selon eux du pouvoir d’attraction du français et de l’anglais au Québec et au Canada. Au Québec, les transferts linguistiques se font encore en faveur de la langue anglaise, moins nettement qu’autrefois, il est vrai[142]. Au Canada, ils favorisent la langue anglaise, même chez les francophones de langue maternelle qui sont de plus en plus nombreux à abandonner l’usage du français à la maison[143]. Le même immigrant peut donc être francophone pour les uns, allophone pour les autres, selon qu’il parle ou non sa langue d’origine à la maison et dans sa vie privée.
Est-il absolument nécessaire de définir le fameux NOUS? Ne serait-ce pas chez certains francophones une manière frileuse de concevoir la culture et la société québécoise par le partage d’un même temps historique, ou, au contraire, chez d’autres, un moyen de proclamer l’ouverture de cette même société à toute personne qui veut en partager le destin et les valeurs et qui le manifeste par l’emploi de la langue française? Ne serait-ce pas plutôt une astuce pour exorciser le malaise avec lequel est vécue la mutation de la composition ethnique de la population du Québec, qu’on soit ou non « de souche », qu’on soit d’ici depuis ses ancêtres ou récemment arrivé, détaché d’un autre pays et d’une autre culture? Peut-on encore dire « Bienvenue chez nous » à un nouvel arrivant, se demandait un lecteur du Devoir, particulièrement déconcerté par l’ambiguïté du NOUS[144]? Ne serait-ce qu’un mauvais moment à passer entre un passé homogène révolu et un avenir multiethnique incertain, mais certainement partagé?
Ces questions divisent les Québécois depuis une vingtaine d’années. Les attitudes sont aussi variées que les opinions, en général teintées chez tous d’une inquiétude quant à la possibilité que les Québécois puissent demeurer majoritaires, surtout à Montréal. Les plus pessimistes évoquent déjà l’hypothèse[145] d’un Québec à majorité francophone en région, composite à Montréal, avec, au mieux, une faible majorité de langue française, langue maternelle ou langue d’usage public.
Tout dépendra de la proportion des francophones ou des francotropes dans la composition des cohortes successives d’immigrants, du taux de natalité des francophones et surtout de l’efficacité des mesures d’intégration linguistiques des immigrants récents. Il est évident aujourd’hui que le Québec n’arrive pas à franciser les immigrants, dont les vagues se succèdent année après année, toujours aussi nombreuses.
La source de la pression sur la langue française s’est déplacée.
Ce n’est plus, comme à l’époque de l’adoption de la Charte de la langue française, la force économique de la minorité anglophone, mais celle de la langue anglaise comme langue internationale.
La pression de la langue anglaise se manifeste dans tous les domaines d’activité : la politique internationale, la recherche, l’économie, la technologie, le commerce, la culture, surtout la chanson et le cinéma. L’anglais est maintenant la langue commune de communication entre personnes de langues différentes, la lingua franca de ce début du XXIe siècle. Aucun pays, aucune langue n’échappe à la concurrence de l’anglais, pas même la France où l’anglomanie n’a jamais été ni aussi forte ni aussi généralisée. « L’anglais est la langue de la modernité », soutenait le journal Le Monde lors de la querelle à propos de la décision de l’Institut Pasteur de publier ses travaux en langue anglaise.
Chacun s’en accommode et contribue de ce fait à conforter l’hégémonie mondiale de la langue anglaise.
Louise Beaudoin, en 1996, a été la première à envisager d’inclure un volet additionnel à la politique linguistique québécoise[146]. Elle proposait que le Québec « prenne l’initiative d’une stratégie internationale en faveur du plurilinguisme ».
Prendre l’initiative, formule prudente pour masquer le fait que le Québec n’étant pas un pays souverain ne peut participer de plain-pied aux délibérations des instances internationales, qu’il en est réduit à une diplomatie de coulisse pour défendre ses positions et ses intérêts, en cherchant à convaincre des pays souverains à les partager et à les faire leurs. C’est de cette manière que le Québec a agi pour prendre la défense de la diversité culturelle, et linguistique au départ, contre la prétention des États-Unis à considérer la culture comme une activité économique soumise aux mêmes règles que tout autre secteur. La position économique ultralibérale défendue par les États-Unis aurait eu comme conséquence de rendre illégale toute forme d’aide du Québec, ou de tout autre état, à la création, la production et la diffusion des biens culturels. La stratégie de coulisse a eu du succès dans ce cas, mais uniquement parce que le Québec a suscité l’appui de la France d’abord, du Canada ensuite, qui ont pris le relais et la parole pour constituer des alliances avec d’autres pays souverains et obtenir ainsi la majorité des voix lors du vote à l’UNESCO. « Succès de la diplomatie québécoise », se sont vantés les journaux d’ici. Mais succès peut-être sans lendemain. La diplomatie de coulisse est un pis-aller. Le Québec a et aura toujours beaucoup de mal à la faire fonctionner.
En somme, ce qui est inquiétant, c’est que rien de tout cela n’inquiète la majorité des Québécois!
Conclusion – Quels sont les défis d’aujourd’hui?
En introduction, j’évoquais l’incident à l’origine de ce livre, la réplique de cette étudiante pour excuser son ignorance de l’origine et du contenu de la politique linguistique du Québec. « C’est de votre faute, m’avait-elle reproché, si on ne sait rien! Personne ne nous en a jamais parlé et vous n’avez rien écrit sur le sujet. » Eh bien! maintenant, c’est fait, avec concision, il est vrai, le plus simplement et le plus complètement que possible.
J’appartiens, comme on le devine, à une génération qui s’est beaucoup impliquée dans la question de la langue, la génération des « vieux », souvent discréditée aux yeux des jeunes d’aujourd’hui qui, à leur tour, veulent refaire le monde à leur manière. Tant mieux. Mais il ne faut pas qu’ils oublient que cet avenir doit, au Québec, se concevoir et se réaliser en langue française. Si on l’oublie, on reviendra rapidement aux deux risques d’avant la politique et la législation linguistiques. Nous risquerons à nouveau de tourner le dos à notre culture française d’origine, fondement de notre identité collective, le fameux caractère distinct du Québec dont on se vante tant. Nous serons encore plus minoritaires dans un grand tout de langue anglaise.
Au cours de cette longue méditation sur l’histoire récente de la politique linguistique, je réfléchissais constamment à son avenir, à la tâche de la génération des « enfants de la loi 101 », au fait que c’est maintenant à leur tour d’assumer la responsabilité de ce qu’elle deviendra. Qu’est-ce qui est le plus urgent aujourd’hui? Qu’est-ce qui doit être entrepris pour que la langue française ne recule pas une fois encore devant la pression de la langue anglaise? Comment résister à la fascination de la puissance économique et culturelle mondiale de la langue anglaise? Comment, de nouveau, nous convaincre tous ensemble, individus et entreprises, que la langue française n’est pas une langue de seconde zone, tout juste utile à communiquer entre membres de la « tribu », comme disait Trudeau en parlant de la langue française québécoise?
Voici ce qui me semble être les défis actuels.
Le plus urgent est de renouer avec ce que j’appellerais l’esprit de Saint-Léonard, avec la conviction que chaque citoyen du Québec a son rôle à jouer dans l’avenir de la langue française, la conviction que cet avenir dépend de l’engagement de chacun à l’égard de notre langue commune, la conviction qu’il ne faut pas en remettre aveuglement et paresseusement le sort entre les mains des seuls politiciens ou du personnel des organismes de la Charte. Pour ma part, je suis profondément convaincu qu’aujourd’hui comme hier, l’avenir de la langue française va se jouer dans la vie quotidienne, dans les choix et les comportements de chaque locuteur de la langue française, au Québec, mais aussi dans les autres pays de la francophonie, au premier chef en France. Ce qui n’exclut pas, mais au contraire suscite l’intervention de l’État, qui n’agit, le plus souvent, que sous l’impulsion de l’opinion publique, c’est-à-dire des électeurs de chaque parti politique. C’est ce qui est arrivé au moment de la crise de Saint-Léonard : les commissaires ont pris l’initiative de déclarer la langue française langue d’enseignement dans leurs écoles primaires, bien soutenus dans leur décision par les parents francophones et la population de la ville. Ce qui obligea le gouvernement à intervenir et fut le point de départ de la succession rapide des lois linguistiques dont les intellectuels des années 1950 avaient préparé le terrain et identifié les grands thèmes. C’est avec ce type d’engagement, personnel et collectif qu’il est essentiel de renouer.
L’action de chacun se joue sur plusieurs plans : comme locuteur de la langue, comme témoin de la langue française devant les immigrants récents, comme consommateur, enfin comme électeur. Autant de formes d’action qui, toutes, font que la politique linguistique est efficace et adaptée à la situation, ou qu’elle ne l’est pas.
Agir comme locuteur du français d’abord. Chacun d’entre nous est responsable de la manière dont il parle et écrit, chacun est ou n’est pas soucieux d’exprimer sa pensée en termes justes et en phrases simples et bien construites. Chacun d’entre nous cependant subit la pression du milieu, qui, souvent, nous enferme dans le carcan linguistique de notre origine. C’est le rôle du ministère de l’Éducation de permettre aux enfants de devenir de vrais caméléons linguistiques, en acquérant par l’École la compétence et la liberté de passer, selon les circonstances, de la langue standard aux autres niveaux de langue. Encore faudrait-il que le Ministère enseigne et valorise la langue standard, écrite et parlée, dont la connaissance et la maîtrise sont à la base de la liberté d’expression dans une société démocratique et à la base du succès personnel dans un monde économique où la communication et l’information ont pris une énorme importance. La qualité de la langue ne relève pas uniquement de l’esthétique, mais surtout du souci de disposer d’un outil de travail efficace et de plus en plus essentiel. C’est encore moins l’affaire des seuls linguistes. Leur rôle, avons-nous dit, est d’observer les manières dont les locuteurs québécois emploient la langue française et de décrire ces différents usages en les situant par rapport à celui que la société considère comme le meilleur, comme étant la norme de la variante québécoise de la langue française. Le français parlé et écrit des locuteurs québécois est la matière première des linguistes, dont ils tireront des dictionnaires, des grammaires, des traités de prononciation. C’est de ce trio que dépend la qualité de la langue, le soin qu’y apporte chaque locuteur, le travail de description des linguistes et l’enseignement de la langue par le ministère de l’Éducation.
Agir ensuite comme témoin de la langue française, tout particulièrement en présence des immigrants récents, une langue qui a ses caractéristiques légitimes, mais autant que possible une langue de qualité, qui ne se complaît pas dans le folklorisme des usages populaires. Surtout, une langue que chacun se doit d’utiliser avec les personnes en voie de francisation, dont le français est hésitant. Nous devons nous considérer à leur endroit comme des moniteurs de français, avec patience et tolérance à l’égard de leurs erreurs, qu’on peut subrepticement corriger en reprenant la forme correcte dans la suite de la conversation. On doit avoir le même comportement à l’égard des anglophones au lieu de leur parler anglais. À ce sujet, le journal Le Devoir a publié la lettre[147] d’un anglophone parfaitement bilingue et francophile qui se plaignait amèrement qu’on lui parle anglais à Montréal sitôt qu’on voyait son nom, Gordon McIvor, qui n’est décidément pas de souche, remarquait-il avec humour. « J’ai la conviction profonde et je veux le crier sur tous les toits du Québec », écrivait-il. « Si un anglophone vous adresse la parole en français et que son français n’est pas trop lamentable, pourquoi nom de Dieu ne pas l’encourager dans cette démarche? » Il nous fournit lui-même ce qui lui semble être la raison de ce passage à la langue anglaise avec les anglophones. À la personne qui venait de lui jouer le tour une fois de plus, il demande : « Pourquoi vous me répondez en anglais quand je vous parle français? » Réponse : « Parce que vous êtes anglais, mon cher Monsieur ». Voilà, cette personne le faisait, pensait-elle, par gentillesse, mais c’est en même temps un geste d’exclusion : vous êtes anglais, je vous parle anglais. Le français est pour les francophones. C’est du moins de cette manière qu’il a interprété ce refus de lui parler français. Cet Anglo francophile a parfaitement raison de protester et il est, sans s’en douter, le porte-parole de toutes les personnes en voie de francisation.
Agir aussi comme consommateur. La loi 101 décrit avec précision les devoirs des entreprises commerciales eu égard à l’emploi au Québec de la langue française comme langue du commerce et des affaires, comme langue de service de la clientèle francophone, dans l’affichage public et les raisons sociales. Nous avons fait état de l’évolution de ces obligations depuis leur formulation initiale en 1977 au chapitre intitulé « L’évolution de la législation linguistique ». Ces obligations imposées aux entreprises deviennent autant de droits dont les consommateurs québécois de langue française peuvent exiger le respect de la part des entreprises et des commerçants. Encore faut-il qu’ils se comportent en conséquence. Si les clients québécois ne réclament pas le respect de leurs droits, en d’autres mots plus percutants, s’ils n’utilisent pas leur pouvoir d’achat comme moyen de pression pour obtenir le respect des dispositions de la loi, pourquoi les entreprises commerciales se donneraient-elles la peine d’en tenir compte, de dépenser de l’argent pour modifier l’emballage et la présentation de leurs produits, pour se donner un nom français, pour veiller à ce que le personnel connaisse le français? Si la compagnie ESSO a si rapidement abandonné son projet d’une bannière en langue anglaise, en décembre 2006, ce n’est pas à la demande du gouvernement ou de l’Office québécois de la langue française, mais bien parce qu’elle a immédiatement perçu la forte réprobation, la colère même des consommateurs québécois et qu’elle a craint de perdre sa part de marché dans une compétition déjà très serrée avec les autres pétrolières. Si ce sursaut d’indignation linguistique des consommateurs québécois s’était manifesté d’une manière constante, les raisons sociales anglaises n’auraient pas proliféré au Québec au point de donner aux rues commerciales et aux centres commerciaux ce visage anglais que les Québécois dénoncent maintenant. Les entreprises commerciales ne sont surtout sensibles qu’au seul argument du profit, qui repose pour elles sur la fidélité et la satisfaction de la clientèle. C’est cette force que les consommateurs québécois doivent utiliser, sans fausse pudeur, pour exiger d’elles le respect de la Charte de la langue française . Il n’y a pas d’autres manières d’agir, pas d’autres manières également de faire disparaître les marques de commerce anglaises à la devanture des magasins : protester, aller ailleurs, compromettre le profit de l’entreprise. Sommes-nous si dépendants que nous ne puissions cesser de fréquenter des établissements qui ne nous respectent pas?
Enfin, agir comme électeurs, pour la simple raison que les gouvernements, à l’instar des entreprises commerciales, ne poursuivent eux aussi qu’un seul objectif, se faire élire ou réélire, donc séduire l’électorat. Les électeurs détiennent le grand pouvoir de faire et de défaire les gouvernements. Plus important encore, ils ont la possibilité tout au long d’un mandat électoral de faire pression sur les ministres et le gouvernement lorsqu’ils estiment qu’une politique dérape ou qu’elle ne les satisfait pas, en tout ou en partie. En matière de politique linguistique, la pression doit s’exercer, directement ou par l’intermédiaire des députés, sur les ministres responsables des grands axes qu’elle comporte, la Charte de la langue français, l’Immigration et les Communautés culturelles, l’Éducation. L’action des électeurs est d’autant plus forte qu’elle est constante et concertée, qu’elle donne lieu à un débat public où les diverses opinions se manifestent, qu’une certaine unanimité se dégage autour d’une idée, d’un constat, d’un projet. C’est l’essence même de la vie démocratique, comme on le voit en ce début d’année 2007 au sujet de la notion d’accommodement raisonnable. À condition cependant que les électeurs s’intéressent au dossier linguistique, ce dont je doute, parce qu’il est complexe, moins aisé à comprendre pour le grand public et qu’on en perçoit mal les grands enjeux, ou peut-être plus prosaïquement, parce que le dossier n’est plus à la mode.
Pour ma part, les questions actuelles les plus stratégiques qui exigent l’intervention rapide du gouvernement me semblent concerner la langue de travail, l’augmentation du niveau de scolarité des Québécois francophones, la politique d’intégration sociale et linguistique des immigrants, l’enseignement du français. La connaissance et le rôle de la langue anglaise au Québec sont le lien commun entre elles.
L’affirmation par la Charte de la langue française du français comme langue de travail est fortement compromise par le retour en force de l’exigence de la connaissance de la langue anglaise comme condition d’embauche. De nouveau, c’est la langue anglaise qui apparaît comme la langue de travail la plus importante, puisqu’elle sert de critère de sélection entre les candidats à un emploi. Les Québécois francophones le savent, les immigrants de langue française que la politique d’immigration cherche à recruter l’apprennent à leurs dépens et se disent floués par le mirage qu’on leur a présenté d’un Québec d’Amérique mais de langue française, les immigrants allophones s’en rendent compte rapidement et ne sont guère motivés à apprendre le français dès leur arrivée puisqu’ils ont du mal à se trouver du travail à moins de connaître la langue anglaise. Ce ne sont pas les dispositions de la loi 101 qui sont en cause. C’est le fait que, dans la procédure de leur mise en œuvre par l’Office québécois de la langue française, on s’est concentré sur la connaissance de la langue française par le personnel et sur l’observation de son emploi dans l’entreprise, et encore uniquement dans les communications écrites. L’Office ne s’est pas soucié, en contrepartie, d’imposer aux entreprises des restrictions quant à l’exigence de la connaissance de la langue anglaise en fonction des exigences de chaque fonction. Les entreprises ont donc toute liberté de poser comme condition d’embauche la connaissance de la langue anglaise sans préciser ni pourquoi, ni à quel niveau de compétence. L’exigence vaut pour tout le monde, indépendamment de la fonction à exercer. Pour l’entreprise, c’est la manière la plus efficace d’éviter de devoir assumer les frais du perfectionnement linguistique de ses employés, même si le coût de ce perfectionnement est déductible de son revenu imposable. Un sérieux coup de barre s’impose pour encadrer l’exigence de la langue anglaise lors du recrutement, y compris dans les offres d’emploi. La connaissance de la langue anglaise ne doit plus être une condition d’embauche, à moins que l’entreprise n’en ait démontré la légitimité devant l’Office de la langue française.
Par contre, l’exclusion, par la loi 101, des entreprises de 49 employés et moins des obligations d’un programme de francisation a comme conséquence que les propriétaires choisissent librement la langue de travail de leurs entreprises. Ils doivent cependant respecter les autres dispositions de la loi, notamment celle de servir en français la clientèle francophone. Il en découle deux conséquences néfastes. Dans ces entreprises, de plus en plus nombreuses, le français risque de ne pas être la langue de travail. D’autre part, ces entreprises sont souvent le refuge des immigrants récents qui y trouvent du travail sans devoir savoir le français. Il est devenu urgent d’intégrer ces entreprises dans le programme de francisation, autant pour généraliser le statut du français comme langue de travail que pour favoriser l’intégration linguistique des immigrants.
Le mythe de la langue anglaise repose le plus souvent sur l’ignorance de cette langue à la fin de la scolarité obligatoire. D’où la tentation pour plusieurs élèves de poursuivre leurs études dans un cégep ou une université de langue anglaise. Le meilleur moyen de dégonfler ce mythe est d’enseigner efficacement la langue anglaise durant la scolarité obligatoire. La responsabilité en revient au ministère de l’Éducation et au gouvernement. Mais l’un et l’autre s’entêtent à enseigner la langue anglaise à petites doses dès les premières années de l’école primaire pour satisfaire la hantise des parents qui confondent la durée de l’enseignement avec son efficacité, et sans se soucier de la compétence des instituteurs et institutrices en langue anglaise et en pédagogie des langues secondes. À venir jusqu’à maintenant, cette manière d’enseigner l’anglais a été un échec : les élèves ne parlent pas anglais à la fin du secondaire à moins que leurs parents n’aient pris d’autres moyens d’y arriver, par exemple en envoyant leurs enfants dans des camps d’été en langue anglaise. Tous les spécialistes, au contraire, favorisent l’enseignement concentré, dont la formule pédagogique va de l’immersion à l’enseignement intensif, avec, comme point commun, la création d’un environnement pédagogique entièrement de langue et de culture anglaises. Les spécialistes québécois sont également d’avis que cet enseignement doit venir après une bonne acquisition de la langue française et qu’il pourrait se situer à la fin du primaire ou au début du secondaire. Qui aura le courage d’une véritable réforme de l’enseignement de la langue anglaise? Ce ne serait pas une trahison, mais la réalisation d’un des objectifs de la politique linguistique du Québec, déjà au programme de l’énoncé de politique présenté par Camille Laurin au nom du gouvernement du Parti québécois en 1977. Une autre action s’impose : le ministère de l’Éducation doit rendre plus accessible l’enseignement de la langue anglaise aux immigrants francophones, tout comme le ministère de l’Immigration le fait pour l’enseignement du français aux autres immigrants. Ce serait justice à leur égard que de leur faciliter l’intégration à ce Québec de langue française mais où la langue anglaise du reste de l’Amérique est omniprésente. Le Québec n’est pas une île de langue française au large du continent!
L’autre défi du ministère de l’Éducation est l’enseignement du français standard, écrit et parlé, à tous les jeunes du Québec. On en est très loin depuis la cascade des réformes scolaires amorcées dès la fin des années 1960, avec l’idée des programmes cadres, fondement de la décentralisation de l’enseignement. Les unes après les autres, des générations d’écoliers sont sortis de l’école obligatoire avec une plus ou moins bonne connaissance pratique de la langue écrite, orthographe et grammaire, ou avec une certaine aisance à parler en phrases qui se tiennent avec le vocabulaire qui convient. Nous en avons traité longuement au chapitre de la qualité de la langue.
Le défi des jeunes d’aujourd’hui est celui de la poursuite des études. En effet, ils sont écartelés entre les tentations de l’hyperconsommation (s’acheter des vêtements, un téléphone cellulaire dernier cri, un lecteur de mp3, un ordinateur, une auto), ce qui les pousse à consacrer de plus en plus de temps à gagner de l’argent, ou se concentrer sur leurs études et se préparer à les poursuivre au collégial et à l’université. Leur avenir se joue sur ce choix. La satisfaction est immédiate dans le premier cas, à long terme dans le second. Rappelons des indices qui cernent bien leur avenir potentiel. La probabilité de se trouver un emploi, et un emploi de plus en plus valorisant, dépend directement du niveau de scolarité atteint. En 2004, cette probabilité, selon les indicateurs du ministère de l’Éducation, augmentait avec le niveau d’études : 14,8 % sans diplôme d’études secondaires, 23,9 % avec un diplôme d’études secondaires et 56,8 % avec un diplôme d’études collégiales ou universitaires. Il n’y a pas d’avenir pour quelqu’un qui n’a que le secondaire, encore moins pour les décrocheurs. Or, le nombre de jeunes qui poursuivent leurs études au-delà du secondaire diminue rapidement d’un niveau à l’autre des études supérieures, toujours selon les prévisions du ministère de l’Éducation : en 2004-2005, sur 100 jeunes qui entrent à l’école, 85 obtiendront un diplôme d’études secondaires, 39, un diplôme d’études collégiales, 29, un premier diplôme universitaire, 9, une maîtrise et un seul, un doctorat. De plus, l’Office québécois de la langue française nous indique que le niveau de scolarité est moins élevé chez les francophones que chez les anglophones et les allophones. Si cette tendance se maintient, et tout porte à croire que tel sera le cas, il faut s’attendre à ce que les jeunes Québécois francophones soient mal adaptés aux exigences de l’économie postindustrielle et mal préparés à la concurrence pour l’obtention des postes les plus intéressants, les plus rémunérateurs et les plus stratégiques.
L’intégration des immigrants est certainement l’élément le plus décisif, avec la langue de travail, pour l’avenir de la langue et de la culture françaises au Québec. D’ailleurs, la relation entre langue de travail et intégration linguistique des immigrants est si étroite que tout recul du français au travail la compromet irrémédiablement. Le défi le plus actuel est cependant celui de l’intégration sociale, plus précisément le retour à la conception de l’immigration comme contrat moral[148] entre les immigrants et les Québécois, qui définit les droits mais aussi les devoirs des uns et des autres. Ce ne sont pas deux groupes qui s’affrontent, mais, au contraire, deux groupes qui ont choisi librement de s’interpénétrer, de s’amalgamer. Cette notion de contrat moral est complètement oubliée aujourd’hui, personne n’en parle plus, ce ne semble plus être le point central de la conception québécoise de l’immigration. De cet oubli découle la dérive de la notion d’accommodement raisonnable, provoquée surtout par une minorité de personnes religieuses ultraconservatrices soucieuses de leurs seuls droits, évoqués pour des motifs dont il faut, chaque fois, apprécier le bien-fondé. La phase d’évaluation, et la décision qui en découle, est sans cesse source de tension entre ces personnes, les autres adeptes de la même religion et les membres de la société d’accueil. Il n’y a pas d’autre solution sociale à cette dérive que de revenir à la notion de contrat moral.
Le Québec est engagé dans une rapide et périlleuse mutation provoquée par la mondialisation, l’hégémonie de la culture américaine, l’arrivée des immigrants vague après vague. C’est le défi qui résume tous les autres, que les Québécois d’aujourd’hui et de demain doivent relever. Espérons qu’ils le feront sans perdre leur âme, la culture française, mais qu’au contraire, ils feront évoluer la culture québécoise sans heurts en y associant les nouveaux Québécois. Les peuples sont grands quand ils demeurent eux-mêmes.
Troisième partie – Documents repères
- Corbeil, Jean-Claude, Essai de définition du bilinguisme fonctionnel : l’expérience québécoise, Québec, Régie de la langue française, Éditeur officiel du Québec, coll. « Études, recherches et documentation », 1975 [septembre 1973], 27 p.
- Corbeil, Jean-Claude, Notes sur les rapports entre le français québécois et le français de France, Québec, Régie de la langue française, Éditeur officiel du Québec, coll. « Études, recherches et documentation », 1975 [mars 1974], 19 p.
- Corbeil, Jean-Claude, « Éléments d’une théorie de la régulation linguistique », La norme linguistique, Textes colligés et présentés par Édith Bédard et Jacques Maurais, Québec/Paris, Conseil de la langue française/Le Robert, coll. « L’ordre des mots », 1983, p. 281-303.
- Corbeil, Jean-Claude, « Comment orienter l’usage d’une langue », La Lingüística aplicada. noves perspectives - noves professions - noves orientacions, coll. « Cicle de conferències », no 9, Barcelona, Universitat de Barcelona, Fundació Caixa de pensions, 1990 [1989], p. 79-85.
- Corbeil, Jean-Claude, « Comment s’insère l’aménagement linguistique dans la structure et la culture politiques d’un pays. Étude d’un cas : les politiques linguistiques au Canada », DiversCité Langues, en ligne, vol. 1, juin 1996.
- Corbeil, Jean-Claude, « Le rôle de la terminologie en aménagement linguistique », Paris, Langages, no 168, juin 2007, p. 92-105.
Annexes
I. Principales dispositions de la Loi sur la langue officielle (loi 22)
Sanctionnée le 31 juillet 1974
Le texte initial bilingue français-anglais est présenté sur deux colonnes; seul le texte français est repris ici.
La langue officielle du Québec
Article 1 – Le français est la langue officielle du Québec.
Article 2 – Le texte français des lois du Québec prévaut sur le texte anglais.
La langue de l’administration publique
Article 6 – Les textes et documents officiels de l’administration publique doivent être rédigés en français.
Article 8 – Ils peuvent être accompagnés d’une version anglaise, mais seule la version française est authentique.
Article 9 – Les organismes municipaux et scolaires dont au moins dix pour cent des administrés sont de langue anglaise […] doivent rédiger leurs textes et documents officiels à la fois en français et en anglais.
En cas de fusion réduisant la proportion d’anglophones, cette disposition continue de s’appliquer si l’acte de fusion y pourvoit.
Article 10 – L’administration publique doit utiliser la langue officielle pour communiquer avec les autres gouvernements du Canada et, au Québec, avec les personnes morales.
Toute personne a le droit de s’adresser à l’administration publique en français ou en anglais, à son choix.
Article 11 – Les organismes gouvernementaux sont désignés par leur seule dénomination française.
Article 12 – Le français est la langue de travail de l’administration publique.
Article 13 – Le français et l’anglais sont les langues de communication interne de ces organismes.
Ils communiquent en français ou en anglais avec les autres gouvernements et avec les personnes morales.
Article 14 – Obligation de connaître le français pour travailler dans l’administration publique, une connaissance appropriée à l’emploi.
Article 16 – Obligation faite au ministre de la justice de traduire les jugements prononcés en anglais.
Article 17 – Les contrats conclus au Québec par l’administration publique et les sous-contrats qui s’y rattachent doivent être rédigés en français.
Ils peuvent aussi être rédigés à la fois en français et en anglais ou, lorsque l’administration publique contracte avec l’étranger, à la fois en français et dans la langue du pays intéressé.
La langue des entreprises d’utilité publique et des professions
Article 18 – Obligation pour les entreprises d’utilité publique et les professions de rendre leurs services en français.
Article 19 – Obligation pour les entreprises d’utilité publique et les professions de s’adresser en français à l’administration publique.
Article 20 – Obligation pour les entreprises d’utilité publique et les professions de rédiger en français tout document destiné au public.
Ces textes et documents peuvent néanmoins être accompagnés d’une version anglaise.
Article 21 – Obligation d’avoir une connaissance d’usage de la langue française pour obtenir un permis d’une corporation professionnelle.
Article 22 – Possibilité d’obtenir un permis temporaire pour une durée maximum d’un an, renouvelable par une décision du gouvernement si l’intérêt public le requiert.
La langue de travail
Article 24 – Obligation pour les employeurs de rédiger en français tout document destiné au personnel.
Les mêmes documents peuvent être rédigés en anglais si une partie du personnel est de langue anglaise.
Article 25 – Le français est la langue des relations de travail dans la mesure et suivant les modalités du Code du travail.
Article 26 – Le gouvernement pourvoit, par règlement, à l’émission de certificats en faveur des entreprises qui ont adopté et qui appliquent un programme de francisation selon les articles 29 et 39 ou dont la situation du français est déjà conforme aux mêmes articles.
Ces règlements établissent des catégories d’entreprises suivant leur genre d’activités, l’importance de leur personnel, l’ampleur
des programmes à adopter et les autres éléments pertinents; ils déterminent aussi, pour chacune des catégories ainsi établies, la date à laquelle le certificat susdit devient exigible pour l’application de l’article 28.
Article 27 – Pouvoir donné à la Régie de demander à toute entreprise de procéder à l’élaboration et à l’implantation d’un programme de francisation.
Article 28 – Les entreprises doivent posséder un certificat de franci sation pour recevoir de l’administration publique les primes, subventions, concessions ou tout autre avantage, ou pour conclure avec le gouvernement les contrats d’achat, de service, de location ou de travaux publics.
Si une entreprise s’est engagée sérieusement dans un programme de francisation, elle peut obtenir un certificat provisoire.
Article 29 – Éléments du programme de francisation :
- connaissance du français par les dirigeants et le personnel;
- présence de francophones dans l’administration;
- l’emploi du français dans les manuels, les catalogues, les instructions écrites et dans tout autre document distribué au personnel;
- droit du personnel de communiquer en français entre eux et avec leurs supérieurs;
- la terminologie française employée dans l’entreprise.
Article 39 – Ce programme doit porter en outre sur :
- la raison sociale de l’entreprise;
- la langue de communication avec les clients et les personnes;
- la langue des avis, communications, certificats et formulaires destinés au public ou aux actionnaires et membres de l’entreprise du Québec.
Article 58 – Le programme de francisation est soumis à la Régie de la langue française.
Si la Régie juge que le programme est suffisant et appliqué efficacement, elle en propose l’approbation au ministre.
En cas contraire, elle recommande au ministre les améliorations qu’elle juge nécessaires.
Article 59 – Après approbation du ministre, la Régie délivre à l’entreprise un certificat de francisation.
Pour des raisons valables, la Régie peut, avec l’accord du ministre, retirer ce certificat.
La langue des affaires
Article 30 – La personnalité juridique ne peut être conférée à moins que la raison sociale adoptée ne soit en langue française. Elle peut être accompagnée d’une version anglaise.
Article 32 – Les raisons sociales françaises doivent ressortir, ou à tout le moins figurer dans les textes et documents d’une manière aussi avantageuse que les versions anglaises.
Article 33 – Doivent être rédigés en français les contrats d’adhésion, les contrats où figurent des clauses-types imprimées ainsi que les bons de commande, les factures et les reçus imprimés.
Ces documents doivent cependant être rédigés en anglais à la demande du client ou de la personne.
La version la plus favorable au client ou à la personne prévaut.
Article 34 – L’étiquetage des produits doit se faire en français, ainsi que les certificats de garantie, les notices qui accompagnent les produits, les menus et les cartes de vins.
Article 35 – L’affichage public doit se faire en français, ou à la fois en français et dans une autre langue, ainsi que les panneaux-réclames et les enseignes lumineuses. Cette disposition ne s’applique pas aux annonces publicitaires paraissant dans un journal ou un périodique publiés dans une autre langue (art. 36).
La langue de l’enseignement
Article 40 – Règle générale 1 : l’enseignement se donne en langue française.
Il se donne également en langue anglaise.
Il peut se donner dans la langue des Indiens et des Inuits du Nouveau-Québec.
Article 41 – Règle générale 2 : les élèves doivent connaître suffisamment la langue d’enseignement pour recevoir l’enseignement dans cette langue.
Ceux qui ne connaissent suffisamment aucune des langues d’enseignement reçoivent l’enseignement en langue française.
Article 43 – Recours à des tests pour s’assurer que les élèves ont une connaissance suffisante de la langue d’enseignement pour recevoir l’enseignement dans cette langue.
Article 44 – Enseignement obligatoire du français, parlé et écrit, dans les écoles de langue anglaise.
Enseignement obligatoire de l’anglais, langue seconde, dans les écoles de langue française.
Dispositions diverses
Article 46 – La version française des textes et documents visés par la présente loi doit ressortir, ou à tout le moins figurer d’une manière au moins aussi avantageuse que toute version dans une autre langue.
La recherche en matière linguistique
Article 49 – Responsabilité du ministre de développer et de coordonner la recherche linguistique au Québec.
Les commissions de terminologie
Article 50 – Pouvoir donné au gouvernement d’instituer des commis sions de terminologie dont la mission est de faire l’inventaire des mots techniques employés dans un secteur, d’indiquer les lacunes qu’elles trouvent et de dresser la liste des termes qu’elles préconisent, notamment en matière de néologismes et d’emprunts (art. 51).
Article 52 – Les résultats de ces travaux sont soumis à l’approbation de la Régie, qui doit veiller à la normalisation des termes employés.
La Régie transmet ses conclusions aux ministres et aux direc tions des organismes intéressés qui peuvent les entériner et en dresser la liste.
Article 53 – Sur publication de la liste visée à l’article 52 dans la Gazette officielle du Québec, l’emploi des expressions et termes y figurant devient obligatoire dans les textes et documents émanant de l’administration publique, dans les contrats dont l’administration publique est partie ainsi que dans les ouvrages d’enseignement, de formation ou de recherche publiés en français au Québec et approuvés par le ministre de l’Éducation.
La régie de la langue française
Article 54 – Il est institué une Régie de la langue française.
Article 55 – La Régie a pour rôle :
- de donner son avis sur les règlements d’application de la loi;
- de veiller à la correction et à l’enrichissement de la langue parlée et écrite;
- de donner des avis au gouvernement à sa demande;
- de reconnaître les organismes municipaux et scolaires pour l’application des articles qui les concernent;
- de mener les enquêtes pour vérifier si la loi et les règlements sont observés;
- de donner son avis au ministre sur l’attribution des crédits destinés à la recherche linguistique et à la diffusion de la langue française;
- de collaborer avec les entreprises à l’élaboration et à la mise en œuvre de programmes de francisation;
- de délivrer les certificats de francisation aux entreprises;
- de normaliser le vocabulaire utilisé au Québec et d’approuver les expressions et les termes recommandés par les commissions de terminologie.
Les enquêtes
Article 78 – Un commissaire-enquêteur en chef et des commissaires-enquêteurs sont nommés à la Régie pour mener les enquêtes prévues au paragraphe e de l’article 55.
Article 87 – Le personnel d’enquête a le pouvoir et jouit de l’immunité accordée aux commissaires nommés en vertu de la loi des commissions d’enquête.
Sont précisées ensuite les modalités des enquêtes.
Dispositions finales
Article 101 – Le gouvernement désigne le ministre chargé de l’application de la présente loi.
Article 102 – Dans les quinze jours de l’ouverture de chaque session, le ministre soumet à l’Assemblée nationale un rapport détaillé sur les activités de son ministère dans le domaine de la dif fusion de la langue française au cours de l’année financière précédente.
Suit en annexe la composition de l’Administration publique.
II. Principales dispositions de la Charte de la langue française (loi 101)
Sanctionnée le 26 août 1977
(Texte de la version initiale de 1977, unilingue français pleine page)
PRÉAMBULELangue distinctive d’un peuple majoritairement francophone, la langue française permet au peuple québécois d’exprimer son identité.
L’Assemblée nationale reconnaît la volonté des Québécois d’assurer la qualité et le rayonnement de la langue française. Elle est donc résolue à faire du français la langue de l’État et de la Loi aussi bien que la langue normale et habituelle de travail, de l’enseignement, des communications, du commerce et des affaires.
L’Assemblée nationale entend poursuivre cet objectif dans un climat de justice et d’ouverture à l’égard des minorités ethniques, dont elle reconnaît l’apport précieux au développement du Québec.
L’Assemblée nationale reconnaît aux Amérindiens et aux Inuit du Québec, descendants des premiers habitants du pays, le droit qu’ils ont de maintenir et de développer leur langue et culture d’origine.
Ces principes s’inscrivent dans le mouvement universel de revalorisation des cultures nationales qui confère à chaque peuple l’obligation d’apporter une contribution particulière à la communauté internationale.
La langue officielle du Québec
Article 1 – Le français est la langue officielle du Québec.
Les droits linguistiques fondamentaux
Article 2 – Toute personne a le droit que communiquent en français avec elle l’Administration, les services de santé et les services sociaux, les entreprises d’utilité publique, les ordres professionnels, les associations de salariés et les diverses entreprises exerçant au Québec.
Article 3 – En assemblée délibérante, toute personne a le droit de s’exprimer en français.
Article 4 – Les travailleurs ont le droit d’exercer leurs activités en français.
Article 5 – Les consommateurs de biens et de services ont le droit d’être informés et servis en français.
Article 6 – Toute personne admissible à l’enseignement au Québec a le droit de recevoir cet enseignement en français.
La langue de la législation et de la justice
Article 7 – Le français est la langue de la législation et de la justice au Québec.
Article 8 – Les projets de loi sont rédigés, déposés à l’Assemblée natio nale, adoptés et sanctionnés en français.
Article 9 – Seul le texte français des lois et règlements est officiel.
Article 10 – L’Administration imprime et publie une version anglaise des projets de loi, des lois et des règlements.
Article 11 – Les procès se déroulent en français, à moins que toutes les parties à l’instance ne consentent à ce qu’elles plaident en langue anglaise.
Article 12 – Les pièces de procédures sont rédigées en français. Elles peuvent être rédigées dans une autre langue si la personne physique à qui elles sont destinées y consent expressément.
Article 13 – Les jugements rendus au Québec sont rédigés en français ou accompagnés d’une version française dûment authentifiée. Seule la version française est officielle.
La langue de l’Administration
Article 14 – Tous les organes du gouvernement ne sont désignés que par leur dénomination française.
Article 15 – L’administration rédige et publie en français ses textes et documents, sauf s’ils sont destinés à l’extérieur du Québec ou à des publications d’une autre langue ou lorsqu’il s’agit de correspondre avec un citoyen qui s’adresse à elle dans une autre langue.
Article 16 – L’administration n’utilise que le français dans ses communications avec les autres gouvernements et avec les personnes morales du Québec.
Article 17 à 22 – Le français est la langue de travail de l’Administration, y compris la rédaction des contrats [ sauf avec l’extérieur du Québec (art. 21) ] et l’affichage [ sauf cas majeur de sécurité ou de santé publique (art. 22) ].
Organismes municipaux et scolaires,
les services de santé et les services sociaux :
Article 23 – Règle générale : les services de santé et les services sociaux doivent assurer que leurs services sont disponibles en français, de même que les avis, communications et imprimés destinés au public.
Article 113, f) – Règle générale pour l’emploi d’une autre langue : l’Office de la langue française doit reconnaître les organismes qui fournissent leurs services à des personnes en majorité d’une autre langue que le français et, dans les organismes scolaires, les services chargés d’organiser ou de donner l’enseignement dans une autre langue que le français.
Ces organismes doivent se conformer aux articles 15 à 23 (art. 25), mais peuvent : afficher à la fois en français et dans une autre langue avec prédominance du français (art. 24), utiliser à la fois le français et une autre langue dans leur dénomination et leurs communications internes (art. 26), rédiger les pièces versées au dossier en français ou en anglais à la convenance du rédacteur, mais les résumés des dossiers cliniques doivent être fournis en français à toute personne qui en fait la demande (art. 27).
Article 29 – Signalisation routière en français seulement ou par usage de symboles ou de pictogrammes.
La langue des organismes parapublics
Article 30 – Les entreprises d’utilité publique, les ordres professionnels et les membres des ordres professionnels doivent faire en sorte que leurs services soient disponibles dans la langue officielle.
Ils doivent rédiger en cette langue les avis, communications et imprimés destinés au public, y compris les titres de transport.
Article 31 – Ils utilisent le français dans leurs communications écrites avec l’Administration et les personnes morales, ainsi qu’avec
l’ensemble de leurs membres, mais peuvent répondre dans la langue d’un interlocuteur particulier (art. 32).
Article 34 – Ils ne sont désignés que par leur dénomination française.
Article 35 – Ils ne peuvent délivrer de permis au Québec qu’à des personnes ayant de la langue officielle une connaissance appropriée à l’exercice de leur profession, prouvée suivant les règlements de l’Office, lesquels peuvent prévoir des examens et la délivrance d’attestations.
Article 37 – Ils peuvent cependant délivrer des permis temporaires valables un an, renouvelables que deux fois, à des personnes venant de l’extérieur du Québec, jugées aptes à exercer leur profession, mais qui n’ont pas la connaissance requise du français.
Article 40 – Possibilité d’un permis restrictif accordé à une personne à l’emploi d’un seul employeur et qui n’est pas en contact avec le public.
La langue de travail (Voir aussi La francisation des entreprises)
Article 41 – L’employeur rédige en français les communications qu’il adresse à son personnel. Il rédige et publie en français les offres d’emploi ou de promotion. Si l’offre d’emploi est publiée dans un quotidien d’une autre langue, elle doit simultanément paraître, avec la même importance, dans un quotidien de langue française (art. 42).
Article 43 – Les conventions collectives et leurs annexes doivent être rédigées en français.
Article 44 – Lors d’un arbitrage, la sentence arbitrale doit être rédigée en français ou être accompagnée d’une version française dûment authentifiée. Seule la version française est officielle.
Article 45 – Il est interdit à un employeur de congédier, de mettre à pied, de rétrograder ou de déplacer un membre de son personnel pour la seule raison que ce dernier ne parle que le français ou qu’il ne connaît pas suffisamment une langue donnée autre que le français.
Article 46 – Il est interdit à un employeur d’exiger pour l’accès à un emploi ou à un poste la connaissance d’une langue autre que le français, à moins que l’accomplissement de la tâche ne nécessite la connaissance de cette autre langue.
Il incombe à l’employeur de prouver à la personne intéressée, à l’association de salariés intéressée ou, le cas échéant, à l’Office de la langue française que la connaissance de l’autre langue est nécessaire. L’Office de la langue française a compétence pour trancher le litige, le cas échéant.
Article 47 – Le travailleur non syndiqué peut se prévaloir des articles 45 et 46 devant un commissaire-enquêteur. S’il est régi par une convention collective, il a le droit de soumettre son grief à l’arbitrage pour les mêmes motifs.
Article 49 – Une association de salariés utilise le français dans ses communications écrites avec ses membres. Elle peut corres pondre avec un interlocuteur individuel dans sa langue.
La francisation des entreprises
Article 136 – Les entreprises employant cinquante personnes ou plus doivent […] posséder un certificat de francisation délivré par l’Office.
Article 138 – Le certificat de francisation atteste que l’entreprise applique un programme de francisation approuvé par l’Office ou que la langue française y possède déjà le statut que les programmes de francisation ont pour objet d’assurer.
Article 141 – Les programmes de francisation ont pour but la généralisation de l’utilisation du français à tous les niveaux de l’entreprise. Ce qui comporte :
- la connaissance de la langue officielle chez les dirigeants, les membres des ordres professionnels et les autres membres du personnel;
- l’augmentation à tous les niveaux de l’entreprise, y compris au sein du conseil d’administration, du nombre de personnes ayant une bonne connaissance de la langue française de manière à en assurer l’utilisation généralisée;
- l’utilisation du français comme langue de travail et des communications internes;
- l’utilisation du français dans les documents de travail de l’entreprise, notamment les manuels et les catalogues;
- l’utilisation du français dans les communications avec la clientèle, les fournisseurs et le public;
- l’utilisation d’une terminologie française;
- l’utilisation du français dans la publicité;
- une politique d’embauche, de promotion et de mutation appropriée.
Article 144 – L’application des programmes de francisation à l’inté rieur des sièges sociaux peut faire l’objet d’ententes particulières avec l’Office.
Article 146 – Les entreprises employant cent personnes ou plus doivent […] instituer un comité de francisation d’au moins six personnes dont au moins le tiers est nommé […] pour représenter les travailleurs de l’entreprise.
Article 149 – À l’aide de formulaires et questionnaires fournis par l’Office, le comité de francisation procède à l’analyse de la situation linguistique de l’entreprise et fait rapport à la direction de l’entreprise pour transmission à l’Office.
Si l’Office juge que l’entreprise doit adopter et appliquer un programme de francisation, l’entreprise charge son comité de francisation d’établir le programme approprié et d’en surveiller l’application (art. 150).
La langue du commerce et des affaires
Article 51 – Toute inscription sur un produit, sur son contenant ou sur son emballage, sur un document ou objet accompagnant ce produit, y compris le mode d’emploi et les certificats de
garantie, doit être rédigée en français. Cette règle s’applique également aux menus et aux cartes des vins.
Le texte français peut être assorti d’une ou plusieurs traductions, mais aucune inscription rédigée dans une autre langue ne doit l’emporter sur celle qui est rédigée en français.
Article 53 – Les catalogues, brochures, dépliants et autres publications de même nature doivent être rédigés en français.
Article 54 – Sauf exception prévue par règlement de l’Office de la langue française, il est interdit d’offrir au public des jouets ou jeux dont le fonctionnement exige l’emploi d’un vocabulaire autre que le français, à moins que le jouet ou le jeu ne soit disponible en français sur le marché québécois dans des conditions au moins aussi favorables.
Article 55 – Les contrats d’adhésion, les contrats où figurent des clauses-types imprimées, ainsi que les documents qui s’y rattachent sont rédigés en français. Ils peuvent être rédigés dans une autre langue si telle est la volonté expresse des parties.
Article 57 – Les formulaires de demande d’emploi, les bons de commande, les factures, les reçus et quittances sont rédigés en français.
Article 58 – Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou par les règlements de l’Office de la langue française, l’affichage public et la publicité commerciale se font uniquement dans la langue officielle, sauf :
- la publicité véhiculée par un média d’une autre langue que le français et les messages de type religieux, politique, idéologique ou humanitaire, sans but lucratif (art. 59);
- l’affichage dans les établissements d’au plus quatre personnes, y compris le patron, à condition que le français apparaisse d’une manière au moins aussi évidente que l’autre langue (art. 60);
- l’affichage public des activités culturelles d’un groupe ethnique particulier qui peut se faire à la fois en français et dans la langue de ce groupe (art. 61);
- l’affichage public dans les établissements spécialisés dans la vente de produits typiques d’une nation étrangère ou d’un groupe ethnique particulier qui peut se faire à la fois en français et dans la langue de ce groupe (art. 62).
Article 59 – L’article 58 ne s’applique pas à la publicité véhiculée par des organes d’information diffusant dans une autre langue que le français ni aux messages de type religieux, politique, idéologique ou humanitaire, pourvu qu’ils ne soient pas à but lucratif.
Article 63 – Les raisons sociales doivent être en langue française.
Article 65 – Les raisons sociales qui ne sont pas en langue française doivent être modifiées avant le 31 décembre 1980, à moins que la loi en vertu de laquelle l’entreprise est constituée ne le permette pas.
Article 68 – Les raisons sociales peuvent être assorties d’une version dans une autre langue pour utilisation hors Québec, ou pour la commercialisation de produits offerts à la fois au Québec et hors du Québec.
Article 71 – Les associations sans but lucratif vouées exclusivement au développement culturel d’un groupe ethnique particulier ou à la défense des intérêts propres à celui-ci peuvent se donner une raison sociale dans la langue de ce groupe à condition d’y adjoindre une version française.
La langue de l’enseignement
Article 72 – L’enseignement se donne en français dans les classes maternelles, dans les écoles primaires et secondaires, aussi bien dans le réseau public que dans les établissements privés subventionnés.
Article 73 – Par dérogation à l’article 72, peuvent recevoir l’enseignement en anglais, à la demande de leur père et de leur mère.
- les enfants dont le père ou la mère a reçu au Québec l’enseignement primaire en anglais;
- les enfants dont le père ou la mère est, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, domicilié au Québec et a reçu, hors du Québec, l’enseignement primaire en anglais;
- les enfants qui, lors de leur dernière année de scolarité au Québec avant l’entrée en vigueur de la présente loi, recevaient légalement l’enseignement en anglais dans une classe maternelle publique ou à l’école primaire ou secondaire;
- les frères et sœurs cadets des enfants visés au paragraphe c.
Article 81 – Les enfants présentant des difficultés graves d’apprentissage doivent être exemptés de l’application du présent chapitre,
Le gouvernement peut, par règlement, définir les catégories d’enfants visés à l’alinéa précédent et déterminer la procédure à suivre en vue de l’obtention d’une telle exemption.
Article 87 – Rien dans la présente loi n’empêche l’usage d’une langue amérindienne dans l’enseignement dispensé aux Amérindiens.
Article 88 – Dans les écoles relevant de la commission scolaire Crie ou de la commission scolaire Kativik, les langues d’enseignement sont respectivement le Cri et l’Inuktitut ainsi que les autres langues d’enseignement en usage dans les communautés cries et inuit du Québec à la date de la signature de la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois.
Ces mêmes commissions scolaires poursuivent comme objectif l’usage du français comme langue d’enseignement en vue de permettre aux diplômés de leurs écoles de pour suivre leurs études en français, s’ils le désirent, dans les écoles, collèges ou universités du Québec.
Elles prennent les mesures nécessaires pour que la règle générale s’applique aux enfants dont les parents ne sont ni Cris, ni Inuit.
Ces dispositions s’appliquent, avec les modifications nécessaires, aux Naskapi de Schefferville.
La Charte de la langue française institue :
- un Office de la langue française (art. 99 à 121) pour faciliter et gérer l’application de la loi;
- une Commission de toponymie (art. 122 à 128) pour établir les critères de choix et les règles d’écriture de tous les noms de lieux, pour attribuer des noms de lieux ou approuver tout changement de nom de lieux (art. 124);
- une Commission de surveillance et des enquêtes (art. 157 à 184) pour traiter des questions se rapportant au défaut de respect de la présente loi (art. 158);
- un Conseil de la langue française (art. 185 à 204) pour conseiller le ministre sur la politique québécoise de la langue française et sur toute question relative à l’interprétation et à l’application de la présente loi (art. 186).
Elle prévoit également des amendes et peines en cas d’infractions (art. 205 à 208).
L’Office de la langue française : mandat et pouvoirs
Article 113 – L’Office doit :
- normaliser et diffuser les termes et expressions qu’il approuve;
- établir les programmes de recherches nécessaires à l’application de la présente loi;
- préparer les règlements de sa compétence qui sont nécessaires à l’application de la présente loi et les soumettre pour avis au Conseil de la langue française, conformément à l’article 188;
- définir, par règlement, la procédure de délivrance, de suspension ou d’annulation du certificat de francisation;
- aider à définir et à élaborer les programmes de francisation prévus par la présente loi et en suivre l’application;
- reconnaître les organismes municipaux et scolaires, les services de santé, les services sociaux et les services scolaires en vue de l’application des articles qui les touchent.
Article 114 – L’Office peut :
- adopter des règlements […];
- instituer des commissions de terminologie, en déterminer la composition et le fonctionnement et, au besoin, les déléguer auprès des ministères et organismes de l’Administration;
- adopter un règlement de régie interne…;
- établir, par règlement, les services et les comités nécessaires à l’accomplissement de sa tâche;
- […] conclure des ententes avec d’autres organismes ou un gouvernement en vue de faciliter l’application de la présente loi;
- exiger de toute institution d’enseignement collégial ou universitaire un rapport sur la langue des manuels utilisés et faire état des observations en la matière dans son rapport annuel;
- assister les organismes de l’Administration, les organismes parapublics, les entreprises, les associations diverses et les individus en matière de correction et d’enrichissement de la langue française parlée et écrite au Québec.
Article 115 – Le gouvernement peut, par règlement, prescrire les mesures que les ministères et les autres organismes de l’Administration doivent prendre pour apporter leur concours à l’Office.
Article 118 – Sur publication à la Gazette officielle du Québec des termes et expressions normalisés par l’Office, leur emploi devient obligatoire dans les textes et documents émanant de l’Administration, dans les contrats auxquels elle est partie, dans les ouvrages d’enseignement, de formation ou de recherche publiés en français au Québec et approuvés par le ministre de l’éducation ainsi que dans l’affichage public.
Le Conseil de la langue française : mandat et pouvoirs
Article 188 – Le Conseil doit :
- donner son avis au ministre sur les questions que celui-ci lui soumet touchant la situation de la langue française au Québec et l’interprétation ou l’application de la présente loi;
- surveiller l’évolution de la situation linguistique au Québec quant au statut de la langue française et à sa qualité et communiquer au ministre ses constatations et ses conclusions;
- saisir le ministre des questions relatives à la langue qui, à son avis, appellent l’attention ou l’action du gouvernement;
- donner son avis au ministre sur les règlements préparés par l’Office.
Article 189 – Le Conseil peut :
- recevoir et entendre les observations et suggestions des individus et des groupes sur les questions relatives au statut et à la qualité de la langue française;
- avec l’assentiment du ministre, entreprendre l’étude de questions se rattachant à la langue et effectuer ou faire effectuer les recherches appropriées;
- recevoir les observations des organismes de l’Administration et des entreprises sur les difficultés d’application de la présente loi et faire rapport au ministre;
- informer le public sur les questions concernant la langue française au Québec;
- adopter un règlement de régie interne soumis à l’approbation du gouvernement.
La Commission de surveillance : mandat et pouvoirs
Article 158 – Une Commission de surveillance est instituée pour traiter des questions se rapportant au défaut de respect de la présente loi.
Article 171 – Les commissaires-enquêteurs procèdent à des enquêtes chaque fois qu’ils ont des raisons de croire que la présente loi n’a pas été respectée.
Article 173 – Une personne ou un groupe de personnes peut demander une enquête.
Article 182 – Lorsque, à la suite d’une enquête, un commissaire-enquêteur a la conviction qu’il y a eu contravention à la présente loi ou aux règlements adoptés, il met en demeure le contrevenant de se conformer dans un délai donné.
Si le commissaire-enquêteur estime que la contravention subsiste passé ce délai, il transmet le dossier au procureur général pour que celui-ci en fasse l’étude et intente, s’il y a lieu, les poursuites pénales appropriées.
Infractions et peines
Article 205 – En cas de violation de l’un ou l’autre article de la loi :
- pour chaque infraction, amende de 25 à 500 $ (1977) pour une personne physique, de 50 à 1 000 $ pour une personne morale;
- pour toute récidive, amende de 50 à 1 000 $ pour une personne physique, de 500 à 5 000 $ pour une personne morale.
Article 206 – Les entreprises qui ne respectent pas les dispositions en matière de francisation des entreprises, amende de 100 à 2 000 $ (1977) pour chaque jour où elles poursuivent leurs activités sans certificat.
Suit en annexe la composition de l’Administration publique.
III. Comparaison entre la loi 22 et la loi 101 de 1977
Il peut être intéressant de connaître les différences les plus significatives entre la loi 22 et la loi 101. Car l’une et l’autre représentent deux visions du rapport du français et de l’anglais par deux partis politiques, inspirés l’un et l’autre par leurs électorats.
L’une et l’autre déclarent le français, seule langue officielle du Québec, en opposition au bilinguisme institutionnel prôné par la Loi sur les langues officielles du Canada.
Ce principe posé, la place accordée à l’anglais au Québec selon les différents articles est plus grande dans la loi 22 que dans la loi 101. La loi 22 s’accommode facilement d’un bilinguisme généralisé, tandis que la loi 101 entend faire du français la langue prédominante et la langue commune en lieu et place de la prédominance de la langue anglaise constatée par les deux commissions d’enquête précédentes.
Les différences entre les deux textes sont donc considérables.
La Charte de la langue française s’ouvre sur un préambule inspiré du livre blanc sur la politique linguistique et qui énonce les principes sociaux de la loi.
Préambule de la Charte de la langue françaiseLangue distinctive d’un peuple majoritairement francophone, la langue française permet au peuple québécois d’exprimer son identité.
L’Assemblée nationale reconnaît la volonté des Québécois d’assurer la qualité et le rayonnement de la langue française. Elle est donc résolue à faire du français la langue de l’État et de la Loi aussi bien que la langue normale et habituelle de travail, de l’enseignement, des communications, du commerce et des affaires.
L’Assemblée nationale entend poursuivre cet objectif dans un climat de justice et d’ouverture à l’égard des minorités ethniques, dont elle reconnaît l’apport précieux au développement du Québec.
L’Assemblée nationale reconnaît aux Amérindiens et aux Inuit du Québec, descendants des premiers habitants du pays, le droit qu’ils ont de maintenir et de développer leur langue et culture d’origine.
Ces principes s’inscrivent dans le mouvement universel de revalorisation des cultures nationales qui confère à chaque peuple l’obligation d’apporter une contribution particulière à la communauté internationale.
En 1983, le gouvernement du Parti québécois (Gérald Godin, ministre responsable de la Charte) modifiait le troisième alinéa pour y mentionner expressément la communauté anglophone. Le texte actuel est maintenant :
L’Assemblée nationale entend poursuivre cet objectif dans un climat de justice et d’ouverture, dans le respect des institutions de la communauté québécoise d’expression anglaise et celui des minorités ethniques, dont elle reconnaît l’apport précieux au développement du Québec.
Rien de tel dans la loi 22, qui commence par six entendus qui annoncent en quelques mots les grandes orientations de la loi, sauf peut-être le premier d’une portée plus générale qui se lisait comme suit :
Attendu que la langue française constitue un patrimoine national que l’état a le devoir de préserver, et qu’il incombe au gouvernement du Québec de tout mettre en œuvre pour en assurer la prééminence et pour en favoriser l’épanouissement et la qualité.
En article 1, la Charte de la langue française déclare le français langue officielle du Québec, exactement dans les mêmes termes que l’avait fait la loi 22. Ensuite, elle énonce solennellement les droits linguistiques fondamentaux analogues aux droits de la personne. La loi 22 n’en fait aucune mention.
Les droits linguistiques fondamentaux :
Article 2 – Toute personne a le droit que communiquent en français avec elle l’Administration, les services de santé et les services sociaux, les entreprises d’utilité publique, les ordres profes sionnels, les associations de salariés et les diverses entreprises exerçant au Québec.
Article 3 – En assemblée délibérante, toute personne a le droit de s’exprimer en français.
Article 4 – Les travailleurs ont le droit d’exercer leurs activités en français.
Article 5 – Les consommateurs de biens et de services ont le droit d’être informés et servis en français.
Article 6 – Toute personne admissible à l’enseignement au Québec a le droit de recevoir cet enseignement en français.
D’après l’interprétation des juristes, le préambule de la Charte et l’énoncé des droits linguistiques fondamentaux ont tous deux un caractère déclaratoire. L’un et l’autre définissent ce qu’il est convenu d’appeler l’esprit de la loi et ont pour fonction principale d’orienter l’interprétation de chacun des articles subséquents. Ils sont de portée trop générale pour qu’on puisse engager des poursuites en invoquant la violation d’un alinéa du préambule ou des droits linguistiques.
Un autre article de la Charte déclare l’unilinguisme français des lois et règlements :
Article 7 – Le français est la langue de la législation et de la justice au Québec.
Cet article allait ouvertement à l’encontre de l’article 133 de la Constitution de 1867 qui obligeait le Parlement du Canada et celui du Québec à adopter et à publier les lois et règlements en anglais et en français, de même qu’il autorisait l’emploi de l’un et de l’autre dans les débats parlementaires et dans les cours de justice.
Pour proposer et adopter l’article 7, le gouvernement se fondait sur les avis de la majorité des juristes qui, lors des consultations de la commission Gendron, avaient « exprimé l’opinion que l’article 133, dans son application au Québec, [faisait] partie de la constitution interne de la province et qu’il [pouvait] être modifié par l’Assemblée nationale », puisque l’article 92, alinéa 1, de la Constitution autorisait « les provinces à amender leur constitution interne à l’exception de la fonction de lieutenant-gouverneur[149] ». Les avis sur ce point étaient cependant très partagés au sein du Conseil des ministres.
La loi 22 respectait le statu quo : les textes des lois et règlements étaient bilingues français-anglais et présentés sur deux colonnes, le français à gauche.
Elle ne comportait qu’une seule restriction :
Article 2 – Le texte français des lois du Québec prévaut sur le texte anglais.
La disposition la plus radicale de la Charte est l’imposition de l’unilinguisme français dans l’affichage public.
Article 58 – Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou par les règlements de l’Office de la langue française, l’affichage public et la publicité commerciale se font uniquement dans la langue officielle, sauf :
- la publicité véhiculée par un média d’une autre langue que le français et les messages de type religieux, politique, idéologique ou humanitaire, sans but lucratif (art. 59);
- l’affichage dans les établissements d’au plus quatre personnes, y compris le patron, à condition que le français apparaisse d’une manière au moins aussi évidente que l’autre langue (art. 60);
- l’affichage public des activités culturelles d’un groupe ethnique particulier qui peut se faire à la fois en français et dans la langue de ce groupe (art. 61);
- l’affichage public dans les établissements spécialisés dans la vente de produits typiques d’une nation étrangère ou d’un groupe ethnique particulier qui peut se faire à la fois en français et dans la langue de ce groupe (art. 62).
Article 59 – L’article 58 ne s’applique pas à la publicité véhiculée par des organes d’information diffusant dans une autre langue que le français ni aux messages de type religieux, politique idéologique ou humanitaire, pourvu qu’ils ne soient pas à but lucratif.
La loi 22 permettait l’affichage en français ou à la fois en français et dans une autre langue sans autre précision :
Article 35 – L’affichage public doit se faire en français, ou à la fois en français et dans une autre langue, ainsi que les panneaux-réclames et les enseignes lumineuses. Cette disposition ne s’applique pas aux annonces publicitaires paraissant dans un journal ou un périodique publiés dans une autre langue (art. 36).
La Charte précise le statut du français comme langue des relations de travail :
Article 43 – Les conventions collectives et leurs annexes doivent être rédigées en français. Voir également les articles 44 à 49 pour les prolongements de cette règle.
Loi 22 : une seule mention, le français est la langue des relations de travail dans la mesure et suivant les modalités du Code du travail, sans plus de précision.
La Charte étoffe le dispositif d’application de la loi en instituant quatre organismes : un Office de la langue française, un Conseil de la langue française, une Commission de surveillance et des enquêtes, une Commission de toponymie.
La loi 22 n’en charge qu’un seul organisme, la Régie de la langue française, qui cumule les fonctions, notamment la surveillance et les enquêtes.
La langue d’enseignement :
La loi 22 ne prenait pas vraiment parti en faveur du français comme langue d’enseignement, notamment en ce qui concerne les enfants immigrants dont il n’est même pas question dans la loi.
Article 40 – Règle générale 1 : l’enseignement se donne en langue française.
Il se donne également en langue anglaise.
Il peut se donner dans la langue des Indiens et des Inuits du Nouveau-Québec.
Article 41 – Règle générale 2 : les élèves doivent connaître suffisamment la langue d’enseignement pour recevoir l’enseignement dans cette langue.
Ceux qui ne connaissent suffisamment aucune des langues d’enseignement reçoivent l’enseignement en langue française.
Article 43 – Recours à des tests pour s’assurer que les élèves ont une connais sance suffisante de la langue d’enseignement pour recevoir l’enseignement dans cette langue.
Article 44 – Enseignement obligatoire du français, parlé et écrit, dans les écoles de langue anglaise.
Enseignement obligatoire de l’anglais, langue seconde, dans les écoles de langue française.
Les dispositions de la loi 101 sont beaucoup plus précises et réservent la fréquentation des écoles anglaises aux seuls enfants de langue anglaise, toute la question étant de savoir comment les identifier au moment de l’inscription à l’école. Le dispositif est le suivant :
Article 72 – L’enseignement se donne en français dans les classes maternelles, dans les écoles primaires et secondaires, aussi bien dans le réseau public que dans les établissements privés subventionnés.
Article 73 – Par dérogation à l’article 72, peuvent recevoir l’enseignement en anglais, à la demande de leur père et de leur mère.
- les enfants dont le père ou la mère a reçu au Québec l’enseignement primaire en anglais;
- les enfants dont le père ou la mère est, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, domicilié au Québec et a reçu, hors du Québec, l’enseignement primaire en anglais;
- les enfants qui, lors de leur dernière année de scolarité au Québec avant l’entrée en vigueur de la présente loi, recevaient légalement l’enseignement en anglais dans une classe maternelle publique ou à l’école primaire ou secondaire;
- les frères et sœurs cadets des enfants visés au paragraphe c.
Article 86 – Le gouvernement peut, par règlement, étendre l’application de l’article 73 aux parents d’une autre province du Canada si une entente de réciprocité est conclue entre le gouvernement du Québec et celui de cette province.
Article 87 – Rien dans la présente loi n’empêche l’usage d’une langue amérindienne dans l’enseignement dispensé aux Amérindiens et aux Inuits.
En ce qui concerne l’emploi du français par l’Administration publique, la Charte établit comme règle générale l’unilinguisme français des textes et documents publiés par l’Administration, sauf s’ils sont destinés à des correspondants à l’extérieur du Québec ou à des citoyens individuels québécois de langue anglaise qui en font la demande.
La loi 22 établit comme règles générales le bilinguisme français-anglais des textes et documents, le français étant obligatoire, l’anglais possible; le bilinguisme des communications avec les personnes physiques et le bilinguisme des contrats conclus au Québec par l’Administration publique.
La francisation des entreprises :
Pour les entreprises de 50 employés et plus (article 136), la Charte exige de détenir un certificat de francisation ou, le cas échéant, une attestation qu’elle applique un programme de francisation.
Pour les entreprises de 100 employés et plus (art. 146), la Charte exige de constituer un comité de francisation d’au moins six personnes dont au moins le tiers est nommé […] pour représenter les travailleurs de l’entreprise pour veiller à l’application de ce programme et maintenir le français comme langue de travail.
À défaut de se conformer à cette obligation, le dossier est transmis au procureur général qui intente les poursuites pénales appropriées, s’il y a lieu. Pénalité prévue par la loi : 100 $ à 2 000 $ (de 1977) pour chaque jour où l’entreprise poursuit ses activités sans certificat ou sans attestation.
La loi 22 ne rend obligatoire de détenir un certificat de francisation que si l’entreprise veut faire affaire avec le Gouvernement ou obtenir de lui des permis, des subventions, des contrats, etc. (article 28).
Dans l’une et l’autre loi, les éléments du programme de francisation sont sensiblement les mêmes et s’inspirent de la définition du français langue de travail à laquelle était arrivé l’Office de la langue française.
Les dispositions de la loi 22 étaient les suivantes :
Article 29 – Éléments du programme de francisation :
- connaissance du français par les dirigeants et le personnel;
- présence de francophones dans l’administration;
- l’emploi du français dans les manuels, les catalogues, les instructions écrites et dans tout autre document distribué au personnel;
- droit du personnel de communiquer en français entre eux et avec leurs supérieurs;
- la terminologie française employée dans l’entreprise.
Article 39 – Ce programme doit porter en outre sur :
- la raison sociale de l’entreprise;
- la langue de communication avec les clients et les personnes; la langue des avis, communications, certificats et formulaires destinés au public ou aux actionnaires et membres de l’engtreprise du Québec.
La loi 101 ne s’éloignait pas des mêmes dispositions :
Article 141 – Les programmes de francisation ont pour but la généralisation de l’utilisation du français à tous les niveaux de l’entreprise. Ce qui comporte :
- la connaissance de la langue officielle chez les dirigeants, les membres des ordres professionnels et les autres membres du personnel;
- l’augmentation à tous les niveaux de l’entreprise, y compris au sein du conseil d’administration, du nombre de personnes ayant une bonne connaissance de la langue française de manière à en assurer l’utilisation généralisée;
- l’utilisation du français comme langue de travail et des communications internes;
- l’utilisation du français dans les documents de travail de l’entreprise, notamment les manuels et les catalogues;
- l’utilisation du français dans les communications avec la clientèle, les fournisseurs et le public;
- l’utilisation d’une terminologie française;
- l’utilisation du français dans la publicité;
- une politique d’embauche, de promotion et de mutation appropriée.
Enfin, la Charte prévoit des amendes en cas de violation de l’un des articles de la loi, constatée et confirmée par une enquête de la Commission de surveillance.
L’amende prévue était, en dollars de l’époque, de 25 $ à 500 $ (1977) pour une personne physique, 50 $ à 1 000 $ pour une personne morale. En cas de récidive, 50 $ à 1 000 $ pour une personne physique, 500 $ à 5 000 $ pour une personne morale.
La loi 22 ne prévoyait aucune pénalité, sauf la sanction morale d’être cité dans le rapport annuel de la Régie si elle constatait une violation de l’un ou de l’autre article de la loi.
IV. Statistiques de l’immigration de 1996-1997 à 2005-2006
| Année budgétaire | Immigrants | Francisation | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif total | Francophones | Effectif total | Temps plein | Temps partiel | |||
| Effectif | % | Autres effectifs | |||||
| 2005-2006 | 43 373 | 24 848 | 57,3 | 18 525 | 19 862 | 9 714 | 10 148 |
| 2004-2005 | 44 246 | 24 476 | 55,3 | 19 770 | 19 401 | 9 873 | 9 528 |
| 2003-2004 | 39 583 | 20 116 | 50,8 | 19 467 | 20 026 | 10 334 | 9 697 |
| 2002-2003 | 37 629 | 18 477 | 49,1 | 19 152 | 19 204 | 9 218 | 9 986 |
| 2001-2002 | 37 538 | 17 636 | 47 | 19 902 | 15 586 | 8 389 | 7 197 |
| 2000-2001 | 32 502 | 14 700 | 45,2 | 17 802 | 14 135 | 6 847 | 7 288 |
| 1999-2000 | 29 214 | 12 514 | 42,8 | 16 700 | 15 226 | 7 053 | 8 173 |
| 1998-1999 | 26 509 | 10 678 | 40,3 | 15 831 | 14 184 | 7 167 | 7 017 |
| 1997-1998 | 27 684 | 9 883 | 35,7 | 17 801 | 15 120 | 7 365 | 7 755 |
| 1996-1997 | 29 772 | 11 583 | 39 | 18 189 | – | 8 134 | – |
| 348 050 | 164 911 | 183 134 | 75 960 | 116 148 | |||
| 8 440 | 12 905 | ||||||
D’après les données disponibles au ministère de l’immigration et des Communautés culturelles.
Repères chronologiques
1950-1960
Un courant de pensée en faveur de la langue française s’amorce. Les intellectuels dénoncent la situation de la langue française face à la langue anglaise et discutent des moyens de modifier la situation, entre l’unilinguisme français et le bilinguisme généralisé. Ce courant prend rapidement de l’ampleur et crée une opinion publique de plus en plus alertée et interventionniste. Le dossier de la langue devient politique.
Avril 1957
Albert Memmi publie les premiers extraits du Portrait du colonisé, dans la revue Les temps modernes et dans la revue Esprit. Le livre paraît la même année. Il aura une grande répercussion au Québec.
Juin 1957
Numéro spécial du journal Le Devoir intitulé « Alerte à la langue française ».
7 septembre 1959
Mort de Maurice Duplessis d’une hémorragie cérébrale, à Shefferville, lors de l’inauguration d’un barrage hydroélectrique.
21 octobre 1959
André Laurendeau publie dans Le Devoir, sous le pseudonyme de Candide, un billet intitulé « La langue que nous parlons », qui lance l’étiquette « joual ».
3 novembre 1959
Publication par Le Devoir de la première lettre du Frère Untel en réponse au billet d’André Laurendeau. Elle crée un grand remous chez les Québécois à propos de la qualité de leur langue.
1960
Publication des Insolences du Frère Untel.
Mars 1961
Création de l’Office de la langue française par la loi instituant un ministère des Affaires culturelles (9-10 Éliz. II, c. 23).
Avril 1961
Création par le gouvernement libéral de Jean Lesage de la Commission royale d’enquête sur l’enseignement, dite commission Parent.
Octobre 1961
Ouverture de la Maison du Québec à Paris par le gouvernement Lesage.
8 mai 1963
Institution par la commission scolaire de Saint-Léonard de classes dites « bilingues » à la demande des parents italophones.
19 juillet 1963
Création par le gouvernement du Canada dirigé par le premier ministre Pearson de la Commission royale d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme, dite commission Laurendeau-Dunton.
1963
Construction, en français, du complexe hydroélectrique de la Manicouagan par Hydro-Québec. Démonstration symbolique de la possibilité de travailler en français, de la capacité de la langue française d’exprimer la technique, même de pointe.
Octobre 1963
Début de la publication de la revue Parti pris.
1964
Création du ministère de l’Éducation par le gouvernement libéral de Jean Lesage. Paul Gérin-Lajoie fut le premier à diriger le nouveau ministère.
Novembre 1964
Publication du Cassé de Jacques Renaud, début de la littérature dite « joualisante », expression des conséquences sur la langue française du Québec de son statut de langue dominée par la langue anglaise.
1er février 1965
Rapport préliminaire de la Commission royale d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme. Diagnostic très sombre de l’état des relations entre francophones et anglophones au Canada.
Février 1965
Signature, à Paris, de la première entente de coopération entre la France et le Québec, qui ne fera que s’intensifier et se diversifier par la suite. Le Québec contrebalance ainsi l’influence de l’Amérique anglophone.
1965
Pierre Laporte, en qualité de ministre des Affaires culturelles, prépare un livre blanc sur la politique culturelle, où il est question de la langue (devoir de l’État, statut de langue prioritaire du français). Jean Lesage en interdit la publication et même la discussion en conseil des ministres.
Juillet 1967
Visite du général de Gaulle au Québec.
Septembre 1967
Création des collèges d’enseignement général et professionnel, les cégeps.
4 octobre 1967
René Lévesque propose au congrès du Parti libéral de reconnaître le principe d’un Québec souverain. Sa proposition est rejetée. Il quitte le congrès et le parti, mais demeure député indépendant.
8 octobre 1967
Publication de la première tranche du rapport de la Commission royale d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme sous le titre Les langues officielles.
Novembre 1967
Première réunion des États généraux du Canada français. Affirmation solennelle du fait que « le Québec constitue le territoire national et le milieu fondamental de la nation » et qu’il dispose du droit à l’autodétermination.
19 novembre 1967
René Lévesque lance le Mouvement souveraineté-association, qui se transforme en Parti québécois en 1968.
20 novembre 1967
Affaire de Saint-Léonard. Réorganisation du régime scolaire : abandon des classes « bilingues », enseignement en français seulement et enseignement de l’anglais comme langue seconde à tous les élèves dès la première année du primaire. Modifications qui entreront en vigueur à la rentrée de septembre 1968.
8 mai 1968
La commission scolaire de Saint-Léonard prend l’initiative d’organiser, à titre expérimental, des classes d’accueil à l’intention des enfants italophones qui ne connaissent pas le français, langue de l’école.
23 mai 1968
Publication de la deuxième tranche du rapport de la Commission royale d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme. Thème : l’éducation.
1968
Création de l’Université du Québec et de son réseau de constituantes.
1er juin 1968
Mort d’André Laurendeau.
27 juin 1968
Affaire de Saint-Léonard. Les commissaires scolaires adoptent une résolution qui fait du français la seule langue d’enseignement dans les écoles primaires sous sa juridiction.
Août 1968
Création de la pièce de Michel Tremblay, Les Belles-Sœurs, par le Théâtre du Rideau-Vert, à Montréal.
5 novembre 1968
Création du ministère de l’Immigration par le gouvernement de l’Union nationale dirigé par Daniel Johnson. C’est le début d’une longue négociation entre le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral sur le rôle du Québec en matière d’immigration.
9 décembre 1968
Création de la Commission sur la situation de la langue française et sur les droits linguistiques au Québec, dite commission Gendron.
Le même jour, dépôt devant l’Assemblée nationale du projet de loi 85 qui donnait à tous les parents du Québec le libre choix de la langue d’enseignement. Projet rapidement abandonné, mais qui reviendra plus tard sous la forme du bill 63.
Janvier 1969
Création des Centres d’orientation et de formation des immigrants, les COFIS.
Avril 1969
Généralisation des classes d’accueil dans l’ensemble du système scolaire québécois à l’intention des enfants immigrants qui ne connaissent pas le français, étape de transition vers les classes régulières.
1969
Adoption par les Communes de la Loi sur les langues officielles du Canada (S.R.C., 1968-1969, c. 54).
Septembre 1969
Début des audiences publiques de la commission Gendron, qui se poursuivront jusqu’en 1970. Environ 210 mémoires y sont présentés.
Septembre 1969
Publication de la troisième tranche du rapport de la Commission royale d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme. Thème : le monde du travail.
Octobre 1969
Publication de la quatrième tranche du rapport de la Commission royale d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme. Thème : l’apport culturel des autres groupes ethniques.
23 octobre 1969
Jean-Jacques Bertrand, premier ministre et chef de l’Union nationale, dépose devant l’Assemblée nationale le bill 63. C’est le début d’un débat houleux en chambre sur fond de contestation populaire de ce projet de loi.
20 novembre 1969
Le bill 63 est adopté sous le titre Loi pour promouvoir la langue française au Québec (S.Q. 1969. c.9). Elle donne aux parents la liberté de choix de la langue d’enseignement, quelle que soit leur origine ethnique ou linguistique. Elle marque pour la première fois l’intention du législateur d’intervenir en faveur de l’usage du français comme langue du travail et de l’affichage public, par voie d’incitation et de conseil. Elle modifie le mandat de l’Office de la langue française et lui donne les pouvoirs d’un commissaire enquêteur.
12 mai 1970
Le Parti libéral dirigé par Robert Bourassa prend le pouvoir avec une majorité de 72 députés. Le Dr François Cloutier devient responsable du dossier linguistique et de l’Office de la langue française. Il réoriente l’action de cet organisme vers la langue de travail, selon les dispositions du bill 63.
Le Parti québécois ne fait élire que sept députés, dont le Dr Camille Laurin et Claude Charron.
Octobre 1970
Crise dite d’Octobre : – enlèvement de James Cross (5 octobre); – enlèvement de Pierre Laporte (10 octobre); – imposition de la Loi sur les mesures de guerre (16 octobre); – mort de Pierre Laporte (17 octobre); – libération de James Cross (3 décembre); – retrait de l’armée des rues de Montréal (4 janvier).
20 novembre 1970
Directive administrative du gouvernement du Québec concernant la langue des communications en vue « d’uniformiser l’usage des deux langues officielles par les ministères et organismes du gouvernement dans leurs relations avec l’extérieur ». Reproduite en annexe B du tome 2 Les droits linguistiques du rapport Gendron.
Automne 1972
Diffusion d’une édition québécoise du Portrait du colonisé de Memmi, suivi de Les Canadiens français sont-ils des colonisés?
31 décembre 1972
Remise du rapport Gendron au gouvernement.
31 juillet 1974
Adoption de la Loi sur la langue officielle (dite loi 22), L.Q. 1974. c. 6.
17 octobre 1975
Signature de l’entente Canada-Québec, dite Andras-Bienvenue, « portant sur l’échange de renseignements, le recrutement et la sélection des ressortissants étrangers qui demeurent à l’extérieur du Canada et qui désirent résider de façon permanente dans la Province de Québec ou être admis à titre temporaire pour y exercer un emploi ».
1976
Début de la bataille judiciaire des « gens de l’air » pour l’usage du français dans les communications aériennes, en vertu de l’article 2 de la Loi sur les langues officielles du Canada.
15 novembre 1976
Le Parti québécois de René Lévesque prend le pouvoir avec une majorité de 71 sièges. Le Dr Camille Laurin devient titulaire du dossier linguistique.
Mars 1977
Publication d’un livre blanc sur La politique québécoise de la langue française par le Dr Camille Laurin, ministre d’État au Développement culturel.
26 août 1977
Adoption de la Charte de la langue française (dite loi 101), L.Q. 1977, c. 5.
En plus de l’Office de la langue française (deuxième version), la Charte de la langue française institue trois autres organismes : la Commission de surveillance de l’application de la Charte, le Conseil de la langue française et la Commission de toponymie.
1978
Début de la contestation juridique de certaines dispositions de la Charte de la langue française devant les tribunaux. Toutes les causes se termineront devant la Cour suprême du Canada. Les principaux arrêts de cette Cour sont :
- 1981 – Arrêt relatif à la langue de la législation et de la justice. Les textes de lois et des règlements doivent être adoptés et disponibles dans les deux langues.
- 1984 – Arrêt relatif à l’accès à l’école de langue anglaise. La clause Québec est jugée inconstitutionnelle et doit être remplacée par la clause Canada.
- 1988 – Arrêt relatif à l’affichage public. Interdire l’emploi de la langue anglaise dans l’affichage public et la publicité commerciale viole la liberté d’expression garantie par les Chartes des droits de la personne. La Cour suprême propose cependant le principe de la nette prédominance du texte en langue française.
Chacun de ces arrêts est exécutoire dès son adoption et confirmé ensuite par les modifications conséquentes du texte de la Charte de la langue française.
20 avril 1978
Signature d’une deuxième entente Canada-Québec, dite Cullen-Couture, portant sur la collaboration en matière d’immigration et de sélection des ressortissants étrangers qui souhaitent s’établir au Québec à titre permanent ou temporaire.
Janvier 1979
Publication de la première tranche du rapport de la Commission de l’unité canadienne, dite commission Pépin-Robarts. La deuxième tranche paraît en février, la troisième et dernière en mars. Début de la politique et de la propagande fédérales en faveur de l’unité du Canada, en réaction à la politique d’indépendance prônée par le Parti québécois, les « séparatiss » de Jean Chrétien.
Août 1979
Rapport de la Commission d’enquête sur les communications aériennes : l’usage du français est déclaré sécuritaire.
18 février 1980
Pierre Elliott Trudeau devient premier ministre du Canada à trois mois du référendum au Québec.
14 mai 1980
Le premier ministre Trudeau s’engage à renouveler le fédéralisme canadien si le NON l’emporte lors du référendum, sans plus préciser cet engagement qui se soldera par le rapatriement de la Constitution du Canada sans le consentement du Québec.
20 mai 1980
Le Parti québécois tient le premier référendum, la question étant : Donnez-vous au gouvernement le mandat de négocier avec le gouvernement fédéral la souveraineté du Québec et son association avec le Canada. 59,56 % des Québécois votent NON. Le taux de participation est de 86 %.
13 avril 1981
Réélection du Parti québécois avec une majorité de 80 sièges.
5 novembre 1981
Rapatriement de la Constitution du Canada.
Durant la nuit, à l’instigation de Jean Chrétien, alors ministre de la Justice du gouvernement Trudeau, le gouvernement fédéral s’entend avec les neuf provinces anglophones pour entériner le texte de la nouvelle Constitution du Canada même si le Québec le refuse. À la reprise des travaux, René Lévesque apprend la machination et quitte l’assemblée sans signer le texte, que le Québec n’a toujours pas signé.
17 avril 1982
Sans le consentement du Québec, Pierre Elliott Trudeau, au nom du gouvernement du Canada, et la reine Élisabeth II signent et promulguent officiellement la nouvelle Constitution du Canada, dont seul le texte en langue anglaise a cours légal.
20 juin 1985
René Lévesque quitte la présidence du Parti québécois. Il publie ses souvenirs l’année suivante sous le titre Attendez que je me rappelle.
2 décembre 1985
Élection du Parti libéral, de nouveau dirigé par Robert Bourassa, avec une majorité de 99 sièges.
1er novembre 1987
Décès de René Lévesque.
1987
Rejet de l’accord du Lac Meech.
Le gouvernement Mulroney proposait un nouveau texte constitutionnel qui permettrait au Québec de le ratifier et d’ainsi réintégrer, « dans l’honneur », le Canada. Pour devenir valide, il fallait que ce texte soit entériné par tous les Parlements provinciaux. Deux provinces refusèrent, le Manitoba et Terre-Neuve.
28 septembre 1989
Réélection du Parti libéral de Robert Bourassa, avec une majorité de 92 sièges.
5 février 1991
Signature d’une autre entente Canada-Québec, dite McDougall/ Gagnon-Tremblay, relative « à l’immigration et à l’admission temporaires des aubains » (des étrangers non naturalisés canadiens).
Août 1992
Rejet de l’accord de Charlottetown.
Un nouveau projet d’accord constitutionnel est proposé par le même gouvernement Mulroney, qui doit être soumis à un référendum national, à double majorité, majorité des citoyens canadiens et majorité des citoyens de chaque province. Cette condition n’ayant pas été respectée, l’accord fut rejeté.
12 septembre 1994
Le Parti québécois dirigé par Jacques Parizeau reprend le pouvoir avec une majorité de 77 sièges.
30 octobre 1995
Deuxième référendum au Québec portant sur l’accession du Québec à la souveraineté, assortie d’une offre au reste du Canada d’un partenariat économique et politique. Résultat : 50,4 % pour le NON et 49,6 % pour le OUI. Taux de participation : 96 %.
22 mars 1996
Publication du rapport du Comité interministériel sur la situation de la langue française au Québec, sous le titre Le français, langue commune, Enjeu de la société québécoise.
Juin 1996
À la suite de ce rapport, Louise Beaudoin, alors ministre responsable de la Charte de la langue française, réactualise les orientations de la politique linguistique québécoise dans un texte intitulé Le français, langue commune, Promouvoir l’usage et la qualité du français, langue officielle et langue commune du Québec.
2 octobre 1996
Décès de Robert Bourassa.
30 novembre 1998
Réélection du Parti québécois, cette fois dirigé par Lucien Bouchard, avec une majorité de 76 députés.
29 juin 2000
Création de la Commission des États généraux sur la situation et l’avenir de la langue française au Québec par Louise Beaudoin, ministre responsable de la Charte de la langue française. La Commission dépose son rapport le 17 août 2001.
14 avril 2003
Élection du Parti libéral sous la direction de Jean Charest, avec une majorité de 76 députés.
26 août 2007
30e anniversaire de la Charte de la langue française.
Bibliographie
Textes de lois
| Année | Loi | Gouvernement | Premier ministre | Ministre responsable |
|---|---|---|---|---|
| 1961 | Loi du ministère des Affaires culturelles créant l’Office de la langue française (L.Q. 1961, c. 57) | Parti libéral | Jean Lesage | |
| 1967 | Loi du ministère des affaires intergouvernementales | Union nationale | Daniel Johnson | |
| 1969 | (Projet de) Loi 63, Loi pour promouvoir la langue française au Québec | Jean-Jacques Bertrand | ||
| 1974 | (Projet de) Loi 22, Loi sur la langue officielle (L.Q. 1974, c. 6) | Parti libéral | Robert Bourassa | François Cloutier, ministre responsable du dossier. |
| 1977 | (Projet de) Loi 101, Charte de la langue française (L.Q. 1977, c. 5) | Parti québécois | René Lévesque | Camille Laurin, ministre responsable du dossier. |
| 1983 | (Projet de) Loi 57, Loi modifiant la Charte de la langue française (L.Q. 1983, c. 56) | Gérald Godin, ministre des Communautés culturelles et de l’Immigration. | ||
| 1988 | (Projet de) Loi 178, Loi modifiant la Charte de la langue française (L.Q., 1988, c. 54) | Parti libéral | Robert Bourassa | Guy Rivard, Ministre délégué aux affaires culturelles. |
| 1993 | (Projet de) Loi 86, Loi modifiant la Charte de la langue française (L.Q., 1993, c. 40) | Claude Ryan, ministre responsable de la Charte de la langue française. | ||
| 1997 | (Projet de) Loi 40, Loi modifiant la Charte de la langue française (L.Q. 1997, c. 24) | Parti québécois | Lucien Bouchard | Louise Beaudoin, ministre responsable de la Charte de la langue française. |
| 2000 | (Projet de) Loi 171, Loi modifiant la Charte de la langue française (L.Q. 2000, c. 57) | Bernard Landry | ||
| 2002 | (Projet de) Loi 104, Loi modifiant la Charte de la langue française (L.Q. 2002, c. 28) | Diane Lemieux, ministre responsable de la Charte de la langue française. |
Principales références
- ARCHAMBAULT, Ariane et Jean-Claude CORBEIL (1982). L’enseignement du français, langue seconde, aux adultes, Description de l’organisation administrative et pédagogique, Réflexion sur certains problèmes linguistiques et culturels sous-jacents, Conseil de la langue française, 141 p.
- AUDET, Philippe (1971). Histoire de l’enseignement au Québec, Montréal, Holt, Rinehart et Winston, tome 1, 432 p. et tome II, 496 p.
- BAILEY, Charles-James (1973). Variation and Linguistic Theory, Arlington, Center for Applied Linguistics, 162 p.
- BARBAUD, Philippe (1984). Le choc des patois en Nouvelle-France, Essai sur l’histoire de la francisation du Canada, Québec, Presses de l’Université du Québec, 204 p.
- BÉLANGER, Henri (1972). Place à l’homme, Éloge du français québécois, Montréal, HMH, 254 p.
- BOISVERT, Lionel, Claude POIRIER et Claude VERREAULT (1986). La lexicographie québécoise, Bilan et perspectives, Québec, Presses de l’Université Laval, 308 p.
- BOUCHARD, Chantal (1998). La langue et le nombril, Histoire d’une obsession québécoise, Montréal, Fides, 305 p.
- — (2005). La question de la qualité de la langue aujourd’hui, dans Le français au Québec, Les nouveaux défis, Conseil supérieur de la langue française, p. 387-397.
- BOUDREAULT, Marcel (1973). Les modèles linguistiques, dans La qualité de la langue, Commission d’enquête sur la situation de la langue française et sur les droits linguistiques au Québec, Québec, Éditeur officiel, 565 p.
- BOULANGER, Jean-Claude (1980). Les français régionaux : observations sur les recherches actuelles, Gouvernement du Québec, Office de la langue française, Études, recherches et documentation, 65 p.
- BOURDIEU, Pierre et Jean-Claude PASSERON (1964). Les héritiers, Paris, éd. de Minuit, 183 p.
- — (1970). La reproduction, éléments pour une théorie du système d’enseignement, Paris, éd. de Minuit, 280 p.
- BOURDIEU, Pierre (1982). Ce que parler veut dire, L’économie des échanges linguistiques, Paris, Fayard, 244 p.
- BOUTHILLIER, Guy et Jean MEYNAUD (1972). Le Choc des langues au Québec, 1760-1970, Presses de l’Université du Québec, 768 p.
- BROCHU, André (2000). L’éveil de la parole, dans Le français au Québec, 400 ans d’histoire et de vie, Conseil de la langue française, p. 260-271.
- BRUNET, Michel (1969). Les Canadiens après la conquête (1759-1775), Montréal, Fides, 313 p.
- CAJOLET-LAGANIÈRE, Hélène et Pierre MARTEL (1995). La qualité de la langue au Québec, Québec, Institut québécois de recherche sur la culture, 167 p.
- CANADA-QUÉBEC (1971). Entente sur la présence d’agents d’orientation du ministère de l’Immigration du Québec dans les bureaux fédéraux d’immigration à l’étranger, dite entente Lang-Cloutier.
- — (1975). Entente portant sur l’échange de renseignements, le recrutement et la sélection des ressortissants qui demeurent à l’extérieur du Canada et qui désirent résider de façon permanente dans la Province de Québec ou être admis à titre temporaire pour y exercer un emploi, dite entente Bienvenue-Andras.
- — (1978). Entente entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement du Québec portant sur la collaboration en matière d’immigration et sur la sélection des ressortissants étrangers qui souhaitent s’établir au Québec à titre permanent ou temporaire , dite entente Couture-Cullen.
- — (1990). Entente Canada-Québec concernant les immigrants investisseurs, dite entente McDougall-Rémillard.
- — (1991). Accord Canada-Québec relatif à l’immigration et à l’admission des aubains, dit accord McDougall/Gagnon-Tremblay.
- CASTONGUAY, Charles (1994). Le français, langue d’assimilation, langue d’intégration, dans Les actes du colloque sur la problématique de l’aménagement linguistique, Office de la langue française, Université du Québec à Chicoutimi, p. 541-567.
- CHARLAND, Jean-Pierre (2000). L’instruction chez les Canadiens français, dans Le français au Québec, 400 ans d’histoire et de vie, Conseil de la langue française, p. 177-183.
- CHÉNARD, Claire et Nicolas van SCHENDEL (2002). Travailler en français au Québec : les perceptions de travailleurs et de gestionnaires, Office de la langue française, Direction de la recherche, 117 p.
- CHOLETTE, Gaston (1993). L’Office de la langue française de 1961 à 1974, Institut québécois de recherche sur la culture, Office de la langue française, 467 p.
- CONSEIL DE LA LANGUE FRANÇAISE (1983). La norme linguistique, sous la direction d’Édith Bédard et de Jacques Maurais, Québec, Gouvernement du Québec, Paris, Le Robert, 850 p.
- — (1987). Politique et aménagement linguistique, sous la direction de Jacques Maurais, Québec, Gouvernement du Québec, Paris, Le Robert, 571 p.
- — (1992). Les langues autochtones du Québec, sous la direction de Jacques Maurais, Québec, Gouvernement du Québec, 455 p.
- — (2000). Le français au Québec, 400 ans d’histoire et de vie, sous le direction de Michel Plourde, Québec, Conseil de la langue française, Montréal, Fides, 516 p.
- CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA LANGUE FRANÇAISE (2005). Le français, langue normale et habituelle du travail, Avis à la ministre responsable de l’application de la Charte de la langue française, Québec, 55 p.
- — (2005). Le français au Québec, Les nouveaux défis, sous la direction d’Alexandre Stéfanescu et de Pierre Georgeault, Montréal, Fides, 622 p.
- CORBEIL, Jean-Claude (1965). L’Office de la langue française du Québec, Paris, Larousse, revue Vie et Langage, n° 164, p. 633-635.
- — (1979). Principes sociolinguistiques et linguistiques de la Charte de la langue française, dans Langue française et Identité culturelle, actes de la septième Biennale de la langue française à Moncton (1977), Dakar, Les Nouvelles éditions africaines, p. 255-262.
- — (1980a). Les choix linguistiques, dans Actes du colloque La qualité de la langue… après la loi 101, Québec, Conseil de la langue française, p. 46 à 52.
- — (1980b). L’aménagement linguistique du Québec, Montréal, Guérin, 154 p.
- — (1983). Éléments d’une théorie de la régulation linguistique, dans La norme linguistique, sous la direction d’Édith Bédard et de Jacques Maurais, Québec, Gouvernement du Québec, Paris, Le Robert, p. 553-566.
- — (1987). Vers un aménagement linguistique comparé, dans Politique et aménagement linguistique, sous la direction de Jacques Maurais, Québec, Gouvernement du Québec, Paris, Le Robert. p. 553-566.
- — (1992). En collaboration avec Lynn DRAPEAU, Les langues autochtones dans la perspective de l’aménagement linguistique, dans Les langues autochtones du Québec, sous la direction de Jacques Maurais, Québec, Gouvernement du Québec, p. 387-409.
- — (1994). Dynamique de l’aménagement linguistique au Québec, dans Les actes du colloque sur la problématique linguistique (enjeux théoriques et pratiques), tome 1, p. 17-33, Québec, Office de la langue française, Université du Québec à Chicoutimi.
- — (2000). Une langue qui se planifie, article accompagné d’un encadré intitulé Les six principes fondamentaux de l’aménagement linguistique au Québec, dans Le français au Québec, 400 ans d’histoire et de vie, p. 306-313.
- CORBEIL, Jean-Claude et Louis GUILBERT (1976). Le français au Québec, Paris, Larousse, Langue française, n° 31, 125 p.
- CÔTÉ, Louise, Louis TARDIVEL et Denis VAUGEOIS (1992). L’Indien généreux, Ce que le monde doit aux Amériques, Montréal, Boréal, 287 p.
- DESBIENS, Jean-Paul (1960). Les Insolences du Frère Untel, Montréal, Les Éditions de L’Homme, 158 p., réédité chez le même éditeur en 1988, avec une préface de Jacques Hébert, texte annoté par l’auteur et avec annexes historiques, 256 p.
- FISHMAN, Joshua A. (1971). Sociolinguistics : A Brief Introduction, Rowley, (Mass.), Newburry House.
- GAGNÉ, Aimé (1998). Le français au-delà des mots, Un cheminement linguistique, Montréal, Les Éditions Varia, 342 p.
- GAGNÉ, Gilles (1980). Pédagogie de la langue ou pédagogie de la parole, dans Actes du colloque La qualité de la langue… après la loi 101, Québec, Conseil de la langue française, p. 79 à 93.
- GAUTHIER, François, Jacques LECLERC et Jacques MAURAIS (1993). Langues et Constitutions, Recueil des clauses linguistiques des constitutions du monde, Québec, Office de la langue française, Paris, Conseil international de la langue française, 131 p.
- GERMAIN, Luc, Luc PAPINEAU et Benoît SÉGUIN (2006). Le grand mensonge de l’éducation, Montréal, Lanctôt Éditeur, 212 p.
- GODIN, Pierre (1990). La poudrière linguistique, Montréal, Boréal, 373 p.
- — (2001). René Lévesque, L’espoir et le chagrin, tome 3 de la biographie, Montréal, Boréal, 631 p.
- GOSSELIN, Jacques (2003). L’évolution de la législation linguistique au Québec, dans Politiques et législations linguistiques comparées, Actes du colloque international tenu à Barcelone les 4, 5 et 6 octobre 1999, Revue d’Aménagement linguistique, autrefois Terminogramme, n° 105, Québec, Les Publications du Québec, p. 9-51.
- GOUVERNEMENT DU QUÉBEC (1977). La politique québécoise de la langue française, présentée à l’Assemblée nationale et au peuple du Québec par Camille Laurin, Québec, Gouvernement du Québec, mars 1977, 67 p. (Livre blanc annonçant l’orientation de la future Charte de la langue française.)
- — (1990). Au Québec pour bâtir ensemble, Énoncé de politique en matière d’immigration et d’intégration. 104 p.
- — (1996). Le français, langue commune, Enjeu de la société québécoise, Rapport du comité interministériel sur la situation de la langue française, Québec, ministère de la Culture et des Communications, 319 p.
- — (1996). Le français, langue commune, Promouvoir l’usage et la qualité du français, langue officielle et langue commune du Québec, Proposition de politique linguistique présentée par Louise Beaudoin, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de l’application de la Charte de la langue française, Québec, 77 pages.
- — (1996). Le français, langue commune, Politique gouvernementale relative à l’emploi et à la qualité de la langue française dans l’Administration, Québec, 9 p.
- — (1998). Une école d’avenir, Politique d’intégration scolaire et d’éducation interculturelle, Québec, 48 p.
- — (2001). Le français, une langue pour tout le monde, Une nouvelle approche stratégique et citoyenne, Rapport de la Commission des États généraux sur la situation et l’avenir de la langue française au Québec, 285 p.
- — (2005). Apprendre le Québec, Guide pour réussir mon intégration, manuel à l’intention des nouveaux arrivants, 132 p.
- GROUPE DE TRAVAIL TRIPARTITE SUR LA FRANCISATION DES ENTREPRISES (1996). La francisation des entreprises, une responsabilité à partager, Québec, Gouvernement du Québec, 54 p.
- GUSDORF, Georges (1952). La parole, Paris, P.U.F., 126 p.
- HALL, Edward T. (1979). Au-delà de la culture, Paris, Le Seuil, 236 p.
- HERSKOVITS, Melville (1952). Les bases de l’anthropologie culturelle, Paris, Payot, 344 p.
- LABOV, William (1966). The Social Stratification of English in New York City, Washington, Center for Applied Linguistics, 655 p.
- LACOURSIÈRE, Jacques, Jean PROVENCHER et Denis VAUGEOIS (2001). Canada-Québec, 1534-2000, Québec, Septentrion, 591 p.
- LAROSE, Karim (2004). La langue de papier, Spéculations linguistiques au Québec, Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal, 454 p.
- LAVOIE, Thomas et Claude PARADIS (1988). Pour un dictionnaire du français québécois, Propositions et commentaires, Revue québécoise de linguistique théorique et appliquée publiée par l’Association québécoise de linguistique, vol. 7, n° 1, 136 p.
- LÉARD, Jean-Marcel (1995). Grammaire québécoise d’aujourd’hui, Comprendre les québécismes, Montréal, Guérin, 237 p.
- LEBRUN, Monique (2005). Qualité de la langue d’enseignement et formation des maîtres, dans Le français au Québec, Les nouveaux défis, Conseil supérieur de la langue française, p. 489-514.
- — (2005). Les programmes d’enseignement du français et la qualité de la langue, dans Le français au Québec, Les nouveaux défis, Conseil supérieur de la langue française, p. 515-552.
- LÉVESQUE, René (1986). Attendez que je me rappelle, Montréal, Québec Amérique, 525 p.
- LINTON, Ralph (1959). Les fondements culturels de la personnalité, Paris, Dunod.
- LOUBIER, Christiane (1994). L’aménagement linguistique au Québec, Enjeux et devenir, Québec, Office de la langue française, Langues et Société, 145 p.
- — (2006). Contribution à une théorie de l’aménagement linguistique , thèse de doctorat soutenue à l’Université Laval (Québec) le 19 mai 2006. Québec, Université Laval, texte dactylographié, 536 p.
- MARCEL, Jean (1973). Le joual de Troie, Montréal, Éditions du jour, 236 p.
- MARCELLESI, J.-Baptiste et Bernard GARDIN (1974). Introduction à la sociolinguistique : la linguistique sociale, Paris, Larousse, coll. « Langue et Langage », 263 p.
- MARTEL, Pierre et Hélène CAJOLET-LAGANIÈRE (1994). Actes du colloque sur les anglicismes et leur traitement lexicographique, Communications, discussions et synthèses, Québec, Office de la langue française, coll. « Études, recherches et documentation », 382 p.
- — (1996). La français québécois, Usages, standard et aménagement, Québec, Institut québécois de recherche sur la culture, Presses de l’Université Laval, 141 p.
- MERCIER, Louis (2002). La Société du parler français au Canada et la mise en valeur du patrimoine linguistique québécois (1902-1962), Histoire de son enquête et genèse de son glossaire, Québec, Presses de l’Université Laval, 505 p.
- MICHAUD, Nelson (2006). La doctrine Gérin-Lajoie, dans Histoire des relations internationales du Québec, p. 263 à 277, Montréal, VLB éditeur, 357 p.
- NOËL, Danièle (1990). Les questions de langue au Québec, 1759-1850, Québec, Conseil de la langue française, 397 p.
- OFFICE DE LA LANGUE FRANÇAISE (1965). Norme du français écrit et parlé au Québec, Québec, Cahiers de l’Office de la langue française n° 1, 12 p.
- — (1969). Canadianismes de bon aloi, Québec, Cahiers de l’Office de la langue française n° 4, 37 p.
- — (1970). Quel français devons-nous enseigner, Québec, Cahiers de l’Office de la langue française n° 7, 11 p.
- — (1980). Énoncé d’une politique relative à l’emprunt des formes linguistiques étrangères, Québec, 20 p.
- — (1985). Énoncé d’une politique linguistique relative aux québécismes, Québec, 64 p.
- — (1999). La norme du français au Québec, Perspectives pédagogiques, Terminogramme, nos 91-92, 145 p.
- — (2002). L’aménagement linguistique au Québec : 25 ans d’application de la Charte de la langue française, sous la direction de Pierre Bouchard et Richard Y. Bourhis, Revue d’aménagement linguistique n° hors série, 249 p.
- — (2003). Politiques et législations linguistiques comparées, Actes du colloque international tenu à Barcelone les 4, 5 et 6 octobre 1999, Revue d’aménagement linguistique, n° 105, 362 p.
- OSTIGUY, Luc et Claude TOUSIGNANT (1993). Le français québécois, Normes et usages, Montréal, Guérin, 247 p.
- OSTIGUY, Luc (2005). La maîtrise de la norme du français parlé dans l’enseignement et les médias : constats et perspectives, dans Le français au Québec, Les nouveaux défis, Conseil supérieur de la langue française, p. 471-487.
- PAGÉ, Michel (2005). La francisation des immigrants au Québec en 2005 et après, dans Le français au Québec, Les nouveaux défis, Conseil supérieur de la langue française, p. 191-231.
- PAQUIN, Stéphane (2006). Les relations internationales du Québec sous Lesage, 1960-1966, dans Histoire des relations internationales du Québec, p. 23 à 39, Montréal, VLB éditeur, 357 p.
- PICARD, Jean-Claude (2003). Camille Laurin, L’homme debout, Montréal, Boréal, 561 p.
- PLOURDE, Michel (1988). La politique linguistique du Québec, 1977-1987, Québec, Institut québécois de recherche sur la culture, 143 p.
- POTTIER, Bernard (1968). Le français et les autres idiomes parlés en France, dans Le langage, Encyclopédie de la Pléiade. Paris, Gallimard, p. 1144-1161.
- REY, Alain (1972). Usages, jugements et prescriptions linguistiques, Paris, Larousse, revue Le langage, n° de déc., p. 4 à 28.
- RIVARD, Adjutor et Ls-Philippe GEOFFRION (1930). Glossaire du parler français au Canada, 709 p.
- ROBERT, J.-Claude (2000). La langue, enjeu politique au Québec, dans Le français au Québec, 400 ans d’histoire et de vie, Conseil de la langue française, p. 239-246, dont l’encadré de la p. 244, La crise de Saint-Léonard.
- ROCHER, Guy (2000). La politique et la loi linguistiques du Québec en 1977, dans Le français au Québec, 400 ans d’histoire et de vie, Conseil de la langue française, p. 273-284.
- — (2005). Texte d’introduction à Le français au Québec, Les nouveaux défis, Conseil supérieur de la langue française, p. 13-28.
- SALVAIL, Bernard (2003). L’Office de la langue française et la francisation des entreprises, dans Politiques et législations linguistiques comparées, Actes du colloque international tenu à Barcelone les 4, 5 et 6 octobre 1999, Revue d’aménagement linguistique n° 105, p. 251-373.
- SAUSSURE, Ferdinand de (1967). Cours de linguistique générale, 3e éd., Paris, Payot, 331 p.
- SCHWAB, Wallace (1979). Recueil des textes législatifs sur l’emploi des langues, Québec, Éditeur officiel, 497 p.
- TREMBLAY, Gaëtan et Manuel PARÈS (1987). Deux nations, deux modèles culturels, Québec Catalogne, Université du Québec à Montréal, 258 p.
- TREMBLAY, Martine (2006). Derrière les portes closes, Montréal, Québec Amérique, 710 p.
- VAUGEOIS, Denis (2000). Une langue sans statut, dans Le français au Québec, 400 ans d’histoire et de vie. Conseil de la langue française, p. 59-71.
- VILLERS, Marie-Éva de (2003). Multidictionnaire de la langue française , quatrième édition, Montréal, Québec Amérique, 1542 p.
- — (2005). Le Vif Désir de durer, Illustration de la norme réelle du français québécois, Montréal, Québec Amérique, 349 p.
- — (2005). La norme réelle du français québécois, dans Le français au Québec, Les nouveaux défis, Conseil supérieur de la langue française, p. 399-420.
- Westley, Margaret W., 1990, Grandeur et Déclin, L’élite anglo-protestante de Montréal 1900-1950, Montréal, Libre Expression, 334 p.
- WOEHRLING, José (2000). La Charte de la langue française, les ajustements juridiques, dans Le français au Québec, 400 ans d’histoire et de vie, Conseil de la langue française, p. 285-291.
- WOLF, Lothar (2000). La langue des premiers Canadiens, dans Le français au Québec, 400 ans d’histoire et de vie, Conseil de la langue française, p. 25-43.
Notes
- [1] Groupe de pression créé en 1982 pour défendre les droits des anglophones au Québec. Il fit une lutte acharnée à la Charte de la langue française. Il cessa ses activités en 2005, lorsque ses membres devinrent peu nombreux et surtout, lorsque les subventions du ministère canadien du Patrimoine cessèrent. À la même époque, et dans le même esprit, Howard Galganov profitait de son poste d’animateur de radio pour s’attaquer violemment aux nationalistes québécois. Il vit maintenant en Ontario. (Notes de l’auteur.)
- [2] La liste des lois linguistiques successives figure en tête de la bibliographie.
- [3] Pour les différents noms qu’ont portés successivement les habitants de la Nouvelle-France, voir la remarque préliminaire en tête de la première partie de l’ouvrage.
- [4] Ferdinand de Saussure, Cours de linguistique générale, Paris, Payot, 1967, p. 107-108.
- [5] Günther HAENSCH, Antécédents et situation actuelle de la lexicographie de l’espagnol d’Amérique, dans Problèmes de lexicographie en Amérique, Revue québécoise de linguistique, vol. 17, n° 2, Montréal, Université du Québec à Montréal, 1988, p. 37-60.
- [6] Cité par Guy BOUTHILLIER et Jean MEYNAUD, Le Choc des langues au Québec, 1760-1970, p. 140.
- [7] Parlons-nous, Rapport du groupe de travail Dialogue, Ottawa, Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada, février 2001, p. 19.
- [8] Voir Les langues autochtones du Québec, sous la direction de Jacques MAURAIS, Québec, Conseil de la langue française, 1992, 455 p.
- [9] Voir le document repère intitulé « Les politiques linguistiques au Canada ».
- [10] Carte extraite de l’ouvrage de Philippe Barbaud, Le choc des patois en Nouvelle-France, Essai sur l’histoire de la francisation du Canada, Québec, Presses de l’Université du Québec, 204 p.
- [11] Alain REY, Dictionnaire historique de la langue française, à l’encadré Le français : évolution d’une langue, Paris, Les dictionnaires LE ROBERT, 1992, tome I, 2383 p. en deux tomes.
- [12] Publié dans les archives du Glossaire du parler français au Canada, Québec, L’Action nationale Limitée, vol. 1, p. 160-165, tableau cité par Philippe Barbaud, o. c., p. xx.
- [13] Bernard POTTIER, Le français et les autres idiomes parlés en France, Encyclopédie de la Pléiade vol. XXV, LE LANGAGE, dir. André Martinet, Paris, Gallimard, 1968, 1525 p.
- [14] Le fait qu’une grande partie des Français de l’époque parlaient surtout leurs dialectes et ignoraient souvent le français compromettait la diffusion des mots d’ordre de la Révolution. Après une période de flottement, on opta pour la seule langue française dont on imposa l’usage officiel sur tout le territoire et à tous les « citoyens ».
- [15] La référence essentielle en toponymie est : Noms et lieux du Québec, Québec, Les Publications du Québec, 1994, 925 p.
- [16] Se dit des personnes qui ont une connaissance approximative de la langue écrite et une faible compétence en lecture.
- [17] Cité dans Le Choc des langues au Québec, 1760-1970, op. cit., p. 139.
- [18] Pour s’en faire une idée, voir le volume de Danièle NOËL, Les questions de langue au Québec 1759-1850, Québec, Conseil de la langue française, 1990, 397 p.
- [19] Mouvement politique des années 1950 animé, en Tunisie, par Habib Bourguiba (indépendance de la Tunisie en 1956), en Côte d’Ivoire, par Félix Houphouët-Boigny (indépendance du pays en 1960) et au Sénégal, par Léopold Sédar Senghor (indépendance du Sénégal en 1960).
- [20] Journaliste et éditorialiste au journal Le Devoir. Nationaliste canadien-français, d’orientation fédéraliste. L’indépendance du Québec était pour lui une chimère. Ardent défenseur de la langue française, dont il dénonce la piètre situation au Québec et au Canada, source de frustration, de préjugés et de tension. Il propose la création d’une commission d’enquête sur la question, dont il sera vice-président.
- [21] De père canadien-français et de mère écossaise. Féroce opposant au nationalisme de Maurice Duplessis au point que, durant toute sa vie, il soupçonnera le nationalisme québécois d’être rétrograde et replié sur lui-même. Il fonde Cité libre en 1949 avec Gérard Pelletier. Élu député fédéral, il devient procureur général du Canada en 1967, puis chef du Parti libéral et premier ministre du Canada de 1968 à 1979, puis de 1980 à 1984.
- [22] Billet reproduit dans la réédition des Insolences du Frère Untel de 1988 aux Éditions de l’Homme, p. 151.
- [23] De son vrai nom Jean-Paul Desbiens, à l’époque religieux de l’ordre des frères maristes.
- [24] Préface de Jacques Hébert à la même édition des Insolences.
- [25] Voir Les Insolences du Frère Untel, op. cit.
- [26] Article 13 de la Loi instituant un ministère des Affaires culturelles de 1961.
- [27] Dans la revue Vie et Langage, n° 164, novembre 1965, Paris, Larousse, p. 634.
- [28] De 1963 à 1968, revue et maison d’édition animées par André Brochu, Paul Chamberland, André Major, Pierre Maheu, tous partisans d’une littérature engagée et au service de la société canadienne-française.
- [29] Poète, romancier et essayiste. Membre actif de l’Hexagone, groupe littéraire, surtout poétique, créé en 1953 par Gaston Miron et Jean-Guy Pilon. Cofondateur en 1959, avec Jean-Guy Pilon, et ensuite directeur de la revue Liberté, qui sera de tous les débats idéologiques, politiques et esthétiques de la Révolution tranquille.
- [30] « La lutte des langues et la dualité du langage », revue Liberté, mars-avril 1964.
- [31] Albert MEMMI, Portrait du colonisé, précédé du Portrait du colonisateur, préface de Jean-Paul Sartre, Corréa, 1957, 184 p.
- [32] Montréal, L’Étincelle, 146 p.
- [33] Journaliste et essayiste, membre du groupe de l’Hexagone et collaborateur de Cité libre, puis de Parti pris. Associé aux activités du Front de libération du Québec fondé en 1963, il sera compromis dans les actions terroristes du FLQ, et emprisonné quatre ans avant d’être acquitté.
- [34] Nègres blancs d’Amérique, autobiographie précoce d’un « terroriste » québécois , Paris, Maspéro, 1969, 289 p.
- [35] Journaliste, surtout au quotidien Le Devoir. Très engagé dans la cause du français. Ardent partisan de l’affirmation et de l’émancipation du peuple québécois.
- [36] Cité p. 61 par Karim LAROSE, La langue de papier, Spéculations linguistiques au Québec, Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal, 454 p.
- [37] Cité dans La langue de papier, p. 62.
- [38] Voir à ce sujet, surtout l’Histoire de l’enseignement au Québec, de Philippe AUDET, 1971.
- [39] Cycle d’études d’une durée de huit années, dont les matières principales des six premières étaient le français et les langues anciennes, le latin et le grec, les deux dernières étant surtout consacrées à la philosophie et aux sciences, selon les options.
- [40] Écoles où s’enseignaient les métiers, menuiserie, plomberie, mécanique, etc., et qui débouchaient directement sur le monde du travail.
- [41] Lors de son intervention au séminaire LNG 6010 au programme du Département de linguistique de l’Université de Montréal à l’hiver 2006. Nous le remercions de l’éclairage qu’il a donné à la lecture du rapport Parent.
- [42] Regards sur l’éducation, Les indicateurs de l’OCDE 1998. Les calculs pour le Québec sont d’après les statistiques du ministère de l’Éducation du Québec pour l’année scolaire 1995-1996. Voir le Bulletin statistique de l’éducation, ministère de l’Éducation du Québec, n° 13, novembre 1999.
- [43] Indicateurs de l’éducation-édition 2006, ministère de l’Éducation, [ /www :/mels.gouv.qc.ca].
- [44] Rapport préliminaire de la Commission royale d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme, page 15.
- [45] Déclaration inaugurale d’André Laurendeau, novembre 1963, cité dans le Rapport préliminaire, p. 170.
- [46] Rapport préliminaire, paragraphe 129.
- [47] Rapport préliminaire, p. 116 et 117.
- [48] Livre I du rapport de la Commission, paragraphe 270.
- [49] Voir le texte « Les politiques linguistiques au Canada » dans la troisième partie de ce livre.
- [50] Livre I du rapport de la Commission, paragraphe 303.
- [51] Voir le chapitre II de la deuxième partie de cet ouvrage.
- [52] Sociologue de formation, il fut successivement, par la suite, président de la Commission de protection de la langue française (1986-1987), de l’Office de la langue française (1987-1990) et du Conseil de la langue française (1990-1995). Il fut député du Parti libéral dans la circonscription d’Outremont de 1996 à 2003.
- [53] Aimé GAGNÉ, Le français au-delà des mots, Un cheminement linguistique.
- [54] Procès-verbal de la réunion des commissaires de la Commission scolaire de Saint-Léonard du 8 mai 1963.
- [55] Procès-verbal de la réunion du 10 juillet 1963.
- [56] Procès-verbal de la réunion spéciale du 20 novembre 1967.
- [57] Procès-verbal de la réunion du 8 mai 1968.
- [58] Le Devoir, 17 mai 1968.
- [59] Texte cité par Gaston CHOLETTE dans L’Office de la langue française de 1961 à 1974, regard et témoignage, p. 62.
- [60] La source principale de cette partie est l’ouvrage de Gaston CHOLETTE, L’Office de la langue française de 1961 à 1974. Cet ouvrage traitant surtout de la francisation des entreprises, l’auteur, alors directeur linguistique de l’Office depuis 1971, a étoffé les autres sujets à même ses souvenirs et en se reportant aux études de l’Office sur l’un ou l’autre sujet.
- [61] Jean-Claude de BROUWER, Le français langue de travail : ce qu’en pensent des élites économiques du Québec, Commission Gendron, Étude E 12, 1973, 382 p.
- [62] Ibid., tableaux des pages 177 et 180. Chaque répondant peut avoir recours à plusieurs arguments.
- [63] Pour l’explication de cette notion, voir le texte intitulé « Essai de définition du bilinguisme fonctionnel : l’expérience québécoise » dans la troisième partie de cet ouvrage.
- [64] Selon le texte du récit de son voyage au Bas-Canada reproduit dans Le choc des langues au Québec, 1760-1970, de Guy BOUTHILLIER et Jean MEYNAUD, p. 139 et suivantes.
- [65] Voir, par exemple, l’ouvrage du linguiste Guy LABELLE, Étude de la langue d’affichage dans la région de Montréal, mémoire de maîtrise présenté à la Faculté des lettres de l’Université de Montréal, 1970, 159 p.
- [66] Voir à ce sujet Problématique de la francisation des raisons sociales, de Bernard SALVAIL, Danielle DEMERS et Suzanne LABERGE, Office de la langue française, 1975, 66 p.
- [67] Voir Bernard SALVAIL et Danielle DEMERS-LARIVIÈRE, Comment formuler une raison sociale en français, Règles d’écriture des raisons sociales, Office (alors Régie) de la langue française, 1975, 31 p.
- [68] Jacques BOUCHARD, Les 36 cordes sensibles des Québécois, d’après leurs six racines vitales, Montréal, Éditions Héritage, 1978, 278 p. en édition électronique.
- [69] Pour un exposé plus complet, voir le texte intitulé « Le rôle de la terminologie en aménagement linguistique : genèse et description de l’approche québécoise » dans la troisième partie de ce livre.
- [70] Première édition en 1973.
- [71] Documents, Démographie scolaire, 9-14, Gouvernement du Québec, ministère de l’Éducation, direction générale de la planification, p. 60-63.
- [72] Michel PAILLÉ, Contribution à la démolinguistique du Québec, Québec, Conseil de la langue française, coll. « Notes et Documents », n° 48, avril 1985, p. 152-178.
- [73] La dynamique des langues en quelques chiffres, dépliant d’information diffusé par le Secrétariat à la politique linguistique.
- [74] Pierre GODIN, tome 3 de sa biographie de René Lévesque, L’espoir et le chagrin, Montréal, Boréal, 2001, p. 169.
- [75] Voir Margaret W. WESTLEY, universitaire américaine de passage à l’Université McGill, qui, intriguée par la splendeur des résidences du Golden Square transformées en dépendances universitaires, a mené enquête pour comprendre les raisons de la Grandeur et [du] Déclin [de] l’élite anglo-protestante de Montréal.
- [76] Rapport de la mission d’étude sur le fonctionnement linguistique des sièges sociaux d’entreprises internationales, Régie de la langue française, non daté. L’auteur se réfère à son propre exemplaire du rapport.
- [77] Paul Joseph James Martin (1903-1992), connu aujourd’hui sous le nom de Paul Martin père, était membre du Parti libéral du Canada. Élu député, il fut ministre sous quatre gouvernements successifs (Mackenzie King, Louis St-Laurent, Lester B. Pearson et Pierre Elliott Trudeau. À trois reprises, il tenta de prendre la direction du Parti libéral (1948, 1958 et 1968).
- [78] Paul Gérin-Lajoie, avocat, vice-président du Conseil des ministres et ministre de l’Éducation de 1964 à 1966 sous le gouvernement libéral de Jean Lesage. Il avait soutenu cette opinion devant le corps consulaire de Montréal le 12 avril 1965. De 1970 à 1977, il fut président de l’Agence canadienne de développement international (ACDI). Il créa la fondation Paul Gérin-Lajoie en 1977, organisation vouée à l’éducation de base des enfants des pays en voie de développement.
- [79] En 1982, dans L’enseignement du français, langue seconde, aux adultes, en collaboration avec Ariane ARCHAMBAULT, p. 116 et 117. Voir bibliographie.
- [80] On en trouve de larges extraits dans Le choc des langues de Guy BOUTHILLIER et Jean MEYNAUD, p. 700 à 710.
- [81] Secrétaire d’État à l’Éducation sous le gouvernement de l’Union nationale dirigé par Daniel Johnson.
- [82] Voir le document que tous reçoivent à leur arrivée, intitulé Apprendre le Québec, Guide pour réussir mon intégration, Québec, ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles, 2005, 132 p.
- [83] Le français, langue commune, Politique gouvernementale relative à l’emploi et à la qualité de la langue française dans l’Administration, Québec, 1996, paragr. 3, p. 5.
- [84] Voir le tableau « Statistiques de l’immigration des 10 dernières années » à l’annexe IV
- [85] Voir l’historique de cette disposition au premier chapitre de la partie suivante.
- [86] Source : Institut de la statistique du Québec, La situation démographique au Québec, Bilan 2006, tableau 507, Mariages selon la langue maternelle des époux, 2004 et 2005.
- [87] Voir l’article de François BERGER dans le journal La Presse du 2 avril 2006.
- [88] Charles CASTONGUAY, Les indicateurs généraux de vitalité des langues au Québec : comparabilité et tendance 1971-2001, Québec, Office québécois de la langue française, 2005, 45 p.
- [89] D’après les renseignements que le ministère a fournis par écrit à l’auteur en décembre 2006.
- [90] Gouvernement du Québec, La politique québécoise de la langue française, mars 1977, 65 p., dans l’édition de diffusion populaire.
- [91] Voir les actes de cette rencontre publiés par la Fédération du français universel, Langue française et Identité culturelle, Moncton (1977), Dakar, Les Nouvelles éditions africaines, 1979, p. 255-262.
- [92] Voir le texte de sa contribution aux mélanges offerts à l’auteur sous le titre Langues et Sociétés en contact, Tübingen, Max Niemeyer Verlag, 1994, 582 p.
- [93] Gouvernement du Québec, Le français, langue commune, Enjeu de la société québécoise, Rapport du comité interministériel sur la situation de la langue française, 1996, 319 p.
- [94] Voir en bibliographie l’énumération des lois modifiant la Charte de la langue française classées en ordre chronologique, avec leurs numéros d’ordre et mention du gouvernement qui en a pris l’initiative.
- [95] En principe, le comité de francisation est responsable de la définition et du suivi du programme de francisation de l’entreprise. C’est le témoin quotidien de l’emploi de la langue française sur les lieux de travail et le gardien de la francisation de l’entreprise.
- [96] Le texte original est cité en italiques.
- [97] Bernard SALVAIL, L’Office de la langue française et la francisation des entreprises , dans Politiques et législations linguistiques comparées, Actes du colloque international tenu à Barcelone les 4, 5 et 6 octobre 1999, Québec, 2003, Office de la langue française, Revue d’aménagement linguistique, n° 105, p. 251-373.
- [98] Langue de travail : indicateurs relatifs à l’évolution de la population active et à l’utilisation des langues au travail en 2001, 2006.
- [99] Indicateurs de l’éducation. Édition 2006, tableau 6.2, ministère de l’Éducation, [www ://mels.gouv.qc.ca].
- [100] Remarque importante : il s’agit ici d’une autoévaluation de la part des répondants. Les anglophones ont tendance à se surévaluer aussitôt qu’ils peuvent parler français, les francophones à se sous-estimer en langue parlée, alors qu’ils sont plus compétents en langue écrite que les anglophones. En réalité, le bilinguisme effectif des francophones est de meilleure qualité que celui des anglophones, d’après un article d’André CAUCHY, Le Devoir, 22 mars 2006.
- [101] Voir la description des variables dans Travailler en français au Québec : les perceptions de travailleurs et de gestionnaires, Office de la langue française, Direction de la recherche, 2002.
- [102] Le français, langue d’assimilation, langue d’intégration, dans les Actes du colloque sur la problématique de l’aménagement linguistique, Chicoutimi, 1993.
- [103] Groupe de travail tripartite sur la francisation des entreprises, 1996.
- [104] En principe, le comité de francisation est responsable de la définition et du suivi du programme de francisation de l’entreprise. C’est le témoin quotidien de l’emploi de la langue française sur les lieux de travail.
- [105] Voir le document intitulé Une école d’avenir, Politique d’intégration scolaire et d’éducation interculturelle, Prendre le virage du succès, Ministère de l’Éducation, 1998, 48 p.
- [106] D’après la conférence prononcée par Marie Mc Andrew, professeure à la faculté des Sciences de l’Éducation de l’Université de Montréal, lors de l’ouverture d’un colloque sur le thème Intégration et scolarisation des élèves immigrants, Dessine-moi une école, 23 mai 2003.
- [107] Voir l’annexe 3 du rapport, page 212, Les différentes options proposées à la Commission dans le débat relatif à la langue d’enseignement dans le réseau collégial.
- [108] Les notes qui suivent s’inspirent de notre propre observation et de nos déambulations dans les rues et les quartiers de Montréal. Il est évident que nous n’avions pas les moyens de leur assurer la rigueur des enquêtes scientifiques.
- [109] Première édition, Paris, Dunod, 1959, deuxième édition, Bordas, 1986, dernière édition, Dunod, 1999.
- [110] Ferdinand de SAUSSURE, Cours de linguistique générale, p. 30 et 37.
- [111] Voir le texte intitulé « Éléments d’une théorie de la régulation linguistique » dans la troisième partie.
- [112] Voir surtout Ce que parler veut dire, L’économie des échanges linguistiques, Paris, Fayard, 1982, 244 p.
- [113] La norme et l’école, dans La norme du français au Québec, Perspectives pédagogiques, nos 91-92 de la revue Terminogramme, Office de la langue française, 1999.
- [114] Multidictionnaire de la langue française de Marie-Éva de VILLERS, Montréal, Québec Amérique, 2003 pour la 4e édition.
- [115] Voir le compte rendu des résolutions de l’assemblée générale du congrès du dixième anniversaire de cette association dans la revue Québec français, n° 28, décembre 1977.
- [116] Une première version de ce texte a servi d’exposé introductif au 22e colloque de l’Académie des lettres du Québec de novembre 2004.
- [117] Clown clochard connu et apprécié de tous pour ses calembours, pseudonyme de Marc Favreau, humoriste et comédien québécois (1929-2005).
- [118] Un collègue de l’Université de Sherbrooke, Jean-Marcel LÉARD, a publié en 1995 un essai sur la Grammaire québécoise d’aujourd’hui, Comprendre les québécismes, titre nettement plus accrocheur que le titre de travail Grammaire de l’oral québécois. On peut cependant regretter une fois de plus la réduction du français québécois à sa forme populaire, qui est la seule que décrit l’auteur.
- [119] 1985, La lexicographie québécoise, Bilan et perspective et 1986, Pour un dictionnaire du français québécois, Propositions et commentaires.
- [120] Plusieurs exemples sont tirés de l’ouvrage de Marie-Éva de VILLERS, Le Vif Désir de durer, ou de son Multidictionnaire de la langue française. D’autres viennent des publications de l’Office de la langue française.
- [121] Voir les cartes du premier chapitre de la première partie. Les indications d’origine sont tirées du Glossaire du parler français au Canada.
- [122] Dictionnaire des anglicismes, Paris, Les usuels du Robert, 1960, 1152 p.
- [123] Voir Le Vif Désir de durer, p. 38 et 62.
- [124] Jacques CELLARD et Alain REY ont réuni en un dictionnaire ces mots éliminés du bon usage social sous le titre de Dictionnaire du français non conventionnel. Paris, Hachette, 1980, 894 p.
- [125] Notre information provient des documents du ministère de l’Éducation. Nous intégrons aussi des témoignages devant la Commission des États généraux sur la situation et l’avenir de la langue française au Québec, dite commission Larose : 211 mémoires de citoyens ou d’organismes lus et résumés, 17 audiences publiques dans toutes les régions administratives du Québec, 4 jours d’audiences nationales, 6 journées thématiques dont l’une consacrée à la qualité de la langue et une autre à la langue d’enseignement et à l’enseignement des langues, un colloque international, enfin un forum national pour tester les grandes orientations du rapport publié en août 2001.
- [126] Ces textes sont disponibles uniquement dans Internet, sur le site du ministère de l’Éducation à l’adresse [www.mels.gouv.qc.ca]. Le Programme de formation de l’école québécoise est un texte de 350 pages, suivi d’une annexe de 18 pages, en anglais seulement, intitulée English as a Second Language. Voir en particulier le chapitre 5, Domaine des langues.
- [127] L’Express international de la semaine du 31 août au 6 septembre 2006.
- [128] Luc OSTIGUY, La maîtrise de la norme du français parlé dans l’enseignement et les médias : constats et perspectives, dans Le français au Québec, Les nouveaux défis, page 477.
- [129] Monique LEBRUN, Qualité de la langue d’enseignement et formation des maîtres, dans Le français au Québec, Les nouveaux défis, page 508.
- [130] Marie-Éva de VILLERS, La Nouvelle Grammaire en tableaux, Québec Amérique, 2003.
- [131] Luc GERMAIN, Luc PAPINEAU et Benoit SÉGUIN, Lanctôt, 2006, 212 p.
- [132] Le français au Québec, 400 ans d’histoire et de vie, sous la direction de Michel PLOURDE, Québec, Les Éditions du Québec, Montréal, Fides, 2000, 516 pages.
- [133] Le français au Québec, Les nouveaux défis, sous la direction d’Alexandre STEFANESCU et de Pierre GEORGEAULT, Québec, Conseil supérieur de la langue française, Montréal, Fides, 2005, 622 p.
- [134] Le français, langue normale et habituelle du travail, Québec, Conseil supérieur de la langue française, 2005, 55 p.
- [135] Revue Barricades, vol.1, n° 1, automne 2005, p. 55.
- [136] Radio Canada a diffusé les résultats de ce sondage lors d’une émission spéciale, Le français qu’on aime, le dimanche 20 novembre 2005.
- [137] Le Devoir, 15 juillet 2005, en première page.
- [138] Le français, langue commune, Promouvoir l’usage et la qualité du français, langue officielle et langue commune du Québec, Proposition de politique linguistique, Gouvernement du Québec, 1996, 77 pages.
- [139] Voir, à ce sujet, les réflexions de Neil BISSOONDATH, Le marché des illusions, La méprise du multiculturalisme, préface de Lise Bissonnette, Montréal, Boréal-Liber, 243 p.
- [140] Voir, par exemple, Selim ABOU, L’identité culturelle, Relations interethniques et problème d’acculturation (Paris, Anthropos, 1981), Albert MEMMI, Le nomade immobile (Paris, Arléa, 2000) et surtout Amin MAALOUF, Les identités meurtrières (Paris, Grasset, 1998).
- [141] Marco MICONE, Speak What, suivi d’une analyse de Lise Gauvin, Montréal, VLB, 2001.
- [142] Transferts linguistiques vers le français; 1971, 29 %, 2001, 46 %; vers l’anglais, 1971, 71 %, 2001, 54 %.
- [143] Taux d’assimilation linguistique des francophones au Canada en 2001 : Colombie-Britannique, 72,7 %, Alberta, 67,7 %, Saskatchewan, 74,6 %, Manitoba, 54,7 %, Ontario, 40,3 %, Nouveau-Brunswick, 10,5 %, Île-du-Prince-Édouard, 53,1 %, Terre-Neuve, 63,6 %. Source : Gouvernement du Québec, Secrétariat à la politique linguistique : La dynamique des langues en quelques chiffres, d’après Statistique Canada.
- [144] Le Devoir, 23 juin 2005.
- [145] Proportion des Québécois de langue maternelle au Québec en 2001 : ensemble du Québec, 81,4 %, région de Montréal, 68,1 %, île de Montréal, 53,2 %. Proportion des Québécois dont le français est la langue le plus souvent parlée à la maison : ensemble du Québec, 83,1 %, région de Montréal, 70,7 %, île de Montréal, 56,4 %. Source : Secrétariat à la politique linguistique.
- [146] Le français, langue commune, Promouvoir l’usage et la qualité du français, langue officielle et langue commune du Québec, Proposition de politique linguistique, Gouvernement du Québec, 1996, 77 pages.
- [147] « Anglo francophile voulant parler la langue de Molière », Le Devoir, 20 novembre 2006.
- [148] Voir le chapitre « La politique québécoise d’immigration ».
- [149] Livre blanc, p. 25.
Référence bibliographique
Corbeil, Jean-Claude, L’Embarras des langues : origine, conception et évolution de la politique linguistique québécoise, préface de Louise Beaudoin, Montréal, Québec Amérique, 2007, 548 p. [livre]