L’Aménagement linguistique du Québec
Jean-Claude Corbeil
Introduction
« Pendant que j’y pense… »
Nous avons choisi de traiter dans cet ouvrage de la question linguistique québécoise et plus particulièrement de la législation linguistique. Alors que nous nous sentons encore très près des événements de la dernière décennie et pendant que l’effervescence des idées et le choc des opinions agitent encore notre mémoire, il nous paraît opportun de faire le point sur cette question.
Conscient de ce que notre entreprise a de prématuré, faute de recul —la législation linguistique étant trop récente pour que nous puissions en évaluer les retombées— et faute également de perspective historique —l’histoire de la langue française au Québec nous apparaissant comme un terrain vierge où quelques rares explorateurs se sont aventurés—, nous nous y engageons en toute humilité, poussé par des préoccupations d’ordres très divers.
Nous tentons d’abord d’expliquer les mobiles qui ont amené le Québec à entreprendre une œuvre aussi étonnante et inédite que la conception et l’adoption, non seulement d’une seule, mais de plusieurs législations linguistiques successives. Il fallait qu’il y eût de très bonnes raisons, car les hommes politiques n’interviennent qu’à la dernière extrémité dans ce domaine, sachant d’instinct que le citoyen y est d’une grande sensibilité, qu’il y a donc pour eux des risques, surtout lorsque la nation comporte plusieurs langues et cultures. Cette réserve, nous l’avons observée non seulement au Québec et au Canada, mais aussi bien en Afrique noire, dans le monde arabe, en Europe, par exemple en France, en Belgique ou en Suisse. En conséquence, nous retraçons dans le premier chapitre les grandes étapes de l’histoire du statut de la langue française au Québec et dans le deuxième le cheminement récent des idées au sujet de la situation de la langue française au Québec, de la nécessité d’une intervention de l’État pour rétablir la langue de la majorité dans tous ses droits, enfin au sujet du contenu d’une éventuelle législation. Il apparaît alors très clairement que la langue française a toujours été l’objet d’un souci constant de la part des Québécois, comme facteur central et symbole d’une volonté partagée d’être soi, sur les plans religieux, culturel, économique et politique; la politique linguistique a des sources lointaines et elle fait partie d’un projet collectif global que les Québécois poursuivent depuis longtemps d’une génération à l’autre, selon les hauts et les bas de l’Histoire.
Ensuite, nous cherchons à exposer la stratégie et la logique qui sous-tendent la législation actuelle. La loi n’est pas explicite sur tout : la stratégie globale est plus vaste, où la loi est la pièce maîtresse qui définit et garantit le statut de la langue française et des langues des minorités, y compris l’anglais, langue de la minorité historique. La loi prévoit aussi la manière et les moyens d’atteindre une nouvelle situation linguistique jugée meilleure et souhaitable. De plus, un texte de loi n’est pas de lecture aisée, puisqu’il demeure de style juridique malgré les intentions de clarté et de simplicité du rédacteur et parce qu’il n’est jamais didactique, en ce sens que ne sont jamais expliquées les raisons d’être des choses. Le chapitre quatre décrit donc la stratégie linguistique québécoise, celle du statut de la langue française et celle de la qualité de la langue, stratégie qui s’appuie sur des éléments de théorie dont les principaux sont présentés au chapitre trois.
Nous souhaitons enfin contribuer aux recherches actuellement en cours dans le monde afin de trouver des solutions aux problèmes des relations entre les langues. Nous avons pu constater que l’expérience québécoise suscite effectivement beaucoup d’intérêt, autant chez les spécialistes, les universitaires, les fonctionnaires et les dirigeants d’entreprises que chez les hommes politiques. C’est la raison pour laquelle nous proposons, au début du chapitre cinq, une première description du modèle linguistique que nous pouvons en tirer, convaincu qu’il pourra servir aux peuples de la francophonie dont les problèmes linguistiques nombreux et souvent peu connus présentent beaucoup d’analogies avec ceux du Québec. L’analyse de ces problèmes permettra, selon nous, de dédramatiser des situations nationales vécues jusqu’à maintenant en vase clos.
Dans la seconde partie de ce cinquième chapitre, nous faisons l’inventaire des défis linguistiques que doit relever la francophonie. Il est urgent en effet que l’intérêt que nous manifestons à son endroit dépasse le stade des allocutions de circonstances prononcées à l’occasion de rencontres à caractère politique, littéraire ou scientifique.
Les travaux de ces dix dernières années, menés au Canada par la Commission Laurendeau-Dunton (chapitre 2, 2.), au Québec par la Commission Gendron (chapitre 2, 3.) et l’Office de la langue française (chapitre 2, 4.), traitent de problèmes qui relèvent de cette partie de la sociolinguistique qu’on appelle en anglais « language planning », dénomination qui a donné en français le calque « planification linguistique ». Nous préférons pour notre part l’expression « aménagement linguistique ». Ce n’est pas simple caprice. Les mots, même les plus abstraits, traînent avec eux, comme leur ombre, des associations, des connotations qui sont comme leur réputation, qui font naître chez les usagers des préjugés favorables ou défavorables. Nous avons remarqué que le syntagme « planification linguistique » pouvait facilement avoir en français une connotation péjorative : l’expression suggère une intervention dirigiste, de type bureaucratique, un peu à la manière des plans quinquennaux en économie, où les experts ont le pas sur les citoyens et les hommes politiques. Par contre, l’expression « aménagement linguistique » s’inscrit dans la série « aménagement du territoire », « aménagement des ressources hydroélectriques ». Elle évoque un effort à moyen et à long termes pour mieux tirer parti d’une ressource, collective[1], la ou les langues, en fonction des besoins et des intérêts de la nation, selon un plan souple qui oriente l’évolution de la société sans la brusquer mais au contraire en réclamant son adhésion et sa participation. En outre, le mot « aménagement » engendre des équivalents plus transparents et plus facilement acceptables pour « language status planning » et « language corpus planning[2] », qui deviennent « aménagement du statut de la langue » et « aménagement de la langue », lorsque l’action porte sur le système même de la langue (par exemple la réduction du nombre d’allophones, l’établissement d’une orthographe, l’enrichissement du vocabulaire par néologie) ou sur la qualité de la langue conçue comme étant la généralisation d’un des usages d’une langue érigé en modèle pour la communication institutionnalisée.
Compte tenu de leurs mandats respectifs, les Commissions Laurendeau-Dunton et Gendron ont été amenées à définir, à évaluer et à comparer le statut de chacune des langues en présence, notamment l’anglais et le français, ce qui a donné lieu à des travaux de recherche particulièrement intéressants autant du point de vue méthodologique que théorique. À l’Office, nous nous sommes surtout intéressés à la méthodologie du changement linguistique planifié, à la définition et à la pratique du bilinguisme fonctionnel (chapitre 3, 1.), à la régulation linguistique, c’est-à-dire à la manière dont les comportements linguistiques d’une collectivité se standardisent (chapitre 3, 4.) et à l’analyse du concept de normalisation selon qu’on l’applique aux vocabulaires de spécialités ou à la langue commune (chapitre 3, 4.2.), ce qui implique un inventaire et une description des fonctions de la langue (chapitre 3, 2.). Nous nous sommes aussi rendu compte que, dans la plupart des pays[3], bon nombre de pratiques linguistiques sont définies par des lois ou des règlements visant entre autres l’enseignement d’une ou de plusieurs langues maternelles ou étrangères, la langue du système juridique, la langue des raisons sociales, des marques de commerce, du commerce intérieur et extérieur, de l’affichage et de l’étiquetage, etc. En fait, si l’impression subsiste qu’il est rare de légiférer en matière de langue, c’est qu’on a surtout à l’esprit des lois portant spécifiquement sur la ou les langues, comme la Charte de la langue française ou la Loi sur les langues officielles. On oublie ou on ignore que des dispositions législatives ou réglementaires traitent de l’usage des langues dans des domaines particuliers et que l’ensemble finit par constituer le statut juridique d’une langue sur un territoire.
La manière de désigner les « Français d’Amérique » varie beaucoup selon les époques et les auteurs. Jadis, on disait les « Canadiens » par opposition aux « Anglais », puis par la suite les « Canadiens français » et les « Canadiens anglais » ou plus simplement les « francophones » et les « anglophones », en ayant bien à l’esprit que sont anglophones non seulement les Anglais, mais aussi les immigrants d’autres langues qui ont choisi l’anglais et qui, souvent, sont plus nombreux. Depuis quelque temps, on dit les « Québécois » et plus spécifiquement parfois les « Québécois francophones » par opposition aux « Québécois anglophones »; les autres francophones du Canada sont devenus les « Francophones hors Québec » qui comprennent aussi bien les Acadiens que les Québécois qui ont été séparés du Québec ou qui ont émigré dans d’autres provinces. Dans cet ouvrage, nous respectons la terminologie des auteurs que nous citons ou dont nous rapportons les travaux. Dans notre texte, l’adjectif ou le substantif « québécois » désigne la majorité française du Québec et ceux qui s’y sont intégrés, tandis que le terme « anglais » désigne la minorité historique d’origine britannique, et l’expression « les minorités » les autres collectivités culturelles qui se sont peu à peu constituées, y compris la minorité anglaise lorsque nous ne jugeons pas utile de la distinguer des autres minorités.
De même, l’Office de la langue française change de mandat et de préoccupations selon l’évolution de la société québécoise. Nous distinguons quatre périodes. De 1961 à 1969, l’Office se préoccupe surtout de qualité de la langue, conformément à son mandat, reflet des intérêts de l’époque et de la manière dont était perçue et abordée la question de la langue française au Québec. De 1969 à 1974, l’Office entreprend les premiers essais d’implantation du français comme langue de travail et des affaires, par voie d’incitation, à la suite d’un élargissement de son mandat par la Loi pour promouvoir la langue française (loi 63). De 1974 à 1977, du fait de la Loi sur la langue officielle (loi 22), l’Office devient la Régie de la langue française, dotée cette fois du pouvoir d’appliquer une loi très détaillée. Enfin, en 1977, la Charte de la langue française (loi 101), en créant un nouvel « Office de la langue française », lui confère le mandat d’appliquer une législation également détaillée, mais cette fois avec le concours d’organismes tels que le Conseil de la langue française et la Commission de surveillance. Nous n’avons retenu que la seule appellation « Office de la langue française », laissant au lecteur le soin de replacer cet organisme dans son contexte historique.
Le présent ouvrage est la mise en forme de travaux et de textes, dont certains ont paru depuis 1970. Nous remercions tous nos amis, tous nos collègues, ceux de l’Office, ceux qui ont participé aux différents colloques et rencontres, ceux des entreprises, traducteurs, terminologues, ingénieurs, gestionnaires, avec qui nous avons travaillé à l’implantation du français et dont les avis, les commentaires, l’expérience ont nourri et enrichi nos propres réflexions.
Chapitre 1 – Genèse de la situation linguistique au Québec[4]
Les phénomènes linguistiques évoluent généralement très lentement. À première vue, la langue paraît immuable, toujours identique à elle-même jour après jour; d’une manière plus globale, la situation linguistique d’un pays semble tout à fait stable, figée à jamais comme un instantané. Cette impression vient d’une part du fait que le mouvement est très lent, d’autre part de la difficulté de constater ce qui se passe faute de repères qui pourraient servir à mesurer l’écart entre deux observations, faute également d’une méthode de mesure de l’évolution linguistique, du double point de vue de son intensité et des directions qu’elle prend. Pourtant, l’histoire nous démontre que la langue, comme tout organisme vivant, se transforme continuellement dans un incessant effort d’adaptation à la réalité, elle-même mouvante, qu’elle est chargée d’exprimer. Nous savons également que les situations linguistiques sont dynamiques et qu’un jeu complexe de forces socio-économiques détermine l’orientation dominante de leur évolution, quoique nous n’ayons pas encore identifié clairement quelles sont ces forces, et encore moins déterminé la manière de mesurer ou de pondérer l’influence relative de chacune d’elles à la fois sur les autres et sur la situation globale.
Au moment où nous étions engagé dans la mise au point d’une stratégie capable de modifier la situation linguistique du Québec, l’idée nous est venue d’examiner comment elle s’était constituée. Il est moins saugrenu qu’on ne le pense de rappeler deux évidences historiques. Sous le Régime français, la seule langue de la Nouvelle-France était le français, langue de l’État, du commerce, de l’industrie naissante, langue de l’enseignement, langue des professions, des sciences et des arts, donc langue de la population, en contact sans doute avec les langues amérindiennes et, épisodiquement peut-être, avec l’anglais des colonies du littoral atlantique, à tel point que les armées anglaises s’étaient fait accompagner d’interprètes et de traducteurs. La Conquête de 1760 introduit l’anglais dans la colonie, mais le français s’y maintient en raison du grand nombre de la population.
Ainsi se trouve amorcée la concurrence de statut entre ces deux langues et le processus de contamination du français au fur et à mesure que l’anglais s’affirme comme langue dominante. On peut donc formuler l’hypothèse que les forces sociales qui ont déterminé la situation linguistique québécoise telle qu’elle se présentera en mille neuf cent soixante sont les mêmes que celles qui en assureront le redressement. En d’autres mots, si, en relisant l’histoire dans cette perspective, on arrive à identifier les facteurs qui ont fait du français une langue dominée et qui ont enclenché un début de créolisation au sein du prolétariat urbain, alors on saura avec plus de certitude comment bloquer cette évolution et quelle stratégie sociale adopter pour orienter la dynamique linguistique vers la « francisation » du Québec, selon l’expression courante.
Nous avons regroupé en cinq grandes classes d’inégale importance les facteurs qui nous ont semblé pertinents. Comme l’écriture est linéaire, nous sommes contraint de les présenter l’un à la suite de l’autre alors que ce sont les interactions et les convergences d’influences qui, en définitive, déterminent la situation, chaque élément à lui seul n’étant pas déterminant. De plus, à un haut niveau d’abstraction, les classes elles-mêmes peuvent être considérées comme des facteurs. Ce sont : les transformations socio-économiques de la société québécoise à la suite de la Conquête anglaise, la constitution et la transformation des idéologies au Québec, le processus de scolarisation de la population, la manière dont s’est constituée la classe ouvrière, enfin le fait de notre insertion dans le continent nord-américain.
1. Les transformations socio-économiques de la société québécoise à la suite de la Conquête anglaise (1760)
Avec la Conquête, la structure de la société québécoise se modifie. Sur le plan linguistique, certaines transformations auront des répercussions importantes tant sur le statut que sur la nature du français au Québec.
1.1 L’économie et le commerce passent aux mains des Anglais : l’anglais sera donc la langue de l’économie et du commerce
Le changement se fait sans heurts, tout naturellement. L’Angleterre, par ses représentants, dirige l’économie du pays et exige que le commerce se fasse par l’intermédiaire de sociétés installées soit dans les colonies anglaises, soit en Angleterre. Bon nombre de commerçants français ont quitté le pays ou sont ruinés par la défaite. Quant à ceux qui ont persisté, soit qu’ils ne connaissent pas les sociétés anglaises, soit que ces dernières ignorent leur existence ou refusent de leur faire crédit. Les commerçants des colonies américaines envahissent le Québec et s’y comportent comme en territoire conquis[5].
Les témoignages des observateurs sont unanimes. Le plus connu d’entre eux, Alexis de Tocqueville, écrivait en 1831 : « Mais il est facile de voir que les Français sont le peuple vaincu. Les classes riches appartiennent pour la plupart à la race anglaise. Bien que le français soit la langue presque universellement parlée, ia plupart des journaux, les affiches et jusqu’aux enseignes des marchands français sont en anglais. Les entreprises commerciales sont presque toutes en leurs mains (aux Anglais)[6]. »
La dernière phrase de Tocqueville est encore vraie en 1970, comme l’ont démontré les études des Commissions Laurendeau-Dunton et Gendron (voir chapitre 2.2.).
1.2 L’industrie du pays est assumée par les grandes sociétés de type monopolistique anglo-saxonnes puis américaines. L’anglais sera la langue de l’industrie[7]
Le développement industriel du Québec ne se fait pas en fonction de ses propres priorités, mais en raison des besoins et de la dynamique de l’économie globale nord-américaine. La plupart du temps, il s’agit de l’exploitation des richesses naturelles qu’on ne transforme pas sur place, donc d’industrie primaire. Les établissements québécois sont en grande partie des succursales de sociétés anglaises ou américaines administrées par des étrangers de langue anglaise, ils imposent leur langue comme langue de travail et vivent en marge de la population locale, dans les beaux quartiers des villes et des villages. Le rôle des Québécois se borne à fournir de la main-d’œuvre bon marché et des bilingues de service, en général contremaîtres ou cadres inférieurs.
La conséquence linguistique de ce mode d’industrialisation sera l’anglicisation massive de la classe ouvrière québécoise, au furet à mesure de sa formation. Les élites francophones de l’époque, tout entières engagées dans l’idéologie de conservation, abandonneront la classe ouvrière à son sort. Au moment où l’industrialisation commence et se poursuit, personne ne semble comprendre qu’elle constitue un puissant facteur qui anglicisera la population plus sûrement que la politique et qui modifiera le statut de la langue française sur le territoire québécois, l’anglais devenant la langue dominante.
1.3 Les institutions politiques, juridiques et administratives du Québec sont influencées par les institutions anglo-saxonnes
Par exemple, notre système politique suit l’évolution de la démocratie en Angleterre et aux États-Unis; les institutions parlementaires sont définies par l’Angleterre; le droit civil est français (code Napoléon) mais avec des emprunts de plus en plus nombreux à la Common Law et au droit américain et le droit criminel, britannique.
1.4 Les relations avec la France sont rompues
On peut discuter de la durée et de l’intensité de cette rupture. Un fait demeure certain : l’essentiel de notre évolution échappera et échappe encore à l’influence de la France, mais sera et est encore lourdement influencé par l’Angleterre et les États-Unis, et ce dans tous les domaines : politique, économique, scientifique, technologique, médical, même artistique, notamment en musique. Pour tout, nous prendrons l’habitude de nous tourner vers les États-Unis et de les imiter. Notre pseudo-colonisation par la France est un des mythes les plus curieux, sans doute entretenu par notre communauté de langue, façade qui masque le peu d’importance de nos relations économiques et scientifiques. En fait, nous ne participerons que de très loin à l’évolution de la langue et de la société françaises pendant tout le dix-neuvième et la moitié du vingtième siècle.
1.5 L’importance démographique des francophones décroîtra sans cesse
C’est probablement Durham qui a perçu le premier et avec à la fois le plus de lucidité et de franchise, l’aspect démographique de la crise canadienne d’alors et proposé une stratégie claire pour y faire face, stratégie qui, somme toute, a fort bien réussi. En fait, la proportion démographique des francophones a baissé, au Canada, sous l’influence conjuguée de trois éléments. Tout d’abord, par l’Acte d’Union et la Confédération, on a fondu le Canada en un seul grand tout, nanti d’un pouvoir central de plus en plus fort. Ensuite, la politique d’immigration a nettement favorisé l’augmentation du nombre des Anglo-Saxons, par exemple à la suite de la Déclaration d’indépendance des États-Unis ou au moment des grandes famines en Irlande. Enfin, le nombre des anglophones, au sens strict de parlants anglais, a augmenté par l’assimilation à cette langue des immigrants allophones et par le transfert linguistique de personnes d’origine française, certainement dans les autres provinces, mais aussi au Québec.
2. L’histoire des idéologies
Nous entendons par idéologie la conception que se fait un groupe humain à la fois de sa situation et du destin qu’il se trace à lui-même. « Une idéologie est un système global plus ou moins rigoureux de concepts, d’images, de mythes, de représentations qui dans une société donnée affirme une hiérarchie de valeurs et vise à modeler les comportements individuels et collectifs[8]. » En ce sens, l’idéologie sous-tend chaque décision que doit prendre le groupe.
À l’intérieur d’un groupe, les idéologies sont nombreuses. Si l’une d’elles domine nettement les autres, la société connaît une relative stabilité qu’on assimile habituellement à la paix sociale. Si, au contraire, deux ou plusieurs idéologies s’affrontent et se partagent l’adhésion des membres du groupe, la société connaît une relative instabilité qui provoque des crises sociales plus ou moins graves.
On peut ramener à trois les grandes idéologies qui ont inspiré le Québec : l’idéologie de conservation, l’idéologie de rattrapage et l’idéologie de dépassement. Par une sorte de télescopage historique provoqué par l’accélération foudroyante de l’évolution sociologique du Québec, elles s’affrontent aujourd’hui toutes trois, d’où la crise que traverse notre société[9].
2.1 L’idéologie de conservation (1840-1945)
Après 1840, à la suite de l’échec de la Révolution des Patriotes et sous l’influence du Rapport Durham et de l’Acte d’Union, une nouvelle idéologie se définit, largement dominante, l’idéologie de la conservation dont les grands traits sont les suivants :
- a) Le repli du peuple québécois vers l’agriculture (le « retour à la terre ») et vers les professions libérales, abandonnant au conquérant anglais l’initiative du commerce et de l’industrialisation, et par ricochet, celle de l’urbanisation. Lorsque la campagne ne pourra plus absorber l’accroissement de la main-d’œuvre consécutive au taux de natalité élevé des familles québécoises, les gens émigreront dans les villes où ils constitueront peu à peu la classe ouvrière. On assistera alors à une véritable prolétarisation des gens de la campagne, selon le processus suivant : pendant que la population rurale augmente, l’industrialisation du Québec s’amorce, créant des besoins croissants de main-d’œuvre; le surplus de la population rurale, puis la population rurale elle-même gagne la ville pour y constituer la main-d’œuvre ouvrière des usines anglophones et y vivre dans des conditions tout à fait différentes.
- b) L’augmentation de l’influence de l’Église et de la petite bourgeoisie québécoise. Ceci se fera par la collaboration avec le capitalisme anglo-saxon (participation à l’autorité de l’argent), parle contrôle de l’éducation et des médias, par « la subordination de l’État aux intérêts de l’Église[10] ».
- c) La poursuite de la contre-réforme, pour rétablir la discipline catholique et décourager les esprits critiques ou libres penseurs.
- d) La conception d’un nationalisme moins politique que culturel, très préoccupé « de la défense de la religion catholique, de la langue et des institutions canadiennes-françaises[11] ».
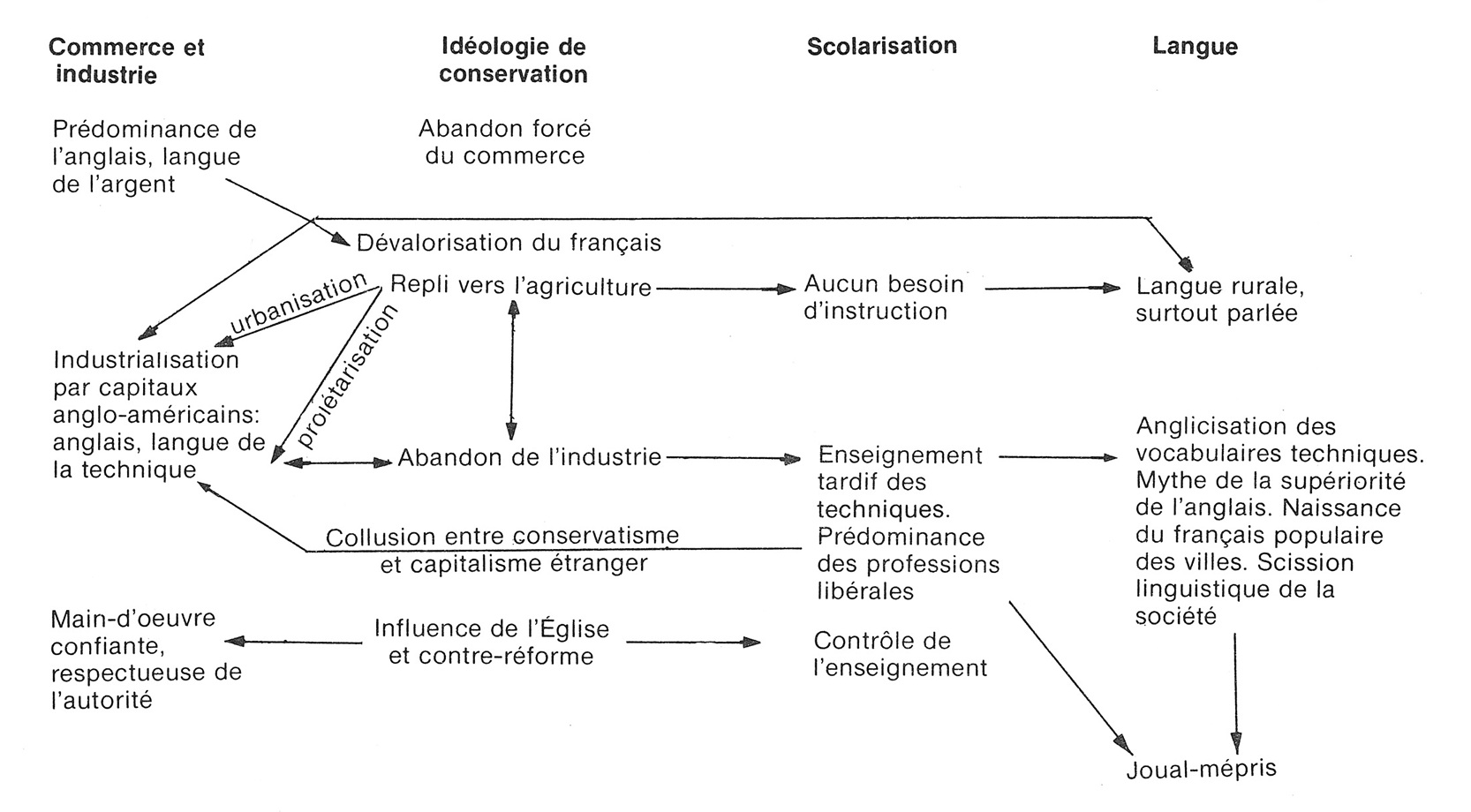
Nous ne sommes pas en mesure aujourd’hui d’analyser avec rigueur l’évolution des idées et des attitudes des Québécois à l’égard de leur langue pendant cette période. La synthèse qui suit est provisoire.
Des textes de l’époque se dégagent nettement deux tendances, l’une et l’autre d’origine bourgeoise : la première, largement répandue, considère la langue comme un héritage sacré qu’il faut conserver et protéger à tout prix; la seconde admet la suprématie de l’anglais et affiche des formes d’anglomanie.
L’affirmation du français comme héritage linguistique au Québec découle du fait que, sous l’influence du commerce et de l’industrie, le français s’est trouvé en concurrence avec l’anglais pour atteindre progressivement le statut de langue dominée. Il est intéressant de constater, à cet égard, dans tous les écrits de l’époque, le voisinage constant de la notion d’héritage linguistique et du constat de l’anglicisation des Québécois. L’élite trouve alors plus facile de pourchasser les anglicismes, de vitupérer contre ceux « qui parlent mal », que de prendre en charge ses responsabilités à l’égard de l’évolution de la langue du peuple, bien qu’elle la perçoive comme étant directement assujettie au « commerce et à l’industrie ». C’est là un indice très net du sentiment d’impuissance qu’elle éprouve déjà face à ces deux facteurs économiques.
On voit ainsi s’esquisser puis s’affirmer une rupture entre la langue des classes instruites et celle des classes populaires, rupture qui s’accompagnera d’un sentiment de mépris des premières à l’égard de la manière de parler des secondes.
L’anglomanie se manifeste chez les Québécois dès le moment de la Conquête. Sous sa forme la plus brutale, elle entraîne l’assimilation plus ou moins poussée et réussie des francophones aux anglophones. Sous sa forme la plus déguisée, elle se manifeste dans le domaine de l’éducation où la connaissance de l’anglais devient le symbole de la supériorité, l’assurance du succès. Ainsi, voit-on des groupes de parents réclamer l’enseignement de l’anglais à l’école primaire, et ce dès 1864, comme en fait foi un article paru dans La Semaine, revue publiée alors par les professeurs laïques de l’École normale Laval[12].
Après 1760, on utilise uniquement l’expression « langue française » pour désigner la langue des « Canadiens ». C’est aux environs de 1875 qu’on se pose pour la première fois la question de l’existence d’une langue « canadienne » d’où on exclut « les anglicismes, les barbarismes, les expressions impropres, les négligences », langue fondée sur « ce bon vieux français parlé dans nos campagnes, enrichi de certains mots nouveaux, français par la forme, que la nécessité a fait inventer[13] ». En 1881, Tardivel note trois courants d’opinion, qu’il discute : nous parlons mieux que les Français; nous parlons un jargon; nous parlons la langue canadienne[14]. Ce débat se poursuit encore aujourd’hui presque dans les mêmes termes.
Enfin, l’idée du « français, héritage à conserver et à protéger » amène la poursuite et la publication de nombreux travaux traitant du français au Canada, surtout en lexicologie. La Société du bon parler français s’est montrée particulièrement active dans ce domaine où elle a joué un rôle d’animation important d’abord par la préparation du Glossaire du parler français au Canada, puis par la publication du Bulletin du parler français au Canada et de la revue Le Canada français, et enfin par la tenue de trois congrès dits « de la langue française au Canada » en 1912, en 1937 et en 1952.
La linguistique comme science s’organise à l’Université Laval et à l’Université de Montréal d’où naîtra une linguistique québécoise de plus en plus rigoureuse.
2.2 L’idéologie de rattrapage (1945-1960)
L’idéologie de rattrapage se caractérise surtout par la critique de l’idéologie de conservation. Le thème en est simple : la société québécoise s’est complu et endormie dans le passé, elle a pris du retard par rapport au reste du monde, il faut reprendre le temps perdu, se mettre à jour.
Ce thème se développe selon les variations suivantes :
- a) Il faut accepter la société industrielle et, par voie de conséquence, l’urbanisation, et cesser de chercher refuge dans les campagnes : l’avenir du Québec est industriel et urbain, et non plus agricole et rural.
- b) Il faut cesser d’idéaliser, mais regarder plutôt le réel en face. Le réel, c’est que les Québécois sont ignorants et absents du monde économique et industriel, sauf comme subalternes ou manœuvres. L’argent n’est pas source de dégradation. Le peuple québécois n’a pas comme vocation d’assurer la permanence des valeurs spirituelles en terre d’Amérique, face au matérialisme des Américains.
- c) Enfin, il faut savoir imiter le Canada anglais et les États-Unis, symboles du dynamisme et de la réussite.
L’idéologie de rattrapage est fédéraliste et assimile le nationalisme —nationalisme incarné par Maurice Duplessis— à l’idéologie de conservation. Elle éprouve cependant beaucoup de mal à définir un nouveau projet collectif pour le Québec, ses protagonistes ne réussissant pas, durant cette période, à formuler et à préciser leurs objectifs.
Sur le strict plan linguistique, l’idéologie de rattrapage n’est qu’un prolongement de l’idéologie de conservation. On observe en fait une recrudescence du purisme qui trouve sa justification dans l’affirmation que le français du Québec doit être aussi fidèle que possible au français de France, c’est-à-dire à une langue idéalisée s’inspirant essentiellement du français des classes instruites et bourgeoises de Paris. Ainsi laisse-t-on croire aux Québécois que tous les Français parlent très bien et tous de la même manière, passant sous silence les nombreuses variations que connaît cette langue sur le territoire d’outre-Atlantique.
Le phénomène le plus important de cette époque est sans aucun doute la cristallisation autour du mot « joual » de l’attitude de mépris manifestée de part et d’autre à l’endroit de la langue populaire québécoise. Dans cet esprit, le terme « joual » symbolise la démission linguistique du peuple québécois; laisser-aller, anglicismes, carence de vocabulaire, syntaxe désarticulée, prononciation avachie, il est tout ce qui n’est pas la langue soignée.
L’analyse du Frère Untel[15], qui met l’accent sur l’inventaire des écarts du français québécois par rapport à une certaine norme du français —et ce, sans la précaution élémentaire de comparer ce qui est comparable, c’est-à-dire le français populaire québécois au français populaire français, ou encore celui des classes instruites du Québec à celui des classes instruites de France—, constitue la synthèse, l’ultime aboutissement de la théorie du français héritage sacré et de son corollaire le « joual ». La conception de la norme que se fait alors la société dans son ensemble est exposée dans une des premières publications de l’Office de la langue française, parue en 1965 et intitulée Norme du français écrit et parié au Québec[16]. Étant donné que l’étiquette « joual » acquerra une autre valeur par la suite, nous désignerons cette attitude par l’expression « joual-mépris ».
Durant cette période, la linguistique recrute de nombreux jeunes adeptes qui seront ainsi formés à l’observation scientifique des faits de langue. Le temps de l’impressionnisme en matière de langue s’achève.
2.3 L’intermède de la Révolution tranquille (1960-1962)
La Révolution tranquille constitue un intermède très court, mais d’une grande importance. Ses effets se font encore sentir aujourd’hui. Pour beaucoup, elle marque un point de non-retour dans révolution de la société québécoise.
Rapidement esquissés, les principaux événements de cette époque sont :
- a) La prise de la parole, début d’une prise de conscience qui ne s’arrêtera pas : les Québécois secouent leur complexe d’infériorité linguistique, conséquence du « joual-mépris », et se mettent à parler, à verbaliser leur situation;
- b) La libération des esprits, surtout par rapport à l’Église (orthodoxie de la pensée, morale janséniste) et à l’État : renouveau de la démocratie, refus du paternalisme à la Duplessis, affirmation d’une volonté de participation, donc de décentralisation, conception de l’État comme moteur du développement collectif, donc revalorisation du rôle de l’État dans la ligne générale de la social-démocratie;
- c) Le renouveau du nationalisme, consécutif à une critique systématique du colonialisme économique anglo-saxon et à la prise de conscience de la valeur intrinsèque de la culture québécoise, qui se définit et s’affirme peu à peu;
- d) La reprise des relations officielles avec la France par l’ouverture de la Maison du Québec à Paris, en 1961, devenue par la suite la Délégation générale, par les premiers accords franco-québécois de coopération (1964, 1965) et par la création de l’Office franco-québécois pour la jeunesse (1968).
La Révolution tranquille a été une période exaltante de déblocage. À cause des ambiguïtés de l’idéologie de dépassement, notamment à l’égard des moyens politiques à prendre pour atteindre les objectifs nouveaux que se fixait alors la société québécoise, elle a semé l’inquiétude, en particulier chez les tenants de l’idéologie de conservation, inquiétude d’abord sourde, puis de plus en plus manifeste, qui devait réussir à la freiner, à l’arrêter presque.
2.4 L’idéologie de dépassement (1962-)
L’idéologie de dépassement se constitue peu à peu aux environs de 1962. L’idée centrale est que le Québec n’a rien à rattraper, mais qu’il doit se projeter lui-même dans l’avenir, en prenant son élan sur lui-même et sur son passé, en définissant lui-même ses objectifs.
Les principaux traits de cette idéologie sont les suivants :
- a) Reprendre le contrôle de l’économie québécoise;
- b) Veiller au destin politique de la société québécoise de façon autonome;
- c) Assurer une certaine qualité à la vie des Québécois dans les domaines économique (revenu minimum décent, conditions de travail non aliénantes, etc.), social (assurance-hospitalisation, allocations familiales, pension de vieillesse, égalité des chances, etc.), culturel (assurer le développement de la culture québécoise et de celle des minorités ethniques : langue, littérature, art, accès à une éducation de qualité, etc.), enfin écologique (lutte contre la pollution, accès à la nature, aménagement des parcs, etc.);
- d) Permettre une plus grande participation des citoyens aux diverses institutions de la société (participation des parents à l’école, décentralisation administrative, comités de citoyens, etc.).
L’incarnation politique de l’idéologie de dépassement se manifeste en deux courants principaux. L’un postule que le cadre fédéraliste permet aux Québécois d’atteindre leurs objectifs; c’est la thèse du Parti libéral. L’autre, au contraire, estime que le peuple québécois ne pourra pleinement s’épanouir qu’en se donnant une tout autre forme de gouvernement faisant appel à un type nouveau d’association avec le reste du Canada, ce qui doit entraîner forcément la négociation d’une nouvelle forme d’association; c’est la thèse du Parti québécois. Ce dernier a poussé le plus loin, et avec le plus de rigueur, la description de la société québécoise de demain.
Sur le plan linguistique, l’idéologie de dépassement marque une rupture très nette avec l’idée du français-héritage.
La critique sociolinguistique de la notion de norme et l’introduction du concept anthropologique de culture dans l’analyse du rapport entre le français du Québec et le français de France amènent la plupart des linguistes et un bon nombre d’intellectuels québécois à prétendre que le français du Québec est une variété de français qui n’est et ne pourra jamais être identique aux autres variétés de cette langue. Ils en arrivent même à contester l’hégémonie des institutions françaises en matière de langue et à définir la « francophonie » comme lieu de rencontre de partenaires à part entière y compris, il va sans dire, sur le plan linguistique. Ainsi s’affirme la volonté des Québécois, fidèles à eux-mêmes, d’orienter l’avenir de la langue québécoise de la manière dont ils le conçoivent et en fonction de leurs propres projets. Les conférences et les débats de la Biennale de la langue française tenue à Québec en 1967 sont très significatifs à cet égard[17].
La réaction au joual-mépris est virulente. Elle prend ses racines dans un désir profond de revalorisation : puisqu’on lui dit qu’il parle le joual, le Québécois en fera non seulement sa langue, mais également l’arme et le symbole de la contestation d’une société aliénée et aliénante. Ce mouvement coïncide avec l’accès des enfants des milieux ouvrier ou petit-bourgeois à l’instruction grâce d’abord à l’accroissement de leurs revenus puis à la démocratisation de l’enseignement. Un courant littéraire important choisira le « joual » comme langue d’écriture : le terme acquérant ainsi une valeur nouvelle, nous le désignerons, en contrepartie du « joual-mépris », par l’expression « joual-fierté ».
Enfin, c’est l’époque de l’analyse et de la description du statut de la langue française au Québec, dont nous traçons les grandes étapes au chapitre suivant.
3. L’histoire de la scolarisation[18]
Un fait brutal se dégage de l’histoire de la scolarisation : jusqu’en 1960, la population québécoise est nettement sous-scolarisée, comme en témoignent les brèves indications historiques qui suivent.
En 1827, sur 87 000 signataires d’une pétition au gouverneur Dalhousie, 78 000 (soit 89,6 %) ne signent que d’une croix[19].
En 1842, le Dr Meilleur, surintendant (sic) de l’Éducation, évalue à 4,4 % le taux de fréquentation scolaire, soit 4 935 enfants sur une population d’âge scolaire de 111 544 enfants, par rapport à une population globale d’environ 700 000 personnes.
En 1855, on estime que les collèges classiques reçoivent 2 350 élèves par rapport à une population masculine d’environ 300 000 personnes. La proportion de la population qui fréquente ces collèges est donc inférieure à 1 %, soit 0,79 %.
En 1871, la population francophone du Québec dispose de 8 établissements d’enseignement supérieur, fréquentés par 751 élèves.
Le taux de persévérance scolaire décroît très rapidement, comme l’indiquent les deux tableaux suivants. Le tableau de gauche, publié par C.J. Magnan dans la revue Enseignement primaire (septembre 1913), couvre l’année scolaire 1910-1911; celui de droite, publié par T. D. Bouchard, dans Le Clairon du 10 mai 1915[20], couvre l’année 1915-1916.
Il est facilement observable qu’en 1910, 82 % de la population scolaire se retrouve dans les trois premières années alors qu’en 1915, le pourcentage de ces mêmes premières années est de 78 %. À l’autre extrémité, moins de 0,5 % de la population scolaire poursuit ses études en 8e année et au-delà.
En 1927, la Commission d’enquête sur la situation des écoles catholiques de Montréal estime à 94 % le nombre des élèves qui quittent l’école en 6e année.
| Inscrits en | 1910-1911 ( % de l’inscription totale) | 1915-1916 ( % de l’inscription totale) |
|---|---|---|
| 1re année | 40 | 38 |
| 2e année | 24 | 24 |
| 3e année | 18 | 16 |
| 4e année | 9,4 | 10 |
| 5e année | 4 | 4 |
| 6e année | 2 | 2 |
| 7e année | 0,8 | 1 |
| 8e année | 0,4 | 0,5 |
Enfin, en 1960, l’opinion des spécialistes attribue à la population adulte de la province de Québec une scolarité moyenne ne dépassant pas la cinquième année de l’école élémentaire. En somme, jusqu’en 1960, la population québécoise apprend à lire, à écrire et à compter et quitte prématurément l’école.
Aux environs de 1945 et sous l’influence de l’idéologie de rattrapage, une vague de scolarisation s’amorce : les jeunes poursuivent de plus en plus nombreux des études secondaires qui leur permettent d’accéder soit à l’université, soit aux écoles techniques supérieures. Les inscriptions augmentent en flèche dans les collèges classiques, à telle enseigne qu’on en arrive à créer des « sections classiques » dans les écoles des commissions scolaires; ces nouvelles sections accueillent le surplus d’étudiants moyennant des frais de scolarité inférieurs à ceux des collèges classiques traditionnels; les effectifs des écoles secondaires croissent aussi.
À la suite de cette vague de scolarisation, les inscriptions au niveau universitaire amorcent une croissance qui demeurera constante jusqu’à nos jours; les écoles techniques connaissent également leur âge d’or. Nous assistons à la réalisation avant l’heure du slogan de Jean Lesage « Qui s’instruit s’enrichit », ce qui d’ailleurs se révélera faux dans plus d’un cas. Un bon nombre de nouveaux diplômés se heurtent en effet au jeu de la cooptation qui favorise les anglophones à qui sont confiés les postes intermédiaires et supérieurs. La Commission Laurendeau-Dunton a reconnu dans ce double phénomène de l’augmentation de la scolarité et du blocage des carrières l’une des raisons profondes de la contestation du statu quo au Québec.
4. La constitution de la classe ouvrière
Comme dans tous les autres pays, la classe ouvrière québécoise se constitue d’abord à partir du surplus de la population rurale, puis par l’apport de cette même population qui émigre vers les villes au fur et à mesure que l’industrialisation du pays s’accentue.
En 1867, au moment de la Confédération, on estime à environ 15 % le pourcentage de la population québécoise qui vit en milieu urbain.
Aux environs de 1900, l’économie québécoise est à très nette prédominance agricole. « Sur une production totale estimée à 150 millions de dollars, la part de l’agriculture totale était de 65 %, celle de la forêt de 25 %, celle de l’industrie de 4 % et celle des mines de 2 %[21] ».
C’est vers cette époque que se produit une transformation radicale du Québec, sous les gouvernements successifs de Laurier (1896-1911). « Au moment où Laurier quitte le gouvernement, en 1911, après quinze ans de pouvoir, le Québec a profondément changé. Rural dans une proportion de 80 % en 1871, il est à moitié urbain quarante ans plus tard. À cause de son développement industriel et commercial, Montréal a attiré beaucoup de ruraux qui y sont venus grossir le contingent des manœuvres et des salariés[22] ».
« En 1920, la part de l’agriculture dans la production totale était de 37 %, celle de la forêt, de 15 %. En 1941, la répartition est la suivante : l’industrie, 64 %, la forêt, 11 %; l’agriculture, 10 %; et les mines, 9 %[23] ».
En résumé, les Québécois ruraux, issus d’un milieu conservateur et traditionnel, qui décident d’aller travailler en usine au service d’un patron anglophone, sont les plus vulnérables, les plus démunis, enfin ceux dont le taux de scolarité est le plus bas. Aux prises avec l’anglais comme seule langue de travail, chacun de son côté tentera de se tirer d’affaire en baragouinant la langue du patron, tout en se convainquant qu’il est né pour un petit pain. Il ne semble pas qu’à cette époque, l’élite québécoise se soit préoccupée de leur sort.
Malgré l’urbanisation rapide du Québec ou peut-être même à cause de ce phénomène, le mythe d’un Québec rural survivra également longtemps dans l’opinion des étrangers, en particulier chez les anglophones du Canada. Ce préjugé s’est manifesté au cours des rencontres régionales de la Commission Laurendeau-Dunton comme en fait foi cet extrait du Rapport préliminaire des Commissaires que nous citons : « Bref, dans presque toutes les provinces à majorité anglophone, nombreux furent ceux de langue anglaise qui voyaient encore le Québec comme une société archaïque et rurale » alors qu’elle n’a jamais été la plus rurale du Canada, que la majorité de sa population vit dans les villes depuis 1921, au point qu’elle est aujourd’hui la plus urbanisée de l’ensemble du Canada[24].
5. L’insertion du Québec dans le continent nord-américain
Le fait de l’insertion du Québec dans le continent nord-américain étant souvent invoqué[25] dans le débat sur la langue française québécoise, il importe d’en souligner brièvement les deux aspects fondamentaux.
Géographiquement, il va sans dire, le Québec fait partie du continent nord-américain. Il y a donc des objets ou des phénomènes particuliers aux domaines de la faune, de la flore, de la climatologie, de la topographie, etc., qu’il a fallu ou qu’il faudra nommer. Nous les avons nommés et nous continuerons à les nommer.
Plus subtilement, par le jeu des succursales américaines installées au Québec, notre industrie et notre économie sont américaines. Nous nous sommes inconsciemment habitués à associer « industrie et capital » à « États-Unis », « technologie et richesse » à « langue anglaise ».
Plus subtilement encore, par contiguïté géographique, nos chercheurs et nos savants ont pris l’habitude de poursuivre leurs études aux États-Unis, d’y assister à des congrès ou à des colloques, ou encore de visiter les laboratoires, les écoles, les hôpitaux américains. Nos références sont devenues américaines.
Conclure de notre situation géographique que nous sommes et que nous devons être dépendants et imitateurs de la technologie, de la science, de l’économie et de la culture des États-Unis procède d’une analyse totalement superficielle.
Conclusion
Des faits qui précèdent découlent trois conséquences linguistiques.
-
a) La rupture entre l’évolution linguistique du Québec et celle de la France.
À partir de la conquête anglaise, la langue française du Québec et celle de la France évoluent chacune de leur côté. La première se heurte au contact quotidien de la langue anglaise. Dans les campagnes, elle se replie sur elle-même dans une attitude de conservation assurée par la tradition orale. C’est alors que s’accentue l’écart entre la langue parlée et la langue écrite, entre la langue des classes ouvrières et la langue de la classe bourgeoise. Au Québec, enfin, la langue française ne participe pas à l’industrialisation du pays, monopole de la langue anglaise.
À la même époque, en France, la langue traverse la Révolution en se donnant les moyens d’exprimer les nouvelles conceptions du pouvoir politique. Elle étend son rayonnement sur le territoire par la scolarisation de la population. Elle sera le moyen d’expression de tous les pouvoirs : pouvoir politique, pouvoir économique, pouvoir militaire, pouvoir religieux. Elle exprimera les réalités nouvelles de la science, de la technologie. Elle connaîtra aussi le déclin de son emploi comme langue internationale.
Cette évolution sans aucun contact a créé des divergences de vues, elle a donné naissance aux préjugés que nous connaissons. Néanmoins, Français et Québécois se comprennent toujours.
C’est là un aspect du problème, à la fois linguistique et psychologique, généralement très mal connu.
-
b) L’anglicisation de secteurs entiers de l’activité humaine.
Il s’agit, entre autres, des secteurs de l’économie, du commerce, de l’industrie, de la politique (surtout fédérale), de la fonction publique fédérale et des forces armées. Les Québécois qui veulent y pénétrer sont forcés d’apprendre l’anglais et de l’utiliser continuellement, sinon exclusivement. De là, le statut de langue inférieure, de langue de seconde zone que connaît la langue française; de là aussi, son rôle de symbole des revendications des Québécois dans tous les domaines, d’outil de transformation d’une situation qu’ils ne veulent pas voir se perpétuer.
-
c) La constitution d’une langue technique, semi-technique et aujourd’hui scientifique, très anglicisée.
Les vocabulaires semi-techniques et techniques se sont implantés en anglais au sein de la population québécoise, non pas parce que la langue française était incapable d’exprimer les différentes réalités qu’ils recouvrent, mais tout simplement parce qu’elle n’était jamais utilisée dans ces mêmes domaines. Il importe de noter qu’il ne s’agit pas, effectivement, de mots isolés, mais de vocabulaires entiers. À l’intérieur de l’usine, le vocabulaire anglais est omniprésent tant sur les plans de la fabrication et sur les cartes de travail des employés que sur les modes d’emploi ou d’entretien des machines-outils ou encore dans les catalogues de pièces et d’accessoires et sur les tableaux de contrôle. La notion d’emprunt ne réussit plus à expliquer ce phénomène.
Grâce à l’enseignement donné dans les collèges classiques et les universités, la langue scientifique a d’abord mieux résisté. Mais, aujourd’hui, du fait que les savants québécois vont poursuivre leurs études postdoctorales aux États-Unis, du fait également des relations scientifiques qui existent entre les États-Unis et le Québec, il nous faut constater que l’anglais est devenu la langue des techniques et des sciences de pointe.
Les faits que nous venons d’évoquer constituent, à notre avis, les origines de la situation linguistique au Québec, situation dont on prendra de mieux en mieux conscience durant la décennie 1960-1970.
Chapitre 2 – Émergence du projet d’aménagement linguistique
Depuis la conquête anglaise, c’est-à-dire depuis l’introduction brusque de l’anglais dans ce pays qui était jusqu’alors la Nouvelle-France et qui deviendra peu à peu, à la manière d’une peau de chagrin, le Québec, la volonté de défendre la langue et la culture françaises a toujours existé chez les francophones, exprimée de diverses manières par les générations successives des porte-parole et des chefs de file de la communauté.
Cependant, à partir de 1960, cette détermination subit une modification majeure : on découvre que l’évolution d’une langue est liée au destin de ceux qui la parlent, que la qualité de la langue est le reflet de la qualité de vie de ses locuteurs et qu’en fait il faut renverser la proposition et affirmer que la qualité de la langue québécoise découlera d’une définition nouvelle et juridiquement fondée de son statut. La question linguistique au Québec cesse alors d’être une question de langue pour devenir une question économique et politique, un élément de la stratégie des Québécois pour échapper à leur condition de peuple dominé et participer de plain-pied à la vie économique et industrielle du pays et du continent.
Ce changement de perspective se produit lentement, au rythme de la prise de conscience du statut réel de la langue française par rapport à la langue anglaise et au fur et à mesure que se définissent et s’affirment les traits de la position qu’on aspire à lui donner, position dont l’importance s’accroît avec la confiance nouvelle des Québécois en eux-mêmes. L’opinion publique amène les partis politiques à introduire un volet « politique linguistique » dans leurs programmes et, de ce fait, les entraîne à légiférer en matière de langue.
Nous nous proposons dans ce chapitre de tenter une description schématique de ce processus. Ce qui nous intéresse, c’est de voir comment la perception de la situation de la langue française au Québec a évolué et comment sont apparus les éléments d’une politique linguistique globale. Dans ce jeu d’opinions, d’influences, de recherches, de témoignages, de prises de position, nous distinguerons pour les besoins de l’exposé quatre sources principales : les mouvements plus ou moins concertés et convergents de l’opinion publique, les travaux de la Commission Laurendeau-Dunton et de la Commission Gendron, enfin ceux de l’Office de la langue française de 1970 à 1974.
1. Les uns et les autres
L’analyse de la situation de la langue française au Québec et au Canada, la recherche des causes de son état, l’inventaire des remèdes possibles, leur proposition et leur discussion, tout ceci a fini par créer un courant d’opinion publique de plus en plus puissant, au début très diversifié mais évoluant rapidement vers des consensus. Il sera nécessaire d’en faire la description pour comprendre pourquoi des partis et des hommes politiques se sont engagés sur un terrain aussi délicat, jusqu’à faire adopter des lois. Nous ne voulons ici qu’essayer de saisir les grands mouvements de l’opinion publique, et rappeler des propos significatifs.
À la charnière des années cinquante et soixante, l’objet des préoccupations se modifie radicalement : la question de la langue au Québec n’est pas un problème strictement linguistique, mais surtout un problème économique et politique; le statut de la langue explique sa qualité.
Par exemple, en 1957, le Congrès de la refrancisation comporte cinq grandes commissions : langue, littérature, arts théoriques, arts pratiques, mœurs et traditions. Ce qui fait écrire à J.-M. Léger : « Il serait utopique d’attendre de ces assises… les grandes lignes d’un programme d’action nationale[26]. » Mais Gérard Filion profite de l’occasion pour écrire, un éditorial dans le ton de l’époque : « Les jeunes d’aujourd’hui n’ont plus le sens de la langue, ne connaissent plus la syntaxe, s’égarent dans les lois de la concordance des temps, ils s’expriment par des exclamations, des vocatifs, des phrases tronquées du verbe principal ou du complément direct[27]. »
Des idées nouvelles se répandent. Des linguistes, surtout de l’Université de Montréal, comme Gilles Lefebvre, rappellent que la langue est un fait social intimement lié aux autres faits sociaux et en tirent comme conséquence qu’on ne peut isoler la langue de l’ensemble du problème national québécois, dont elle est à la fois l’un des éléments et le symbole. À l’occasion de ce qui se passe dans les colonies d’Afrique, alors sur le chemin de l’indépendance, on commence à considérer le Québec comme une colonie du capitalisme anglo-américain et à examiner notre situation sous cet angle : le français apparaît alors comme une langue dominée par l’anglais, une langue sans prestige. Ainsi, en 1958, J.-M. Léger écrit : « Un peuple politiquement dominé, économiquement asservi, en demi-rupture avec les sources profondes de sa culture, en désarroi quant au sens même de son destin, peut-il avoir le souci de la qualité de la langue, être, même confusément, sensible à l’impératif de sa sauvegarde?[28] » Dans le même ordre d’idée, Marcel Chaput, président du R.I.N. (Rassemblement pour l’indépendance nationale), déclare : « Le Québec est la dernière colonie d’importance au monde, où la langue française est une pièce folklorique alors que l’anglais est la langue de communication et de travail[29]. » Fernand Ouellette explore la relation entre la langue, l’économie et la politique : « En fait, ce sont des facteurs extralinguistiques qui déterminent la force ou la faiblesse des langues en lutte et leurs situations respectives (…) Notre langue est une structure sociale qui attend ses solutions d’une façon aussi urgente que la structure économique. Le problème de la langue, au Québec, doit être immédiatement politisé[30]. » Et Hubert Aquin exprime bien la relation entre langue et destin collectif : « On ne fait pas la révolution linguistique du bon parler français avant d’avoir consolidé le statut national des Canadiens français; mais, bien sûr, la revalorisation du français d’une nation francophone qui se décolonise suit de près la révolution nationale[31]. » Enfin, le texte suivant de Maurice Beaulieu, alors directeur de l’Office de la langue française, est révélateur de la nouvelle manière de subordonner la qualité au statut de la langue : « La domination ou l’impérialisme des autres, la résignation, l’ignorance ou la veulerie des nôtres ont provoqué une situation caractérisée par la réduction du français à l’état de langue secondaire dans le Québec même notamment en ce qui a trait à l’économie, aux finances, aux techniques, caractérisée aussi par une détérioration constante du français parlé et un affaiblissement non moins constant de la connaissance du français, caractérisée enfin par le détachement des masses à l’endroit d’une langue qui ne leur est ni un moyen de prestige mi un moyen de progrès économique et de promotion sociale[32]. »
La revendication du « visage français » du Québec s’affirme le plus tôt, s’organise le plus rapidement, s’intègre successivement à tous les programmes et à toutes les politiques linguistiques. D’abord, on réclamera la présence du français, et d’un français de qualité, puis, les droits du français reconnus, on discutera de sa cohabitation avec l’anglais, donc du bilinguisme, surtout dans des domaines comme la signalisation routière, l’affichage, les raisons sociales. On commence à discuter sérieusement des raisons sociales vers 1957[33]. En 1959, J.-M. Léger affirme : « Il serait élémentaire d’interdire l’unilinguisme anglais sur tout ce qui atteint le public, tout ce qui est à l’extérieur : affiches, lumineuses ou non, panneaux, menus, indications diverses, etc[34]. » J.-N. Tremblay, en qualité de ministre des Affaires culturelles, lors de la 2e Biennale de la langue française à Québec, procède à un remarquable inventaire des tâches des pouvoirs publics en matière de langue et y insère ceci : « Inviter, par la persuasion, les sociétés industrielles et commerciales, de même que toutes les entreprises, à adopter des raisons sociales en langue française, à faire chez nous leur publicité en français, à présenter leurs produits sous des étiquettes françaises afin que le gouvernement ne soit plus obligé de procéder en cette matière par ordonnance ou, éventuellement, par voie législative[35]. » On discute de toponymie et de signalisation routière en 1962, de la première à l’occasion de la francisation d’une centaine de noms du Nouveau-Québec par le ministre Bona Arsenault, puis de la réhabilitation de quelques noms anglais à la demande de fonctionnaires fédéraux[36], de la seconde, lors de l’adoption d’une version traduite du système canadien de signalisation routière[37]. Les Québécois réclament souvent, avec ténacité, d’être servis en français dans tous les services publics (par exemple, Air Canada), dans tous les établissements publics : magasins, banques, restaurants, etc., par tous les représentants des ordres professionnels : médecins, notaires, etc., d’avoir à leur disposition des documents et formulaires en français. Les publicitaires mènent campagne contre la publicité traduite, revendiquent une publicité conçue en français et d’inspiration culturelle québécoise, dénoncent la mainmise des unilingues anglophones sur la publicité exprimée en français, qui devient alors un facteur d’anglicisation et d’américanisation[38].
Les termes « bilinguisme » et « unilinguisme » sont les mots-clés de la période 1960-1970. Surtout au début de la période, ce sont pour ainsi dire des étiquettes qui identifient des groupes selon leur conception de l’avenir national. Puis, les concepts commencent à s’affiner, l’un par rapport à l’autre, en contrepoint, mouvement qui se continue encore aujourd’hui et qui fait la différence entre la Loi sur la langue officielle du Parti libéral et la Charte de la langue française du Parti québécois.
Ce qui est le plus net durant cette décade, c’est le rejet du bilinguisme sans que, la plupart du temps, on fasse de nuances. L’inventaire des motifs est systématique dans au moins trois directions. Première direction : le bilinguisme d’une nation est une absurdité et, pour nous, un suicide culturel collectif. « Aucun peuple au monde n’est bilingue, pas même les Belges et les Suisses. Le bilinguisme est un non-sens, un péché contre nature. Il y a des peuples composés de plusieurs groupes unilingues réunis sous un gouvernement commun, comme en Belgique ou en Suisse[39]. » Et puis, que serait « dans les faits un État tout à fait bilingue[40] », se demande André Laurendeau, qui passera le reste de sa vie à chercher la réponse à cette question dans la perspective d’une Confédération renouvelée fondée sur la théorie des deux Nations[41]. Quant au danger qu’on y voit, Gaston Dulong, du Département de linguistique de l’Université Laval, le formule clairement : « Le jour où la masse d’une population devient bilingue, il arrive presque fatalement que cette population bascule du côté du groupe le plus nombreux et le plus fort[42]. » André Belleau fait écho à la même idée : « Le bilinguisme apparaît toujours comme un état confusionnel où deux langues se croisent un moment : celle qui sort et celle qui entre[43]. » Deuxième direction : le bilinguisme, ici, est une contrainte, et uniquement pour les francophones. « Au Canada français, il s’agit non pas de l’étude librement décidée d’une langue étrangère parmi d’autres mais de l’étude obligatoire d’une seule et même »langue seconde« imposée par les circonstances et les données de l’existence quotidienne[44]. » « Le bilinguisme au Québec a favorisé l’unilinguisme de la minorité anglophone. » [45] Troisième direction : le bilinguisme entraîne d’une part la confusion mentale, d’autre part la contamination linguistique par la généralisation de la traduction ou le passage constant d’une langue à l’autre. « Celui qui grandit dans un milieu bilingue fait l’expérience continuelle de la confusion mentale, de la lutte de deux langues à l’assaut de son cerveau : ses structures mentales sont ainsi affaiblies. Il faut d’abord que le cerveau ait des structures saines et solides avant d’affronter un autre univers linguistique[46]. » « Sommes-nous asservis par la traduction?[47] », ce titre d’un article de Pierre Daviault, traducteur et alors vice-président de la Société royale du Canada, résume bien les inquiétudes de beaucoup : « Cessons de penser à l’anglaise, pensons français et nous voudrons un vocabulaire français, une syntaxe française[48]. »
Mais alors, que faut-il faire? Les solutions proposées sont à la fois claires et imprécises. Il y a quelque chose de nominaliste pendant cette période, on se bat sur les mots, rarement en les définissant, en leur donnant un contenu applicable, ce que feront les Commissions et l’Office de la langue française. Au bilinguisme, on oppose naturellement, presque d’une manière manichéenne, l’unilinguisme, terme provocant qui voisine souvent avec l’expression « langue officielle » accompagnée ou non de l’adjectif « unique ». Le texte suivant de Raoul Roy est très significatif du flou terminologique des premières propositions d’unilinguisme : « Il n’y a pas de peuples bilingues qui durent. Dans le contexte nord-américain seul l’état français unilingue au Québec rend possible la vie active de la culture française dans les régions laurentienne et alléghanienne. Pour alléger les conséquences néfastes du colonialisme dans le domaine culturel, les socialistes doivent réclamer le retour graduel au statut de langue officielle unique pour le français dans le Québec[49]. » À la même époque, Raymond Barbeau publiait le projet de constitution laurentienne dont l’article 66 dit : « La langue officielle de la Laurentie est la langue française[50] », tout en faisant des discours favorables à l’unilinguisme[51]. En fait, on présente comme synonymes des termes qui ne le sont pas : que le français soit la langue officielle du Québec n’entraîne pas nécessairement et automatiquement le rejet total de l’anglais et des autres langues des minorités, partout et pour tout. L’hypothèse que l’on pourrait formuler pour interpréter les textes de cette période est que le mot « bilinguisme » désigne le statut de langue dominante de l’anglais au Québec et le terme « unilinguisme », la recherche du même statut pour le français par un renversement de la situation dont il faut inventer les moyens. L’un et l’autre des camps a intérêt à brandir l’étendard de l’unilinguisme, les uns pour galvaniser les troupes du changement, les autres pour apeurer les simples gens, maintenir le statu quo ou s’allier l’électorat anglophone ou allophone. Opteront successivement pour l’unilinguisme ou pour le français, langue officielle, avec des nuances et des contenus différents : l’Alliance laurentienne (1957), le Rassemblement pour l’indépendance nationale (1960), les Sociétés Saint-Jean-Baptiste (1963), les États généraux du Canada français (1967), le Parti québécois (1968), la Confédération des syndicats nationaux (1968), le Mouvement Québec français (1969), le Parti libéral du Québec (1970). Une autre solution qui rejoindra celle du français, langue officielle, à partir de 1974, est de faire du français une langue motivée, surtout la langue du travail et des affaires : « Ou la langue française sera la langue normale de travail, de l’activité économique et sociale, ou elle sera de plus en plus une sorte de sabir à usage purement familial[52]. » Pierre Laporte affirme en 1965 « la nécessité de faire du français la langue prioritaire du Québec », c’est-à-dire « la première langue de pensée, d’expression et de communication dans toutes les activités collectives de la majorité francophone »; mais, en même temps, il propose que « comme langues officielles, l’anglais et le français [soient] sur un même pied du point de vue de l’État[53]. » Jugeant sans doute que le projet n’était pas mûr et trop explosif, Jean Lesage, premier ministre de l’époque, en interdit la publication et la discussion en conseil des ministres. Cependant, en 1969, comme chef de l’opposition, lançant un pressant appel pour que tous fassent un « essai loyal » de la loi 63, il affirme que les libéraux tiennent à la priorité de la langue française et que « tout en acceptant le bilinguisme comme nécessaire dans le contexte nord-américain, la langue française doit être au Québec la langue d’usage et la langue du travail. » Il conclut : « Et si par hasard, ce que je ne crois pas, il arrivait que nous subissions un échec, eh bien, il faudrait bien à ce moment-là revoir toute la situation et aviser[54]. » Ce que fera le Parti libéral de Robert Bourassa en 1974.
À la fin de 1970, un petit groupe de termes, plus ou moins précis, sont donc en usage dans l’opinion publique : bilinguisme, unilinguisme, langue prioritaire, langue d’usage, langue officielle.
Qui est responsable de ce qu’il faut faire pour redresser la situation de la langue française au Québec? Au début des années 60, la réponse la plus fréquente est : l’École. « En définitive, c’est à l’école que la langue sera sauvée ou perdue. C’est donner une terrible responsabilité aux enseignants, mais eux seuls peuvent l’assumer », dira Jean Drapeau, maire de Montréal, aux membres de l’Alliance des professeurs catholiques de Montréal[55]. Ce thème ira decrescendo jusqu’au manifeste de l’Association québécoise des professeurs de français, constituée en février 1967, qui, au nom de ses membres, décline cette responsabilité[56]. On commence à réclamer l’intervention et l’action de l’État vers 1957, alors que Gérard Filion demande un institut de linguistique, ancêtre sans doute de l’Office de la langue française créé en 1961. En 1964, J.-M. Léger fait peser sur l’État et l’École le salut de la langue : « L’action de l’État s’exerce par des mesures législatives et au besoin coercitives; celle de l’École se traduira par une révision complète de l’enseignement du français[57]. » En 1965, Pierre Laporte est très explicite : « L’État québécois est l’incarnation politique de la nation canadienne-française et il est le seul à pouvoir éviter la disparition de la culture française au Canada. L’État a le devoir de défendre la culture nationale[58]. » Idée qu’on retrouve chez Jean-Noël Tremblay et dans les textes et résolutions des États généraux de 1967. Un éditorial d’un numéro spécial de la revue Maintenant conclut : « Tout ceci doit se traduire par des mesures législatives précises : il est urgent de définir une politique véritable de la langue[59]. » Cependant, au nom d’un certain libéralisme, l’idée d’une politique linguistique, surtout dans les domaines de l’économie et de l’industrie, apparaît comme une impossibilité ou rencontre une opposition plus ou moins explicite.
Les concepts de « majorité » et de « minorité » évoluent, ce qui entraîne une redéfinition des objectifs et de la stratégie du Québec à l’égard des « Canadiens français d’outre-frontière », comme on disait sous Lesage. Le Québec commence à se percevoir comme une nation composée d’une majorité française, d’une minorité historique anglaise, d’un certain nombre de minorités ethniques plus ou moins récentes, encore aujourd’hui en voie d’organisation, enfin comportant des groupes d’indiens et d’Inuit dispersés en « bandes » en général peu nombreuses sur l’ensemble du territoire. Cette nouvelle perception provoque des réactions en chaîne. Les Britanniques ont peine à se voir comme une minorité et l’acceptent mal : ils sont en majorité au Canada, donc au Québec aussi, morceau du Canada. Les francophones hors Québec sont amenés à se définir une stratégie propre à eux-mêmes pour ce qui est de leurs relations avec Ottawa et cherchent à évaluer ce que signifiera pour eux, dans leurs provinces respectives, le changement des rapports entre francophones et anglophones au Québec. Le premier choc, pour eux, a certainement été ressenti lors des États généraux de 1967. Les minorités ethniques de leur côté se demandent vers qui aller, quoi faire, maintenant que les règles du jeu changent. Enfin, les minorités autochtones sont tiraillées entre les juridictions fédérales et québécoises, entre l’anglais, le français et leurs propres langues, entre la préservation de leurs cultures et l’envahissement ou l’attrait des cultures du Sud. Les négociations de l’accord de la Baie de James ont cristallisé cette crise. Ces questions sont toujours d’actualité.
Le système scolaire subit une réforme en profondeur, d’abord par la création d’un ministère de l’Éducation (1964), ensuite par une démocratisation qui entraîne la création des écoles secondaires régionales et celle des collèges d’enseignement général et professionnel (les cégeps). L’enseignement du français cherche à se renouveler et à s’adapter à une nouvelle clientèle, sans, semble-t-il, y réussir puisque aujourd’hui on s’en plaint encore. L’âge où débutera l’enseignement dé l’anglais est l’objet d’un débat éternel : en général, les parents veulent qu’il commence tôt, selon le préjugé que l’anglais est la langue du succès, tandis que ceux qui craignent les méfaits du bilinguisme sont d’avis d’attendre le début du secondaire. Le passage d’une époque où la religion déterminait l’école de l’enfant à une autre où c’est la langue, fait se poser la question de la liberté de choix des parents et force chacun à y réfléchir. L’aspect de la question qui devient rapidement le plus débattu, le plus stratégique, est celui de l’évolution démographique de la population de langue française : l’école anglaise attire déjà le plus grand nombre des allophones, que serait-ce si les francophones y envoyaient aussi leurs enfants! De majoritaire, le groupe francophone deviendrait minoritaire, surtout à Montréal. L’opposition à la liberté de choix des parents francophones s’est nettement manifestée lors de l’étude du projet de loi 63. L’opinion publique, surtout chez les anglophones, se préoccupe encore aujourd’hui du libre choix de l’école pour les parents anglophones et pour les minorités d’autres langues. Au fond, le groupe anglophone veut continuer à intégrer à son système scolaire les minorités ethniques et se croit sans cela menacé d’extinction au Québec. Ce débat continue.
Nous terminerons ce tour d’horizon par quelques mots sur l’idée du français, langue de travail. Le premier à en parler semble avoir été Philippe Garigue en 1957, alors qu’il était doyen de la Faculté des sciences sociales de l’Université de Montréal. Ses propos sont nettement avant-gardistes et d’une clairvoyance surprenante. D’une étude qu’il avait menée pour le compte d’une entreprise qui désirait comprendre et résoudre ses difficultés de relations avec son personnel canadien-français, Garigue disait au journaliste : « Mes conclusions dépassent le cas de cette seule entreprise. La vérité, c’est que les firmes étrangères ici auront de plus en plus d’ennuis si elles n’acceptent pas de multiplier le nombre de Canadiens français occupant les postes les plus élevés dans la hiérarchie technique et administrative[60]. » En 1959, Raoul Roy met au programme de son parti « la nécessité de la francisation des sources d’emploi, mesure qui doit être imposée par le gouvernement québécois et exigée par les unions syndicales[61]. » L’idée de faire du français la langue de travail s’imposera de plus en plus à l’attention au fil des années jusqu’aux Commissions Laurendeau-Dunton et Gendron qui en feront, l’une et l’autre, l’un des thèmes principaux de leurs recherches.
2. La Commission Laurendeau-Dunton
La Commission Laurendeau-Dunton se veut une tentative de satisfaire les aspirations des Québécois et de régler le problème de l’usage de la langue française dans la perspective de l’unité canadienne et comme facteur de l’avenir de la Confédération. « La Commission a été formée … pour examiner les griefs formulés de plus en plus vigoureusement par les Canadiens français et en particulier par le Québec. C’est le Canada français qui, par ses porte-parole, se déclare insatisfait de l’état de choses actuel et assure qu’il est victime d’inégalités inacceptables. » (Rapport préliminaire, p. 15). La question linguistique est considérée comme « l’un des éléments essentiels de la crise que traverse le Canada ». (R.p., p. 16).
2.1 Description de la Commission
Elle a été constituée le 19 juillet 1963 par le gouvernement Pearson, sous le titre officiel de Commission royale d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme. La présidence était double : André Laurendeau, à qui succédera Jean-Louis Gagnon, et Davidson Dunton.
Le mandat était de « faire enquête et rapport sur l’état présent du bilinguisme et du biculturalisme au Canada et recommander les mesures à prendre pour que la Confédération canadienne se développe d’après le principe de l’égalité entre les deux peuples qui l’ont fondée, compte tenu de l’apport des autres groupes ethniques à l’enrichissement culturel du Canada, ainsi que les mesures à prendre pour sauvegarder cet apport[62]. »
Le rapport s’échelonne au fil des années en plusieurs tranches : 1965, Rapport préliminaire; 1967, rapport sur les langues officielles; 1968, rapport sur l’Éducation; 1969, rapport sur Le monde du travail; L’apport culturel des autres groupes ethniques; 1970, La capitale fédérale; Les associations volontaires.
La Commission tient une audience publique préliminaire sur l’interprétation de son mandat les 7 et 8 novembre 1963 : elle y reçoit les opinions de 76 associations ou individus. À cette occasion, elle prend conscience du danger d’aborder ouvertement des questions aussi controversées et aussi viscéralement vécues que celles des langues, mais conclut que « le risque de la lucidité est aujourd’hui moins périlleux que le risque du silence ». (R.P., p. 5). Elle se convainc que le succès de ses recommandations tiendra au fait que l’opinion publique sera bien informée du problème. On retrouve ici les préoccupations et les hésitations de bien des hommes d’État face à la nécessité de définir pour leur pays une politique linguistique.
De mars à juin 1964, la Commission organise vingt-trois rencontres régionales à travers tout le Canada. Elles fourniront la matière du Rapport préliminaire, qui présente le grand intérêt de révéler les attitudes, les préjugés, les opinions, les impressions des Canadiens les uns sur les autres sans l’écran d’un appareil de recherches.
De mars à décembre 1965, la Commission tient quatorze audiences publiques, où elle reçoit au-delà de quatre cents mémoires.
Enfin, la Commission se définit un plan de recherches ambitieux et très diversifié. Elle commande cent quarante-cinq rapports et constitue une équipe de recherches de très haute compétence.
2.2 Apports de la Commission
Consciente du fait que la situation des langues au Canada était alors le résultat de l’interaction de très nombreux facteurs, la Commission Laurendeau-Dunton a voulu aborder son mandat sous tous ses aspects : « Les termes de notre mandat paraissent viser toutes les formes de la vie en société : en particulier le secteur public, la vie économique et sociale, l’éducation, la vie culturelle et les techniques de diffusion … en fonction des problèmes que suscite ici la coexistence de deux langues et de deux cultures. » (R.P., p. 13). De cette information, nous avons tenté d’extraire les éléments qui ont provoqué une prise de conscience parfois brutale du statut du français au Québec et qui de ce fait ont renforcé la nécessité de mesures propres à l’améliorer. Les notes qui suivent se rapportent à l’époque de la Commission sans intention de dire ce qui a changé depuis lors. Ce serait là une toute autre entreprise.
-
a) La Commission démontre le peu d’importance des francophones dans l’économie du Canada et du Québec[63].
Il y a nette prédominance des Britanniques et des Juifs (terme utilisé par la Commission) dans les postes ou les secteurs influents et rentables, dans les postes de cadres (Livre III, p. 36). D’après une étude de John Porter, citée par la Commission, le phénomène va en s’accentuant depuis 1930, en ce sens que selon les statistiques, la place des francophones dans l’échelle des occupations va toujours en se dégradant (Livre lll, p. 39). Mais surtout, chose plus significative quant au sujet qui nous intéresse, c’est au Québec et à Montréal que l’écart entre Français et Anglais est le plus grand : 8 points d’écart en faveur des Canadiens anglais dans l’ensemble du Canada, 16 points au Québec et 18 points à Montréal (Livre lll, p. 44). En somme, « les postes de commande sont partout entre les mains des anglophones … et la présence des Canadiens anglais est écrasante, même au cœur de la société francophone (le Québec non métropolitain) (cité par L. Gagnon, p. 373) ». L’anglais est la langue du monde industriel au point qu’à Montréal, 86 % des anglophones qui gagnent plus de $5 000 sont unilingues (Livre lll, p. 514), donc n’ont pas besoin du français pour gagner leur vie.
La place réciproque des anglophones et des francophones dans l’échelle des occupations se confirme par les revenus de l’un et de l’autre groupe. Au Canada, le Canadien français a un revenu moyen de 20 % inférieur à celui du Canadien anglais et de 12 % inférieur au revenu moyen des provinces (Livre lll, p. 19). Au Québec, le Canadien français a un revenu moyen de 35 % inférieur à celui du Canadien anglais; dans l’échelle des revenus selon l’origine ethnique, en 1961 (Livre lll, p. 23), il vient au 12e rang, avant les Italiens et les Indiens. La situation des Britanniques au Québec constitue « une anomalie »; leur revenu au Québec est de 40 % au-dessus de la moyenne québécoise, alors qu’elle est de 10 % au-dessus de la moyenne des autres provinces (Livre lll, p. 17). Au point de vue du revenu, le Québec apparaît en somme comme un endroit privilégié pour les anglophones; on saisit alors l’un des motifs profonds de leur hostilité à l’égard des lois linguistiques québécoises. Notons que l’écart de revenu entre francophones et anglophones au Québec est encore aujourd’hui favorable aux anglophones, même s’il a tendance à se réduire. L’évolution est lente et paradoxale : les francophones ont amélioré globalement leur situation, mais « les inégalités n’ont fait que se déplacer légèrement, leurs tailles n’ont que peu changé … l’égalité n’est pas atteinte », tout le branle-bas des dernières années « n’a servi qu’à ne rien perdre[64]. »
Il n’apparaît pas, d’après la Commission, que le bilinguisme ait une forte influence sur les revenus. Si la connaissance de l’anglais par les Canadiens d’origine française entraîne un très faible avantage financier, c’est surtout dû au fait que les bilingues sont plus instruits et exercent des professions mieux rémunérées (Livre lll, p. 76). Au Québec, « les bilingues, d’origine française ou britannique, gagnent moins que les Britanniques anglophones unilingues » (Livre lll, p. 21), sans doute à cause de la concentration des Britanniques unilingues dans les hauts postes à revenus élevés.
L’anglais apparaît donc comme langue dominante, évidemment en Amérique du Nord, par l’addition des États-Unis au Canada anglais; au Canada dans tous les secteurs, y compris celui de la fonction publique et des services; au Québec même, surtout dans le monde des affaires et de l’industrie, à l’exception d’îlots comme la fonction publique québécoise ou le réseau francophone des services (enseignement, santé, etc.). Les anglophones et les allophones en sont profondément convaincus, d’où la surprise voire l’opposition de la plupart des anglophones à l’idée d’une extension de l’usage du français au Canada ou à l’égard de son emploi comme langue de travail du Québec[65]. Au moment de la Commission Gendron, beaucoup de Québécois du monde des affaires partagent cette conviction et s’opposeront à la généralisation de l’usage du français ou en craindront les effets sur l’économie québécoise ou sur leurs propres revenus. Les francophones du Québec se trouveront donc deux fois divisés, d’abord sur le statut du français, puis dans leur vie quotidienne sur ce qui se fait en anglais et ce qui se fait en français.
Face à une telle situation, il est facile de comprendre le peu d’attrait qu’exerce le français chez les immigrants et les transferts linguistiques chez les francophones. Au Canada, « 1 Canadien sur 6 ne parle plus la langue de ses origines. De ceux qui ont passé d’une langue à l’autre, 93 % sont aujourd’hui de langue anglaise. » (Livre I, p. 23). Seuls les Italiens marquent une nette tendance à s’assimiler aux francophones (tableau 6, Livre I, p. 32), d’où le sentiment de trahison qu’éprouvent les Québécois lors de l’affaire Saint-Léonard, face à l’intention affirmée des Italiens de passer à l’anglais. À Montréal, « métropole industrielle et commerciale, largement livrée à l’influence de la langue anglaise », « la force assimilatrice du français paraît aléatoire, dans l’avenir immédiat » (Livre I, p. 33). Enfin, « plus un groupe d’origine française est éloigné du Québec, plus le taux d’assimilation y est élevé. » (Livre I, p. 34).
-
b) La Commission fait apparaître clairement la difficulté et l’ambiguïté du bilinguisme au Canada.
La Commission distingue soigneusement « le bilinguisme d’une institution, d’une province ou d’un pays » du « bilinguisme des individus » (Livre I, p. XVII et s.) : « Un pays bilingue n’est pas un pays dont tous les habitants doivent nécessairement parler les deux langues; c’est un pays dont les principales institutions, tant publiques que privées, doivent dispenser leurs services dans les deux langues, à des citoyens qui peuvent fort bien, dans l’immense majorité, être des unilingues. » Le bilinguisme intégral étant rare, le bilinguisme des individus signifie en fait une connaissance plus ou moins bonne d’une autre langue, d’où la prudence avec laquelle il faut considérer les statistiques relatives au nombre des « bilingues » publiées par Statistiques Canada. En outre, la notion de bilinguisme au Canada s’entend du français et de l’anglais, alors que bien d’autres langues sont connues des Canadiens, comme langues maternelles ou étrangères. Fait à remarquer, même aujourd’hui, cette distinction n’a pas pénétré profondément l’opinion publique et, qui plus est, l’existence de zones unilingues ne paraît pas acceptable ou même souhaitable : l’unilinguisme est encore un sacrilège.
En raison du statut de l’anglais, il apparaît clairement que pour les anglophones, le bilinguisme constitue un choix, alors que pour les francophones, il devient une contrainte, étant donné que les anglophones, même au Québec, ne sont pas obligés de connaître le français et que les francophones doivent savoir l’anglais au point même, dans certains cas, d’en faire leur langue principale de travail. Cet état de fait est déjà contesté au Québec où, d’une part, la connaissance de l’anglais est perçue comme une exigence d’emploi supplémentaire sans contrepartie chez l’anglophone, et où, d’autre part, l’anglais est considéré comme « une barrière culturelle » qui, une fois franchie, entraîne chez les francophones « des conséquences psychologiques négatives » qui gravitent autour du sentiment d’aliénation ou de trahison (Livre lll, p. 535).
Le Québec est souvent cité comme exemple d’une société « officiellement bilingue », qui traite avec justice et beaucoup d’égards la minorité anglophone. Pour la Commission, c’est le modèle qu’il faut suivre, de là le principe de « la reconnaissance par la loi et dans la pratique des deux langues officielles, même là où l’une des deux est parlée par une minorité dès que, numériquement, celle-ci paraît viable. » (Livre I, p. 89). En conséquence, la Commission recommande la déclaration du français et de l’anglais comme langues officielles du Canada (Livre I, p. 94). Au Nouveau-Brunswick et à l’Ontario, elle propose de déclarer d’elles-mêmes le français et l’anglais langues officielles (Livre I, p. 99) et d’en appliquer les conséquences, aux autres provinces, de faire de même dès que la minorité officielle atteindra ou dépassera dix pour cent (Livre I, p. 102). Enfin, pour les services publics provinciaux du type commissions scolaires ou municipalités, elle suggère la création de « districts bilingues » où le français et l’anglais seront utilisés dès que la minorité sera de dix pour cent (Livre I, p. 114). La Loi sur la langue officielle du Québec fera écho à cette recommandation (art. 9).
-
c) Enfin, la Commission attire l’attention sur « le jeu des nombres » auquel donnent lieu les notions de démocratie, de majorité ou de minorité.
Les principaux axes de ce jeu sont : le calcul selon le nombre de provinces (le Québec vaut un sur dix ou sur onze, si on compte Ottawa); le calcul pour l’ensemble du Canada ou pour chaque province (les proportions changent; les francophones sont une majorité au Québec, mais une minorité au Canada; l’inverse est vrai des anglophones, minorité au Québec, majorité partout ailleurs); le calcul selon l’origine ethnique ou la langue (distinction entre le nombre de Britanniques, les véritables Anglais, et le nombre d’anglophones, les Britanniques avec en plus les assimilés à l’anglais, c’est-à-dire les immigrants d’autres origines et les transfuges linguistiques); l’évolution des proportions dans le temps (minorité qui s’affaiblit, majorité en danger, diminution de la proportion des Britanniques, etc.). Ce qui rend la démographie florissante.
2.3 Principaux effets de la Commission
La conséquence la plus évidente de la Commission est le vote par les Communes d’Ottawa, en 1969, de la Loi sur les langues officielles du Canada, proposée par le gouvernement libéral de Pierre Trudeau. L’article 2 stipule que « l’anglais et le français sont les langues officielles du Canada pour tout ce qui relève du Parlement et du gouvernement du Canada. » Dix ans plus tard, on constate que cette loi n’a pas beaucoup changé les choses. Pourquoi? D’abord et fondamentalement, parce qu’aucun organisme central n’est responsable de son application (voir chapitre 5, 1.2.b) : la volonté politique de l’appliquer varie d’un ministère à l’autre, d’un service à l’autre, en fait elle se dissout en se fractionnant. Quand le commissaire Max Yalden note qu’une loi ne peut à elle seule transformer les mentalités et tenir lieu de réforme linguistique, il fait une remarque qui ne s’applique qu’à cette loi en particulier : il vaudrait mieux dire que la loi n’a donné aucun pouvoir à personne pour la faire appliquer, pas même au commissaire. Ensuite, parce que soudain, certains anglophones se sont trouvés en situation de « bilinguisme forcé », soit pour obtenir ou conserver un poste déclaré bilingue, soit parce qu’ils se retrouvaient dans un environnement francophone, devant la fameuse « barrière culturelle » : beaucoup ont mal réagi, n’ont pas accepté la chose, n’ont pas réussi à apprendre le français malgré l’énorme effort des cours de langue, l’exemple le plus spectaculaire étant le chantage des pilotes et contrôleurs aériens anglophones contre l’usage du français sous prétexte que ce n’était pas sécuritaire, qui a fait plier le ministre Otto Lang. Enfin, parce que le gouvernement Trudeau a maintenu l’ambiguïté du Canada bilingue, alors qu’en réalité, il s’agissait d’une fonction publique bilingue, et encore pour certains services en certains endroits, et uniquement de cela. À vouloir projeter l’image d’un Canada bilingue « from coast to coast », malgré l’évidence de la portée restreinte de la loi, ce gouvernement n’a réussi qu’à alarmer tout le monde, les Québécois pour qui le bilinguisme généralisé apparaît comme la phase ultime de l’assimilation collective à la manière de Durham, les anglophones, surtout de l’Ouest, parce qu’ils tiennent à rester unilingues et à devenir bilingues s’ils le veulent bien, les minorités francophones hors Québec parce que tous ces heureux discours n’auront été que du vent, n’auront en définitive entraîné aucune amélioration de leur sort, parce qu’ils sont traités ou comme des mineurs en tutelle ou comme des otages.
Une autre conséquence importante de la Commission aura été de provoquer une délimitation très claire des champs de compétence juridique. Ainsi, il apparaît nettement que le gouvernement central n’a de pouvoir que sur les organismes qui relèvent de lui, que les provinces seules ont pouvoir de légiférer sur la ou les langues d’enseignement, de travail, d’affichage, d’administration gouvernementale ou municipale. D’où l’échec des recommandations de la Commission en ces domaines, notamment en ce qui concerne l’établissement des districts bilingues, malgré les efforts d’Ottawa pour les créer.
Paradoxalement, on peut dire que la Commission a eu comme effet de rendre évidente aux Québécois la nécessité de changer chez eux les règles du jeu en ce qui touche à l’usage du français et de l’anglais, surtout dans le monde du travail; de faire surgir l’idée de fixer par une loi les conditions d’emploi de l’une et de l’autre dans le but d’assurer un meilleur statut à la langue française dans tous les domaines et des conditions plus favorables à son développement, à son épanouissement, enfin à sa diffusion.
3. La Commission Gendron
La Commission Gendron se préoccupera essentiellement d’identifier et d’analyser les facteurs qui déterminent l’importance relative d’une langue dans une situation de multilinguisme, en l’occurrence la société québécoise. L’approche sera globale en ce qu’elle visera tous les aspects de la question (statuts des langues, aspirations des groupes ethniques et linguistiques, compétence juridique du Québec en la matière) dans tous les domaines d’utilisation de la langue (langue de travail des secteurs public, parapublic et privé, langue des activités de consommation de produits ou de services, langue de l’information : presse, radio, télévision, livres, films, publicité). En cela, elle est une entreprise originale, unique en son genre encore aujourd’hui.
3.1 Description de la Commission
Elle a été constituée le 9 décembre 1968 par le gouvernement du Québec, alors que l’Union nationale, dirigée par Daniel Johnson, était au pouvoir, sous le titre officiel de Commission d’enquête sur la situation de la langue française et sur les droits linguistiques au Québec. Le président en fut Jean-Denis Gendron, professeur de phonétique, vice-doyen de la Faculté des lettres de l’Université Laval.
Le mandat était de « faire enquête et rapport sur la situation du français comme langue d’usage au Québec, et pour recommander les mesures propres à assurer : a) les droits linguistiques de la majorité aussi bien que la protection des droits de la minorité; b) le plein épanouissement et la diffusion de la langue française au Québec dans tous les secteurs d’activité, à la fois sur les plans éducatif, culturel, social et économique[66]. » Il fut précisé en septembre 1970, après l’accession au pouvoir du Parti libéral dirigé par Robert Bourassa, qui demanda à la Commission de « s’attaquer d’abord et en priorité aux questions du français, langue de travail, de l’intégration des nouveaux Québécois à la communauté francophone du Québec, et des droits linguistiques de nos concitoyens[67]. »
Le rapport fut remis le 31 décembre 1972, quatre ans après la formation de la Commission. Il comporte trois tomes : 1, La langue de travail; 2, Les droits linguistiques; 3, Les groupes ethniques. Le rapport, tout comme celui de la Commission Laurendeau-Dunton, particulièrement le Livre lll sur le monde du travail, est d’esprit et de ton conservateurs. L’ensemble des recommandations reflète surtout les compromis auxquels sont arrivés les membres de la Commission[68] quelque part entre leurs convictions et préjugés personnels et les faits dont ils avaient pris connaissance.
On peut décrire l’activité de la Commission sous quatre aspects : animation, recherches, documentation, préparation et présentation du rapport.
Animation. La Commission s’étant proposée au début de son existence six visites régionales, la première, en Abitibi, a lieu en août 1969, puis le projet se modifie en visites industrielles : de février à juin 1971, elle visite cinq entreprises. La Commission tient des audiences publiques, huit au total, de septembre 1969 à mai 1970 : elle prend ainsi connaissance de quelque deux cent dix mémoires « provenant en majeure partie d’associations, de groupements ou d’entreprises industrielles, commerciales et financières[69] ». C’est probablement en ces audiences qu’a consisté l’apport principal de la Commission, en ce que la préparation, la présentation, la diffusion de ces mémoires ont permis à beaucoup, et parmi les plus influents, de préciser et d’exposer avec soin et nuance leur manière de voir la situation et leurs opinions sur les transformations à y apporter, à tous les citoyens de voir s’exprimer une grande variété de points de vues et d’arguments. D’autant plus que cette information s’ajoutait à celle fournie par les audiences de la Commission Laurendeau-Dunton et par les tranches du rapport déjà publiées, le Rapport préliminaire en 1965, le Livre I sur Les langues officielles en 1967, le Livre II sur l’Éducation en 1968 et surtout, au moment même des audiences Gendron, le Livre lll sur Le monde du travail en 1969. Mais la Commission jouissait des avantages de l’unité de lieu, le Québec, évitant ainsi le mouvement du pendule « au Canada —au Québec » de la Commission fédérale. On voit, durant cette période, des conclusions s’imposer, des opinions se cristalliser, s’amorcer des consensus dans l’ensemble de la population ou dans des secteurs particuliers de celle-ci. En somme, l’opinion publique arrive ainsi au point de saturation de l’information : elle s’estime suffisamment éclairée!
Recherches. À l’instar de la fédérale, la Commission Gendron s’est donné un plan de recherches : elle a ainsi commandé et reçu de mai à décembre 1971 trente rapports de recherches, traités en neuf rapports de synthèse d’août 1971 à juin 1972[70]. Les rapports de synthèse ont tous été publiés par la suite, de même que les principales études. Ces documents ont été et seront encore fort utiles d’abord parce qu’ils ont fourni des données aux membres de la Commission, puis à ceux qui ont été mêlés de près à la préparation de la Loi sur la langue officielle et de la Charte de la langue française, ensuite parce qu’ils ont favorisé l’éclosion de connaissances et de compétences dans des champs très originaux, enfin parce que nous avons ainsi une description détaillée de la situation à une date précise, qui sera le moment par rapport auquel on pourra mesurer les gains et les pertes depuis l’adoption d’une politique linguistique.
Documentation. « Le travail des services de la recherche documentaire a consisté à découvrir, recueillir, colliger et classer toute la documentation relative à la situation de la langue française au Québec en général[71]. » Résultat : 1 900 titres, 120 cahiers représentant 15 000 pages dactylographiées. Tout ceci a été par la suite déposé au CIRES (Centre international de recherche sur le bilinguisme) de l’Université Laval, avec tous les autres documents de la Commission.
3.2 Apports de la Commission
Ici comme pour la Commission Laurendeau-Dunton, nous avons l’intention d’indiquer les apports les plus importants de la Commission Gendron à l’aménagement linguistique du Québec.
-
a) En ce qui concerne la situation du français dans les activités de travail, le rapport expose clairement l’écart entre l’impression du réel et le réel lui-même, c’est-à-dire entre la langue dans laquelle on dit travailler et celle dans laquelle on le fait vraiment. Dans la terminologie de la Commission, cela revient à la distinction entre les communications générales (de toute nature sur tous les sujets) et spécifiques (celles qui ont trait au travail lui-même).
Dans les communications générales, les francophones ont l’impression de travailler en français (I, p. 30), les anglophones de travailler en anglais (I, p. 56), les allophones de le faire en anglais (I, p. 63). Donc tous ont l’impression de travailler dans leur propre langue, sauf les membres du tiers groupe linguistique. Les impressions des francophones sont donc douteuses quant à leur bien-fondé.
Dans les communications spécifiques, nette prédominance de l’anglais chez les francophones et, en conséquence, extension du bilinguisme (I, 52); cette prédominance va de soi chez les anglophones et les allophones (I, 59), d’où peu de raisons d’apprendre ou d’utiliser le français (I, 60). En somme, il y a prédominance de l’anglais sur le marché du travail québécois dans les communications administratives et techniques des travailleurs (I, 85) de même que dans les exigences linguistiques des fonctions (I, 97). En conclusion : « Le français n’apparaît utile qu’aux francophones. Au Québec même, c’est somme toute une langue marginale, puisque les non-francophones en ont fort peu besoin (84 % d’anglophones en situation d’unilinguisme, 60 % d’allophones en situation d’unilinguisme anglais ou autre, à l’exclusion du français) (I, 139) et que bon nombre de francophones, dans les tâches importantes, utilisent autant, et parfois plus, l’anglais que leur langue maternelle. » (I, 110)
Ceci aura comme conséquence d’exclure de la notion de français, langue de travail, les communications non spécifiques : il importe peu de savoir en quelle langue un travailleur demande une cigarette à son voisin! Les communications générales n’ont pas d’influence sur le statut de la langue (voir chapitre 3, 3).
La Commission donne son avis sur « les obstacles au plein épanouissement et à la diffusion du français dans tous les secteurs d’activité. » (I, chap. 2). À son avis, ces obstacles sont : l’intégration de l’économie québécoise à l’économie canadienne et nord-américaine (I, 17), leitmotiv du monde des affaires au Québec, que la Commission avoue n’avoir pas étudiée d’une manière précise et dont nous pensons qu’on a nettement exagéré l’importance ou l’influence en ce qui a trait à l’usage des langues; l’organisation sociale, c’est-à-dire le « double réseau d’institutions et de services qui permettent à toute personne se trouvant en dehors des circuits de travail (et encore, la chose est possible pour le personnel du circuit) de vivre sa vie tout en n’ayant à apprendre ou à utiliser soit que le français, soit que l’anglais » (I, 139); l’absence de législation spécifique, dont découle une sorte de laisser-aller caractéristique de la libre entreprise, « une atmosphère de liberté juridique presque totale » (I, 131); la ségrégation et la stratification socio-économique dans le monde du travail (I, 114) : spécialisation des tâches sur une base ethnolinguistique (I, 117), sur représentation des anglophones aux paliers supérieurs des fonctions administratives et techniques (I, 122), ce qui confirme les données de la Commission Laurendeau-Dunton (Livre lll, b, p. 1022), le tout entraînant une stratification des revenus, les francophones se concentrant dans les revenus les plus bas et les anglophones dans les plus hauts (I, 123); l’ambiguïté des attitudes et des objectifs des Québécois, tant francophones qu’anglophones, à l’égard de l’usage généralisé du français au travail (I, 141); les francophones souhaitent que la situation change, mais ils sont perplexes quant à l’usage du français dans l’industrie et l’économie, surtout les hommes d’affaires[72], les anglophones reconnaissent le droit des francophones de travailler en français, mais sans pour ainsi dire que la chose ait des conséquences pour eux-mêmes.
-
b) La Commission affirme la compétence du Québec à légiférer en matière d’usage des langues, compte tenu d’un certain flou juridique lié à l’interprétation des articles 93 et 133 de l’A.A.N.B. (II, 18 et 19). Elle conclut également à « l’absence de doctrine constitutionnelle fédérale ou québécoise touchant les »droits acquis« , les »droits collectifs« ou les »droits des groupes« (II, 18) » qui limiterait le pouvoir que détient l’Assemblée nationale du Québec. Le texte est net : « Les droits acquis et les notions connexes sont du domaine de la spéculation politique. Ils ne reposent sur aucun fondement juridique. » (II, 19).
-
c) La Commission établit une distinction entre francisation et francophonisation à partir de ses observations sur la concentration des anglophones dans certaines fonctions clés et ses conséquences sur la généralisation de l’usage du français. L’approche est quantitative. L’objectif proposé est « d’augmenter graduellement, à compétence égale, la présence des francophones aux échelons moyens et supérieurs de la hiérarchie administrative jusqu’à un taux moyen qui dans la majorité des établissements se rapproche sensiblement de celui qu’on trouve dans la main-d’œuvre québécoise, selon les deux réglons distinguées dans ce rapport » (I, 166). La Loi sur la langue officielle fera écho à cette recommandation en incluant « la présence francophone dans l’administration » (art. 29 b) comme élément du programme de francisation, d’où l’annonce d’une guérilla juridico-administrative : qu’est-ce qu’un francophone (eh oui!); le Québec n’a pas ou ne fournit pas assez de personnel compétent, ou la compétence des francophones n’est pas celle dont a besoin l’entreprise; quelle proportion de francophones faut-il pour respecter l’esprit ou le texte de la loi. Lors de la préparation de la Charte de la langue française, on renversera la proposition en concevant l’augmentation de la présence francophone comme une conséquence de la généralisation de l’usage du français et comme un moyen économique d’y arriver, dans la perspective de la théorie de la technostructure de Galbraith[73], d’où le paragraphe b de l’article 141, qui traite de « l’augmentation du nombre de personnes ayant une bonne connaissance de la langue française de manière à en assurer l’utilisation généralisée ». La chose est à suivre.
3.3 Accueil réservé au rapport
Malgré la réelle valeur des travaux de la Commission et l’intérêt certain du rapport, l’accueil que le public lui a réservé a été ou hostile ou indifférent : en peu de temps, personne n’en a plus parlé. Qu’est-ce qui explique cette réaction?
Au moment où le rapport paraît enfin (trois reports : au 9 décembre 1970, au 31 mars 1972, enfin au 31 décembre 1972), la description des faits n’intéresse plus personne : la situation est dévoilée ou bien par les rapports de la Commission Laurendeau-Dunton, ou bien par les audiences de la Commission Gendron, par les mémoires qui y ont été présentés, ou enfin par les travaux commandités par elles, dont les résultats sont connus par un plus ou moins grand nombre de personnes, malgré les efforts de la Commission pour leur conserver une certaine valeur d’inédit.
Les opinions sont faites et le débat est passé de la description de la situation aux moyens à prendre pour la corriger, dans la foulée de la crise qu’a suscitée l’adoption de la Loi pour promouvoir la langue française au Québec (novembre 1969) et de l’échec évident de ses articles sur la langue de travail (chapitre 2, 4.1).
D’où une lecture « politique » du rapport, la mise en relief et la discussion de son orientation idéologique; en fait, l’attention se concentre sur les recommandations qui déçoivent beaucoup.
On recommande de déclarer le français langue officielle du Québec, mais du même souffle de donner à l’anglais le statut de langue nationale (r. 2). D’où, en conséquence, l’ombre du bilinguisme officieux et institutionnel qui plane sur toutes les recommandations et sur le Québec qui s’y dessine.
Les recommandations révèlent une approche timorée de la nécessité de faire prédominer l’usage du français sur celui de l’anglais, cachée derrière un écran de chiffres et de proportions, légitimée par le respect de la minorité, dont d’autres pensaient qu’il s’agissait plutôt de crainte de la minorité. La Loi sur la langue officielle s’engagera dans la même voie, en ne contentant personne. Comme le dit la chanson : « Tu veux ou tu veux pas, mais me laisse pas dans l’embarras! »
Enfin, les recommandations relatives à la langue de travail sont du type incitatif, malgré l’échec évident et notoire de cette démarche, et ne révèlent pas une stratégie opérationnelle. Le modèle auquel était arrivé l’Office était nettement plus réaliste et plus applicable (chapitre 2, 4.1).
En conclusion, le rapport arrive trop tard et ses recommandations ne rejoignent pas les aspirations de la population québécoise, ni francophone, ni anglophone.
4. Les travaux de l’Office de la langue française de 1970 à 1974
Trois événements font que cette période est particulière. Tout d’abord, la Loi pour promouvoir la langue française au Québec (dite loi 63) a confié à l’Office la tâche nouvelle de favoriser l’utilisation du français comme langue des affaires et du travail en concertation avec les entreprises. Malgré le caractère strictement incitatif de la loi, cette disposition donne à l’Office l’autorité voulue pour engager le processus de francisation de l’économie et de l’industrie. Ensuite, le Parti libéral de Robert Bourassa ayant pris le pouvoir en 1970, le Dr François Cloutier devient ministre des Affaires culturelles responsable de l’Office : il s’intéresse vivement et de très près aux affaires linguistiques, particulièrement au français, langue de travail, et augmente les ressources humaines et financières de l’Office pour lui permettre une plus grande activité, un plus grand rayonnement. Le premier, il se convainc de la nécessité d’une politique globale de la langue et en établit la première version qu’il fait voter sous le titre Loi sur la langue officielle (dite loi 22). Enfin, monsieur Gaston Cholette prend la direction de l’Office avec rang de sous-ministre, ce qui est l’indice de l’importance nouvelle de l’organisme. Il constitue autour de lui et anime une équipe d’un nouvel esprit en même temps qu’il établit les premiers contacts avec les dirigeants des entreprises installées au Québec pour les inviter à utiliser surtout le français dans leurs activités.
Au-delà de l’objectif global de promotion du français, l’équipe Cholette poursuit un double objectif : déterminer les limites possibles de l’utilisation du français entre les deux limites extrêmes d’un unilinguisme français irréaliste et d’un bilinguisme généralisé, et définir pour l’ensemble de la politique linguistique et pour chacun de ses constituants une méthodologie d’intervention efficace et contrôlable. L’équipe entreprend alors un ensemble très différencié de travaux plus ou moins expérimentaux, dont le point ultime d’achèvement est la Charte de la langue française. Nous tenterons de donner un aperçu de ces travaux, en relation avec les préoccupations et revendications principales des Québécois : en somme, le rôle de l’Office aura été de concrétiser les objectifs de la société québécoise en matière de langue.
4.1 Le français, langue du travail et des affaires
En 1971, l’Office constitue un groupe de travail composé de représentants de l’entreprise privée ou des syndicats et de fonctionnaires, soit de l’Office, soit des ministères à vocation économique, chargé de réfléchir à la stratégie la plus adéquate pour généraliser l’usage du français dans l’industrie[74]. Dès le départ, le groupe s’inspire de la théorie du changement social ou technologique planifié et conçoit le passage de l’usage généralisé de l’anglais à celui du français comme on concevrait un changement de procédé de fabrication dans une usine, sans arrêt ni ralentissement de la production mais avec tous les phénomènes sociopsychologiques liés au changement, notamment la résistance sous toutes ses formes. D’autre part, en s’inspirant du circuit de la parole entre l’émetteur et le récepteur, on pose en principe l’existence au sein des entreprises d’un double réseau de communication, interne et externe, et la nécessité de connaître comment il fonctionne pour mieux le contrôler. En conséquence de quoi le groupe conclut à la nécessité de mettre au point une procédure d’implantation en trois phases : description de la situation de départ, description de la situation souhaitée, définition des mesures à prendre pour passer de l’une à l’autre et établissement d’un échéancier de réalisation. Tout est à créer pour ainsi dire, sans modèle d’inspiration. Les fonctionnaires de l’Office prendront la relève du groupe, après la première phase d’exploration.
À l’invitation de l’Office, plusieurs entreprises, engagées dans différents domaines d’activité, acceptent de se prêter à une expérience d’implantation du français. Une grille d’analyse de la situation linguistique est élaborée, appliquée, modifiée au rythme des essais. Le concept de français, langue de travail, se précise peu à peu, ce qui cerne mieux du même coup la définition des objectifs à atteindre, c’est-à-dire les objectifs pragmatiques de la francisation des entreprises. L’observation du réseau des communications fait apparaître plus clairement les zones d’utilisation du français et de l’anglais, de même que les points d’insertion des passerelles, linguistiques, en communication soit interne, soit externe (chapitre 3, 1) et l’importance du siège social en cette matière. Les besoins de l’entreprise en terminologie et en traduction sont définis et évalués, compte tenu des différentes terminologies utilisées par chaque entreprise (technique, administrative, comptable, etc.), compte tenu également des types de documents et du traitement linguistique qu’on doit leur faire subir (traduction, adaptation, rédaction nouvelle en français, utilisation de l’original anglais dans le cas de certains documents à circulation restreinte).
En même temps, l’Office suit de près le démarrage en français de la raffinerie de l’Aigle d’Or à Saint-Romuald qui sert de prototype[75], observe et soutient des essais de généralisation du français que des entreprises mettent sur pied de leur propre chef comme Alcan à Arvida, Générale électrique à Québec, les mines Cartier à Fermont. Hydro-Québec sert aussi de source d’inspiration, d’exemple de ce qui est possible. Tous ces travaux, toutes ces réflexions aboutiront à la préparation et à la publication, en 1974, d’un guide général d’implantation, sous le titre Le français dans l’entreprise. Ce sera la base des dispositions de la Loi sur la langue officielle et de la Charte de la langue française en matière de francisation des entreprises.
Enfin, l’Office constate l’échec de la politique d’incitation : d’une part peu d’entreprises s’engagent dans le processus de francisation, à l’invitation de l’Office, d’autre part celles qui le font ne dépassent pas l’étape de l’analyse de la situation linguistique, ne s’engageant jamais dans un programme d’implantation du français. D’un autre point de vue, l’Office avait constaté l’interrelation des entreprises dans une stratégie globale de francisation et l’effet d’entraînement des plus grandes sur les moyennes et petites entreprises. L’idée avait surgi d’elle-même d’une opération globale de francisation touchant toutes les entreprises de plus de cinq cents employés. L’opération ne sera jamais lancée, mais la Loi sur la langue officielle reprendra à son compte l’idée d’un étalement des programmes de francisation en trois étapes, en commençant par les entreprises de plus de cinq cents employés.
Notons enfin qu’à l’occasion de tous ces travaux, il est vite apparu que deux modèles d’organisation linguistique s’affrontaient, le premier de type européen favorisant un bi- ou un multilinguisme souple, l’autre de type américain tendant à la forme la plus complète d’unilinguisme anglais. Les Québécois spontanément réfléchissaient à partir du premier modèle, les hommes d’affaires et les chefs d’entreprise à partir du second, l’anglais leur apparaissant, de toute évidence, la langue des affaires et de la technique.
4.2 Le « visage français » du Québec
Les Québécois ont toujours été très sensibles à l’utilisation du français dans l’étiquetage, la publicité, les services publics. Pour l’Office, il s’agissait de comprendre comment les choses se passaient dans chacun de ces domaines et de déterminer l’usage du français qu’on pouvait y réclamer, en tenant compte des multiples contraintes, surtout économiques et juridiques.
En matière d’étiquetage, les premiers règlements et les premiers travaux terminologiques[76] qui en ont découlé concernaient les aliments. Le précédent d’intervention était créé, il ne s’agissait plus que de définir les principes d’une politique. L’Office est ainsi arrivé à la conclusion que celle-ci devait tenir compte de trois données : la protection des consommateurs aussi bien francophones qu’anglophones, la circulation des produits par importation ou exportation et les avantages de l’assurer dans le même emballage, l’existence de conventions internationales comme le Codex alimentaire qui recommande l’étiquetage des produits dans la langue du consommateur et non celle du producteur, ou la Communauté économique européenne qui favorise l’étiquetage dans toutes les langues de la communauté. En somme, cela revenait à proposer d’exiger partout la présence du français, en n’excluant l’usage d’aucune autre langue. Par ailleurs, l’Office arriva à la conclusion qu’il fallait étendre la même politique à tous les produits, y compris les produits industriels, et à tous les documents accompagnant les produits (garantie, mode d’emploi) ou relatifs aux produits (catalogues, dépliants, brochures, etc.). Les catalogues surtout sont importants du fait qu’ils sont des manuels de référence d’usage courant pour la recherche ou l’identification d’un produit au moment de la commande, de l’achat ou de la facturation.
Dans l’affichage public[77], concept beaucoup trop vaste au départ, on a distingué les raisons sociales et les marques de commerce qui leur sont apparentées, le contexte de la raison sociale[78], la publicité, les multiples affiches de toute nature qui sont installées dans les lieux publics et la toponymie. On ne dispose pas de la même liberté linguistique dans chaque cas.
Les raisons sociales et les marques de commerce sont ni plus ni moins que des noms propres, soumis à des lois nationales et internationales très précises et très coercitives. La langue d’une raison sociale est déterminée par la loi d’après laquelle une entreprise est constituée. Une entreprise qui fait affaire au Québec peut avoir été constituée par une loi québécoise, par une loi d’une autre province, par la loi fédérale (qui admet les deux langues officielles), enfin par une loi d’un autre pays. Le Québec a pleine juridiction pour décider de la langue des raisons sociales des entreprises qui s’enregistrent en vertu d’une loi québécoise, mais il n’a pas le moyen d’empêcher les sociétés d’obtenir une charte fédérale, ni d’empêcher une compagnie à charte fédérale de faire affaire sous son nom au Québec; d’autre part, le Québec n’a aucune juridiction sur les raisons sociales des entreprises étrangères; quant aux autres provinces, elles sont considérées comme « étrangères », sauf l’Ontario où existe un accord de réciprocité dont les termes peuvent être modifiés. Donc, l’autorité juridique du Québec s’arrête aux noms des compagnies québécoises; pour les autres, il faudra procéder indirectement, par le biais du certificat de francisation et des différents permis exigés du Québec. Quant aux marques de commerce, elles sont, pour l’instant, de juridiction fédérale, par abandon de ce champ : c’est le gouvernement du Canada qui les reçoit en dépôt et les enregistre, qui négocie et signe les accords internationaux, comme l’Union de Paris qui permet dans chaque pays de l’Union l’usage d’une marque de commerce sans nécessité de la traduire dans la langue du pays.
Une raison sociale est généralement composée de deux éléments, un élément générique qui informe sur la nature de l’entreprise (par exemple, restaurant, épicerie) et un élément distinctif ou spécifique qui individualise l’entreprise par rapport à toutes les autres. Sur le plan linguistique, les problèmes ne sont pas les mêmes dans l’un et l’autre cas : dans le premier, il s’agit de savoir comment s’appelle le type d’entreprise, s’il y a adéquation entre l’activité principale et le générique proposé, ce que l’on fait des emprunts comme pizzeria, steak house, variety; dans le second, il s’agit de décider ce que l’on admettra comme spécifique hors des mots de la langue commune (exemple : restaurant La pointe du jour), comme les patronymes et toponymes en toute langue, les combinaisons artificielles de lettres, de syllabes ou de chiffres, les mots étrangers, etc.
Le contexte de la raison sociale, en général un slogan (le roi de l’habit), une offre de service (habits sur mesure), un renseignement quelconque (service à travers tout le pays), tout comme la publicité et les diverses affiches, ne comportent aucune limitation juridique : le Québec peut légiférer en ces domaines comme il l’entend. Sur le plan linguistique, ce sont des domaines d’une grande importance étant donné l’influence que ces messages exercent sur la langue des citoyens et étant donné le type d’image de la réalité québécoise qu’ils projettent, en harmonie ou en contradiction soit avec les faits, soit avec l’image collective la plus admise.
Stratégiquement, c’est un domaine relativement facile à contrôler. Les constructeurs de panneaux-réclame, d’enseignes ou d’affiches sont nombreux, mais deux ou trois d’entre eux totalisent quatre-vingts pour cent de la production. On peut donc les intéresser à la question et créer un effet d’entraînement sur tous les autres. De plus, pour poser une affiche ou un panneau fixe sur une voie publique, il faut un permis de la municipalité ou d’un ministère, qui atteste que les règlements sont respectés : il s’agit donc de demander aux fonctionnaires responsables d’évaluer le texte soumis. Pour enregistrer une raison sociale, il faut présenter une demande au ministère des Institutions financières ou au bureau d’un protonotaire. Le ministère a toujours été attentif à la langue des raisons sociales selon la loi de l’époque (une version française obligatoire) et on pouvait compter sur la collaboration de ce service; les protonotaires, en général, s’en désintéressaient et se contentaient d’inscrire le nom proposé sans examen critique, ce qui nous a valu les magnifiques « Labelle pétaque »! Il était possible, cependant, de modifier cette attitude en convainquant le ministère de la Justice dont relèvent les protonotaires d’émettre une directive à ce sujet. Enfin, les publicitaires de langue française étaient très sensibilisés à l’usage du français et militaient pour une publicité créée directement en français et de bonne qualité. Le plus difficile, l’incontrôlable, c’est la publicité « sauvage », celle qui est faite par le marchand lui-même, donc par des centaines de personnes qui s’improvisent agents de publicité.
4.3 La langue juridique et administrative
L’Office a abordé la question à partir de la terminologie des textes des lois et des règlements. On a ainsi démontré à l’évidence que dès qu’un mot ou un syntagme apparaît dans le texte d’une loi ou d’un règlement, il acquiert une valeur très particulière, la valeur juridique, qui fait qu’on ne peut plus le corriger, même s’il est erroné, et qu’on est même obligé de l’utiliser comme tel dans d’autres textes ou d’autres circonstances liés à l’application de la loi ou du règlement. Si une loi parle « d’officiers d’élection », il y aura partout des officiers d’élection, que le mot « officier » soit un anglicisme ou pas. L’Office a également fait l’expérience de la révision systématique de textes juridiques : la première loi révisée fut celle des Assurances[79], le premier règlement, celui de la Construction[80]. Ces travaux nous ont permis de comprendre les caractères spécifiques de la langue juridique et, en conséquence, la manière de l’améliorer.
La donnée fondamentale est celle de la cohérence juridique. En droit, un mot n’est jamais isolé, il est en position à la fois dynamique et statique, comme un atome dans la représentation tridimensionnelle classique d’une molécule complexe, d’abord par rapport à tous les termes de la même loi ou des autres lois ou règlements, ensuite par rapport aux termes de la jurisprudence, enfin et surtout par rapport aux synonymes et parasynonymes dont il est censé se distinguer. Tout se tient. Les membres de la profession sont hantés par la crainte que la modification d’un terme n’entraîne le déséquilibre de tout le système, sans qu’on puisse s’en douter au départ : . Là est la source du conservatisme de la langue juridique, pour le meilleur et pour le pire.
La procédure de la révision juridique est la deuxième donnée. L’essentiel, pour notre propos, est de savoir qu’on ne peut pas modifier le texte d’une loi ou d’un règlement après son adoption, même s’il s’agit uniquement d’une correction linguistique. D’une part, il faut représenter le texte devant l’Assemblée nationale, d’autre part, on ne peut pas limiter le débat puisqu’il doit pouvoir porter sur l’ensemble de la loi, fond et forme de tous les articles, ce qui est beaucoup demander pour la correction d’une phrase ou d’une expression.
La dernière donnée est celle d’abord du mystère qui entoure souvent la préparation d’une loi ou d’un règlement, ensuite des conditions très particulières des modifications qu’on lui apporte lors de la discussion en Chambre selon le jeu des amendements dont la formulation vient de partout et est souvent improvisée sur place, dans l’agitation de l’action. Même si le rédacteur juridique est très compétent et élabore un projet de loi dont la langue est de grande qualité, rien ne peut empêcher que des erreurs y soient introduites lors du débat en Assemblée et le texte final voté avec des erreurs. Le contenu de la loi court d’ailleurs le même risque.
L’Office est ainsi peu à peu arrivé à définir une stratégie de la qualité des textes juridiques[81], en deux grands mouvements. D’une part, sensibiliser et conseiller les rédacteurs juridiques de manière à ce que les projets de loi ou de règlements soient de bonne qualité au moment de leur présentation; ces rédacteurs sont peu nombreux : les conseillers juridiques des ministères ou des organismes gouvernementaux, les membres du comité de législation (qui revoient presque tous les textes des projets de loi avant leur impression), enfin les membres du comité de législation déléguée (qui revoient les textes des projets de règlements). Dans cet esprit, l’Office a entrepris la préparation d’un manuel de rédaction juridique, en collaboration avec des juristes québécois et français. D’autre part, poursuivre et encourager les travaux de terminologie juridique avec comme objectifs de bien identifier les choses à corriger et d’élaborer des propositions de correction compréhensibles et acceptables pour les praticiens du droit au Québec.
Le vocabulaire des lois et de la jurisprudence est aujourd’hui sur ordinateur et on peut sérieusement envisager une opération de correction globale sous la forme d’un projet de loi d’équivalence terminologique. La correction de la terminologie des règlements est plus complexe du fait de la présence dans ces textes d’une terminologie technique spécialisée, par exemple la terminologie du bâtiment dans le Code de la construction, ce qui nous ramène à la francisation des entreprises : les terminologies doivent être mises au point d’une manière cohérente.
La langue administrative[82] présente moins de difficulté. Si on exclut les problèmes liés à la langue juridique, aux transformations de la société (l’emploi du féminin dans les désignations de fonction) ou au conservatisme des appellations d’emploi en relation souvent avec une pratique de la rémunération, on retrouve ici les mêmes problèmes que dans tout autre secteur terminologique.
4.4 Les travaux terminologiques
Le programme des travaux a comporté trois grands volets : la terminologie systématique, la terminologie ponctuelle (les consultations), la diffusion de la terminologie (la publication des lexiques et la banque de terminologie).
En terminologie systématique, l’Office se trouvait confronté à deux problèmes. D’un côté, il fallait examiner le rôle de la terminologie dans la francisation des entreprises et trouver la manière de substituer des vocabulaires techniques français aux vocabulaires anglais en usage. De l’autre, il fallait assurer la qualité et l’uniformité de ces vocabulaires et, d’une manière plus générale, de la langue technique et administrative. Pour l’instant, nous nous en tiendrons à l’exposé des travaux, renvoyant au chapitre suivant celui de la stratégie à laquelle le Québec est arrivé.
Au début, l’Office a pensé pouvoir prendre en charge tout l’aspect terminologique de la francisation des entreprises. Des chantiers terminologiques ont été ouverts dans certains grands secteurs comme l’industrie minière, l’industrie textile, l’automobile, la métallurgie, l’industrie des pâtes et papier, le raffinage, etc., en liaison étroite avec le milieu (pendant cette période, les terminologues ont vraiment été sur le terrain) et en collaboration avec les industries françaises du même secteur grâce aux missions de la coopération franco-québécoise. Nous avons ainsi beaucoup appris. Premièrement, que la terminologie technique existe en français dans tous les secteurs industriels et que le problème est de la réunir pour ensuite la mettre en circulation : le français est une langue technique de grande qualité, malgré qu’on affirme ou croit le contraire encore aujourd’hui. Deuxièmement, que les besoins terminologiques d’une entreprise dans la conduite normale de ses affaires se répartissent en trois grandes zones : le vocabulaire de la gestion, le vocabulaire technique général, le vocabulaire technique spécifique, les deux premiers étant communs à toutes les entreprises, le dernier propre à une entreprise ou à un groupe d’entreprises de même vocation, par exemple le vocabulaire de la concentration du minerai. Troisièmement, que la question de la normalisation ne se pose pas dans les mêmes termes en langue commune et en langue de spécialité, cette dernière ayant un besoin et une tendance naturelle à l’uniformisation, d’où la nécessité pour l’Office de bien distinguer les deux domaines dans ses recommandations. Quatrièmement, qu’il fallait être critique à l’égard de la notion d’emprunt, d’abord parce qu’il ne s’agit plus d’emprunt lorsque la totalité d’un vocabulaire est de langue étrangère, ensuite parce que les nombreux emprunts à l’anglais qui parsèment la langue québécoise (les anglicismes, dirait-on d’un autre point de vue) sont les signes de notre aliénation et que leur disparition fait partie de l’effort général de décolonisation, enfin parce qu’il y va de la vitalité du français, qui devrait être capable d’inventer des désignations au fur et à mesure des besoins par une pratique normale de la néologie. Enfin, cinquièmement, que dans la perspective d’une francisation intégrale du monde du travail, il faudrait à l’Office un très grand nombre de terminologues et un important budget pour mener à bien la totalité des travaux dans un laps de temps raisonnable et qu’en conséquence, il vaudrait peut-être mieux songer à un partage des tâches entre les trois grands responsables, c’est-à-dire l’Entreprise, pour les terminologies techniques spécifiques, le ministère de l’Éducation, pour les vocabulaires techniques généraux, et l’Office, pour les vocabulaires de gestion[83].
Pour ce qui est de la qualité de la langue, l’Office a pris ses distances par rapport au débat sur la norme du français au Québec, alors beaucoup trop théorique et idéologique. L’Office s’est surtout préoccupé du statut du français, avec la conviction profonde que l’amélioration de la qualité viendrait de l’amélioration du statut. En terminologie cependant, l’Office a affirmé que la qualité découle de la rigueur des travaux et a, de ce fait, entrepris la mise au point d’une méthodologie du travail terminologique[84] propre à l’assurer et à faciliter les échanges entre les terminologues; dans le même esprit, une procédure de normalisation a été expérimentée et arrêtée[85].
En terminologie ponctuelle, l’Office a organisé un service de consultation, qui présente des problèmes très particuliers. Tout d’abord, les usagers de ce service sont totalement disparates : cela va de la secrétaire aux prises avec un problème d’accord de participe au terminologue chevronné qui a épuisé toutes ses ressources. La réponse dans l’un et l’autre cas ne demande pas le même type de compétence et de recherches de la part de la personne à qui on s’adresse, en général par téléphone. Ensuite, pour l’Office, il s’agit d’aider les gens en répondant le mieux possible à leurs questions, non de donner sur tout des avis officiels, alors que les usagers veulent des avis sûrs, qu’il est souvent impossible de leur donner. Enfin, la clientèle augmente constamment et toutes les catégories professionnelles veulent un service personnalisé, les journalistes, les publicitaires, les professeurs, les terminologues, etc., ce qui pose d’insolubles questions d’organisation.
La diffusion des travaux s’est d’abord faite par la publication d’ouvrages de terminologie. Puis, le volume augmentant, l’Office a créé une banque de terminologie informatisée[86], avec comme objectifs de stocker et de diffuser le plus grand nombre de termes en fonction des besoins du Québec, de mener l’inventaire permanent de toutes les publications de terminologie et de tous les travaux en cours, enfin de constituer pour les terminologues un instrument de travail et pour l’Office un procédé de gestion de la terminologie.
On voit donc que, durant une quinzaine d’années, il y eut au Canada et au Québec un intense brassage d’idées sur le thème de l’avenir du français, de l’anglais et des autres langues.
Au Québec, la nécessité s’est imposée d’une stratégie globale en matière de langues, que nous tenterons d’exposer au chapitre 4, dans sa forme actuelle d’achèvement. Elle repose sur quelques idées maîtresses que nous voudrions d’abord présenter.
Chapitre 3 – Les concepts clés de l’aménagement linguistique québécois
Au fur et à mesure que la situation du français au Québec, et par voie de conséquence celle de l’anglais et des langues des autres minorités ethniques, était analysée et révélée, au fur et à mesure que les traits de la situation souhaitable étaient identifiés, discutés, mis en place d’une manière plus ou moins systématique ou cohérente, certaines questions d’ordre sociolinguistique se sont vite imposées comme primordiales, exigeant de ce fait qu’on leur apporte une réponse à la fois bien fondée, susceptible de guider les choix des dispositions à prendre et surtout acceptable par la plus grande partie de la population. Au sens d’universalité, ces questions étaient alors et demeurent d’une grande banalité; ce qui importe c’est la réponse puisqu’elle est en relation étroite avec une situation et des objectifs originaux.
Selon nous, les questions qui sont au centre de l’aménagement linguistique québécois sont les suivantes : le bilinguisme, bien qu’il soit plus juste de parler de multilinguisme; les fonctions de la langue au sein de l’organisation sociale; la distinction entre communications institutionnalisées et communications individualisées et, enfin, la norme de l’usage linguistique. Nous nous efforcerons d’abord de dégager la réponse du Québec à chacune de ces questions; puis, nous verrons comment ces concepts s’organisent à l’intérieur d’une stratégie globale.
1. Le concept de bilinguisme : les rapports avec l’anglais
Il est important au départ de circonscrire et de nuancer le concept de bilinguisme. L’image que l’on se fait du terme « bilinguisme » donne l’illusion que le bilinguisme est en soi une chose toute simple alors qu’il est à la fois extrêmement complexe et multiforme à travers le monde. Certaines distinctions sont essentielles qui fourniront d’emblée les quelques expressions propres à faire éclater l’ambiguïté de ce terme et à faire apparaître plus clairement les objectifs qu’une société peut poursuivre à cet égard.
-
a) Distinction entre bilinguisme de langue commune et bilinguisme de langue spécialisée.
Le bilinguisme de langue commune résulte de la connaissance partielle de la langue seconde acquise aux niveaux suivants :
- niveau de la composante phonologique, identifiée et réalisée à travers les sons les plus habituels chez les locuteurs de cette langue;
- niveau de la composante syntaxique, soit l’essentiel des structures syntaxiques de base et des règles de transformation les plus usuelles;
- niveau du lexique, dont le registre varie beaucoup selon les individus, les méthodes d’apprentissage, le niveau d’enseignement, etc. Les extrêmes peuvent se situer, par exemple, entre le Vocabulaire fondamental de Saint-Cloud et le Dictionnaire du français contemporain de Dubois;
- niveau de la norme linguistique, surtout en ce qui a trait aux écarts que présentent les grandes langues, par exemple le français du Québec par rapport à celui de la France, ou l’anglais du Canada par rapport à celui des États-Unis ou de l’Angleterre.
Enfin, l’objectif du bilinguisme de langue commune est de donner à l’individu une aisance linguistique en langue seconde de façon à lui permettre d’accomplir les gestes familiers de la vie quotidienne.
Le bilinguisme de langue spécialisée comporte les mêmes éléments que le bilinguisme de langue commune, mais avec des différences notables, à savoir :
- la composante phonologique reste la même bien que de nouveaux allophones puissent intervenir au niveau de l’identification des phonèmes;
- la composante syntaxique peut devoir s’enrichir de règles de transformation particulières à la langue technique;
- le lexique ou le vocabulaire joue un rôle primordial, l’essentiel étant d’acquérir le vocabulaire d’une science, d’une technique, d’un métier donnés ou encore l’ensemble des vocabulaires constituant la langue de l’entreprise. L’étendue de ce vocabulaire variera donc énormément en fonction des besoins de l’individu; il s’étalera par exemple des quelques centaines de mots que doit connaître le plombier anglophone pour travailler en équipe avec des francophones aux milliers de termes utilisés quotidiennement par l’ingénieur spécialiste de la sidérurgie.
-
b) Distinction entre bilinguisme projet individuel et bilinguisme projet collectif.
La distinction entre bilinguisme projet individuel et bilinguisme projet collectif découle de la nature des causes du bilinguisme.
Le bilinguisme est un projet individuel lorsque l’individu décide lui-même d’acquérir une seconde langue. Nous ramenons à deux types les diverses raisons qui peuvent l’amener à cette décision :
- il obéit à une motivation d’ordre culturel : le désir de connaître une langue et une culture étrangères, d’accéder à sa littérature, de voyager à l’étranger, etc.;
- il obéit à une motivation d’ordre pratique, la connaissance d’une seconde langue étant ressentie comme nécessaire à sa réussite professionnelle. L’individu qui décide d’aller travailler à l’étranger, le savant qui apprend une langue étrangère parce qu’une partie importante des ouvrages qu’il doit consulter paraissent uniquement dans cette langue, le francophone québécois promu à un poste qui le met en contact avec la langue anglaise ou l’anglophone québécois qui doit travailler en français sont autant d’exemples de ce dernier type de motivation.
Le bilinguisme est un projet collectif lorsque deux communautés linguistiques se trouvent dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
- soit qu’elles doivent coexister sur un même territoire, souvent à l’intérieur des mêmes institutions politiques, juridiques, économiques ou industrielles, par exemple en Belgique;
- soit qu’elles occupent des territoires distincts tout en étant liées par une certaine forme d’interdépendance politique, économique ou industrielle, comme dans le cas des pays du marché européen;
- soit enfin que ces deux communautés linguistiques cohabitent à l’intérieur d’un même territoire tout en étant en étroite relation, surtout dans le domaine industriel, économique et touristique, avec le reste du pays et les pays voisins, par exemple le Québec en relation avec le reste du Canada et avec les États-Unis.
Le fait que le bilinguisme soit un projet collectif n’entraîne pas la nécessité d’être bilingue pour l’ensemble de la population d’un pays. Toutefois, il oblige la société à trouver la manière ou les moyens de faire coexister harmonieusement les langues en présence, selon la conception qu’elle se fait des fonctions de chacune d’elles au sein de l’organisation sociale globale. Le degré de bilinguisme des individus peut effectivement varier considérablement, surtout en fonction du nombre de langues existantes et de leur répartition sur un même territoire. Le besoin que l’individu ressent d’apprendre une langue le détermine.
-
c) Distinction entre bilinguisme institutionnel et bilinguisme fonctionnel.
L’expression « bilinguisme institutionnel » s’interprète dé deux façons selon le sens que l’on donne au mot « institutionnel ».
- Le bilinguisme est le fait de l’institution (entreprise, établissement, services gouvernementaux, hospitaliers, etc.) et non de l’individu. C’est là le sens que la Commission Laurendeau-Dunton donne à l’expression « bilinguisme institutionnel ». Il faut néanmoins dans ce cas définir le rapport individu/institution face à l’emploi des langues dites langues de travail de l’institution (en l’occurrence le français et l’anglais). Cette conception du bilinguisme institutionnel se rapproche de la notion d’un bilinguisme que nous préférons qualifier de « fonctionnel » afin de lever l’ambiguïté provoquée par l’interprétation qui suit.
- Le bilinguisme est une institution, c’est-à-dire une disposition de l’organisation sociale établie par la loi ou garantie par la coutume d’un groupe donné. C’est ainsi que nous pouvons affirmer qu’en Suisse le bilinguisme est une institution de la Confédération helvétique. Au Canada, la Loi sur les langues officielles a érigé le bilinguisme de la fonction publique en institution. Lorsque le bilinguisme est une institution, toutes les nuances sont possibles aussi bien au niveau des rapports entre les langues en présence (égalité absolue, prédominance d’une langue sur l’autre eu égard au genre d’activités, à la spécialisation des secteurs touchés, etc.) qu’en ce. qui a trait à la nécessité pour l’individu d’être bilingue, laquelle variera suivant les rapports établis entre ces mêmes langues ou encore en fonction de sa langue maternelle.
Dans ce dernier sens, le bilinguisme institutionnel n’implique pas plus que le bilinguisme collectif la « bilinguisation » de toute la population. « Il peut y avoir des institutions bilingues composées exclusivement d’unilingues, comme il peut y avoir des institutions unilingues composées entièrement de bilingues … Un État est bilingue non pas parce qu’il est constitué d’individus bilingues, mais au contraire parce qu’il permet l’unilinguisme des groupes qui en font partie[87]. » Mais il oblige l’institution, par exemple l’État, à garantir certains services qu’il doit déterminer, dans deux ou plusieurs langues qu’il doit choisir. Il entraîne des conséquences quant à la compétence linguistique des personnes qui rendent ces services et rejoint, par ce biais, le concept de bilinguisme fonctionnel.
Le bilinguisme est fonctionnel lorsque la connaissance d’une langue seconde est liée à l’exercice de certaines fonctions clairement identifiées, pour des raisons bien déterminées et liées au projet collectif qu’a décidé de poursuivre une société donnée.
Au fil des années, les distinctions que nous venons d’esquisser sont apparues et se sont approfondies, obligeant la société à préciser ses aspirations en matière de bilinguisme, amenant les hommes politiques à définir de mieux en mieux le caractère linguistique du Québec.
De la distinction entre bilinguisme en tant que projet collectif et bilinguisme en tant qu’institution découle en même temps le refus d’un Québec bilingue et le rejet d’un Québec rigoureusement unilingue. Le bilinguisme institutionnel du Québec, au sens second, aurait perpétué le statu quo, affermi le caractère dominant de la langue anglaise, menacé à long terme la survie et surtout l’épanouissement de la culture française en terre d’Amérique. C’est ce qu’ont non seulement démontré, mais répété à satiété tous les observateurs, toutes les commissions chargées d’étudier la question du bilinguisme au Canada et au Québec (Laurendeau-Dunton, Gendron, Pépin-Robarts), la quasi-totalité des rapports annuels du Commissaire aux langues officielles du gouvernement fédéral, d’où l’affirmation du français comme langue officielle du Québec. L’unilinguisme se heurte à deux obstacles au Québec. Il entre en contradiction avec une conception généreuse des droits de la personne, avec laquelle les Québécois sont en général d’accord, qui estime normal et souhaitable d’accorder certains droits aux minorités culturelles du Québec, notamment à la minorité anglaise, particulièrement en matière d’enseignement. Ces droits s’exercent également au niveau des institutions à caractère culturel (presse, radio, télévision, théâtre, restauration, artisanat, etc.) ou à l’égard des communications personnelles avec l’État, les ordres professionnels, les services, en somme les organismes avec lesquels la communication est de caractère privé (chapitre 3, 4.). Mais surtout le Québec participe étroitement à l’économie nord-américaine; il s’ouvre à des relations avec d’autres pays où souvent la langue anglaise joue le rôle de « lingua franca », ce qui fait qu’il y aura toujours une partie de sa population qui devra passer d’une langue à l’autre, donc être bilingue. Toute la question est de savoir qui doit être bilingue, dans quelle mesure et pour quelles raisons. La distinction entre bilinguisme de langue commune et bilinguisme de langue spécialisée permet une amorce de réponse à cette triple question.
En principe, à la fin des études secondaires, et pour des raisons d’accès à une culture étrangère tout aussi bien que pour lui permettre d’évoluer dans ce monde qui est le nôtre, tout adolescent québécois, qu’il soit francophone ou anglophone, devrait posséder une certaine connaissance de l’anglais ou du français langues secondes. Il devrait en connaître tout au moins l’essentiel, soit cette partie de la langue commune qui en constitue le noyau central, la base même. Mais en pratique, de nombreuses difficultés psychopédagogiques surgissent au niveau des aptitudes et des réactions de l’étudiant, du choix des méthodes, de la disponibilité, de la compétence et de l’attitude des professeurs, etc. Beaucoup sont convaincus que l’enseignement des langues sera facilité lorsque la Charte de la langue française aura produit ses effets et entraîné chez les francophones un sentiment de réussite linguistique, donc de disponibilité aux langues des autres et, chez les anglophones ou allophones, la conscience de la nécessité du français au Québec. Enfin, le bilinguisme de langue commune s’étend à d’autres langues que l’anglais comme langues tierces, en particulier aux langues des autres groupes linguistiques telles que l’italien, l’espagnol, le portugais ou le grec.
Le bilinguisme de langue spécialisée est lié d’une part aux exigences linguistiques des fonctions, telle ou telle fonction nécessitant une connaissance plus ou moins approfondie du français ou de l’anglais, et d’autre part au projet personnel de l’individu, c’est-à-dire à son plan de carrière. Eu égard à la Charte de la langue française et à la structure économique du Québec, la nécessité du bilinguisme de langue spécialisée ne se réalise pas de la même manière chez les francophones et chez les anglophones. Elle sera plus intense et plus généralisée chez les anglophones d’une extrémité à l’autre de l’éventail des occupations : le médecin, tout aussi bien que le plombier, devra connaître la terminologie française de son domaine d’activité parce qu’il aura à travailler en français. Par contre, chez les francophones elle sera plus limitée, étant en général liée à des fonctions de cadre ou à des tâches professionnelles, du fait de la stratégie dite « stratégie de la passerelle linguistique[88] ».
Il s’agit, en somme, de concilier deux objectifs en apparence contradictoires, soit :
- assurer aux Québécois l’usage du français comme langue de travail, quel que soit leur niveau hiérarchique au sein de l’entreprise ou leur spécialité;
- maintenir le contact avec la technologie et l’économie nord-américaines de langue anglaise et avec les établissements de l’entreprise situés hors du Québec, donc généralement de langue anglaise.
La poursuite de ces deux objectifs implique donc, en dernière analyse, la nécessité d’accepter et d’aménager la coexistence et le voisinage de deux langues comme langues de travail, dont l’une, le français, sera d’un usage généralisé et l’autre, l’anglais, d’un usage restreint. Cette manière d’envisager la question de la langue de travail rompt complètement avec la tradition industrielle du Québec où, pour des raisons historiques, la langue anglaise a toujours dominé. En observant d’une manière plus précise le circuit de la communication dans un certain nombre d’établissements, nous nous sommes rendu compte que le passage d’une langue à l’autre, du sommet à la base de la hiérarchie industrielle, de la conception à l’exécution, pouvait être assuré par un nombre relativement restreint de personnes facilement identifiables. Ainsi est née dans notre esprit l’idée de « passerelle linguistique ». Nous entendons par cette expression une nouvelle attribution confiée à des personnes occupant des postes stratégiques le long de la chaîne des communications au sein de l’établissement, postes où le passage d’une langue à l’autre peut s’effectuer pour permettre l’usage généralisé du français comme langue du travail sans pour autant couper les relations avec le monde anglophone environnant. Le bilinguisme est alors uniquement le fait des titulaires de ces postes, soit un nombre restreint de personnes qui le pratiquent pour des motifs très précis. La « passerelle linguistique » permet en somme à deux unilinguismes techniques de coexister sans difficulté; elle est le concept clé du bilinguisme fonctionnel qu’il faut concevoir comme une stratégie visant à assurer la communication d’une langue à l’autre au sein d’un réseau donné ayant fait l’objet d’une analyse appropriée.
Il devient alors important de préciser en détail, pour chaque situation de bilinguisme fonctionnel, les zones d’utilisation exclusive de chaque langue (zones dites d’unilinguisme) et les points de contact de ces zones où doit s’insérer une passerelle linguistique. Tous les pays d’Europe ont réglé ainsi le problème des contacts linguistiques et cela, le plus naturellement du monde, au point que les industriels européens ont du mal à comprendre la question linguistique du Québec.
Dans cette optique, la Charte de la langue française a prévu un ensemble de dispositions ayant pour objet de délimiter l’usage du français et de l’anglais au Québec, de même que le recours à la procédure de l’analyse linguistique pour recueillir les données permettant de fixer l’échéancier et le contenu du programme de francisation de l’entreprise d’une part, et d’autre part d’identifier et de mettre en place les passerelles linguistiques jugées nécessaires.
2. Les fonctions de la langue
La langue remplit diverses fonctions au sein de la société. C’est là un principe établi depuis longtemps déjà[89] et généralement accepté par la plupart des linguistes, quoique nous ayons l’impression que les recherches ne sont guère avancées dans ce domaine aussi bien en ce qui concerne la nature et la typologie de ces fonctions que leur influence respective sur l’émergence d’un modèle linguistique dominant.
En aménagement linguistique, il est essentiel de tenir compte des fonctions de la langue puisqu’elles constituent la distinction fondamentale entre communications institutionnalisées et communications personnelles et qu’elles permettent de mieux comprendre le phénomène de l’usage linguistique. Il existe, selon nous, cinq fonctions importantes de la langue que nous qualifierons de fonction d’intégration sociale, fonction de communication, fonction d’expression, fonction esthétique et fonction ludique. Les fonctions peuvent fort bien s’additionner l’une à l’autre. La distinction est surtout méthodologique.
Il nous paraît très difficile de cerner la fonction intégrative de la langue. Il faut tout d’abord établir une distinction entre langue maternelle et langue non maternelle. Pour un individu, apprendre et pratiquer une langue non maternelle c’est faire preuve d’intérêt pour le groupe parlant cette langue, d’où l’accueil bienveillant que lui manifeste ce groupe. Il réussit de ce fait à participer plus facilement à la vie sociale du groupe, voire à assimiler les nombreux éléments de sa culture. Ainsi s’estompe peu à peu son statut d’étranger. Le partage de la même culture est, en dernière analyse, la seule forme d’intégration sociale et le comportement du groupe à l’égard de l’étranger, selon que le groupe est plus ou moins disposé à accueillir les éléments exogènes, est déjà un trait de cette culture. En réalité, ce comportement est très différent d’une culture à l’autre, il va du refus pur et simple, plutôt rare de nos jours, à la volonté d’assimilation totale. C’est la langue maternelle qui favorise le plus l’intégration au groupe d’origine du fait qu’elle est à la fois l’un des éléments les plus importants de la culture comme instrument de communication, d’expression et de création, et le moyen d’accéder aux autres éléments de cette culture à travers les diverses formes du processus de socialisation. Mais là encore, il faut tenir compte du caractère plus ou moins compartimenté de la société et de la facilité des individus à passer d’un sous-groupe à l’autre.
Au départ, l’enfant s’intègre au cercle de famille et à son voisinage immédiat, donc à une communauté plutôt restreinte qui se caractérise par un ensemble de traits socioculturels, dont une certaine norme de comportement linguistique. Devenu adolescent puis adulte, il entre en contact avec d’autres communautés, d’abord par l’école puis par le travail, communautés dont les caractéristiques culturelles confirment ou contredisent celles de son milieu d’origine, particulièrement sur le plan linguistique à cause du caractère très apparent et éminemment perceptible de la parole. Des choix se présentent, des adaptations s’imposent, des conflits surgissent et se dénouent. En fait, une dynamique s’organise, à la fois chez l’individu et au sein du groupe, pour trouver une solution visant d’une part à concilier les différences entre le milieu d’origine et les autres milieux qui constituent la société et, d’autre part, à assurer la relation d’un milieu à l’autre dans la mesure où faire se peut. La langue joue un rôle important dans cette dynamique : par la manière dont il parle, par la langue qu’il utilise, l’individu exprime le type de relation qu’il entretient avec le groupe et avec chacun de ses membres. Le comportement linguistique n’est jamais neutre, il est effectivement la manifestation d’une appartenance, d’où l’importance que peut avoir tout changement de comportement linguistique, qu’il soit passager comme lorsqu’on tente de s’adapter à un milieu, ou permanent, comme lorsqu’on change totalement d’allégeance ou de groupe. Dans les milieux bilingues ou multilingues, la fonction intégrative de la langue se complique du fait que l’individu et la société font face non seulement à la variation des modèles linguistiques d’un groupe à l’autre au sein de la même communauté linguistique, mais aussi et surtout à la concurrence des langues entre elles. Du point de vue de l’organisation sociale, la fonction intégrative est la plus importante des fonctions de la langue, elle est fondamentale à toute la question de la norme.
Les fonctions de communication et d’expression sont corrélatives[90]. Tout acte de parole poursuit deux intentions : permettre au sujet parlant de « se dire », c’est-à-dire parler pour se faire entendre, et « entrer en relation avec l’autre », c’est-à-dire parler pour se faire comprendre. Dans l’un et l’autre cas, l’instrument est le même, le langage et davantage la langue qu’il doit d’abord apprendre, accueillir comme un donné, s’approprier. Pour communiquer, il doit tenir compte de l’autre, de sa capacité à parler la langue, donc en rechercher les éléments qu’il partage en commun avec cet autre. Pour s’exprimer, il puise dans sa propre connaissance de la langue les éléments les plus aptes à dire sa pensée, ses sentiments, son univers, d’où une certaine tension entre deux objectifs tout aussi importants l’un que l’autre : ne pas se trahir mais se faire comprendre, d’où également la nécessité de choisir entre privilégier la qualité de l’expression de soi au risque de ne pas être compris et privilégier la communication avec l’autre au risque de ne pas tout dire de ce que l’on veut dire. Il est difficile d’atteindre pleinement l’un et l’autre de ces objectifs parce qu’on ne peut jamais les exclure l’un de l’autre, les deux fonctions étant complémentaires. Il ne faut surtout pas oublier qu’il y a en fait deux fonctions et que, outre la fonction de communication, il existe une fonction d’expression qui suppose l’acquisition d’un style, d’une manière à soi de sortir de soi grâce à la langue. La fonction de communication est pour ainsi dire centripète en ce sens qu’elle recherche l’intercompréhensibilité, alors que la fonction d’expression, qui recherche l’originalité, est centrifuge. Certains domaines d’utilisation de la langue, comme nous le verrons plus loin (chapitre 3, 4.), favorisent la communication alors que d’autres privilégient l’expression, d’où l’existence de besoins très différents, voire divergents, en matière de norme et de normalisation.
La fonction esthétique de la langue est liée à son emploi en littérature, en poésie, au théâtre, dans la chanson, en publicité, en somme dans toutes les circonstances où la langue devient un matériau dont on veut tirer des effets stylistiques ou autres. La fonction esthétique jouit généralement d’un grand prestige et, de ce fait, influence la manière d’établir ou de concevoir la norme linguistique. Il est donc important d’en délimiter soigneusement l’aire d’utilisation. En principe, le créateur a la liberté la plus absolue d’utiliser la langue comme il l’entend, aux fins d’expression qu’il poursuit et à ses propres risques. Dans le roman ou le théâtre, par exemple, il est normal qu’il donne à ses personnages la langue qui correspond au milieu auquel ils appartiennent. Néanmoins, cette langue ne doit jamais être considérée comme une reproduction fidèle du réel ou encore comme une description linguistique de même type que celle du linguiste. Par définition, elle est créée par l’amalgame de traits puisés dans le réel et si le créateur connaît à fond tous les registres de la langue, s’il poursuit des intentions de réalisme, il se peut que sa création donne l’illusion du réel. Mais elle n’en demeure pas moins une création, une illustration des possibilités de la langue dont il ne faut tirer d’argument que celui de rendre témoignage ou encore de servir d’« exemple », un peu comme on cite certains écrivains dans les grammaires, les dictionnaires, les ouvrages de linguistique. Il faut laisser les questions d’esthétique littéraire à leur place, c’est-à-dire en littérature. Les créateurs vivent généralement avec difficulté le choix de la langue d’écriture. Au Québec, écrire en langue soignée ou en langue populaire constitue un réel problème, lequel a d’ailleurs fait l’objet d’un débat passionné qui a donné naissance à des clans, à des amitiés, à des alliances. Chose certaine, la langue de l’écriture ne détermine pas à elle seule la norme de l’usage : tout au plus, montre-t-elle la vaste étendue des possibilités expressives d’une langue, en fait la multiplicité réelle des normes linguistiques existant dans la communauté culturelle. La fonction esthétique de la langue est finalement la forme la plus achevée, la plus consciente de la fonction d’expression.
Enfin, quelques brèves remarques sur la fonction ludique de la langue nous permettront d’affirmer que le langage, donc la langue, est aussi un jeu. En effet, l’enfant apprend la langue en jouant, comme l’atteste le plaisir qu’il éprouve à produire des sons, à utiliser les mêmes mots dans toutes sortes de contextes. Malheureusement, le sérieux gagne l’adulte qui oublie le plaisir de jouer avec la langue, qui ne semble plus rechercher la joie de la manipuler, joie analogue à celle qu’un objet donne au toucher, sauf parfois à travers les jeux de mots qui ne sont que rarement gratuits. Il est important, selon nous, de reconnaître la place du jeu dans le langage, en tant que source de connaissances, preuve de jeunesse à la fois de la langue et de ceux qui la parlent.
3. La distinction entre communication individualisée et communication institutionnalisée
Nous entendons par communication individualisée l’acte personnel par lequel un individu entre en relation avec un autre au moyen du langage. La liberté dont jouit alors l’émetteur est ambiguë. D’un côté, compte tenu de la fonction d’expression de la langue, elle est totale : l’individu a le droit le plus strict et le pouvoir le plus absolu d’utiliser la langue comme il le veut surtout si, au même moment, les fonctions esthétiques et ludiques entrent en jeu. De l’autre, eu égard aux fonctions d’intégration et de communication de la langue, cette liberté est réduite d’une part par le contrôle social à travers le mécanisme des modèles culturels (chapitre 3, 4.) et, d’autre part, par la nécessité de tenir compte des ressources langagières du récepteur. Les communications individualisées se font le plus souvent en langue parlée; elles sont parfois écrites comme dans la correspondance et surtout à travers les divers genres de la création littéraire (poésie, roman, théâtre, chanson, etc.). Enfin et dans un grand nombre de cas, elles sont marquées d’une connotation affective, notamment dans les circonstances où elles impliquent entre les locuteurs des relations amicales ou amoureuses, et leurs contraires, de toute espèce et à tous les degrés.
Nous entendons par communication institutionnalisée l’acte, le plus souvent anonyme ou impersonnel, par lequel une institution entre en relation avec des personnes soit en tant que membres de cette institution (par exemple, l’État avec ses citoyens, une société avec ses actionnaires), soit dans la relation employeur-employé, ou encore en qualité de clients, d’auditeurs ou de spectateurs. Nous donnons ici au terme « institution » son sens le plus large, c’est-à-dire toute entité devant son existence à une loi (personnes morales ou associations), à un accord international (agences internationales telles que l’UNESCO, l’ONU), ou encore à une constitution coutumière ou écrite (l’État). En général, l’institution a soit le choix absolu de la langue, par exemple dans le cas d’une multinationale qui s’installe dans un pays, soit un choix relatif, dans le cas des institutions qui ont une clientèle, comme l’État ou les sociétés commerciales, dont elle doit tenir compte. L’institution est surtout libre de déterminer le type de langue dont elle fera sa norme et dispose d’ailleurs des moyens nécessaires pour obliger ses membres à s’y conformer, d’autant plus facilement que ses communications relèvent la plupart du temps de la fonction de communication. Enfin, les communications institutionnalisées se faisant le plus souvent en langue écrite, donc à la suite d’une réflexion sérieuse et à l’aide d’ouvrages de consultation tels que grammaires, dictionnaires ou autres ouvrages spécialisés, l’institution bénéficie de conditions privilégiées qui favorisent à la fois la qualité du texte et le recours à des rédacteurs professionnels.
Nous avons ramené à quatre grands groupes les communications institutionnalisées, à savoir l’enseignement, l’administration publique, les institutions économiques, enfin les médias d’information ou de communication de masse. Cette division nous a permis de répartir comme suit les comportements linguistiques inhérents aux communications institutionnalisées :
- les comportements linguistiques du système d’enseignement, c’est-à-dire le choix de la langue ou des langues qu’il sera jugé opportun d’enseigner comme langues maternelles ou non maternelles, de même que les modalités d’application de cette politique; le choix de la langue d’enseignement des professions, des métiers, des sciences et des techniques;
- les comportements linguistiques de l’administration publique, soit le choix de la langue dans laquelle seront rédigés lois, règlements, décrets, formulaires et documents d’information à l’usage des citoyens; le choix de la langue dans laquelle seront dispensés les services de l’État, c’est-à-dire la langue de la relation individuelle du citoyen avec l’État; le choix de la langue des relations de l’État avec ses fonctionnaires, la langue de travail de l’État considéré comme employeur; le choix de la langue des hommes politiques et des hauts fonctionnaires dans leurs relations avec leurs électeurs, les personnes morales à l’intérieur du territoire, ou encore avec les autres États et les organismes internationaux;
- les comportements linguistiques des institutions économiques, soit le choix de la langue de travail, c’est-à-dire la langue utilisée dans la gestion de ces institutions (directives, plans, procédés, etc.); le choix de la langue des relations de l’institution avec la clientèle (étiquetage des produits, notices d’emploi, garanties, catalogues, etc.); la langue de la publicité et de l’affichage public; la langue des raisons sociales et des marques de commerce;
- les comportements linguistiques des médias d’information ou de communication de masse, soit la langue des journaux, de la radio, de la télévision et, d’une certaine manière, bien qu’elle appartienne davantage à l’univers de la création, la langue du cinéma et de la chanson.
Il existe un point de jonction entre communications individualisées et communications institutionnalisées. Fondamentalement il y a toujours un individu à la source d’une communication, ce qui nous permet d’affirmer que toutes les communications sont individualisées. Toutefois, cette affirmation nous amène à faire une distinction entre d’une part la responsabilité de l’individu faisant usage de la langue à titre personnel et, d’autre part, celle de l’individu faisant usage de la langue à titre public. Dans le premier cas, la responsabilité est strictement celle de l’individu alors que dans le second, elle incombe à l’institution qu’il représente, laquelle doit en principe répondre des faits et gestes de ses membres. C’est de ce dernier point de vue, soit du point de vue de la « non-responsabilité » de l’individu et de sa « dépersonnalisation » au profit de l’institution, que nous nous plaçons pour faire la distinction entre communications individualisées et communications institutionnalisées.
4. Les concepts de norme et de normalisation
La question de la norme est extrêmement complexe et nous n’avons ni l’espace voulu pour en traiter de façon exhaustive, ni davantage la prétention de l’épuiser. Notre seule intention est de proposer des concepts outils de même qu’une terminologie permettant d’en discuter et d’étayer la stratégie de l’usage linguistique dont il sera question au prochain chapitre.
4.1 Norme et modèle de comportement
La langue est un phénomène social. C’est là une constatation qui peut paraître banale, mais encore faut-il pouvoir en tirer toutes les conséquences. La réflexion peut s’engager dans au moins deux directions, l’une anthropologique ou sociologique et l’autre nettement linguistique, ce qui explique que la sociolinguistique cherche, depuis quelques années, à faire le joint entre ces deux orientations. Il n’est pas étonnant d’ailleurs de constater la grande difficulté qu’éprouvent, au niveau du vocabulaire, les chercheurs qui tentent d’expliquer la langue en tant que phénomène social, la terminologie de base étant elle-même très ambiguë. Nous n’en voulons pour exemples que les seuls termes « norme », « langue » et « usage ».
Le terme « norme » oscille entre deux acceptions que les qualificatifs « normal » et « normatif » font apparaître[91]. La première relève de l’observation; elle correspond à une situation objective et statistique, c’est-à-dire à l’idée de moyenne, de fréquence, de tendance généralement et habituellement réalisée que suggère l’adjectif « normal ». La seconde, par contre, relève de l’élaboration d’un système de valeurs et correspond à un faisceau d’intentions et d’attitudes subjectives, à l’idée de conformité à une règle, ce que sous-entend l’adjectif « normatif ». Le terme « langue », pour sa part, est fortement polysémique comme l’indiquent les nombreuses combinaisons qu’il peut constituer avec d’autres substantifs. Il a, par exemple, un sens différent dans chacune des expressions suivantes : langue française, langue de Montréal, langue de la publicité, langue de Victor Hugo[92]. Enfin, depuis la publication de la préface des Remarques de Vaugelas, le terme « usage » projette l’ombre des qualificatifs « bon » et « mauvais », à telle enseigne que l’aphorisme « C’est l’usage qui fait la langue » provoque automatiquement la réplique « Oui, mais quel usage? »
Quant à nous, nous avons choisi comme point de départ à notre réflexion l’approche et la terminologie anthropologiques, notamment celles de Linton, que nous mettrons en relation avec la linguistique.
-
a) La notion de culture
« Une culture est la configuration des comportements appris et de leurs résultats, dont les éléments composants sont partagés et transmis par les membres d’une société donnée[93]. »
« Configuration » pour indiquer qu’une culture est un ensemble d’éléments interreliés; « comportements » pour exclure de la notion de culture les faits biologiques automatiques comme la respiration, la digestion, ou les pulsions instinctuelles comme se reproduire, survivre; « résultats » pour inclure dans la culture certains produits de l’homme, comme la radio ou l’automobile, à cause de leur influence sur les comportements : « partagés et transmis » pour insister sur le fait que la notion de culture implique nécessairement un processus de façonnement de l’individu par le groupe, quel que soit l’âge de l’individu, de même qu’une forme de consensus établi entre les individus quant à la manière de vivre ou de faire les choses.
Il faut distinguer soigneusement la culture réelle et la culture construite[94]. La culture réelle est celle vécue par chaque individu qui y participe; elle comprend un très grand nombre d’éléments, parce qu’elle englobe l’extrême variété des comportements des individus : personne n’agit exactement comme son voisin, tout en agissant comme lui. C’est le partage difficile du personnel et du social. La culture construite est le produit de l’activité du chercheur qui tente d’extraire des comportements des individus les éléments stables et qui considère le résultat ainsi obtenu comme l’essence même de la culture. En somme, décrire une culture consiste à supprimer ce qu’a de personnel le comportement de chacun des individus observés.
La langue donne lieu à un ensemble de comportements. Elle est donc partie intégrante de la culture et exige qu’on lui applique la même analyse anthropologique qu’aux autres institutions ou comportements constitutifs de la culture. Système de conventions grâce auxquelles les individus d’un même groupe communiquent entre eux, elle se caractérise par ses composantes phonologique, syntaxique et sémantique. Elle possède également une profondeur et une surface qui correspondent à peu près à l’implicite et à l’intériorité (observables et vérifiables non pas directement mais de façon indirecte, par le biais des comportements) et à l’extériorité (observable et vérifiable directement). Alors que la composante phonologique (profondeur) se réalise dans la chaîne phonétique (surface) et la composante syntaxique dans le déroulement linéaire de la phrase, la composante sémantique se réalise d’une part par le truchement de la composante syntaxique et, d’autre part, par la composition (grâce à la composante phonologique) de divers sémèmes, soit lexèmes c’est-à-dire le lexique, soit morphèmes c’est-à-dire la morphologie.
-
b) La notion de modèle culturel
Le modèle culturel est une certaine conception de la manière dont il faut se comporter ou agir au sein d’un groupe social donné. Il y a un modèle culturel pour chaque type de comportement, pour s’habiller, se nourrir, se loger, agir avec les siens, avec ses supérieurs ou ses subalternes. Il est possible d’établir une certaine synonymie entre modèle culturel, standard et norme. Appliqué à la langue, le terme « norme » désigne un modèle culturel de comportement linguistique.
À la notion de culture réelle correspond celle de modèle culturel réel qui peut se définir comme étant l’aire de variabilité à l’intérieur de laquelle le comportement est jugé acceptable, et à l’extérieur de laquelle il est jugé bizarre et provoque des réactions diverses qui se traduisent soit par des punitions, soit par des félicitations. En linguistique, l’expression « norme sociale » correspond sensiblement au modèle réel et désigne l’ensemble des comportements langagiers des individus au sein d’un groupe donné, comportements qui ne donnent lieu à aucune réaction (surprise, désapprobation, admiration, incompréhension, etc.) chez les autres membres du groupe. Les modèles linguistiques réels, donc les normes sociales, sont d’autant plus nombreux qu’il y a de groupes et de sous-groupes dans le super-groupe. La communauté linguistique se définit par l’intercompréhension, c’est-à-dire la capacité de tous ses membres de communiquer entre eux par le truchement de la même langue, indépendamment et malgré l’existence de traits caractéristiques propres à chaque sous-groupe, ce qui suppose l’interaction des normes sociales, la primauté des traits communs sur les traits particuliers. Enfin, notons que les diverses normes sociales sont généralement hiérarchisées, l’une ou l’autre d’entre elles étant valorisée par rapport à toutes les autres et jouant un rôle dominant au sein de l’organisation sociale. La question est alors davantage de savoir pourquoi telle norme est valorisée plutôt que de contester l’existence d’une norme dominante. Dans le cas des langues à grande diffusion, il peut arriver que plusieurs normes dominantes solidement établies entrent en concurrence et se hiérarchisent à leur tour comme les normes américaine et anglaise ou encore les normes québécoise, belge, africaine et même française par rapport au « français » avec lequel elles entretiennent des rapports mal définis.
À la culture construite correspond le modèle construit, lequel est lui aussi le résultat de l’activité du chercheur qui essaie de ramener le modèle réel à ses composantes stables, c’est-à-dire à celles que l’individu doit absolument respecter pour être accepté du groupe, quitte à y intégrer ses variantes personnelles sans courir le moindre risque. Le modèle culturel construit est donc une aire de plus petite surface au centre de l’aire du modèle réel; il repose entièrement sur le modèle réel. Le fait qu’il découle de l’activité du chercheur entraîne le problème épistémologique de la relation de ce dernier au réel. En linguistique, l’expression « norme objective » se rapproche de celle de « modèle construit ». Cependant, elle a l’inconvénient de donner l’impression d’être unique alors qu’elle varie considérablement selon l’école à laquelle appartient le chercheur, l’objet qu’il décrit et la perspective dans laquelle il se place. On saisit alors l’importance de l’aspect épistémologique de l’activité du linguiste, chacune des normes qu’il propose devant faire l’objet d’un examen soigné quant à la manière dont elle a été établie et quant au type de « vérité » qui lui convient selon qu’elle est du domaine des sciences humaines, où la vérité souvent fragile découle de la convergence et du consensus des observateurs, ou des sciences de la nature (en fait presque uniquement de la phonétique), où la vérité s’établit par la possibilité de reproduire le phénomène.
Enfin, il existe un troisième type de modèle, le modèle idéal. « Il s’agit d’abstractions élaborées par les membres de la société eux-mêmes; ils représentent leur opinion unanime sur la façon dont il faut se comporter en certaines situations … En général, les modèles idéaux paraissent édifiés le plus souvent pour les situations que la société juge d’une importance primordiale et notamment pour celles qui engagent l’interaction des individus qui occupent des positions différentes dans le système social. Les modèles idéaux peuvent ne pas concorder, et de fait, ne concordent habituellement pas, avec les modèles construits que le chercheur élabore au moyen de ses observations sur le comportement réel. Dans certains cas, le désaccord peut signifier simplement que le modèle idéal ne parvient pas à conserver le contact avec les réalités d’une culture en plein changement … Mais dans d’autres cas, il semble bien que le modèle idéal n’ait encore jamais concordé avec la moyenne du modèle culturel réel : il représente alors l’objet d’un désir, une valeur qu’on a toujours admise davantage en la violant qu’en la respectant. Dans les deux cas, les modèles idéaux exercent une action normative en décourageant les conduites qui s’écartent trop des standards qu’ils proposent[95]. »
En linguistique, la définition du modèle idéal est loin d’être précise. Le plus souvent, l’expression « la norme » doit s’entendre de la norme idéale, d’où l’opposition « la norme/les normes » pour marquer la distinction entre modèle idéal et modèles réels; afin défaire apparaître l’aspect moral de la norme, Alain Rey la qualifie de norme prescriptive, évaluative ou subjective, le modèle idéal tend à être unique et à se rapprocher du modèle réel dominant, selon l’influence et le pouvoir que détient la partie de la population dont c’est l’usage. Les défenseurs du modèle idéal tentent de réduire la variété des modèles réels à ce seul modèle, ce qui veut dire qu’au sujet de la langue, les défenseurs de « la norme » donnent l’impression que cette norme est « la » langue, réduisant ainsi à une seule ses multiples manifestations. Il ressort de toute évidence de cette constatation que les tenants du « modèle idéal » ou de « la norme » ont un double combat à mener d’une part contre la reconnaissance de l’existence de plusieurs modèles réels ou normes sociales et d’autre part, contre l’élaboration de modèles construits ou normes objectives; ils doivent en somme livrer une bataille contre la linguistique et, plus particulièrement, contre la sociolinguistique.
-
c) La problématique de la norme : la double variation des usages (les modèles réels) et des descriptions qui en sont faites (les modèles construits)
La problématique de la norme implique donc une double variation, celle des usages et celle des diverses manières de décrire la langue. Si, aujourd’hui, la plupart des observateurs ont pris conscience de la multiplicité des usages et tentent de substituer l’étude de la manière dont coexistent les normes à la définition ou à l’élaboration d’une norme unique, ils semblent ignorer, ou tout au moins ne pas vouloir tenir compte des diverses manières de décrire la langue ni du niveau d’abstraction où se situe chacune des descriptions retenues.
Les modèles réels varient en fonction des quatre facteurs suivants : le registre de communication, la stratification sociale, la géographie et le temps. Aux fins de cette étude, nous les traiterons séparément quoique, en réalité, ils se manifestent simultanément. Lorsqu’il parle ou écrit, l’émetteur se trouve toujours en situation, situation définie par un lieu donné, Montréal par exemple, un moment précis, 1976, un ou des récepteurs, soit un groupe d’ingénieurs, et enfin un registre, en l’occurrence une langue de spécialité, la discussion portant par exemple sur les défauts du laminage des tôles d’acier.
-
Les variations de registre proviennent de deux sources principales :
-
L’écart entre langue parlée et langue écrite.
Ces deux modalités d’émission sont extrêmement différentes. En langue parlée, le sujet est en contact direct avec le ou les récepteurs dans une certaine relation d’affectivité. Il fabrique ses énoncés spontanément, sans possibilité de biffer quoi que ce soit, pressé par la succession temporelle inéluctable et essentielle des syllabes, des mots, des phrases; s’il se reprend, c’est au vu et au su de ses interlocuteurs. Cependant, il bénéficie de l’apport de certains autres moyens de communication, particulièrement le geste, l’intonation, la mimique et, enfin, un peu comme en compensation au fait d’être sur la corde raide, il peut compter sur la solidarité instinctive des récepteurs dont l’attitude à l’égard de la forme du message n’est pas aussi critique que pour le message formulé en langue écrite. En fait, tout se passe comme si le contenu de l’émission importait nettement plus que son contenant. La transcription d’une conférence improvisée qui s’était révélée brillante oblige souvent le transcripteur à corriger certaines maladresses, parfois à l’adapter à un nouveau registre, celui de la langue écrite. En langue écrite la situation est effectivement différente. L’émetteur est seul face à la page blanche; il se trouve généralement dans un cadre familier ayant à sa disposition les menus objets, la documentation, les instruments qui lui permettront de rédiger son texte. Enfin et surtout, il dispose du temps voulu pour réfléchir, se reprendre sans témoin aucun et aussi souvent qu’il le juge nécessaire. De même le lecteur se trouve dans une situation toute autre que le récepteur en langue parlée, situation qui lui permet de porter davantage d’attention au message et donc d’adopter une plus grande attitude critique. Ce sont là, sans doute, les raisons qui expliquent le prestige de la langue écrite et le rôle qu’elle joue dans la dynamique de la norme.
-
La distinction entre communication institutionnalisée et communication individualisée.
C’est à cette distinction que se rattachent le plus grand nombre de registres. En général on emploie pour les désigner diverses expressions dont le pivot est le mot « langue » : langue administrative, langue scientifique, langue des journaux, etc. Les ouvrages dits de stylistique tentent de définir ces différents registres, d’en dégager les caractéristiques. L’apprentissage du style qui correspond à une technique et à un registre donnés se fait concurremment à l’apprentissage de la technique elle-même : c’est en cours d’étude que l’étudiant en sciences acquiert le style scientifique.
-
-
La stratification sociale se manifeste par l’existence et la concurrence de plusieurs modèles réels. Les connaissances dans ce domaine sont plutôt fragmentaires et restreintes. On désigne habituellement par l’expression « niveaux de langue » la perception que l’on a de la variété des usages selon la composition de la société : d’où les concepts de langue populaire, langue vulgaire, langue soutenue sous lesquels on regroupe ce qui semble caractéristique d’un groupe par rapport à un autre de ce point de vue. On remarque que la mobilité d’un « niveau » à l’autre est d’autant plus grande que le locuteur est instruit.
-
En matière de variation géographique, les expressions « dialecte » et « langue régionale » sont souvent utilisées pour désigner les « parlers » auxquels elle donne lieu. Cependant, dans une perspective chronologique, la tendance se dessine en faveur d’une distinction entre ces deux termes, distinction selon laquelle les dialectes seraient le produit de la différenciation engendrée par le temps à l’intérieur d’une même langue, alors que les langues régionales proviendraient plutôt des différences culturelles entre pays de même langue et à la même époque.
-
La variation temporelle relève des trois facteurs suivants :
- Les quelques différences plus ou moins marquées observables d’une génération à l’autre, donc une microdiachronie;
- Les ruptures d’évolution entre les usages de groupes plus ou moins éloignés inhérentes au fait qu’ils ne se transforment pas en même temps et de la même façon. Certaines expressions du français québécois contemporain seraient considérées comme archaïques par un Français citadin, l’adjectif « fiable », par exemple, qui est en passe de devenir à la mode en France depuis l’adoption du néologisme « fiabilité »;
- Les grands états successifs d’une langue sur une très longue période de temps, donc la diachronie elle-même ou, pour mieux dire, la macrodiachronie : les grandes étapes du français par exemple, soit l’ancien français, le moyen français et le français moderne.
Les modèles construits varient en fonction de trois facteurs, à savoir : la formation de l’observateur ou encore l’école de laquelle il se réclame, l’amplitude de la description et son objet.
-
La variation relative à la notion d’école est la plus large. L’observateur qui élabore la description de la langue peut être soit un amateur, comme il est arrivé souvent dans le cas des langues amérindiennes, esquimaudes ou africaines, dont les premières descriptions furent l’œuvre de missionnaires; soit un spécialiste qui s’intéresse surtout à la langue écrite littéraire et qu’il est convenu d’appeler « grammairien », l’exemple le plus célèbre pour la langue française étant, à notre avis, Maurice Grevisse, auteur du Bon usage, soit enfin un linguiste, donc un observateur qui a reçu une formation très pertinente au domaine. Cependant, même dans ce dernier cas, il peut appliquer diverses méthodes d’analyse suivant qu’il fait appel à la linguistique distributionnelle, fonctionnelle, générative, historique, guillaumienne, ou encore à la sociolinguistique.
-
La variation relative à la notion d’amplitude se rapporte à l’étendue du champ d’application des conclusions de la description linguistique, c’est-à-dire au nombre plus ou moins grand de locuteurs auxquels elles conviennent. Par exemple, la description d’un idiolecte ne vaut que pour un locuteur, alors que la description d’un sociolecte concerne les membres d’un groupe restreint de locuteurs dont les caractéristiques socioculturelles sont bien définies, comme dans le cas de la description de la syntaxe des enfants de cinq ans de Montréal et de Paris par Guy Labelle[96]. Il est souvent intéressant d’étendre les conclusions au-delà de leur champ immédiat d’application, mais il faut alors être bien conscient de la relative valeur d’une extrapolation. Ce qui motive l’intérêt de ce type de variation et qu’il est important de signaler, c’est que la description comporte d’autant plus de traits différentiels qu’elle se rapproche de l’idiolecte. En d’autres termes, plus on élargit le champ de l’observation, plus on écarte d’éléments jugés non pertinents parce que trop spécifiques, moins la description rend compte de l’ensemble des aspects de l’usage réel de chacun des locuteurs : ce que la description gagne en compréhension, elle le perd en extension.
-
La variation correspondant à la notion d’objet répond, par contre, à la question suivante : à quel aspect de la langue l’observateur s’intéresse-t-il : phonologie, syntaxe, sémantique, lexicologie ou terminologie? Ou n’a-t-il pas plutôt choisi de traiter tous ces aspects à la fois dans une tentative de description globale de la langue?
Le schéma qui suit illustre et résume la théorie des modèles culturels et de leurs variations. À droite du tableau figurent les facteurs de variation de l’usage qui déterminent la situation de parole où se trouve chacun des locuteurs au moment de la communication; au centre, le facteur « langue » ou moyen de communication utilisé par les locuteurs (la compétence linguistique) et décrit par les observateurs à partir de l’usage d’un nombre plus ou moins restreint de sujets; enfin, à gauche, les facteurs de variation des modèles construits définissant la situation de description de l’observateur.
-
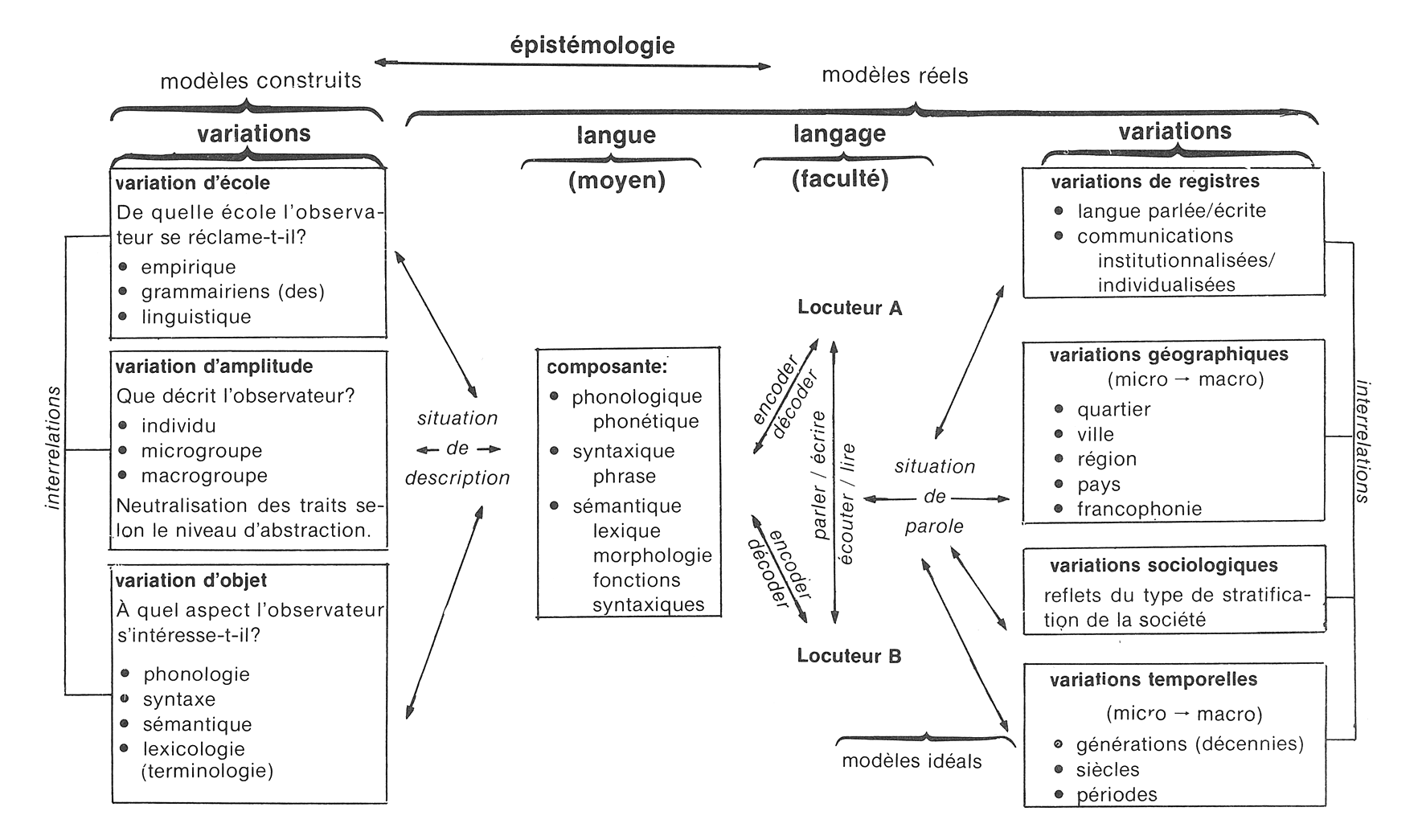
4.2 La normalisation
Nous entendons par normalisation la démarche qui vise d’une part à amener les usagers à se mettre d’accord sur tel ou tel aspect de la langue lorsqu’il y a divergence d’usages et d’autre part, à assurer la diffusion et la généralisation de l’usage retenu. La qualité de la normalisation repose en principe sur la qualité de la description des usages en concurrence, mais elle ne se confond pas nécessairement avec elle puisque la normalisation implique l’intention d’intervenir dans l’usage. En réalité, elle ne devient utile ou nécessaire que dans le cas où cette concurrence s’avère une source de difficultés de toutes espèces, de nature à perturber la communication. On comprend dès lors qu’elle s’exerce surtout au niveau des communications institutionnalisées.
La normalisation porte le plus souvent sur les éléments de surface de la langue tels que prononciation, graphie, vocabulaire; elle touche très rarement la morphologie et presque jamais la phonologie et la syntaxe, soit autant de domaines hors d’atteinte de l’usager moyen. Elle se pratique en outre de façon très marquée, et selon une certaine progression, en langues de spécialités. Les nomenclatures relevant de la chimie, de la botanique, de la zoologie, de la médecine sont effectivement fortement normalisées et normalisatrices : les signifiants sont univoques, ne pouvant se substituer l’un à l’autre, donc être synonymes; les néologismes sont rigoureusement créés à partir de modèles morphologiques bien définis et occupent une place précise dans le système. Par contre, comme nous le verrons plus loin, les vocabulaires des techniques et des sciences exactes, tout en recherchant l’uniformité susceptible d’assurer le maximum d’efficacité à la communication, ne peuvent éviter la concurrence de synonymes gênants et constituent, à ce titre, le domaine par excellence de la normalisation. Enfin, les sciences humaines, qui poursuivent la même intention de s’exprimer par un vocabulaire uniformisé que les sciences exactes, ont plus de mal à y parvenir. Elles sont forcées d’intégrer dans leur terminologie un certain nombre de termes quasi synonymes qui expriment des différences d’idéologies ou d’écoles.
Les communications individualisées s’accommodent fort bien de la variation des usages. En général, elles sont moins source d’incompréhension ou de gêne que source de surprise, de plaisir ou de déplaisir; elles sont en quelque sorte le moyen de situer socialement et stylistiquement chacun des individus d’une communauté linguistique. Le consensus qui les caractérise est le résultat de la fonction d’intégration et de communication de la langue, à savoir la nécessité de posséder un système commun. Les variations traduisent les fonctions expressive, esthétique et ludique de la langue et sont l’expression de l’individu, être unique, distinct de tous les autres. Dans les rares cas où un acte de normalisation s’impose, c’est que le groupe ou la communauté linguistique éprouve le besoin de confier à une autorité compétente le soin de dégager un consensus.
L’existence ou la concurrence de synonymes gênants, particulièrement dans les vocabulaires de spécialités, représente l’une des principales causes de normalisation. Dans les communications institutionnalisées par exemple, il peut s’avérer nécessaire d’éliminer ou de faire échec à une éventuelle ambiguïté en dégageant pour ainsi dire un usage officiel acceptable par les parties en cause.
En examinant de près les situations à la faveur desquelles la synonymie prolifère en terminologie, il est facile de comprendre que la normalisation est un phénomène nécessaire et légitime. Mentionnons entre autres :
-
L’équivalence de certaines expressions (syntagmes) soit par rapport à un mot simple (lexème), soit par rapport à une autre expression.
Les vocabulaires spécialisés comportent deux types de signifiants : des mots simples (lexèmes) et des expressions ou groupes de mots (syntagmes). Il peut arriver qu’un mot simple ait comme équivalents synonymiques une ou plusieurs expressions qui sont soit des paraphrases, soit des définitions du mot simple. Le signifié semble alors se décomposer en ses éléments constitutifs (sèmes), chacun cherchant sa propre voie d’expression, son signifiant propre. L’exemple le plus simple nous paraît celui des « machines », dont les désignations donnent lieu très souvent à des paires de signifiants telles que « machine à laver/laveuse », « machine à sécher/sécheuse ». Dans un autre domaine, celui des compteurs d’électricité, les expressions « molette » et « bouton de réglage » sont parfaitement synonymiques dans leur contexte, de même que « contrepoids » et « masse d’équilibrage » en mécanique. Enfin, en tissage, on utilise indifféremment les expressions « peigne/peigne à tisser/peigne du battant/peigne du métier à tisser » pour désigner le « ros ».
Il peut aussi arriver que plusieurs expressions soient synonymiques. La synonymie des syntagmes est due ou bien au fait qu’on choisit pour les composer des constituants différents, ou bien au fait que les mêmes constituants puissent s’exprimer par des termes eux-mêmes synonymiques. Ainsi en est-il des exemples suivants tirés du vocabulaire de la machine à coudre industrielle : « broche à bobine/broche porte-bobine », « dégageur de fil/tire-fil », « point bâti/ point de bâti/point de bâtissage », « relève-presseur/releveur de pied presseur », « pied ganseur/pied passepoileur ».
-
La concurrence des théories, des techniques, des procédés, des établissements ou des entreprises.
Dans le vocabulaire de la machine à coudre, la même pièce porte le nom de « plaque frontale », « plaque de face », « couvercle frontal » et « couvercle de tête ». En effet, la compagnie Pfaff utilise « plaque frontale » alors que Singer emploie plus volontiers « plaque de face » et que le Comité européen de liaison des industries de la machine à coudre préconise « couvercle frontal ». Enfin, dans son vocabulaire textile trilingue, Jean Dusy propose « couvercle de tête ».
La langue de la publicité des appareils électroménagers fait appel à une abondance d’expressions pour vanter les mérites de réalités identiques, particulièrement celles qui peuvent varier d’une année à l’autre, par exemple « bras gicleur » qui a pour concurrents « bras de lavage/bras d’aspersion/bras rotatif/bras à jet rotatif/ bras arroseur rotatif/bras d’arrosage », ou encore « œufrier » qui se dit également « casier (à œufs)/bac (à œufs)/panier (à œufs) /tiroir (à œufs)/plateau (à œufs)/plateau. à alvéoles/compartiment à alvéoles/balconet à alvéoles/moule (à œufs)/tablette (à œufs) / porte-œufs/galerie moulée (pour les œufs)/niche (à œufs) /alvéoles (à œufs) ». Il existe une même variation pour « bac à viande », « bac à glaçons », « garde-beurre », « thermomètre à rôti », etc.
-
La difficulté de définir le concept.
La difficulté de définir le concept se manifeste souvent au moment de la transformation des techniques et des procédés ou encore dans le cas où de globale qu’elle était, une activité devient superspécialisée. Le cas le plus connu est sans doute celui de « marketing » et de ses proches parents « commercialisation » et « merchandising ». De l’avis même des spécialistes, le terme « marketing » dont le sens varie considérablement selon le point de vue que l’on adopte, est ambigu et difficile à définir. En effet, les définitions auxquelles il a donné lieu sont souvent très générales pour ne pas dire évasives. M. Marcel Lagrenade a fait à ce sujet une excellente étude pour le compte de la société Domtar[97]. Son point de départ est l’analyse de la séquence des opérations qui interviennent entre l’étude des marchés et l’analyse des réactions de la clientèle une fois le produit fabriqué, distribué et vendu. C’est au moment de découper et de nommer les étapes de cette séquence que surgit le problème.
Pour certains spécialistes, les Français surtout, le « marketing » désigne l’ensemble des études préliminaires qui mènent à la connaissance du consommateur et de ses besoins, à la définition des caractéristiques optimales du produit, à l’étude des marchés et même, pour certains d’entre eux, à la détermination des canaux de vente et à l’organisation des services après-vente. Pour d’autres, les Américains en particulier, le « marketing » englobe toute la séquence des opérations qui va des études préliminaires aux études terminales en passant par la fabrication, l’emballage et le conditionnement, l’étalage, la publicité et la réclame, la distribution, la vente et le service après-vente. Par ailleurs, le terme « commercialisation » qu’on cherche à substituer à « marketing » désigne la séquence des opérations qui interviennent entre le moment où le produit sort de l’usine et celui où l’on doit assurer le service après-vente. Ce dernier terme recouvre donc une réalité distincte de celle du « marketing » au sens français et différente également de celle du « marketing » au sens américain dont elle devient d’ailleurs l’une des parties constituantes.
Enfin, le « merchandising » consisterait à offrir la marchandise en quantité voulue, au prix convenable et aux endroits stratégiques. Ce concept coïncide avec l’expression « mise en vente » mais ne correspond pas au concept que recouvre le terme « commercialisation », qui effectivement constitue un englobant par rapport à « merchandising ».
Ainsi que nous l’affirmions précédemment, toute la question tourne autour du concept, de l’idée que l’on se fait de la « chose ».
-
Le contact entre langues différentes particulièrement avec l’anglais.
Le contact entre langues différentes se produit généralement de deux façons :
- a) le mot étranger entre en concurrence avec un terme français existant qui pourrait, même avec extension de sens, lui servir d’équivalent. C’est le cas des termes « design » et « désigner » qui sont entrés en concurrence avec les expressions « création industrielle », « créateur industriel » et « concepteur ». La mode et le snobisme favorisent plus souvent qu’autrement le terme étranger;
- b) le terme étranger est un néologisme que l’usage cherche à remplacer. Il se produit alors une période de flottement au cours de laquelle plusieurs propositions d’équivalents sont avancées, chacune ayant ses propres défenseurs; qu’on se rappelle les célèbres débats auxquels ont donné lieu des termes comme « software », « hardware », « by-pass », « bulldozer ».
-
Le renouvellement accéléré du vocabulaire technique.
Guilbert[98] signale que, à en juger par l’observation du mouvement général du lexique français, le vocabulaire technique se renouvelle d’une manière accélérée alors que le lexique général demeure plus stable. Cette remarque suggère qu’on pourrait observer à l’intérieur d’une science ou d’une technique des vagues successives de terminologie parallèles au rythme des transformations. Dans le cas où ces vagues seraient très rapprochées dans le temps, ou encore si elles se manifestaient de manière différente selon les régions ou les établissements, la synonymie observable serait l’indice de la coexistence de plusieurs vagues terminologiques.
Le processus de normalisation doit réaliser trois conditions indispensables à sa réussite. Tout d’abord, il importe de repérer tous les éléments du problème qui permettront d’offrir la ou les solutions possibles; c’est là le travail des spécialistes de la langue, linguistes ou terminologues selon le domaine d’intervention. Cette première étape implique à la fois la théorie et la pratique de la norme linguistique. Dans le cas des langues peu décrites, il se peut même que la première tâche du linguiste soit de dégager de l’ensemble des modèles réels manifestés dans l’usage un modèle construit, donc une norme objective, ce qui prouve que la description linguistique est en soi un geste de normalisation. En outre, la qualité du dossier de normalisation qu’établira le linguiste est d’une extrême importance car c’est sur elle que repose la pertinence des solutions proposées et par ricochet l’adhésion des usagers, bref l’efficacité de la normalisation.
En second lieu, le linguiste devra solliciter l’avis de personnes représentatives du milieu visé par la normalisation, lesquelles auront pour tâche de discuter et d’évaluer chacune des solutions proposées et d’adopter celle qui sera jugée la meilleure. En ce faisant, la relation entre le linguiste ou le terminologue et les usagers est établie dans le respect de la responsabilité des usagers face à l’usage qu’ils entendent privilégier. C’est à cette seconde étape du processus de normalisation qu’apparaît l’ambiguïté du rôle du linguiste dans la société. D’une part, en sa qualité de spécialiste il se doit de décrire les faits et de proposer une ou des solutions de normalisation alors que, d’autre part, en sa qualité de citoyen et donc d’usager il participe au débat en vue d’une prise de décision sans plus d’autorité que le reste des usagers, si ce n’est une autorité morale.
Enfin, troisième et dernière condition à la réussite de la normalisation, le linguiste doit s’assurer l’appui des institutions qui seront chargées d’adopter la solution jugée la meilleure et de l’appliquer. La nature de ces institutions varie en fonction de l’objet même de la normalisation : par exemple, toute réforme de l’orthographe exigera l’accord du ministère de l’Éducation, des écrivants (écrivains, journalistes), du Syndicat des typographes, etc. Il y aura donc lieu pour les responsables du dossier de normalisation de prévoir une stratégie d’implantation différente dans chaque cas.
La normalisation linguistique est donc un phénomène courant si bien intégré à notre société complexe que nous n’en avons même pas conscience. La sociolinguistique devrait, selon nous, se préoccuper de faire l’inventaire des différentes formes de normalisation et de la manière dont fonctionne chacune d’entre elles. En fait, cela revient à reconnaître que la langue, institution sociale, subit comme toutes les autres institutions l’influence de forces régulatrices. Malheureusement nos connaissances à cet égard sont pratiquement nulles.
Chapitre 4 – La stratégie linguistique québécoise au moment de la Charte de la langue française
Le gouvernement québécois a légiféré trois fois en matière de langue : en 1969, sous l’Union nationale, par la Loi pour promouvoir la langue française (loi 63); en 1974, sous le Parti libéral, par la Loi sur la langue officielle (loi 22); en 1977, sous le Parti québécois, par la Charte de la langue française (loi 101). Chaque fois, la stratégie sous-jacente à la loi est différente.
Nous nous proposons de décrire les grandes lignes de la stratégie linguistique québécoise au moment de la Charte de la langue française. Nous avons choisi ce moment précis d’une part, parce qu’il marque le point d’achèvement d’une intense période de travaux, de réflexion et de discussions au cours de laquelle les citoyens, les hommes politiques et les spécialistes de l’Université ou de la Fonction publique ont exploré les objectifs, le contenu et les moyens de la politique linguistique; d’autre part, parce que les idées ou les opinions n’ont guère évolué depuis lors, le débat étant considéré comme clos pour les uns, suspendu pour les autres et la loi, mise en application. Il s’agit d’une stratégie globale, visant à la fois le statut et la qualité de la langue, à cause des étroites relations de l’un avec l’autre.
Tous les éléments de cette stratégie ne se retrouvent pas dans la Charte. Notre description s’appuiera donc tantôt sur le texte de la loi, tantôt sur des textes disponibles, tantôt sur notre propre connaissance du dossier, ce qui se produira surtout au sujet de la qualité de la langue.
Le contenu de la loi relève du législateur. Il provient de deux sources principales, de nature très différente. La première est d’ordre technique : c’est la connaissance que le législateur a du dossier, à partir des travaux à la fois descriptifs et théoriques des spécialistes, comme ceux dont nous avons fait état aux chapitres deux et trois, ce qui lui permet d’intervenir avec réalisme et à-propos. La seconde est d’ordre politique : ce sont les intentions, les objectifs de la nation tels que les interprète l’homme politique, d’où en démocratie l’importance de s’assurer qu’il traduit bien la volonté populaire, de connaître l’étendue du consensus que suscite son projet de loi, de pondérer les divergences d’objectifs entre les diverses composantes culturelles de la nation, dans la perspective d’une paix sociale durable.
Le cadre politique de la Charte de la langue française a été clairement défini. Ainsi, en mars 1977, le gouvernement du Québec a publié un livre blanc sur « La politique québécoise de la langue française », où sont exposés les principes qui ont guidé le législateur dans l’élaboration de la loi, de même que les grandes lignes de son contenu. À plusieurs reprises, et afin de bien faire comprendre les intentions de la Charte, M. Camille Laurin, titulaire de ce dossier en qualité de ministre d’État au Développement culturel, a prononcé d’importants discours[99].
L’essentiel tient dans les points suivants :
- a) Le Québec est une nation dont la très grande partie de la population —la majorité— est de langue française. Cette langue doit devenir, sans ambiguïté aucune, la langue officielle de cette nation, facteur d’identité culturelle pour les uns, facteur de cohésion nationale pour tous, langue commune à la majorité et à toutes les minorités.
- b) La nation québécoise est composée, non pas d’une majorité francophone et d’une minorité anglophone, mais bien d’une majorité francophone et de plusieurs minorités de langues différentes. Face à la langue officielle, toutes les minorités doivent être traitées sur un pied d’égalité et ce, non pas dans le dessein de les assimiler, mais plutôt de les intégrer à la nation en les faisant participer à la culture et à la vie de la majorité tout en leur offrant la possibilité de maintenir certains aspects de leur culture d’origine, dont, au premier chef, leur langue, leur religion, leurs institutions culturelles. Du fait du caractère historique de la minorité anglaise, il convient qu’elle conserve son réseau d’institutions scolaires.
- c) Le bilinguisme généralisé, officiel ou officieux, est à rejeter comme la plus grande menace à la survie de la langue française au Québec. Encore est-il nécessaire de lever une double ambiguïté. L’anglais est, au Québec, à la fois une langue internationale fort répandue dans le monde et la langue d’une minorité, distinction qui entraîne des dispositions différentes dans la loi selon que l’on traite de la francisation des entreprises ou de l’usage d’une langue de minorité, par exemple dans l’affichage. Le rejet du bilinguisme institutionnel ne signifie pas l’unilinguisme ou le refus d’enseigner les langues étrangères aux enfants. L’usage de l’anglais, langue internationale, est admis chaque fois que la nécessité en est démontrée et, comme langue d’une minorité, de la même manière que les autres langues des autres minorités. L’enseignement du français et de l’anglais comme langues secondes est assuré par le ministère de l’Éducation et l’enseignement d’autres langues comme langues tierces est fortement encouragé.
- d) Dans la conception et le détail de la loi, il faut faire la différence entre communications institutionnalisées et individualisées, entre communications à l’intérieur du Québec ou vers l’extérieur selon le type d’interlocuteurs ou de messages.
Ceci étant dit, nous décrirons d’abord la stratégie relative au statut de la langue, puis celle concernant sa qualité, enfin les modalités d’application et de suivi de ces stratégies.
1. Stratégie du statut de la langue
Le principe fondamental en est la déclaration du français comme langue officielle du Québec (article premier). Il est explicité par domaines d’usage institutionnalisé de la langue : législation et justice, administration et organismes parapublics, monde du travail, du commerce et des affaires, de l’enseignement, des entreprises.
Ce principe fondamental est nuancé par des principes annexes : protection du consommateur et accès aux services, épanouissement des minorités culturelles, communications individualisées, communications avec l’extérieur du Québec.
1.1 Le français est la langue officielle du Québec
Il en découle les conséquences suivantes, explicitées par la loi :
Extrait de la Charte de la langue française – Préambule
Langue distinctive d’un peuple majoritairement francophone, la langue française permet au peuple québécois d’exprimer son identité.
L’Assemblée nationale reconnaît la volonté des Québécois d’assurer la qualité et le rayonnement de la langue française. Elle est donc résolue à faire du français la langue de l’État et de la Loi aussi bien que la langue normale et habituelle du travail, de l’enseignement, des communications, du commerce et des affaires.
L’Assemblée nationale entend poursuivre cet objectif dans un climat de justice et d’ouverture à l’égard des minorités ethniques, dont elle reconnaît l’apport précieux au développement du Québec.
L’Assemblée nationale reconnaît aux Amérindiens et aux Inuit du Québec, descendants des premiers habitants du pays, le droit qu’ils ont de maintenir et de développer leur langue et culture d’origine.
Ces principes s’inscrivent dans le mouvement universel de revalorisation des cultures nationales qui confère à chaque peuple l’obligation d’apporter une contribution particulière à la communauté internationale.
-
a) Législation et justice.
Le français est la langue de la législation et de la justice au Québec (art. 7).
Les projets de loi sont rédigés, déposés, adoptés et sanctionnés en français (art. 8). Seul est officiel le texte français des lois et des règlements (art. 9), des jugements et des tribunaux ou des organismes judiciaires ou quasi judiciaires (art. 13). Les personnes morales utiliseront le français devant les tribunaux ou les organismes de même nature (art. 11).
-
b) Administration publique et organismes parapublics.
Le gouvernement, ses ministères, les autres organismes de l’Administration et leurs services (art. 14), les ordres professionnels (art. 34) ne sont désignés que par leur dénomination française.
Le gouvernement, ses ministères et les autres organismes de l’Administration n’utilisent que le français dans leurs communications écrites avec les autres gouvernements et avec les personnes morales établies au Québec (art. 16), entre eux (art. 17) et dans leur gestion interne (art. 18).
L’Administration publique rédige et publie dans la langue officielle ses textes et documents (art. 15), conclut dans cette langue ses contrats et ceux qui s’y rattachent en sous-traitance (art. 21).
Font en sorte que leurs services soient disponibles en français, les entreprises d’utilité publique, les ordres professionnels et leurs membres (art. 30), les services de santé et les services sociaux (art. 23).
-
c) Monde du travail.
Les communications de l’employeur avec son personnel, les offres d’emploi ou de promotion sont rédigées et publiées en français (art. 41).
Les conventions collectives et leurs annexes (art. 43), les sentences arbitrales (art. 44) relatives à un grief ou à un différend, au renouvellement ou à la révision d’une convention collective doivent être rédigées en français.
« Il est interdit à un employeur de congédier, de mettre à pied, de rétrograder ou de déplacer un membre de son personnel pour la seule raison que ce dernier ne parle que le français ou qu’il ne connaît pas suffisamment une langue donnée autre que la langue officielle », (art. 45).
-
d) Monde du commerce et des affaires.
Toute inscription sur un produit, sur son contenant ou sur son emballage, sur un document ou un objet accompagnant ce produit, y compris le mode d’emploi et les certificats de garantie (art. 51), tout catalogue ou dépliant, toute brochure ou autre publication de même nature (art. 53) doivent être rédigés en français.
Les contrats d’adhésion, les contrats où figurent des clauses types imprimées, ainsi que les documents qui s’y rattachent (art. 55), les formulaires de demandes d’emploi, les bons de commande, les factures, les reçus et quittances (art. 57) sont rédigés en français.
L’affichage public et la publicité commerciale se font uniquement en français (art. 58). Les raisons sociales doivent être en langue française.
-
e) Monde de l’enseignement.
Ce chapitre, le plus délicat de la loi, repose, en somme, sur deux idées maîtresses. D’une part, assurer la continuité culturelle à la majorité, à la minorité historique anglaise, aux minorités autochtones, amérindiennes et inuit. D’autre part, faire en sorte que les enfants des immigrants fréquentent l’école française, pour éviter qu’ils n’aillent accroître la démographie anglo-canadienne; la continuité avec leurs langues d’origine découlera d’un programme spécial du ministère de l’Éducation. Le tout doit être vu en relation avec l’ensemble de la loi qui, à moyen terme, devrait donner la sécurité linguistique aux francophones et créer une solide motivation à l’égard du français chez tous les autres.
En conséquence, la loi détermine que « l’enseignement se donne en français dans les classes maternelles, dans les écoles primaires et secondaires » (art. 72) pour les francophones et tous les immigrants; qu’il se donne en anglais aux anglophones du Québec, anglophones de naissance ou de choix (art. 73). Administrativement, vu la difficulté de rendre effectif le critère de la langue maternelle, pourtant le plus juste, la loi définit l’enfant anglophone comme étant celui dont l’un des parents (le père ou la mère) a reçu l’enseignement primaire en anglais au Québec, ou ailleurs s’il était domicilié au Québec au moment de l’entrée en vigueur de la loi, ou comme étant celui qui fréquentait l’école anglaise au moment de la loi, ou ses frères et sœurs cadets. Enfin, l’enseignement peut se donner dans une langue amérindienne aux Amérindiens, dans une langue inuit aux Inuit, tout particulièrement dans les territoires sous traité.
Des exceptions sont prévues pour les enfants dont les parents sont au Québec de façon temporaire (art. 85).
L’Office de la langue française a le pouvoir « d’exiger de toute institution d’enseignement collégial ou universitaire un rapport sur la langue des manuels utilisés et de faire état des observations en la matière dans son rapport annuel », (art. 114, par. f).
-
f) Monde des entreprises.
Les entreprises de cinquante employés ou plus doivent s’engager dans un programme de francisation (art. 136), dont les objectifs sont (art. 141) : la connaissance du français chez les cadres et l’augmentation à tous les niveaux du nombre de personnes ayant une bonne connaissance de la langue française, l’utilisation du français comme langue du travail et des communications internes, notamment dans les documents de travail, les manuels et les catalogues, l’utilisation du français dans les communications avec la clientèle, les fournisseurs et le public, l’utilisation d’une terminologie française, l’usage du français dans la publicité; enfin une politique d’embauche, de promotion et de mutation appropriée.
1.2 Principes annexes
Le principe fondamental est pondéré par des dispositions particulières inspirées de principes d’un autre ordre, mais tout aussi importants. Ce sont :
-
a) La protection du consommateur et son accès aux services.
En ce domaine, l’idéal est que le consommateur soit informé et servi dans sa propre langue. Dans cet esprit, la loi prévoit les dispositions suivantes à l’intention des minorités du Québec.
Rien n’empêche les services de santé, les services sociaux, les entreprises d’utilité publique, les ordres professionnels et leurs membres d’offrir leurs services dans une ou plusieurs autres langues, à condition qu’ils puissent le faire en français (art. 23 et 30).
Peuvent être rédigés et publiés dans une autre langue : les pièces de procédure émanant des tribunaux ou des organismes de même nature (art. 12); les jugements (la version française étant la version officielle, art. 13); l’affichage (art. 24) et la dénomination (art. 26 et 70) des organismes municipaux ou scolaires, des services de santé et des services sociaux (en même temps qu’en français), les contrats d’adhésion ou ceux où figurent des clauses types imprimées, ainsi que les documents qui s’y rattachent (art. 55).
Peuvent être publiés ou diffusés dans la langue d’un organe d’information autre que français les textes ou documents, les messages publicitaires ou les communiqués de l’Administration (art. 15) et des organismes parapublics (art. 33), la publicité commerciale (art. 59).
À l’intention de la minorité anglaise, la loi prévoit la publication d’une version anglaise des projets de loi, des lois et des règlements (art. 10) et la possibilité pour les personnes morales d’utiliser l’anglais devant les tribunaux si les parties y consentent (art. 11).
En plus du français, les inscriptions sur un produit, sur son contenant ou sur son emballage, sur un document ou un objet accompagnant ce produit (mode d’emploi, certificat de garantie) peuvent être en une ou plusieurs autres langues (art. 51). Il en va de même pour les menus et les cartes de vins (art. 51 ), pour les catalogues, brochures, dépliants et autres documents de même nature, à condition qu’ils constituent des publications distinctes (art. 10 et 11 du règlement 77-488).
-
b) L’épanouissement des minorités culturelles.
À cet égard la loi prévoit que :
Dans leurs communications internes, les organismes scolaires, les services de santé et les services sociaux peuvent utiliser à la fois le français et une autre langue (art. 26 et 28).
Les messages de type religieux, politique, idéologique ou humanitaire, sans but lucratif, peuvent être dans d’autres langues que le français (art. 59).
Lorsqu’il s’agit des activités d’un groupe ethnique particulier (art. 61), d’établissements spécialisés dans la vente de produits typiques d’une nation étrangère ou d’un groupe ethnique (art. 62), de la raison sociale d’une association sans but lucratif vouée aux intérêts d’un groupe ethnique (art. 71 ), la publicité peut se faire en français et dans la langue du groupe ethnique.
Les programmes de francisation des entreprises produisant des biens culturels à contenu linguistique (comme un poste de radio) doivent tenir compte de la langue de ces entreprises comme langue de travail (art. 145).
-
c) Les communications individualisées et les communications avec l’extérieur du Québec.
Peuvent utiliser une autre langue que le français les personnes physiques qui correspondent avec l’Administration (art. 15), les membres d’un ordre professionnel (art. 32) ou d’une association de salariés (art. 49) dans leurs communications écrites. Les communications orales en une autre langue que le français sont laissées au jugement des interlocuteurs.
Enfin, les communications avec l’extérieur du Québec donnent lieu aux dispositions suivantes : utilisation d’une autre langue par l’Administration publique (art. 15 et 21); et par l’entreprise (art. 143); raisons sociales dans une autre langue pour utilisation hors du Québec (art. 68); nécessité de tenir compte des ententes fédérales-provinciales, interprovinciales, ou internationales dans les inscriptions sur les produits (art. 56), de la loi constitutive d’une société en ce qui concerne sa raison sociale (art. 65), enfin des usages internationaux (art. 92). Dans les cas légitimes, l’employeur peut exiger la connaissance d’une autre langue (art. 46).
2. Stratégie de la qualité de la langue
Le principe essentiel est que, dans les sociétés industrialisées, qui se caractérisent par une organisation très diversifiée de tous les pouvoirs, politique, économique, culturel, au travers d’institutions comme l’État, les syndicats, les partis, les associations, les médias, etc., l’usage que chacun fait de la langue est fortement orienté, influencé par la langue de ces institutions. La qualité moyenne de la langue d’une population est le reflet de la langue des communications institutionnalisées et le résultat résiduel du système d’éducation.
L’expression « la qualité de la langue » signifie tout ou rien, selon le moment ou l’allure de la discussion. Pour nous[100], il s’agit d’une réalité fondée sur l’existence d’une norme objective qui définit le noyau dur du français, ce qui fait que le français est le français et non une autre langue, et en ce sens, les Québécois se savent et s’affirment de langue française; mais il s’agit aussi d’une sorte d’euphémisme pour désigner la prédominance inévitable d’une norme sociale sur une autre et l’intention de la société d’en généraliser l’usage, et en ce sens les Québécois s’identifient spontanément à une manière québécoise d’utiliser le français, plutôt qu’à la manière parisienne (dite française), d’où l’existence et l’utilisation d’un « bon français d’ici » dans les faits ou la discussion théorique autour de la définition et de la description du français québécois.
Enfin, on ne peut pas légiférer sur la qualité de la langue de la même manière que sur son statut, d’une part parce qu’il paraît odieux ou ridicule de vouloir contraindre le style d’un individu, d’autre part parce que, le voulut-on, il serait impossible de contrôler l’application de la loi. Il s’agit donc plutôt de favoriser le consensus autour d’une manière d’utiliser la langue dans certains champs ou pour certaines de ses fonctions, notamment la fonction d’intégration.
Sur cette base, s’est dégagée peu à peu une approche québécoise de la qualité de la langue, très tactique, en rupture avec le panache habituel des discours sur « la défense de la langue française ».
2.1 La valeur juridique de la langue[101]
Il faut d’abord s’interroger sur la signification linguistique et juridique des termes et expressions qui désignent dans la loi la langue officielle : le français, en français, terminologie française, connaissance appropriée du français, connaissance du français exigée par les programmes d’études, généralisation de l’utilisation du français. De quel français s’agit-il?
Dans l’esprit du législateur, il ne s’agit certainement pas de n’importe quel charabia, comme celui qui suit : « L’autorisation (la garantie)… ni couvre-t-elle l’antennae casse, nor les dommages sont causé de fair un mauvais usage ou le traitement négligent[102] », ni de n’importe quelle forme de français dite populaire. « En français » signifie « en bon français », selon la norme du français d’ici, c’est-à-dire fondamentalement le français commun, tel qu’on le trouve décrit dans les grammaires et les dictionnaires, auquel s’ajoutent les particularités admises, officiellement ou non, par la société québécoise.
Toutefois, en cas de litige portant strictement sur la qualité de la langue, la question se complique. Conformément aux mécanismes de la loi en matière d’interprétation, avocats et juges se référeront aux grammaires et aux dictionnaires pour décider de ce qui est français ou non. En cas de contestation, ils feront appel aux témoignages d’experts tels que ceux de l’Office de la langue française. Enfin, si l’infraction linguistique entraîne des conséquences graves, par exemple l’annulation d’un contrat pour vice de terminologie, il est vraisemblable que le juge fera prévaloir l’intention des parties sur la qualité du texte. Chose certaine, le défaut d’être en français et, d’une certaine manière, en bon français, constitue une infraction à la loi et encourt les peines prévues à l’article 205.
Ainsi, non seulement la loi impose-t-elle l’usage du français, mais elle favorise en outre un français de qualité dans les grands domaines tels que la législation et la justice, l’administration, le commerce et les affaires, le travail et les entreprises, l’étiquetage et la publicité, et enfin l’enseignement.
2.2 Pouvoir de la normalisation
La loi impose à l’Office de la langue française le devoir de normaliser et de diffuser les termes et expressions qu’il approuve (art. 113, par. a). Elle lui donne le pouvoir de constituer des commissions de terminologie (art. 114 et 116) pour l’aider à mener à bien les travaux de terminologie nécessaires à l’implantation du français, soit dans l’Administration, soit dans les entreprises, où la qualité de la langue et de la terminologie est partie intégrante du programme de francisation prévu aux articles 129 et 138.
Dans le domaine de la toponymie, la loi donne le mandat à la Commission de toponymie « d’établir les normes et les règles d’écriture à respecter dans la dénomination des lieux, d’établir et normaliser la terminologie géographique en collaboration avec l’Office » (art. 125).
2.3 Responsabilité du ministère de l’Éducation
Le ministère de l’Éducation est l’un des principaux responsables de la qualité de la langue. Dans tous les pays, c’est l’un de ses rôles primordiaux.
Il est responsable de la qualité de l’enseignement de la langue maternelle, à la fois par les programmes qu’il instaure et par la compétence linguistique du personnel qu’il recrute.
Il est aussi responsable de la qualité de l’enseignement du français comme langue seconde des minorités québécoises. Ceci est d’autant plus important que cet enseignement est souvent leur premier contact officiel avec la langue et la culture de la majorité. La compétence du personnel et son identification à la culture québécoise sont ici particulièrement importantes.
Il est responsable enfin de la qualité du français technique et scientifique, de même que de l’enseignement et de la diffusion des terminologies propres à chacune des sciences et des techniques pratiquées au Québec. C’est là sa participation à la francisation des entreprises. En assurant la qualité de la langue des entreprises et de celle de l’enseignement des sciences et des techniques, le législateur permet au Québec de sortir du cercle vicieux dans lequel il était enfermé, en fonction duquel l’enseignement d’une terminologie anglaise ou simplement hybride se légitimait par son emploi dans les entreprises.
2.4 Responsabilité des médias
La presse, la radio et la télévision de langue française exercent une grande influence sur les comportements linguistiques des individus. Ils diffusent au sein de la population des modèles de langue, qui se répandent et concourent à la standardisation linguistique des populations dispersées.
L’épanouissement de la minorité anglaise est favorisé par l’existence d’un réseau complet de médias, presse, radio, télévision, cinéma, que respecte la Charte. Le livre blanc sur La politique québécoise du développement culturel en assure le maintien et favorise l’accès des autres minorités aux mêmes instruments, notamment à la télévision par le moyen d’émissions en langue d’origine sur les ondes de Radio-Québec.
3. Modalités d’application et de suivi
Rien ne sert de définir une stratégie, dut-elle être inscrite dans une loi, si on ne prend pas les moyens de l’appliquer.
Dans la Charte, ces moyens sont de trois ordres : création d’organismes, fixation d’échéances ou de programmes et amendes.
3.1 Création d’organismes
Les organismes suivants sont créés :
- a) Un Office de la langue française « pour définir et conduire la politique québécoise en matière de recherche linguistique et de terminologie et pour veiller à ce que le français devienne, le plus tôt possible, la langue des communications, du travail, du commerce et des affaires dans l’Administration et les entreprises » (art. 100).
- b) Une Commission de toponymie « pour établir les critères de choix et leurs règles d’écriture de tous les noms de lieux et pour attribuer en dernier ressort des noms aux lieux qui n’en ont pas encore, aussi bien que pour approuver tout changement de nom de lieu » (art. 124).
- c) Une Commission de surveillance« pour traiter des questions se rapportant au défaut de respect » de la loi (art. 158).
- d) Un Conseil de la langue française « pour conseiller le ministre sur la politique québécoise de la langue française et sur toute question relative à l’interprétation et à l’application » de la loi (art. 186). Le Conseil doit particulièrement « surveiller l’évolution de la situation linguistique au Québec quant au statut de la langue française et à sa qualité » (art. 188).
- e) Un comité constitué par le ministre de l’Éducation pour vérifier l’admissibilité des enfants à l’enseignement en anglais et statuer à ce sujet (art. 75).
- f) Une commission d’appel pour étudier et trancher les contestations relatives aux décisions de ce comité (art. 83).
- g) Une commission d’appel pour étudier et trancher les contestations relatives à « une décision de l’Office de refuser, suspendre ou annuler un certificat de francisation » (art. 155).
- h) Des comités de francisation d’entreprises, composés d’au moins six personnes, dont au moins le tiers représentent les travailleurs de l’entreprise. Ces comités créés par les entreprises elles-mêmes sont les principaux responsables des programmes de francisation (art. 146).
3.2 Fixation d’échéances
Les dispositions de la loi sont entrées en vigueur soit au moment de la sanction de la loi, soit à des dates déterminées.
Les principales échéances qui courent encore sont les suivantes :
- a) Jusqu’au 31 décembre 1980 pour modifier les raisons sociales en conformité avec la loi (art, 65);
- b) Jusqu’au 1er septembre 1981 pour modifier à nouveau les affiches bilingues en application de la loi précédente (art. 211);
- c) Jusqu’au 31 décembre 1983 pour que l’Administration publique respecte les dispositions de la loi qui la concernent (art. 25);
- d) Jusqu’au 31 décembre 1983 pour les dernières catégories d’entreprises qui détiennent un certificat de francisation (art. 137 et 152).
3.3 Les programmes de francisation
« Les organismes de l’Administration qui ont besoin d’un délai pour se conformer à certaines dispositions de la loi ou pour assurer la généralisation de l’utilisation du français dans leurs domaines doivent adopter le plus tôt possible un programme de francisation sous le contrôle et avec l’aide de l’Office » (art. 129). Ce programme doit indiquer les mesures qu’entend prendre l’organisme, et les dates de leur entrée en vigueur.
Les entreprises de plus de cinquante personnes (art. 136) ou celles de moins de cinquante personnes désignées par l’Office (art. 151) doivent détenir avant le 31 décembre 1983 un certificat de francisation qui « atteste que l’entreprise applique un programme de francisation approuvé par l’Office ou que la langue française y possède déjà le statut » désiré (art. 138).
La procédure est en trois étapes : analyse de la situation linguistique de l’entreprise par son comité de francisation à l’aide de formulaires et de questionnaires uniformes fournis par l’Office (art. 149); examen du rapport de ce comité par l’Office et, s’il y a lieu, définition d’un programme de francisation (art. 150); application du programme sous la surveillance du comité de francisation et de l’Office.
3.4 Les amendes
En cas d’infraction, si la Commission de surveillance n’obtient pas du contrevenant qu’il respecte la loi, le procureur général intente les poursuites nécessaires (art. 207). La loi fixe des amendes selon qu’il s’agit d’une personne physique, d’une personne morale ou d’une entreprise lorsqu’il s’agit des certificats de francisation (art. 205 et 206).
La stratégie québécoise relative au statut et à la qualité de la langue constitue, on le voit, une expérience à la fois particulière et originale. Elle découle d’une réflexion théorique sur la régulation linguistique, d’une expérience vécue de la concurrence entre langues différentes sur le même territoire. Elle a pour objectifs de préciser et de modifier le statut des langues en présence et défavoriser l’usage d’un français de qualité comme langue commune des Québécois.
C’est l’étape décisive d’un long cheminement vers un Québec français, le témoignage d’une volonté populaire qui ne s’est jamais démentie mais qui rencontre constamment les mêmes obstacles sur son chemin.
Chapitre 5 – L’aménagement linguistique de la francophonie
Dans les chapitres précédents, nous avons voulu décrire de quelle façon et sur quelles bases théoriques les Québécois ont abordé la double question de leur relation avec le français français et l’anglais. Le moment est venu de tenter de dégager de cette expérience particulière un modèle théorique d’aménagement linguistique et, afin de vérifier à la fois l’intérêt qu’il présente et son efficacité, de le projeter sur ce qu’il est convenu d’appeler « la francophonie » en s’interrogeant sur les défis qu’elle affronte et sur ce qu’il conviendrait de faire pour qu’elle se développe au-delà du ronron habituel des rencontres panfrancophones. Par rapport à la réalité linguistique et politique du Québec et de chaque pays, réalité mouvante et échevelée, un tel modèle apparaîtra statique, trop logique, paré comme une vedette au soir de la remise des Oscars. C’est là l’aspect négatif de tout modèle, dont l’aspect positif est de servir d’outil, de guide à l’action qu’on veut ou qu’on doit entreprendre, en y intégrant les adaptations requises et les inévitables méandres.
1. Modèle théorique d’une procédure d’aménagement linguistique
L’élaboration d’un processus d’aménagement linguistique nous amène à réfléchir successivement sur les circonstances qui poussent normalement un État à intervenir dans le domaine linguistique, sur les principes qui devraient guider une telle intervention et enfin, sur le mode d’intervention lui-même.
1.1 Circonstances qui font naître la nécessité d’un aménagement linguistique
À l’origine de toute démarche d’aménagement linguistique, quelle qu’en soit la forme et malgré l’hétérogénéité apparente des diverses situations, on retrouve toujours, semble-t-il, les mêmes circonstances. En d’autres termes, l’intensité des interventions, leurs objets, les formes qu’elles prennent sont liés à certaines circonstances et déterminés par elles. Nous ramenons à trois ces circonstances-sources qui fonctionnent d’ailleurs en enchaînement : la diversité linguistique au sein d’un même pays, la concurrence entre les langues ou les variantes de la même langue au sein des institutions et enfin la conscience de cette concurrence et l’intention collective de l’ordonner, voire de l’apaiser.
La diversité linguistique du pays est très apparente lorsque coexistent, sur le même territoire national, deux ou plusieurs langues. Au Québec, le français et l’anglais. En Suisse, le français, l’allemand, l’italien, le romanche. En Belgique, le français et le flamand. Aux États-Unis, l’anglais, l’espagnol, l’italien, le français, et pour ainsi dire toutes les langues d’Europe, en des minorités culturelles plus ou moins nombreuses et vivantes. En France, le français, l’alsacien, le breton, le basque. À dessein, nous signalons des exemples de multilinguisme dont les uns sont associés dans l’esprit d’à peu près, tout le monde à une politique linguistique (Québec, Suisse, Belgique), les autres pas (France, États-Unis), même si, en fait, il en existe une. Moins évidente, la diversité linguistique due à l’existence de variantes d’une même langue, variantes dialectales ou variantes socioculturelles, entraîne des actions d’aménagement linguistique. L’exemple le plus connu est celui de la lutte entre le français de Paris et les dialectes à partir surtout de la Révolution française. On pourrait aussi citer le cas des rapports entre les dialectes wallons et le français en Belgique[103]. Dans tous les pays, pour toutes les langues, la stratification sociale plus ou moins complexe, plus ou moins marquée, se manifeste par une plus ou moins grande variation linguistique. La variété de langue qui agit comme norme est toujours celle du groupe dominant, la chose allant habituellement de soi, du moins le croit-on. La diversité linguistique du pays est une condition de base de l’aménagement linguistique.
Le besoin d’un aménagement linguistique s’accroît selon l’intensité de la concurrence entre les langues ou entre les variétés de la même langue, manifestation de la concurrence entre les groupes. Ainsi, aux États-Unis, la concurrence est pour ainsi dire nulle entre, disons, l’italien ou le français et l’anglais; elle est plus marquée entre l’espagnol et l’anglais, surtout à l’ouest du pays, mais pas encore au point de nécessiter la définition explicite d’une politique linguistique générale. En Suisse, le partage du pays en zones linguistiques unilingues, avec la pratique du multilinguisme dans les institutions fédérales, a réglé d’une manière satisfaisante la question des langues. En Belgique, la division du pays en deux zones linguistiques a donné d’excellents résultats; c’est l’ambiguïté de la région de Bruxelles, où vraiment les deux langues sont en présence, qui agit comme catalyseur de la querelle linguistique. Au Québec, le français et l’anglais étaient, sont et seront toujours en concurrence, d’où la nécessité évidente et constante de règles de jeu claires et précises. Cependant, l’exemple du même Québec indique que la concurrence entre les langues n’est pas une condition suffisante à une entreprise d’aménagement linguistique, puisque ce n’est que tout récemment qu’on y a eu recours.
En fait, la condition déterminante est la conscience de cette concurrence et le désir d’intervenir, non seulement chez quelques personnes, mais dans de larges secteurs de la population. La réalisation de cette condition est elle-même assujettie à d’autres facteurs difficiles à identifier, à circonscrire. À ce stade de notre réflexion, nous estimons que les facteurs suivants sont importants. Au premier chef, le type d’organisation politique du pays qui règle la manière dont se définissent les projets de la collectivité. Au Québec, la démocratie et le parlementarisme de type britannique ont fait que le débat linguistique a été public, d’où le recours à la technique des commissions d’enquête et la succession des projets de loi, toujours accompagnés d’une commission parlementaire et d’un intense débat, rendant possible le jeu de toutes les influences, sous toutes les formes. Les choses ne se passent pas ou ne peuvent évidemment pas se passer de la même manière dans un pays de type socialiste à parti unique comme l’Algérie, ou à régime monarchique comme le Maroc, ou présidentiel comme la plupart des pays d’Afrique noire. Le niveau de scolarisation et d’éducation de la population nous apparaît comme un facteur également important d’une part pour saisir le lien entre l’organisation sociale et la pratique linguistique et, d’autre part, pour participer pleinement au débat, le cas échéant, par la parole, l’écriture et la lecture, en somme par l’information reçue et émise. Ainsi, il se crée une certaine dynamique entre les agents sociaux, dynamique devant déboucher peu à peu sur un certain nombre de consensus, notamment par le dialogue entre les hommes politiques, les spécialistes des questions linguistiques, les corps intermédiaires (sociétés commerciales, entreprises privées, associations diverses, syndicats, etc.) et la nation. Enfin, le degré de dépendance ou d’indépendance économique et politique du pays par rapport à d’autres pays, à travers la relation linguistique. Par exemple, la définition d’une politique linguistique peut influencer les investisseurs étrangers ou les programmes de coopération bilatérale. Il s’agit moins d’indépendance politique que d’indépendance économique, c’est-à-dire à la fois de l’intégration à une économie étrangère (par exemple, l’intégration de l’économie québécoise à l’économie canadienne et américaine) et de la forme de cette intégration, surtout en ce qui concerne la direction des établissements et leur marge d’autonomie par rapport au siège social.
En somme, certaines conditions éveillent la conscience linguistique et poussent à l’action. Toute la question est maintenant de savoir comment infléchir la concurrence linguistique dans la direction désirée.
1.2 Principes de l’aménagement linguistique[104]
Ces principes sont de deux ordres. Les premiers ont trait à la manière dont une langue ou une variante d’une langue en arrive à s’imposer dans les pratiques linguistiques d’une collectivité nationale. Les seconds concernent la manière de procéder à l’établissement d’un plan d’organisation linguistique d’un État; ils sont prospectifs et immédiatement orientés vers l’action, vers la prise de décisions. Les premiers dépendent d’une théorie générale de l’usage linguistique, dont les composantes principales sont l’analyse des fonctions de la langue (chapitre 3, 2.), la distinction entre communications individualisées et institutionnalisées (chapitre 3, 3.), l’intégration du comportement linguistique dans une théorie globale des comportements sociaux, ce qui permet d’analyser la question de la norme sous le même angle et avec le même appareil que tout modèle de comportement social (chapitre 3, 4.). Les seconds découlent immédiatement de l’expérience québécoise.
Nous en sommes arrivé à réduire à deux grands principes le processus par lequel une langue, ou une variante d’une langue, prédomine ou s’impose comme norme.
Premier principe (principe de la globalité) : ce sont les communications institutionnalisées qui déterminent une situation linguistique et non les communications individualisées. En d’autres termes, le comportement linguistique des institutions politiques et économiques détermine à la longue, s’il est constant et identique, la prédominance d’une variante ou d’une langue sur les autres. Tout particulièrement, nous croyons que trois groupes d’institutions exercent, à cet égard, une influence décisive. Ce sont : le système scolaire (langue d’enseignement et enseignement de la langue), l’administration publique (langue des lois, des décrets, des règlements, des directives, des formulaires, etc.) et le monde de l’économie, du commerce et de l’industrie (langue des plans, des procédés, des directives, des catalogues, des modes d’emploi, de l’étiquetage, etc.). Le comportement linguistique de l’individu est façonné par ses contacts nombreux, répétés et pour ainsi dire officiels avec la langue des institutions.
En conséquence, lorsqu’on souhaite modifier une situation linguistique ou en orienter l’évolution, il faut contrôler le comportement linguistique des institutions. Il est dangereux de faire peser le changement linguistique sur les individus. Leur responsabilité, en la matière, est trop limitée. Le recours exagéré à la responsabilité de l’individu pour obtenir des changements significatifs à une situation linguistique donnée ne saurait que susciter une sorte de sentiment d’impuissance collective et provoquer la dégradation accélérée de cette situation, comme le Québec l’a fort bien expérimenté entre la fin du XIXe siècle et le début des années soixante.
Second principe (principe des images) : réalité abstraite d’une grande complexité, toute situation linguistique se révèle à la population par certaines de ses manifestations qui jouent alors le rôle d’images collectives. Dans le processus même de l’édification de la personnalité, chaque individu construit à l’intérieur de lui-même une certaine image de son être linguistique, image qui sera à la base de ses attitudes et de ses comportements, et ce, à partir des nombreuses images extérieures qu’il capte d’abord dans sa vie familiale, puis dans la vie de son entourage immédiat et, enfin, dans sa propre vie sociale dont le premier contact se situe au niveau de l’école. Il est indispensable qu’une certaine cohérence s’établisse entre les images collectives et l’image intérieure, c’est-à-dire l’image que l’individu a de lui-même. Sinon, il y a risque de schizophrénie linguistique, provoquée par l’incapacité d’intégrer la succession des images linguistiques distinctes, l’individu étant à la quête d’une réponse à la double question : de quelle langue suis-je? de quelle(s) langue(s) dois-je ou devrais-je être?
Dans la perspective d’un aménagement linguistique cohérent, certaines images linguistiques collectives nous semblent plus particulièrement importantes. Ce sont, en tout premier lieu, la langue des premières années de scolarité; ensuite, celle de l’affichage, de la publicité, des raisons sociales, la langue des médias, surtout de la radio et de la télévision; enfin, le vocabulaire et la terminologie, seule surface visible, sensible de la langue pour le plus grand nombre d’usagers de la langue.
Les principes qui guident la manière de procéder à l’établissement d’un plan d’organisation linguistique sont en réalité fort simples mais lourds d’implications politiques, sociolinguistiques et budgétaires.
Premier principe. Toute intention d’aménagement linguistique suppose une connaissance approfondie de la situation linguistique de départ, à la fois à un certain niveau d’abstraction, pour dégager les lignes de force du paysage, et dans le détail, pour bien fonder la vue générale.
Puisqu’il y a toujours un fort danger d’impressionnisme à cet égard, provenant aussi bien de la complexité du phénomène que du jeu inconscient des « a priori » et des préjugés, il vaut mieux procéder à une description détaillée de la situation avec le maximum de rigueur méthodologique. Toutes les grandes fonctions de la langue doivent être l’objet d’un examen. L’équipe responsable de cette description doit être largement multidisciplinaire.
Il s’agit ici uniquement de décrire ce qui est, non de choisir ce que l’on veut qui soit. À cette étape-ci, le choix est prématuré. L’objectif est que le plus grand nombre de personnes comprennent la situation et réfléchissent aux choix possibles, en soupesant les avantages et les inconvénients de chacun et de tous. Toute cette activité d’enquête, d’information, d’animation joue un rôle primordial dans la formation d’un consensus social en matière de langue. Cette période peut durer plus ou moins longtemps.
Deuxième principe. À partir de la description de la situation de départ, il faut ensuite définir les caractéristiques de la situation jugée souhaitable et qui sera considérée comme « situation cible ».
Cette démarche implique une relation étroite entre les spécialistes qui ont établi la description, ou du moins certains d’entre eux, et les responsables politiques du pays. Alors que les premiers ont la responsabilité de fournir aux seconds les éléments d’information propres à fonder des choix politiques éclairés, il revient à ces derniers de faire ces choix et de leur donner un statut juridique sous forme de loi, de décret, de règlement, de directive, etc. De plus, il est primordial que ces choix politiques fassent l’objet d’un large consensus, qu’ils reçoivent l’adhésion d’un grand nombre d’usagers et qu’ils représentent véritablement et sans ambiguïté aucune un projet collectif. L’étape précédente ayant fourni à l’ensemble de la population de nombreux éléments d’information, l’homme politique se doit, à partir de ces éléments, d’exposer le bien-fondé de ses choix; c’est là la condition du succès de sa politique linguistique.
Il vaut mieux aborder d’un seul coup tous les domaines d’emploi de la langue à cause de leurs interactions. L’approche sectorielle est dangereuse. L’exemple le plus probant est de réduire la politique linguistique au seul domaine de l’éducation : enseignement de la ou des langues maternelles, enseignement des langues non maternelles, choix de la ou des langues de l’alphabétisation, sans se préoccuper de la ou des langues de l’administration, du travail et de l’économie, des médias. On risque ainsi d’introduire dans l’enseignement ou l’alphabétisation une ou des langues qui ne trouveront aucun emploi institutionnel une fois apprises, d’où la réaction négative de la population à l’égard d’un objectif en soi louable.
Troisième principe. Une fois la situation cible définie, il convient de mettre au point une stratégie qui permettra de passer de la situation de départ à cette situation cible. Cette stratégie doit être originale puisqu’elle correspond à une situation de départ et à une situation cible particulières, les expériences des autres ne pouvant alors servir que de sources d’inspiration ou de stimulants à l’imagination et à la volonté d’action. Elle doit être orientée, selon nous, en fonction de quatre facteurs que nous estimons fondamentaux, à savoir le temps, le mode de contrôle du processus de changement, les travaux nécessaires à sa mise en place et les ressources financières adéquates.
Le temps. Il serait faux de considérer comme acquis que tous les éléments de la stratégie sont immédiatement applicables. Certains le sont, il est vrai, mais la plupart exigent des délais plus ou moins longs, soit qu’il faille mener certains travaux préliminaires, comme réunir la terminologie ou produire le matériel pédagogique indispensable, soit qu’il y ait lieu de former un personnel cadre inexistant, soit enfin qu’il s’avère nécessaire de réduire les coûts qu’entraînerait pareil changement, en ne modifiant par exemple la langue des formulaires qu’au fur et à mesure de leur réimpression. Il n’y a certes aucun avantage et beaucoup d’inconvénients à brusquer les choses. L’essentiel est de fixer l’échéance de chacun des éléments de la stratégie.
De plus, les objectifs de l’aménagement linguistique évoluent avec la situation linguistique elle-même, comme nous l’avons constaté dans le cas du Québec. Il s’agit ici d’un processus en constante évolution, dont l’essentiel, dans la perspective où nous nous plaçons, est d’additionner les possibles, dans le lent travail de façonnement d’une société meilleure et plus juste.
D’où la nécessité absolue d’un mode de contrôle administratif du processus de changement. Les principales personnes, physiques ou morales, responsables de prendre les dispositions propres à réaliser la politique linguistique, doivent rendre compte, périodiquement, des mesures qu’elles ont prises à cette fin à une personne ou à un organisme dûment mandaté et doté d’autorité. Cette disposition correspond à deux besoins : veiller à ce que la politique linguistique se traduise dans les faits, assurer la continuité et de la politique et de son application.
Enfin si l’on veut atteindre la situation cible, il y a lieu de mettre en œuvre divers travaux. Il importe d’abord de départager soigneusement les tâches qui incombent à l’État de celles qui doivent être assumées par le secteur privé. Parmi celles de l’État, nous citerons la préparation du matériel pédagogique, des formulaires de gestion et certains travaux de terminologie. Quant au secteur privé, il devrait assurer entre autres la mise au point de l’étiquetage et de la publicité, de même que le recrutement et la formation du personnel qui sera affecté à la rédaction et à la traduction de la documentation administrative et technique. L’État doit donc prévoir à son budget les crédits nécessaires à la mise en place de sa politique linguistique, essentiellement en ce qui a trait au fonctionnement de l’organisme ou des organismes de contrôle, à la mise en œuvre des travaux qui lui incombent et enfin à la mise en application de cette politique au sein de ses ministères, notamment le ministère de l’Éducation.
1.3 Mode de réalisation de l’aménagement linguistique
Nous constatons que les manières dont se fait effectivement l’aménagement linguistique des pays varient beaucoup en elles-mêmes, et d’un pays à l’autre.
La méthode la plus répandue est celle de la libre concurrence des communications institutionnalisées. Les seules interventions de l’État portent sur l’enseignement : on ne peut éviter de choisir une ou des langues d’enseignement, ni de décider lesquelles on enseignera comme langues non maternelles; et sur l’administration publique : choix de la langue ou des langues officielles, usage des langues dans les communications entre l’État et les citoyens, les entreprises, les autres États. Le secteur privé est laissé totalement libre dans ses comportements linguistiques, surtout dans le commerce et l’industrie. La situation linguistique se régularise alors par le jeu des forces politiques, économiques et démographiques.
Il arrive aussi que l’intervention de l’État se fasse dans des domaines en apparence étrangers à la politique linguistique. Il s’agit en somme de gestes d’aménagement linguistique partiels et indirects, qui souvent passent complètement inaperçus[105]. Par exemple, la France a légitimé par le souci de la protection du consommateur sa législation linguistique en matière d’étiquetage. La plupart des pays ont statué sur l’usage des langues dans le commerce international et, notamment, sur la ou les langues d’importation. Le problème des travailleurs étrangers a amené beaucoup d’industries et de pays européens à préciser leur politique linguistique. Enfin, exemple peut-être extrême mais significatif, un syndicat de pilotes s’opposait récemment à l’usage du français dans les communications air/sol au nom de la sécurité des passagers.
L’aménagement linguistique pourrait finalement être explicite et global, mais du fait de la complexité même de cette entreprise et de ses incidences politiques, c’est là une solution peu fréquente.
2. Les défis de la francophonie
La francophonie ne va pas de soi. Ce n’est pas parce que, au hasard de l’histoire, plusieurs pays ont été appelés à partager la même langue qu’ils constituent nécessairement une sorte de club, gardiens d’intérêts communs et assurant un réseau de relations suivies. Il n’existe pas que nous sachions de club des pays de langue espagnole ou portugaise. En fait, la religion unit davantage que la langue, comme en témoignent d’ailleurs les pays islamiques.
L’idée de la francophonie a été lancée immédiatement après la décolonisation, soit dans des circonstances troubles qui font que le terme même de francophonie est équivoque et que, pour plusieurs, il sent le néo-colonialisme, un peu comme le diable sent le soufre dans les contes populaires. En fait la francophonie en est encore au stade où, quoique née, sa survivance n’est pas assurée et ce, à notre avis, en raison de l’ambiguïté du concept même de francophonie et des objectifs qu’elle entend poursuivre.
Nous constatons que la francophonie fait face à deux défis fondamentaux : le multilinguisme et la diversité linguistique, dont on parle en utilisant une terminologie dont le moins qu’on puisse dire est qu’elle n’est pas innocente.
2.1 Le multilinguisme
Le multilinguisme est la règle générale des pays dits francophones. Hors de France, le français est toujours en contact avec une ou plusieurs langues sur le même territoire, donc en relation avec des aires culturelles et linguistiques plus ou moins grandes, de plus ou moins grand prestige, auxquelles s’identifient à des degrés variables les individus, les communautés, les États. Le statut du français est divers : langue maternelle (au Québec, avant la Loi sur la langue officielle), langue maternelle officielle (au Québec depuis lors, en Suisse, en Belgique), langue officielle non maternelle (dans les pays d’Afrique noire, les Antilles, l’océan Indien), langue non officielle de grand prestige, en général en concurrence avec l’anglais (dans les pays du Maghreb : Tunisie, Algérie, Maroc). Le statut des langues en présence avec le français est également varié : langue maternelle officielle (comme le flamand en Belgique, l’arabe au Maghreb, l’anglais au Québec par rapport à l’ensemble du Canada, où le français et l’anglais sont langues officielles), langue maternelle non officielle (comme l’anglais au Québec proprement dit, où seul le français est langue officielle; comme aussi le plus grand nombre des langues africaines en Afrique noire), langue officielle non maternelle (comme l’anglais au Cameroun), langue de grand prestige en concurrence avec le français (comme l’anglais au Québec, par rapport cette fois au bloc anglophone d’Amérique du Nord). Ces situations de multilinguisme sont sources d’une dynamique complexe d’attitudes à l’égard du français et à l’égard des autres langues, et de rapports naturels, consentis, obligés de chacun et de l’État avec le français et avec les autres langues.
En France, il existe, en apparence, une forte situation d’unilinguisme. En fait, on y constate la présence et la persistance d’aires linguistiques et culturelles allogènes[106], l’alsacien, le breton et le basque, dont les statuts sont indéfinis et dont les rapports avec le français sont sources de tensions plus ou moins vives. Par ailleurs, le français, en France même et dans le reste du monde, est en relation et en concurrence avec l’anglais, dans des secteurs bien particuliers, par exemple la langue de travail de certains sièges sociaux, la langue technique de certaines industries, en général de pointe, comme l’électronique ou l’informatique, la langue des publications scientifiques, la langue des grandes organisations internationales, comme l’UNESCO ou la Communauté économique européenne. Pour préciser le concept d’unilinguisme apparent, on pourrait évoquer l’exemple des États-Unis, symbole de l’unilinguisme, alors qu’en fait, il s’agit là aussi de multilinguisme, dont les éléments sont : l’espagnol (surtout à l’ouest), l’italien, le français (en Louisiane et les États de la Nouvelle-Angleterre), enfin la diaspora de toutes les langues d’Europe, en colonies culturelles plus ou moins nombreuses et organisées. Toutefois l’anglais n’y fait face à aucune concurrence, pas même de l’espagnol, et est fortement soutenu par son statut de langue dominante mondiale.
Les problèmes que pose le multilinguisme à la francophonie sont à la fois d’ordre international et national.
Sur le plan international, il s’agit davantage d’une question d’objectif, soit de la manière d’envisager et de résoudre le multilinguisme. Il existe à cet égard deux tendances nettement distinctes. La première vise la forme la plus complète possible d’unilinguisme français, alors que la seconde cherche à établir une relation d’équilibre entre le français et les langues avec lesquelles il doit coexister.
Chacune de ces tendances est affirmée et défendue, officiellement ou officieusement, aussi bien par des Français de France que par des Québécois, des Belges, des Africains ou des Arabes, ce qui explique l’emploi de l’expression « débat international ». En fait, la francophonie est divisée en deux grands courants qui permettent toutes les formes de compromis possibles.
La première tendance aspire à faire du français, et ce de façon générale, la seule langue des communications institutionnalisées, indépendamment de la situation linguistique de départ. Elle propose donc cet objectif à tous les pays et à tous les membres de la francophonie. Il s’ensuit, en conséquence, une stratégie consciente ou inconsciente qui vise à instaurer ou à généraliser l’unilinguisme français, d’une part par la généralisation de l’usage exclusif du français dans l’enseignement de même que dans toutes les communications institutionnalisées (administration, presse, radio, télévision, affichage public, raisons sociales, industrie et économie) et d’autre part, par la réduction des langues du pays à un statut d’infériorité et, il va sans dire, la restriction de leur usage aux seules communications individualisées affectives ou familiales, donc surtout à leurs fonctions intégratives, esthétiques et ludiques.
Le danger d’une telle stratégie est de faire du français une langue d’oppression et, en contrepartie, de convertir la langue ou les langues nationales en cause en langues de la révolte politique, économique ou culturelle dans le grand courant mondial d’identité culturelle et d’autonomie nationale que nous connaissons présentement. L’exemple type de la confusion entre français-langue et français-pays, du rejet du français en même temps que d’un système politico-économique, est celui de l’Algérie où la première phase de la révolution a voulu substituer l’arabe au français pour tout et en tout, c’est-à-dire opposer un unilinguisme apparent à un autre.
La seconde tendance recherche une relation d’équilibre entre les langues en présence y compris, il va sans dire, le français. Elle poursuit donc comme objectif une forme de bilinguisme ou de multilinguisme fonctionnel (chapitre 3, 1.c) adaptée à la situation de départ et conforme à la situation souhaitée. Elle débouche en général sur une démarche du type aménagement linguistique, qu’elle soit ou non systématique, dont les grands axes sont actuellement la politique d’enseignement des langues maternelles, du moins dans les premières années de scolarité, le choix des langues à « officialiser » dans le cas où elles sont très nombreuses, comme il arrive en Afrique noire, ce qui signifie le choix d’une ou de plusieurs langues selon les fonctions et les domaines d’utilisation (domaines d’unilinguisme, de bilinguisme, de multilinguisme). Le danger le plus immédiat de cette tendance est le manque de rigueur, l’impressionnisme à la fois de l’analyse de la situation et de la définition des objectifs, ce qui fait que les politiques vont sans cesse cahin-caha.
Cette seconde tendance engendre des appréhensions. Certains, surtout des francophones de naissance, craignent que l’utilisation généralisée des langues nationales entraîne comme conséquence à long terme le passage à l’anglais comme langue seconde de grande diffusion au détriment du français. D’autres, en général des hommes politiques, influencés par la relation étroite que la Révolution française a établie entre unité politique et unité linguistique, l’une n’allant pas sans l’autre dans la forme la plus pure de ce mythe, redoutent que la reconnaissance des langues confirme la division du pays en zones linguistiques et compromette ou rompe l’unité nationale.
Sur le plan national, le problème du multilinguisme se situe à deux niveaux : statut du français (donc l’aspect participation à la francophonie) et statut des autres langues. Qu’on le veuille ou non, ces questions se posent et il est souhaitable que les réponses soient lucides et clairvoyantes. Malheureusement, on a l’impression que les discussions se font aujourd’hui soit à l’ombre des institutions politiques, soit sous le couvert des slogans, souvent en contradiction avec les politiques réelles.
Nous ne pouvons donc que constater l’importance que devraient revêtir les thèmes du débat panfrancophone sur le multilinguisme. Le malheur, c’est la multiplicité et la variété des situations linguistiques existantes, la connaissance qu’en a le public n’étant que fragmentaire et les termes mêmes du débat prêtant à des interprétations différentes. En réalité, ce débat n’a vraiment jamais eu lieu; la francophonie n’a pas d’objectif clair et défini en matière de multilinguisme.
2.2 La diversité linguistique
La langue française, comme toute langue de grande diffusion, prend une coloration particulière selon les pays (variation géographique), les couches sociales (variation socioculturelle) et les époques (variation temporelle). Les variables peuvent être d’ordre phonétique et prosodique (la source première du préjugé de l’accent), d’ordre syntaxique (difficile à percevoir et à analyser), d’ordre lexical, ce qui est le gros de l’affaire, le cœur de la notion de français régional. Là-dessus, presque tout le monde est d’accord. Ce qui est intéressant et important, c’est ce qui s’en suit, c’est-à-dire les problèmes que la diversité linguistique pose aujourd’hui à la francophonie. Nous en ferons rapidement le tour, le tableau d’ensemble nous intéressant ici davantage que l’exposé de détail de chaque question.
-
a) L’inventaire et la description des usances (des variantes, voir Piron[107])
La démarche en « isme » est encore aujourd’hui très pratiquée. Nous entendons par là la sélection, à même un système linguistique global, d’éléments que l’on juge propres à un usage régional du français ou caractéristiques de cet usage et que l’on qualifie de « canadianismes », « québécismes », « belgicismes », « helvétismes », « africanismes », etc. selon la provenance. Elle est la résultante de choix plus ou moins impressionniste qui favorise les faits de langue les plus apparents tels que les formes lexicales ou la phonétique, dictés en fonction de critères de type normatif plus ou moins bien établis, d’où l’épithète « de bon aloi » qui qualifie souvent de telles expressions, « canadianismes de bon aloi » par exemple. C’est une démarche de grammairiens, d’amateurs de beau langage plutôt que de linguistes ou de lexicographes. Elle a suivi, presque partout, la même évolution, qui a connu trois phases successives : la phase péjorative, la phase sélective et enfin la phase descriptive. La phase péjorative considère le « isme » comme une forme fautive, du type « Dites… ne dites pas… »; par l’adjonction de l’épithète « de bon aloi », la phase sélective n’entérine que certains « ismes », ce qui fait que ceux qui ne sont pas dits « de mauvais aloi » n’ont en fait aucun statut; enfin, la phase descriptive, récente, entend tout simplement faire l’inventaire, sans juger de ce qu’on doit décider de chaque forme du point de vue de l’usage institutionnalisé mais qui comporte tout de même un choix puisque manifestement, on ne met pas tout dans l’inventaire.
La démarche en « isme » est sans doute une étape nécessaire, mais elle ne peut nous fournir une description rigoureuse et fiable du français régional. Il y aurait lieu, pour ce faire, d’y substituer une analyse linguistique stricte qui, pour des raisons évidentes de comparaison des résultats, devrait nécessiter une concertation entre spécialistes, tout au moins sur le choix des appareils de description de la langue. Nous ne pouvons que déplorer l’absence d’une méthodologie de la description globale du français régional, c’est-à-dire une méthodologie de la construction du français commun dit « universel », à un niveau d’abstraction qui fasse l’objet d’un certain consensus, un peu à la manière de celui qui a favorisé les travaux de dialectologie.
-
b) La question de la norme (chapitre 3, 4.)
Elle se pose aux niveaux théorique et pratique. La discussion au sujet du concept de norme est à peine amorcée. Les linguistes ont toujours mal réagi à cet égard pour plusieurs raisons. Intéressés surtout à la description du système, ils ont senti le besoin de se démarquer par rapport aux grammairiens et au concept de « bon usage », étant eux-mêmes descriptivistes et peu enclins à intervenir dans les mécanismes de la régulation linguistique qui les intéressent peu et que d’ailleurs ils connaissent mal. Ce qui n’empêche pas que la régulation linguistique existe, que l’usage en est un résultat et non un principe et qu’il faudra éventuellement en faire l’analyse et en élaborer la théorie, soit autant de responsabilités qui incombent aux sociolinguistes, aux anthropologues, aux sociologues, enfin à tous ceux qui s’intéressent à la fois à la communication et à l’organisation de la vie en société.
Sur le plan pratique, beaucoup de personnes, qui ne sont pas des linguistes, ont sans cesse des choix linguistiques à faire dans l’exercice normal de leurs métiers ou de leurs responsabilités. Ces choix, et leur convergence, jouent un rôle dans l’orientation de l’usage du groupe et la construction de la hiérarchie des usages linguistiques. Ils portent sur la langue qu’il faut écrire ou parler dans les médias selon les types d’articles ou d’émissions, la langue qu’il faut enseigner, la langue qu’il faut utiliser dans tous les imprimés de l’administration, la langue des communications internationales, la langue de la publicité, etc. En somme, il y a un recours obligé quotidien à la norme par un grand nombre d’usagers qui cherchent des guides, des instruments de référence, des critères de conduite et ce, dans tous les pays. C’est, pour nous, l’aspect le plus important d’une problématique de la norme.
-
c) Le monde des préjugés
Les francophones sont « divisés par la même langue », aurait pu écrire Daninos. D’instinct, ils font l’inventaire de leurs différences en oubliant presque et en sous-estimant toujours ce qu’ils ont en commun. Le préjugé par excellence c’est de croire que nous n’avons personnellement pas d’accent et de prétendre que ce sont les autres qui en ont un. Lorsque nous arrivons à prendre conscience que nous avons aussi un accent, et qu’en fait tout le monde a un accent et que cela va de soi, le second préjugé, c’est de s’imaginer que son accent est le moins marqué, le plus répandu, le plus acceptable, et de revenir, par ce biais, à l’exclusion de l’autre dans les ténèbres du mauvais accent; d’où, troisième préjugé, cette sorte de hiérarchie esthétique des accents qui manifeste soit nos sympathies, soit nos allégeances à un groupe particulier. C’est ainsi qu’on pourra aimer l’accent de Provence, mais détester l’accent alsacien, trouver charmant l’accent québécois, mais ne pas priser l’accent belge, etc. Notons le flou du mot « accent » : si on pense surtout à sons et ligne mélodique, on y fait entrer aussi le vocabulaire, la syntaxe, la stylistique; en somme c’est l’antithèse du français non marqué, neutre, idéal qui nous vient surtout à travers la langue écrite. Enfin, un dernier préjugé consiste à réclamer des autres le respect de la forme régionale de français qui est la nôtre et à se moquer des autres formes de français régionaux, fait beaucoup moins contradictoire et est plus fréquent qu’on ne le croit.
2.3 La fausse innocence de la terminologie
Une certaine terminologie est en usage au sein de la francophonie. Du fait que la valeur et le sens même de ces mots varient selon les attitudes, les objectifs attribués à la francophonie ou tout simplement selon la qualité de l’information de ceux qui les utilisent, il convient d’amorcer l’analyse critique de ces termes en indiquant les ambiguïtés que nous y voyons à la suite d’une fréquentation assidue des lieux de la francophonie.
- Francophone.
- De par sa composition, francophone désigne celui qui parle français. C’est un peu court : à ce compte, l’anglophone qui a appris le français comme langue étrangère est un francophone, puisqu’il parle français. Si nous ajoutons « … comme langue maternelle », la définition est meilleure, mais pas encore satisfaisante, puisque beaucoup d’Africains, d’Antillais, d’Arabes se conçoivent comme francophones sans avoir le français comme langue maternelle; à cause du multilinguisme de leur pays, ils participent à deux ou plusieurs mondes linguistiques. Il faudrait en fait que la définition retienne l’élément de fréquence dans l’usage du français, donc de la distribution des langues selon les domaines ou les fonctions, et qu’elle intègre l’appartenance et la participation à un univers culturel de grande extension. Chose certaine, la définition ne doit pas être telle qu’elle oblige l’individu à choisir entre langue maternelle et langue française, car ce serait en contradiction explosive avec le fait du multilinguisme, mais en harmonie avec la tendance unilinguiste. Ce qui donnerait une définition comme celle-ci : « celui qui s’intégre et participe à un univers culturel multinational dont la langue d’usage est le français, bien que ce ne soit pas forcément sa langue maternelle ».
- Francophonie.
- Le mot francophonie subit en ce moment les contrecoups de la décolonisation, du zèle des tenants de la tendance unilinguiste, enfin de la confusion entre « français » signifiant « appartenant ou relatif à la France » et « français » se rapportant au mot langue dans le syntagme « langue française ». Sous le couvert de la langue, il y a danger que la francophonie soit récupérée par les hommes d’affaires et les hommes politiques pour masquer une mainmise économique et politique sur certains pays; qu’elle empêche l’épanouissement des langues et des cultures nationales au nom de la langue française alors qu’en fait, cette langue est le moyen de préserver un marché et une zone d’influence. Il semble bien que le mot « francophonie » soit à ce point compromis qu’il faille en abandonner l’usage. Si on veut le réhabiliter, il faudra mettre de l’avant l’idée d’égalité des partenaires, favoriser les relations et les échanges multilatéraux, culturels et surtout économiques, sans passer sans cesse par Paris, faire de la francophonie un lieu où coexistent en harmonie plusieurs langues et cultures.
- Français, français universel, français régional, français dialectal.
- Derrière ces mots, il y a tout le malaise de la diversité linguistique : existence inéluctable de formes régionales du français, donc de normes régionales de l’usage, d’où l’éclatement du mythe d’une seule et même norme pour tous; malaise théorique et méthodologique des spécialistes face à ces phénomènes, ambiguïté des attitudes de ceux qui en parlent, il faut revenir à la marguerite : le français est la somme du français commun (tous les éléments de la langue qui sont utilisés par tous les francophones, dans toutes les circonstances et à tous les niveaux), de tous les français régionaux (variantes linguistiques d’une région) et de tous les français spécialisés (variantes des niveaux socioculturels et éléments, surtout terminologiques, des langues de spécialités). C’est plus et autre chose que le français des manuels, des dictionnaires, des ouvrages de linguistique, qui n’en sont que des fragments, des choix, des descriptions (chapitre 3, 4.c). Le français régional est un cadre de vie, la manière naturelle et coutumière de s’exprimer de personnes qui vivent ensemble : à la limite, tous les français sont des français régionaux.
- Le français universel est ou bien synonyme de français commun, ou bien une construction de l’esprit, une manière de décrire le français en y intégrant certains régionalismes selon des critères à déterminer. Chose certaine, la sanction internationale des faits de langue régionaux n’est pas nécessaire : il faut abandonner l’objectif de la reconnaissance panfrancophone des régionalismes, concrétisée par exemple par leur inscription au dictionnaire. Certains traits régionaux sont strictement de tradition locale; d’autres se diffusent avec les personnes et les choses, sans qu’on sache trop comment. Les premiers appartiennent à la norme régionale, les autres à la norme du français commun. C’est davantage une question d’attitude qu’une question linguistique.
- Le français dialectal est à la fois différent du français régional et du dialecte. À un certain moment, l’expression « français dialectal » a été utilisée dans le sens de français régional. Mais, d’une part on est revenu à un sens plus technique du mot dialecte, d’autre part ce dernier a été entaché d’une valeur péjorative qui en rend aujourd’hui l’usage difficile, surtout dans les milieux et pour les publics non spécialisés. Français dialectal s’entend aujourd’hui pour désigner les traces des dialectes, au sens diachronique strict, qu’on retrouve dans les français régionaux, ou les formes hybrides que sont devenus les dialectes à force d’être envahis de termes français.
- Créole et créolisation.
- Dans la perspective où nous nous plaçons, celle de la diversité linguistique, les mots « créole » et « créolisation » sont péjoratifs et souvent utilisés à tort, le premier pour désigner toute forme de contamination d’une langue par une autre, et le second pour en qualifier le résultat. C’est ainsi qu’aux débuts de la querelle du « joual » au Québec, certains ont soutenu qu’il s’agissait d’un créole, donc d’un processus de créolisation, ce qui paraît maintenant totalement exagéré. Il faudrait définir soigneusement ces deux termes et, comme dans le cas de « dialecte », en user avec prudence ou en restreindre l’emploi aux milieux spécialisés. Ce sont là des mots qui jouent un rôle très particulier dans l’expression des préjugés.
- Emprunt.
- Il y a ici deux problèmes distincts. D’une part, ce mot est trop vaste, ou trop flou, ou encore préstructuraliste : il sert à désigner tout passage d’un terme d’une langue dans une autre, quelles qu’en soient la fréquence (nombre total de mots empruntés), l’ancienneté (donc le degré d’intégration de l’emprunt dans le système), l’appartenance à la langue commune ou à une langue de spécialité. Peut-on vraiment parler d’emprunt lorsqu’on constate que la terminologie de pointe d’une spécialité est en forte majorité composée de termes anglo-américains? Est-ce le même phénomène que redingote, streaker ou fast food? Est-ce encore de l’emprunt quand tout le vocabulaire industriel est d’une autre langue, comme en anglais au Québec avant les programmes de francisation? D’autre part, la pratique de l’emprunt n’a jamais fait l’objet ni d’un débat ni d’une définition de politique au sein de la francophonie. Par rapport à l’anglais, les choses se présentent si différemment d’une situation linguistique à une autre, par exemple en France et au Québec, que la perception du phénomène et les attitudes sont pour ainsi dire aux antipodes : accueil de l’emprunt et snobisme de l’anglais en France, francisation des terminologies et usage restrictif de l’anglais au Québec. Par rapport aux autres langues, notamment aux langues africaines, la question ne s’est pas encore posée, ce qui se fera avec la publication de L’inventaire des particularités lexicales du français en Afrique noire[108], quand on aura en main une description suffisamment riche pour bien saisir la problématique de l’emprunt dans une conception non normative du français régional : synonymie des emprunts découlant du nombre de langues en contact avec le français, difficultés d’intégration des emprunts au système français quant à la graphie, au genre, au nombre, etc., extension limitée à l’Afrique noire ou à une région de l’Afrique noire de la plus grande partie de ce vocabulaire par sa liaison étroite avec des faits socioculturels africains, ce qui milite en faveur d’une politique du français régional sans intention de sanction internationale. Ici encore, on voit que le mot « emprunt », comme « bilinguisme », doit être utilisé avec soin et prudence. Nous avons besoin d’une nouvelle analyse du phénomène de l’emprunt, plus sociolinguistique et plus structuraliste que la seule dont nous disposons aujourd’hui, celle de Leroy.
- Normalisation, normatif.
- Les mots-clés de l’horreur, pour un linguiste! Pourtant, ces faits existent et se produisent tous les jours. Ils sont au cœur d’une théorie de l’aménagement linguistique, en ce que celle-ci nous oblige à examiner, à expliquer comment se constitue un usage linguistique. Autant il est légitime, dans la définition d’une méthodologie de la description, d’exiger du descripteur une neutralité aussi grande que possible à l’égard des faits observés, autant il est utile de chercher à comprendre les mécanismes de la régulation linguistique et admissible d’y intervenir consciemment, en sociolinguistique théorique et appliquée, plutôt que de se voiler pudiquement les yeux et laisser les forces sociales jouer aveuglément toujours au profit du plus fort. L’essentiel, pour tous, est de ne pas confondre les démarches, pour les linguistes d’assumer le fait que la langue n’est pas un seul objet de description, mais un élément stratégique de l’organisation sociale et de la concurrence entre les groupes qui constituent la société.
3. Proposition d’objectifs linguistiques à la francophonie
Ce qui précède nous amène à proposer des objectifs linguistiques à la francophonie, c’est-à-dire à expliciter et formuler ce que beaucoup pensent que devraient être ses objectifs mais qui n’a jamais fait l’objet ni d’un débat, encore moins d’une unanimité au sein des instances et des institutions de la francophonie. Nous les formulerions ainsi : coexistence des langues, coexistence des usages, sentiment et valorisation de la ressemblance.
Coexistence des langues. La francophonie doit être un lieu où, grâce au fait que la langue française sert de lien culturel et spirituel, chaque pays cherche une solution originale aux problèmes qui découlent de la multiplicité des langues sur son territoire, en dehors d’une volonté ou d’un idéal d’unilinguisme. Si, dans certains pays, le français est langue officielle et/ou langue dominante parce que langue maternelle (France, Belgique, Québec, Suisse), il n’est pas nécessaire qu’il en soit ainsi dans tous les pays de la francophonie, où le français peut fort bien être, devenir, demeurer une langue étrangère privilégiée, la langue de communication internationale choisie, une langue en équilibre fonctionnel avec une ou plusieurs autres. La francophonie doit s’engager dans une stratégie de multilinguisme fonctionnel français/autre(s) langue(s), comme le Québec s’est engagé dans une stratégie de bilinguisme fonctionnel français/anglais.
Coexistence des usages. La francophonie doit reconnaître et admettre l’existence de normes régionales de l’usage, autour d’un noyau linguistique central qui assure l’intercompréhension des pays entièrement ou partiellement de langue française, d’où la nécessité de définir une stratégie de la variation linguistique. La francophonie ne doit pas se donner comme objectif l’usage du même français pour tous, c’est-à-dire une même manière pour tous de parler français, soit en somme la plus grande illusion, la plus vaste fumisterie qui plane sur nous ou qui nous soit proposée.
Sentiment de la ressemblance. Les francophones doivent surtout valoriser ce qu’ils ont en commun sur le plan linguistique, en général les structures profondes de la langue, plutôt que de faire inlassablement l’inventaire de ce qui les distingue, en général les faits de surface. C’est strictement une question d’attitude, de point de vue, comme dans l’histoire du verre à moitié vide ou à moitié plein. La francophonie doit entraîner ses membres dans une stratégie de la tolérance, qui remplacera avantageusement celle de l’élitisme, et dans une stratégie de la performance, qui reconnaît que les critères de qualité varient avec les circonstances, stratégie préférable à celle de la culpabilité, c’est-à-dire la crainte paralysante et la mauvaise conscience des fautes.
4. Conditions du développement de la francophonie
En conclusion, nous voudrions attirer l’attention sur ce que nous pensons être les conditions du développement de la francophonie.
La francophonie ne saurait se développer sans l’observance de certaines règles de conduite de la part des pays membres. Il nous semble indispensable, au départ, que les pays membres de la francophonie se mettent d’accord sur des objectifs définis, objectifs linguistiques, politiques et économiques, le premier et le plus important étant, selon nous, la création d’un réseau préférentiel de relations économiques. Il existe actuellement un fossé qu’il est urgent de combler entre la francophonie culturelle et la francophonie politique et économique. L’essentiel n’est pas la francophonie culturelle, car elle ne peut subsister sans la francophonie politique et économique qui nous offre malheureusement l’image d’une réalité fragile, sujette à de constants tiraillements.
Une fois ce premier principe admis, la concertation de tous les pays membres s’impose sur la formulation des programmes de coopération; il importe en somme de passer de la conception bilatérale de la coopération à la conception multilatérale. Il est déplorable, en effet, de constater le degré d’incohérence qui existe au sein de la francophonie.
Il faudrait enfin mettre fin au verbalisme et cesser de se faire des illusions au sujet de l’importance des institutions. En effet, ce ne sont pas les longs discours, les grandes déclarations, les colloques, les congrès, les biennales qui font la francophonie et ce n’est pas non plus parce qu’on se donne des institutions que la francophonie existe. En réalité, la francophonie se meut dans l’abstrait; elle n’a pas encore fait la preuve de sa raison d’être. Les francophones ont-ils véritablement la volonté de faire quelque chose ensemble, au-delà des mots? C’est la question que nous nous posons au terme de cette réflexion.
Postface en guise de conclusion
Le moment n’étant pas encore venu de tirer de l’expérience québécoise d’aménagement linguistique des conclusions même provisoires, nous ne pouvons que livrer les quelques réflexions suivantes.
Ce qui frappe, lorsqu’on retrace l’évolution des idées à partir des environs de 1960, c’est chez les Québécois la continuité des aspirations, leur approfondissement constant, la recherche progressive des moyens de les réaliser. Malgré les divergences, tumultueuses parfois, l’impression d’un mouvement vers un accord profond chez les Québécois se dégage nettement, au-delà des allégeances politiques et des « partisaneries » électoralistes des formations politiques. Accord pour le français, langue officielle du Québec, contre le bilinguisme institutionnalisé et généralisé. Accord pour l’omniprésence du français dans l’étiquetage, l’affichage public, la publicité, les services publics, contre l’unilinguisme anglais. Accord pour que le français devienne une langue de promotion et de succès dans le monde du travail et de l’économie, au lieu d’être une langue de seconde zone face à l’anglais. Accord pour que les minorités, y compris la minorité anglaise, s’intègrent et participent à la culture québécoise, au lieu de l’ignorer ou de tenter de la noyer par le nombre, mais en même temps, et sans contradiction, accord pour que les minorités culturelles maintiennent le contact avec leur culture d’origine, sans devoir s’assimiler intégralement à la manière du melting pot américain. Nous sommes convaincu que les Québécois ne reculeront pas sur ces points.
Il existe incontestablement deux manières de considérer le problème des langues, du point de vue du Canada ou du Québec. En passant de l’une à l’autre, la majorité linguistique change : anglaise au Canada, française au Québec. Tout le reste s’ensuit. Les solutions convenables pour le Canada ne le sont pas pour le Québec. Le Canada, en tant que gouvernement central, s’est découvert l’obligation d’assurer certains de ses services en certains endroits dans deux langues, dites langues fondatrices, le français et l’anglais. Ce qui ne signifie pas qu’il conviendrait au Québec de déclarer le français et l’anglais langues officielles, hypothèse qu’avait envisagée Pierre Laporte en 1965 et que Jean Lesage, avec sagesse, avait écartée. Le statut du français au Québec définit par voie de réciprocité celui de l’anglais. Une politique linguistique pour le Canada, considéré comme l’ensemble des populations de cultures diverses vivant aujourd’hui sous dix gouvernements différents, implique des modifications profondes à l’actuelle constitution, comme le soutenait sans détour André Laurendeau, et comme le prouve à l’évidence le jugement récent de la Cour suprême au sujet du Chapitre III de la Charte de la langue française en imposant à deux provinces sur dix une obligation dont les huit autres sont exemptes, au nom d’une constitution qui, dans le cas du Manitoba, est un souvenir historique, puisque la minorité francophone de l’époque a été frustrée de son destin et a fondu par assimilation comme beurre au soleil d’été. Au Canada, l’unilinguisme anglais est la règle, normalement et sans problème, à un degré que le français ne pourra jamais atteindre au Québec, puisque le Québec est l’anomalie linguistique de l’Amérique du Nord. C’est le seul endroit où le français a la possibilité d’être « la » langue, la langue de la vie quotidienne et la langue de tous les secteurs d’activité; on voit mal comment il pourrait en être ainsi dans les autres provinces, où les domaines d’utilisation du français et de l’anglais sont encore à définir.
La perspective dans laquelle les Québécois se sont placés est celle de la décolonisation culturelle, politique et économique. Il ne s’agit pas ici d’esprit revanchard, comme d’aucuns le prétendent. Il s’agit de corriger des injustices réelles, démontrées et analysées par deux Commissions, de pallier les effets d’orientations prises par nos élites d’autrefois, qui n’ont pas assumé le leadership dans les domaines de l’économie et qui ont laissé y prédominer l’anglais au nom du libéralisme et par crainte de représailles. Il s’agit surtout de la recherche d’une paix sociale plus juste pour la majorité, pour la minorité anglaise, pour les minorités autochtones, pour toutes les minorités culturelles, donc en somme, d’un projet global de société, qui implique une nouvelle définition des droits et devoirs des uns et des autres.
Désireux avant tout de conserver le statu quo, les anglophones n’ont pas semblé prendre au sérieux ce projet de société nouvelle. Repliés sur eux-mêmes et bien au chaud sous le manteau du gouvernement central d’Ottawa, ils n’ont pas voulu tirer les conséquences pour eux des revendications que les Québécois exprimaient ouvertement, souvent au cours d’assemblées imposantes auxquelles la presse faisait largement écho. Nous retrouvons ici la double perspective Canada-Québec : pour les anglophones, le vrai pays, c’est le Canada, le Québec est le pays des « autres ». Sauf la communauté juive, qui a toujours été très attentive et très intéressée à ce qui se passait chez les francophones, sauf aussi la communauté italienne qui, bien que vivant en milieu francophone, a poussé à ses extrêmes conséquences le choix de l’anglais en réclamant des classes anglaises, d’où l’affrontement de Saint-Léonard, les minorités culturelles en général ont fait cause commune avec la minorité anglaise et calqué leurs comportements sur les siens. Ces attitudes entraînent un important hiatus entre l’état des réflexions chez les francophones et la conscience de leurs effets pour eux chez les anglophones et les allophones. L’avènement d’un gouvernement péquiste, l’adoption de la Charte de la langue française, l’intérêt récent des Québécois à l’égard des minorités ont provoqué chez ces dernières une sorte de brusque réveil à l’égard du fait français et leur a fait prendre conscience de la nécessité de se définir, non seulement par rapport à Montréal, « la ville aux cent illusions », mais surtout par rapport au Québec et à la nation québécoise. Nous assistons donc de leur part à une réflexion qui fait suite à celle des Québécois au cours des années soixante. Leur laisser croire que les choses pourraient redevenir ce qu’elles étaient auparavant est malhonnête et dessert autant les intérêts des minorités que de la majorité, dont les relations au lieu d’évoluer vers la compréhension réciproque pourraient fort bien devenir hostiles si les minorités compromettaient sérieusement les projets de la majorité. Grâce à la Charte de la langue française, la paix linguistique s’est établie au Québec. À quoi servirait alors de rouvrir le dossier, sinon de vouloir jouer à l’apprenti-sorcier?
Il est de la plus haute importance que les Québécois continuent à veiller au respect et à l’application de cette loi. Leur vigilance devra s’exercer d’abord à l’égard de la loi elle-même, afin de faire évoluer la situation dans le sens souhaité; à l’égard également des organismes créés par cette même loi et de leurs dirigeants, afin qu’ils s’acquittent consciencieusement de leurs mandats, surtout en ce qui concerne les projets à long terme comme la francisation des entreprises ou l’application de sanctions aux contrevenants, particulièrement en matière d’affichage et d’étiquetage. Il faudra faire échouer toute tentative d’enlever à la Charte le peu de mordant qu’elle contient, ou encore de rétablir les deux catégories d’immigrants préconisées par la loi 22, celle des immigrants de langue anglaise et celle des immigrants des autres langues, ou de revenir au principe du libre choix de la langue d’enseignement de la loi 63.
Enfin, nous formulons le vœu que les linguistes d’ici et d’ailleurs s’intéressent davantage à la théorie et à la pratique de l’aménagement linguistique, dans ses deux grands axes : la régulation linguistique et la concurrence entre les langues sur un même territoire. Ces questions sont vitales pour la francophonie.
Au Québec comme ailleurs, est intolérable la contradiction entre la langue du cœur et la langue du pouvoir économique ou politique.
Appendice 1 – Repères chronologiques
| 1957 | Un courant de pensée en faveur de l’unilinguisme français s’amorce et prend rapidement de l’ampleur, en relation étroite et équivoque avec les mouvements nationalistes favorables à l’indépendance du Québec. Ce mouvement est la riposte à la thèse du bilinguisme, à sa conséquence la plus nocive, la traduction. | |
|---|---|---|
| avril | Albert Memmi publie les premiers extraits du Portrait du colonisé, dans Les temps modernes et dans Esprit. Ce livre aura une grande influence au Québec. | |
| juin | Numéro spécial du journal Le Devoir intitulé « Alerte à la langue française ». | |
| 1959 | 21 octobre | Éditorial d’André Laurendeau, « La langue que nous parlons », qui lance l’étiquette « joual ». |
| 1960 | septembre | Publication des Insolences du frère Untel. |
| 1961 | mars | Création de l’Office de la langue française par la loi instituant un ministère des Affaires culturelles (9-10 Éliz. II, c. 23) |
| octobre | Ouverture de la Maison du Québec à Paris, par le gouvernement Lesage. | |
| 1963 | 19 juillet | Création de la Commission royale d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme, dite Commission Laurendeau-Dunton. |
| Construction, en français, du complexe hydroélectrique de la Manicouagan par Hydro-Québec. Démonstration symbolique de la possibilité de travailler en français, de la capacité de la langue française d’exprimer la technique, même de pointe. | ||
| octobre | Début de la publication de la revue Parti-Pris. | |
| 1964 | 13 mai | Création du ministère de l’Éducation. |
| novembre | Publication du Cassé de Jacques Renaud, début de la littérature dite « joualisante », qui se veut l’expression et la prise en charge du statut de langue dominée du français au Québec. | |
| 1965 | 1er février | Rapport préliminaire de la Commission royale d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme. |
| février | Signature à Paris de la première entente de coopération franco-québécoise, qui ne fera que s’intensi-fier et se diversifier par la suite. Le Québec contrebalance ainsi l’influence de l’Amérique anglophone. | |
| Pierre Laporte, en qualité de ministre des Affaires culturelles, prépare un livre blanc sur la politique culturelle, où il est question de langue (devoir de l’État, statut de langue prioritaire au français). Jean Lesage en interdit la publication et même la discussion en conseil des ministres. | ||
| 1967 | juillet | Visite du général de Gaulle au Québec. |
| 8 octobre | Publication de la première tranche du rapport de la Commission royale d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme sous le titre Les langues officielles. | |
| novembre | Première réunion des États généraux du Canada français. Affirmation solennelle du fait que « le Québec constitue le territoire national et le milieu fondamental de la nation » et qu’il dispose du droit à l’autodétermination. | |
| 1968 | février | Publication de Nègres blancs d’Amérique par Pierre Vallières. |
| 23 mai | Publication de la deuxième tranche du rapport de la Commission royale d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme. Thème : l’éducation. | |
| 1er juin | Mort d’André Laurendeau. | |
| juin | Les commissaires scolaires de Saint-Léonard adoptent une résolution qui fait du français la langue d’enseignement des immigrants installés sur leur territoire. C’est ainsi que commence l’affaire Saint-Léonard, qui se terminera avec celle du bill 63. | |
| août | Création de la pièce de Michel Tremblay, Les Belles-sœurs, par le Théâtre du Rideau-Vert de Montréal. | |
| 9 décembre | Création de la Commission sur la situation de la langue française et sur les droits linguistiques au Québec, dite Commission Gendron. | |
| 1969 | Adoption par les Communes de la Loi sur les langues officielles (S.R.C., 1968-1969, c. 54). | |
| septembre | Début des audiences publiques de la Commission Gendron, qui se poursuivront jusqu’en 1970. Environ 210 mémoires y sont présentés. | |
| Publication de la troisième tranche du rapport de la Commission royale d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme. Thème : le monde du travail. | ||
| octobre | Publication de la quatrième tranche du rapport de la Commission royale d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme. Thème : l’apport culturel des autres groupes ethniques. | |
| 23 octobre | Jean-Jacques Bertrand, premier ministre et chef de l’Union nationale, dépose devant l’Assemblée nationale le projet de loi 63 : c’est le début de l’affaire du bill 63. | |
| 20 novembre | Le bill 63 est adopté sous le titre Loi pour promouvoir la langue française au Québec (S.Q. 1969, c.9). Elle donne aux parents la liberté de choix de la langue d’instruction, quelle que soit leur origine ethnique ou linguistique. Elle marque pour la première fois l’intention du législateur d’intervenir en faveur de l’usage du français comme langue du travail et de l’affichage public, par voie d’incitation et de conseil. Elle donne à l’Office de la langue française les pouvoirs d’un commissaire. | |
| Modification du rôle de l’Office de la langue française par la Loi pour promouvoir la langue française au Québec (dite loi 63) (S.Q. 1969, c. 9, art. 4) | ||
| 1970 | avril | Le Parti libéral de Robert Bourassa prend le pouvoir. Le Dr François Cloutier devient responsable du dossier linguistique et de l’O.L.F. |
| octobre | Crise dite d’Octobre :
|
|
| 20 novembre | Directive administrative du gouvernement du Québec concernant la langue des communications en vue « d’uniformiser l’usage des deux langues officielles par les ministères et organismes du gouvernement dans leurs relations avec l’extérieur ». Reproduite en annexe B du tome 2 Les droits linguistiques du Rapport Gendron. | |
| 1972 | février | Intégration de l’Office de la langue française au ministère de l’Éducation, par le passage du ministre François Cloutier du ministère des Affaires culturelles à celui de l’Éducation. |
| automne | Diffusion d’une édition québécoise du Portrait du colonisé de Memmi, suivi de Les Canadiens français sont-ils des colonisés? | |
| 31 décembre | Remise du Rapport Gendron au gouvernement. | |
| 1973 | Début de la publication d’un certain nombre des études commandées par la Commission Gendron. | |
| 1974 | 31 juillet | Adoption de la Loi sur la langue officielle (dite loi 22), L.Q. 1974, c. 6. |
| Création de la Régie de la langue française par la Loi sur la langue officielle. | ||
| Abolition de l’Office de la langue française au profit de la Régie de la langue française par la Loi sur la langue officielle. | ||
| 1976 | Début de la bataille judiciaire des « gens de l’air » pour l’usage du français dans les communications aériennes, en vertu de l’article 2 de la Loi sur les langues officielles du Canada. | |
| 15 novembre | Le Parti québécois de René Lévesque prend le pouvoir. Le Dr Camille Laurin devienttitulairedu dossier linguistique. | |
| 1977 | mars | Publication d’un livre blanc sur La politique québécoise de la langue française par le Dr Camille Laurin, ministre d’État au Développement culturel. |
| avril | La Fédération des Francophones hors Québec publie un manifeste sous le titre Les héritiers de lord Durham. | |
| 26 août | Adoption de la Charte de la langue française (dite loi 101), L.Q. 1977, c. 5. | |
| Création d’un Office de la langue française (deuxième version) par la Charte de la langue française. | ||
| Création d’une Commission de surveillance de l’application de la Charte. | ||
| Création d’un Conseil de la langue française. | ||
| Création d’une Commission de toponymie. | ||
| Abolition de la Régie de la langue française. | ||
| 1979 | janvier | Publication de la première tranche du rapport de la Commission de l’unité canadienne, dite Commission Pépin-Robarts. La deuxième tranche paraît en février, la troisième et dernière en mars. |
| août | Rapport de la Commission d’enquête sur les communications aériennes : l’usage du français est déclaré sécuritaire. |
Appendice 2 – Chronologie des principales législations ou réglementations québécoises relatives à l’emploi de la langue française
Contrats (langue des)
- 1) Loi de la protection du consommateur, L.Q. 1971, c. 74, art.4et65.
- 2) Loi de ia protection du consommateur, L.Q. 1974, c. 6, art. 33.
- 3) Loi de la protection du consommateur, L.Q. 1977, c. 5, art. 55.
Étiquetage (langue de l’)
- 1) Règlement sur les fruits et légumes frais, Gazette officielle du Québec, 3823 (NO 28, 16.07.1966) art. 22.
- 2) Règlement sur les aliments, Gazette officielle du Québec, 2507 (NO 15, 15.04.1967) art. 38.
- 3) Règlement sur les succédanés de produits laitiers, Gazette officielle du Québec, 1332 (NO 8, 21.02.1970) art. 46.
- 4) Règlement relatif aux normes de composition et à l’emploi de vitamines dans les produits laitiers, Gazette officielle du Québec, 1441 (NO 9, 28.02.1970) art. 18.
- 5) L.Q. 1974, c. 6, art. 34.
- 6) L.Q. 1977, c. 5, art. 51 et 54.
Professions (langue des)
Spécification des exigences linguistiques pour l’admission à l’étude et à l’exercice d’une profession.
- 1) S.R.Q. 1964, c. 246.
- 2) L.Q. 1970, c. 57.
- 3) L.Q. 1973, c. 43.
- 4) L.Q. 1974, c. 6, chap. II.
- 5) L.Q. 1977, c. 5, chap. V.
Raisons sociales (langue des)
Spécification de la ou des langues des raisons sociales.
- 1) S.R.Q. 1964, c. 31.
- 2) L.Q. 1974, c. 6, chap. IV.
- 3) L.Q. 1977, c. 5, art. 63 à 71.
Travail (langue du)
Spécification de la ou des langues des relations de travail.
- 1) S.R.Q. 1964, c. 141, art. 51.
- 2) L.Q. 1974, c. 6, chap. lll.
- 3) L.Q. 1977, c. 5, chap. VI.
Toponymie
- 1) Loi de la Commission de géographie, S.R.Q., 1964, c. 100.
- 2) L.Q. 1977, c. 5, chap. lll.
Bibliographie
Lorsque plus d’une date apparaît, la première est celle, par exemple, où une communication a été prononcée et la dernière, celle où elle a été publiée.
- ALEXANDRE, Pierre (1967), Langues et langage en Afrique noire, Paris, Payot, 176 p.
- AUGER, Pierre et Coll. (1973), Guide de travail en terminologie, Office de la langue française, Québec, Éditeur officiel, 103 p.
- — (1977), Méthodologie de la recherche terminologique, Office de la langue française, Québec, Éditeur officiel, 80 p.
- BLANCPAIN, Marc et André REBOULLET (1976), Une langue, le français aujourd’hui dans le monde, Paris, Hachette, 328 p.
- BOUTHILLIER, Guy et Jean MEYNAUD (réd.) (1972), Le choc des langues au Québec, 1760-1970, Montréal, Presses de l’Université du Québec, 768 p.
- CANADA, COMMISSION ROYALE D’ENQUÊTE SUR LE BILINGUISME ET LE BICULTURALISME (1965), Rapport préliminaire, 217 p.; Livre 1, Les langues officielles, 1967, 230 p.; Livre II, L’Éducation, 1968, 379 p.; Livre lll, Le monde dutravail, 1969, 646 p.; Livre IV, L’apport culturel des autres groupes ethniques, 1969, 390 p. Ottawa, Éditeur officiel.
- CHAMPION, Jacques (1974), Les langues africaines et la francophonie, Paris, Mouton, 344 p.
- COLLOQUES (1965), Le français, langue sans frontières, Les Biennales de Namur (1965), Québec, (1967), Liège (1969) et Menton (1971), Fédération du français universel, Paris, Le Pavillon, 1973, 259 p.
- — (1968), Le français en France et hors de France, Actes du colloque sur les ethnies francophones (Nice, avril 1968), Centre d’études des relations interethniques de Nice, Paris, Belles-Lettres, Annales de la Faculté des lettres et sciences humaines de Nice, Fasc, I : Créoles et contacts africains, 1969, 100 p.; Fasc, II : Les français régionaux, les français en contact, 1970, 146 p.
- — (1973a), La normalisation linguistique, Québec, Office de la langue française, octobre 1973, Actes parus à Québec, Éditeur officiel, 1974, 255 p.
- — (1973b), Le français hors de France, Actes de la 5e Biennale de la langue française, Dakar du 1er au 8 décembre 1973, Dakar, Nouvelles Éditions Africaines, 1975, 373 p.
- — (1974a), Identité culturelle et francophonie dans les Amériques, Actes du colloque tenu à l’Université d’Indiana, Bloomington, du 28 au 30 mars 1974, Québec, P.U.L., 1976, 298 p.
- — (1974b), L’aménagement de la néologie, Lévis, Office de la langue française, octobre 1974, Actes parus à Québec, Éditeur officiel, 1975, 214 p.
- — (1975 a), Identitéculturelleet francophonie dans les Amériques, Actes du colloque tenu à l’Université Dalhousie, Halifax, du 2 au 5 avril 1975, Bloomington, Indiana University Press, 1976, 190 p.
- — (1975b), Les relations entre la langue anglaise et la langue française, Paris, Conseil international de la langue française, mai 1975, Actes parus à Québec, Éditeur officiel, 1978, 185 p.
- — (1975c), Plurilinguisme et enseignement du français, Compte rendu du 3e congrès mondial de la Fédération internationale des professeurs de français (F.I.P.F.), Bulletin de la F.I.P.F., nos 12-13, Sèvres, 1975-76, 245 p.
- — (1976), Les implications linguistiques de l’intervention juridique de l’État dans le domaine de la langue, Québec, octobre 1976, Office de la langue française, Actes parus à Québec, Éditeur officiel, 1978, 206 p.
- — (1977), Sixième colloque international de terminologie, octobre 1977, Québec, Éditeur officiel, 1979, 753 p.
- — (1979), La qualité de la langue après la loi 101, Québec, octobre 1979, Conseil de la langue française, Québec, Éditeur officiel, 1980, 244 p.
- CORBEIL, Jean-Claude (1967), « Le français menacé », Maintenant, avril 1967, p. 115-116.
- — (1967), « Situation de la langue française », Maintenant, septembre 1967, p. 273-275.
- — (1971), « Aspects du problème néologique », Colloque international sur la néologie, Paris, 1971, Texte paru dans La banque des mots, no 2, Conseil international de la langue française, Paris, P.U.F., 1971, p. 123-126.
- — (1972), Éléments d’une théorie de l’aménagement linguistique, Collection Études, recherches et documentation, no 4, Québec, Éditeur officiel, 1975, 40 p.
- — (1973a), Essai de définition du bilinguisme fonctionnel : l’expérience québécoise, Colloque sur le Bilinguisme et le Biculturalisme, Edmonton, septembre 1973, Texte paru dans la collection Études, recherches et documentation, no 5, Québec, Éditeur officiel, 1975, 27 p. Et dans les actes du colloque.
- — (1973b), « Problématique de la synonymie en vocabulaire spécialisé », Colloque international de terminologie, octobre 1973, Actes parus sous le titre La normalisation linguistique, Québec, Éditeur officiel, 1974, p. 7-24.
- — (1974a), « Description des options linguistiques qui sous-tendent l’action de l’Office de la langue française », Identité culturelle et francophonie dans les Amériques, Actes du colloque tenu à l’Université d’Indiana, Bloomington, du 28 au 30 mars 1974, Québec, P.U.L., 1976, p. 16-22.
- — (1974b), Essai sur l’origine historique de la situation linguistique du Québec, Collection Études, recherches et documentation, no 6, Québec, Éditeur officiel, 45 p. Repris dans Langue française, no 31, Le français au Québec, Paris, Larousse, septembre 1976, p. 6-19.
- — (1975), « Analyse des fonctions constitutives d’un réseau de néologie », in L’aménagement de la néologie, Québec, Éditeur officiel.
- — (1976a), « Les conditions de succès des lois à caractère linguistique », in Les implications linguistiques de l’intervention juridique de l’État dans le domaine de la langue, Québec, Éditeur officiel, 1978, p. 155-171.
- — (1976b), « Témoignage sur l’entreprise de la R.L.F. La manière dont le Québec aborde la politique linguistique », Compte rendu de la 3e table ronde des centres et instituts linguistiques d’Afrique francophone, décembre 1976, Lubumbashi, Centre international de sémiologie, juillet 1977, p. 67-72.
- — (1976c), « La normalisation terminologique », Colloque canadien sur les fondements d’une méthodologie générale de la recherche et de la normalisation en terminologie et en documentation, Ottawa, Secrétariat d’État, p. 207-218.
- — (1977), « Principes sociolinguistiques de la Charte de la langue française », Biennale de la langue française, Moncton, août 1977, Texte à paraître dans les actes de la Biennale.
- — (1978a), « Théorie et pratique de la planification linguistique », 5e Congrès international de linguistique appliquée, Montréal, août 1978, Texte à paraître dans les actes du congrès.
- — (1978b), Langue et société, Étude préalable à la création d’un centre international de recherche en linguistique fondamentale et appliquée, Paris, Agence de coopération culturelle et technique, 90 p.
- — (1979), « Les choix, linguistiques », La qualité de la langue… après la loi 101, Actes du colloque, Ouébec, Éditeur officiel, 1980, p. 46-52.
- CORBEIL, Jean-Claude et Louis GUILBERT (réd.) (1976), Le français au Québec, Langue française, no 31, Paris, Larousse, 125 p.
- FAÏK, Sully (1977), « Les études de français en Afrique subsaharienne », Le français moderne, Paris, octobre 1977, p. 342-350.
- GUSDORF, Georges (1952), La parole, Paris, P.U.F., 126 p.
- HOUIS, Maurice (1971 ), Anthropologie linguistique de l’Afrique noire, Collection SUP, Paris, P.U.F., 232 p.
- HOUIS, Maurice et Rémy BOLE-RICHARD (1977), Intégration des langues africaines dans une politique d’enseignement, Paris, Agence de coopération culturelle et technique, UNESCO, 72 p.
- JAKOBSON, Roman (1963), Essais de linguistique générale, Paris, Éditions de Minuit, 260 p.
- LAGANE, René et Jacqueline PINCHON (réd.) (1972), La norme, Langue française, no 16, Paris, Larousse, 132 p.
- LAPORTE, Pierre-É, (1978), « Structure sociale, concurrence linguistique et législation linguistique au Québec », in Les relations entre la langue anglaise et la langue française, Québec, Éditeur officiel, p. 131-141.
- LAURIN, Camille (1977), Le français, langue du Québec, Recueil des discours prononcés de mars à octobre 1977, suivi du texte de la Charte de la langue française, Montréal, Éditions du Jour, 214 p.
- LEBEL-HAROU, Lise (1980), Aménagement linguistique : rapports entre le projet d’aménagement et les caractéristiques socio-politiques du milieu visé, Québec, Éditeur officiel, 66 p.
- LEROND, A, (réd.) (1973), Les parlers régionaux, Langue française, no 18, Paris, Larousse, p. 3-7.
- MACKEY, William (1977), Bilinguisme et contact des langues, Paris, Klincksieck, 545 p.
- — (1978), « Niveaux et fonctions du bilinguisme », in Les relations entre la langue anglaise et la langue française, Québec, Éditeur officiel, p. 88-109.
- MARTINET, André (1960), Éléments de linguistique générale, Paris, Ar, Colin, 224 p.
- MONIÈRE, Denis (1977), Le développement des idéologies au Québec, Des origines à nos jours, Montréal, Québec/Amérique, 381 p.
- PIRON, Maurice (1975), « Pour un inventaire général des ‘usances’ de la francophonie », Bulletin de l’Académie royale de langue et de littérature françaises, Bruxelles, p. 111-122.
- — (1978), Aspects et profil de la culture romane en Belgique, Liège, Éditions Sciences et Lettres, 166 p.
- QUÉBEC, COMMISSION D’ENQUÊTE SUR LA SITUATION DE LA LANGUE FRANÇAISE ET SUR LES DROITS LINGUISTIQUES AU QUÉBEC (1972), Tome 1, La langue de travail, 379 p.; Tome 2, Les droits linguistiques, 474 p.; Tome 3, Les groupes ethniques, 570 p. Québec, Éditeur officiel.
- QUÉBEC, RÉGIE DE LA LANGUE FRANÇAISE (1974), Le français dans l’entreprise, Guide général d’implantation, Québec, Document administratif, 90 p.
- — (1976a), La normalisation terminologique, Québec, Document administratif, 14 p.
- — (1976b), Partage des tâches en matière de travaux terminologiques, Québec, Document administratif, 9 p.
- — (1976c), La stratégie de la direction de la terminologie en matière linguistique et traductionnelle, Québec, Document administratif non publié, 14 p.
- REY, Alain (1972), « Usages, jugements et prescriptions linguistiques », La norme, Langue française, no 16, Paris, Larousse, p. 4-29.
- — (1975), « Essai de définition du concept de néologisme », L’aménagement de la néologie, Québec, Éditeur officiel, p. 9-29.
- — (1976), « La normalisation linguistique dans la perspective des nouvelles dispositions législatives », in Les implications linguistiques de l’intervention juridique de l’État dans le domaine de la langue, Québec, Éditeur officiel, 1978, p. 23-41.
- — (1979), La terminologie, Coll. « Que sais-je? », no 1780, Paris, P.U.F., 129 p.
- REY-DEBOVE, Josette (1976), « L’emprunt lexical prohibé », in Les implications linguistiques de l’intervention juridique de l’État dans le domaine de la langue, Québec, Éditeur officiel, 1978, p. 79-99.
Notes
- [1] Voir Lise Lebel-Harou, Aménagement linguistique: rapports entre le projet d’aménagement et les caractéristiques socio-politiques du milieu visé, Québec, Office de la langue française, 1980.
- [2] Heinz Kloss, Research Possibilities on Group Bilingualism: A Report, Québec, Centre international de recherche sur le bilinguisme, 1969.
- [3] Voir par exemple Wallace Schwab, Recueil des textes législatifs sur l’emploi des langues, Québec, Conseil de la langue française, 1979.
- [4] L’essentiel de ce chapitre a paru en 1975 et a été repris dans Le français au Québec, Larousse, 1976.
- [5] Voir Michel Brunet, Les Canadiens après la Conquête (1759-1775), Montréal, Fides, 1969, 314 p.
- [6] Cité par Guy BouthiIlier et Jean Meynaud, in Le choc des langues au Québec 1760-1970, Montréal, P.U.Q., 1972, p. 139.
- [7] Voir les travaux et écrits de Marcel Rioux, Yves Martin, Maurice Lamontagne, Everett C. Hughes, Gérard Dion.
- [8] Voir Denis Monière, Le développement des idéologies au Québec, des origines à nos jours, Montréal, Québec/Amérique, 1977, p. 13.
- [9] Voir surtout Marcel Rioux, La question du Québec, Paris, Seghers, 1969, 184 p.; Léon Dion, La prochaine révolution, Montréal, Leméac, 1973, 358 p.; et Denis Monière.
- [10] Denis Monière, o.c., p. 187.
- [11] Ibid., p. 184.
- [12] Voir Bouthillier-Meynaud, o.c., p. 172.
- [13] Jules P. Tardivel, in Bouthillier-Meynaud, o.c., p. 217.
- [14] Ibid., p. 216.
- [15] Les Insolences du Frère Untel, préface d’André Laurendeau, Montréal, Les Éditions de l’Homme, 1960, 154 p.
- [16] Cahier de l’Office de la langue française, no 1, Québec, Éditeur officiel, 1965,12 p.
- [17] Les actes n’ont pas paru, mais les documents sont déposés à la bibliothèque de l’Office de la langue française.
- [18] Voir surtout Louis-Philippe Audet, Histoire de l’enseignement au Québec, Montréal, Holt, Rinehart et Winston, 1971, tome I, 432 p., tome II, 496 p.
- [19] Auguste Viatte, cité par Marcel Rioux, o.c., p. 52.
- [20] Voir Louis-Philippe Audet, o.c., tome II, p. 280.
- [21] Albert Faucher et Maurice Lamontagne, « Histoire du développement industriel au Québec », in Marcel Rioux et Yves Martin, La société canadienne-française, Montréal, HMH, 1971, p. 269.
- [22] Marcel Rioux, o.c., p. 85.
- [23] Albert Faucher et Maurice Lamontagne, o.c., p. 273.
- [24] Rapport préliminaire de la Commission royale d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme, Ottawa, 1965, p. 71 et 72.
- [25] Voir, par exemple, Henri Bélanger, Place à l’homme, Montréal, HMH, 1971, et Jean Marcel, Le joual de Troie, Montréal, Le Jour, 1973.
- [26] J.-M. Léger, Le Devoir, 21 juin 1957.
- [27] Gérard Filion, Le Devoir, 29 juin 1957.
- [28] J.-M. Léger, Le Devoir, 14 août 1958.
- [29] Marcel Chaput, Le Devoir, 23 janvier 1962.
- [30] Fernand Ouellette, « La lutte des langues et la dualité du langage », in Liberté, mars, avril 1964, p. 103 et 112.
- [31] Hubert Aquin, Le Basic bilingue, ibid., p. 116.
- [32] Maurice Beaulieu, conférence au congrès Visage français de la S.S.J.B. (Montréal), selon Le Devoir, 16 mars 1964.
- [33] Voir Le Devoir, par Gérard Filion (29 juin 1957), Pierre Laporte (16 juillet 1957).
- [34] J.-M. Léger, Le Devoir, 7 août 1959.
- [35] J.-N. Tremblay, extraits d’une conférence de presse, in Culture vivante, Québec, ministère des Affaires culturelles, 1968.
- [36] Paul Sauriol, Le Devoir, 16 janvier, 23 janvier, 9 février 1962.
- [37] Le Devoir, 28 février 1962.
- [38] Voir, par exemple, Maurice Watier, in Culture vivante, Québec, 1968.
- [39] Marcel Chaput, Pourquoi je suis séparatiste, Montréal, Éditions du Jour, 1961, cité par Guy Bouthillier, Le choc des langues, p. 656.
- [40] André Laurendeau, Le Devoir, 20 janvier 1962.
- [41] André Laurendeau, Le Devoir, 27 janvier 1962.
- [42] Gaston Dulong, Le Devoir, 12 janvier 1962.
- [43] André Belleau, « Notre langue comme une blessure », in Liberté, mars-avril 1964, p. 83.
- [44] J.-M. Léger, Le Devoir, 12 février 1962.
- [45] J.-M. Léger, cité par La Presse, 16 mars 1964.
- [46] Fernand Ouellette, o.c., p. 93.
- [47] Numéro spécial du Devoir, « Alerte à la langue française », 22 juin 1957.
- [48] Pierre Daviault, lors du Congrès de la refrancisation, Le Devoir, 22 juin 1957.
- [49] Raoul Roy, « Propositions pragmatiques de la revue socialiste », 1959, cité dans Guy Bouthillier, o.c., p. 652.
- [50] Ibidem, p. 562.
- [51] Raymond Barbeau, Le Québec bientôt unilingue; Montréal, Éditions de l’Homme. 1961, 157 p.
- [52] Maurice Beaulieu, Le Devoir, 16 mars 1964.
- [53] Pierre Laporte, « Livre blanc sur la politique culturelle », document inédit, dont des extraits paraissent dans Bouthillier, o.c., p. 689.
- [54] Jean Lesage, cité par Le Devoir, 20 novembre 1969.
- [55] Jean Drapeau, cité par Le Devoir, 12 février 1964.
- [56] Association québécoise des professeurs de français, Le livre noir: De l’impossibilité (presque totale) d’enseigner le français au Québec, Montréal, Éditions du Jour, 1970, 109 p.
- [57] J.-M. Léger, Le Devoir, 16 mars 1964.
- [58] In Guy Bouthillier, o.c., p. 689.
- [59] Revue Maintenant, « Un Québec libre à inventer », nos 68-69, septembre 1967.
- [60] Le Devoir, 5 août 1957.
- [61] Raoul Roy, in Bouthillier, o.c., p. 553.
- [62] Procès-verbal d’une réunion du Comité du Conseil privé, reproduit en page 143 du Rapport préliminaire de la Commission.
- [63] Voir le compte rendu que fait Lysiane Gagnon du Livre III de la Commission Laurendeau-Dunton in Économie québécoise, Montréal, Presses de l’Université du Québec, 1969 et 1976.
- [64] Paul Bernard et coll., L’évolution de la situation socio-économique des francophones et des non-francophones au Québec (1971-1978), Québec, Éditeur officiel, 1979, p. 137.
- [65] Voir, par exemple, le Rapport préliminaire où ces attitudes se manifestent souvent, le Rapport Gendron, les débats autour des lois 22 ou 101.
- [66] Arrêté en conseil du 9 décembre 1968, reproduit en page IV du tome I du rapport de la Commission Gendron.
- [67] Rapport Gendron, tome I, La langue de travail, p. 3.
- [68] Ces membres étaient: Madeleine Doyon Ferland, professeur à la Faculté des lettres de l’Université Laval, Aimé Gagné, directeur des relations publiques à l’Alcan, Nicolas Mateesco Matte, professeur à la Faculté de droit de l’Université de Montréal, Edward McWhinney, visiting professor of law, Law School, Indiana University.
- [69] Rapport Gendron, tome I, p. 2.
- [70] Voir Document de la Commission Gendron, bibliographie et documentation, Bibliothèque de la Législature, Assemblée nationale, Québec, 1974.
- [71] Rapport Gendron, tome I, p. 364.
- [72] Voir Le français, langue de travail: ce qu’en pensent les élites économiques du Québec, Québec, Éditeur officiel, 1973.
- [73] Voir, entre autres, John Kenneth Galbraith, La.science économique et I intérêt général, Paris, Gallimard, 1974, 398 p.
- [74] Les membres de ce comité étaient: Gaston Cholette, Roland Piquette, Gaston Pelletier, J.-C. Corbeil, de l’Office de la langue française, Adrien Lalonde et Claire Lamy, de l’Hydro-Québec, André Déom et Thérèse Heurtebise, de Ducharme, Déom et Associés, Nicolas Champoux, de la Banque du Canada, Claude Desjardins, d’AIcan, Claude Lafontaine, de la FTQ, Jean Lévesque, du ministère du Travail et de la Main-d’œuvre, Rolande Normandeau, de CIL, Frédéric Phaneuf, du CN et Roger Touyer, du ministère de la Fonction publique.
- [75] Aigle d’Or a constitué le premier comité de francisation, sous l’inspiration de Monique Héroux (OLF), démontrant que la gestion d’un programme de francisation et la conduite des travaux linguistiques requis pouvaient se faire de l’intérieur, comme toute autre fonction de l’entreprise.
- [76] Les principaux responsables de ce domaine sont Thérèse Villa, Jacques Maurais, Gilles Boivin.
- [77] Travaux menés sous la direction de Bernard Salvail.
- [78] L’expression est de Guy Labelle, in Étude de la langue de l’affichage dans la région de Montréal, Montréal, 1970, 159 p. dactylographiées, U. de Montréal.
- [79] Par Louis-Paul Béguin, en association avec des collaborateurs du Surintendant des assurances et des représentants de l’industrie privée.
- [80] Par association d’Hélène Martin au comité chargé de la révision du Code de la construction.
- [81] Travaux menés par Wallace Schwab et Michel Sparer.
- [82] Travaux sous la direction de Marie-Éva de Villers.
- [83] Voir Le partage des tâches en matière de travaux terminologiques, Québec, Régie de la langue française, 1976.
- [84] Voir le Guide de travail en terminologie, par Pierre Auger, Bruno de Bessé, Bernard Salvail et Jean-Marie Fortin, Québec, Office de la langue française, 1973 et la Méthodologie de la recherche terminologique, par Pierre Auger et Louis-Jean Rousseau, Québec, Office de la langue française, 1977.
- [85] Voir La normalisation terminologique, Québec, Office de la langue française, 1976.
- [86] Sous la direction de Jean-Marie Fortin.
- [87] William Mackey, « Niveaux et fonctions du bilinguisme », in Les relations entre la langue anglaise et la langue française, Québec, Éditeur officiel, 1978, p. 88-89.
- [88] J.-Claude Corbeil, Essai de définition du bilinguisme fonctionnel: l'expérience québécoise, Québec, Éditeur officiel, 1973, 27 p.
- [89] Voir, par exemple, Roman Jakobson, Essais de linguistique générale, Paris, Éd. de Minuit, 1963, 260 p.
- [90] Voir Georges Gusdorf, La parole, Paris, P.U.F., 1952, 126 p.
- [91] Voir Alain Rey, « Usages, jugements et prescriptions linguistiques », in Langue française, no 16, Paris, Larousse, 1972, p. 4-29.
- [92] Alain Rey, « La normalisation linguistique dans la perspective des nouvelles dispositions législatives », in Les implications linguistiques de l’intervention juridique de l’État dans le domaine de la langue, Québec, Éditeur officiel, 1978.
- [93] Ralph Linton, Le fondement culturel de la personnalité, Paris, Dunod, 1959, p. 33.
- [94] lb., p. 43 et s.
- [95] Linton, o.c. p. 50 et 51.
- [96] Guy Labelle, La syntaxe des enfants de 5 ans à 10 ans de Montréal et de Paris, thèse de doctorat, Université de Paris (VII), 1976.
- [97] Marcel Lagrenade, Marketing et merchandising, Montréal, Domtar, 1971.
- [98] Louis Guilbert, « La spécificité du terme technique et scientifique », in Langue française, no 17, Paris, Larousse, 1973.
- [99] Camille Laurin, Le français, langue du Québec, Montréal, Éditions du Jour, 1977
- [100] J.-C. Corbeil, « Les choix linguistiques », communication présentée au Colloque sur la qualité de la langue française, organisé par le Conseil de la langue française, octobre 1979.
- [101] Voir, par exemple, les exposés du colloque sur Les implications linguistiques de l’intervention juridique de l’État dans le domaine de la langue, Québec, Office de la langue française, 1978.
- [102] Voir La Presse, 4 août 1979.
- [103] Voir Maurice Piron, Aspects et profil de la culture romane en Belgique, Liège, Éditions Sciences et Lettres, 1978, p. 34 et suiv.
- [104] Voir J.-C. Corbeil, « Théorie et pratique de la planification linguistique », conférence prononcée devant le Ve Congrès international de linguistique appliquée, Montréal, août 1978. Le choix du mot « planification » est une concession à la terminologie en usage dans ces milieux.
- [105] Voir l’inventaire de Wallace Schwab, Recueil des textes législatifs sur l’emploi des langues, Office de la langue française, Éditeur officiel du Québec, 1977.
- [106] Voir Bernard Pottier, « La situation linguistique en France », in Le langage, coll. Encyclopédie de la Pléiade, Paris, NRF, 1968, p. 1144-1161.
- [107] Maurice Piron, « Vers un inventaire général des « usances » de la francophonie », in o.c., p. 139-147.
- [108] Prototype présenté lors de l’Assemblée générale de l’Association des universités partiellement ou entièrement de langue française, à Bordeaux, en novembre 1978.
Référence bibliographique
Corbeil, Jean-Claude, L’Aménagement linguistique du Québec, coll. « Langue et société », no 3, Montréal, Guérin éditeur limitée, 1980, 154 p. [livre]